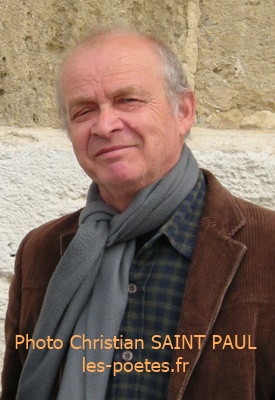cliquer sur le haut parleur pour écoute l'emission
Pour écouter 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
|
Didier THURIOS
5/01/2017 29/12/2016
|
Christian Saint-Paul revient sur l’œuvre de création poétique de Jean Joubert. Il rappelle quelle fut son activité militante en poésie, son engagement désintéressé auprès des enfants. Il allait dans les classes de l’école primaire apporter la bonne nouvelle : celle de la poésie. Et les enfants le lui rendaient bien cet intérêt qu’il leur manifestait. La profondeur de la trace qu’il laissait peut se lire dans une lettre d’une classe d’école primaire à Jean Joubert publiée dans « Jean Joubert par Michel Cosem » aux éditions du Rouergue dans la collection Visages de ce temps dirigée alors par Jean Digot. Lecture de cette lettre.
Nous avons aimé tes poèmes, celui de la grenouille nous a fait rire. Tes histoires, dans les poèmes et dans les livres ne sont pas vraies, mais elles sont belles et quelquefois jolies. Tu dois aimer les œufs ; y en a dans Pilou, dans Blouson bleu et dans la grenouille de la mare. Tu as des poules dans ton jardin ? Nous croyons que tu es beau, tu as des cheveux roux, avec une moustache, tu aimes les enfants. Tu es jeune et un peu vieux, tes yeux sont noirs ou marron. Tu as des enfants, ils doivent jamais s’embêter ; quand ta « maman » fait les pavés et qu’ils peuvent pas bouger tu leur lis une histoire. Tu écris avec une plume d’oiseau ? Tu nous fais rêver, moi j’ai regardé la lune cette nuit, c’est une buée dans le ciel. Est-ce que tu connais les disques de Peter Bowman et de Keith Jarett ? Ils sont beaux, on aime les écouter. Tu dois avoir une grande maison avec un grand bureau pour écrire et même un jardin avec beaucoup d’animaux mais pas de salades, tu as pas le temps de les faire pousser, tu peux pas tout faire... Nous t’envoyons un gros bisou, merci et on t’aime bien. Toute la classe
Lecture de poèmes de Jean Joubert
Tu es ce corps et l’ombre de ce corps et l’ombre de cette ombre cette ombre encore infiniment
jusqu’à ce centre de lumière où se confondent le corps et l’ombre toutes les ombres et tous les corps. * Quelques visages demeurent comme reflets sur l’eau de ceux qui vers nous jadis se penchèrent, pour nous parler, pour chercher dans nos yeux un accord, une promesse
- si clairs, si nets que l’on s’étonne de ce ciel vide entre les arbres et, sur le pont, de la seule poussière.
D’autres encore tremblent par temps de brume, se brouillent, se disloquent, insaisissables presque : ombres d’ombres pour nos regards.
Et tant d’autres nous abandonnent, mêlés, sans nom, au plus noir de la terre.
Pour eux nous n’avons plus ni lampe ni mémoire. * Christian Saint-Paul reçoit Didier THURIOS, voyageur, écrivain, poète, chanteur de rock’nd roll.
Il se décrit ainsi : une enfance tarnaise à taper dans un ballon rond, construire des cabanes dans les arbres, cracher des poèmes et parcourir d'un œil avide les planisphères. La musique plus tard, chant et guitare, surtout le besoin impérieux de jeter des passerelles entre littérature et riffs rock and roll. Mais c’est le voyage qui lui rendra le véritable plaisir des mots. D’abord l’Europe et le Maghreb, l’Amérique du sud et l’Asie du sud-est, le sous-continent indien, l’Asie centrale et le Moyen-Orient, l'Afrique... Ses vagabondages, ses immersions, ses exils volontaires, sans but ou défi à relever, donneront naissance à des carnets de route, poèmes et témoignages du monde : "Désorientales" (Le Manuscrit), "Echappée, poèmes nomades" (L’Harmattan), "Vents arabesques" aux éditions Le solitaire.
En 2012, il a reçu le Prix de Poésie des Gourmets de Lettres, sous l’égide de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Il vient de terminer un nouveau livre, une lettre dédiée à sa mère « Aussi sacrée que le Gange » qui sera publiée aux éditions Autrement.
« Désorientales » est le récit d’un voyage d’un an avec sa femme et sa fille. Le voyage, dit-il, c’est une injonction, un besoin d’exprimer un ressenti et de garder une trace et la meilleure trace, c’est quand même le livre. Je n’aime pas la photo, avoue-t-il. Elle ment un peu la photo. C’est juste vital, poursuit-il, ce besoin d’aller me confronter à d’autres mondes, à d’autres consciences, à d’autres morales. Je prends des congés sans solde et je dégage ce temps qui est juste salvateur. Mes voyages ne nécessitent pas beaucoup d’argent. Ce sont des voyages de pauvre, souvent semi-ascétiques dans des contrées lointaines. « Echappée (poèmes nomades » a été publié par L’Harmattan dans la collection « Poètes des cinq continents ». Ce sont des poèmes de voyage, de l’Inde à l’Europe. Ces voyages se font en immersion totale avec les gens des pays traversés, avec leurs moyens locaux de déplacement les plus économiques. Encore une fois, c’est un voyage de pauvre. Le problème de la langue n’en est pas un. Ce n’est pas le langage qui prime. La communication passe par le regard, par un sourire, par une main sur l’épaule. C’est une communication quasi universelle. Didier Thurios est quelqu’un qui a trouvé les moyens d’aller à la rencontre de l’humanité. Les différences auxquelles nous sommes confrontés, juge-t-il, nous permettent de casser nos certitudes, nos vérités. Il y a d’autres vérités. Chaque voyage est un voyage initiatique. Nous apprenons toujours de nous, même après de multiples voyages. C’est ce qui compte en fait. On s’améliore. On se pose les bonnes questions métaphysiques existentielles et l’on peut juger si l’on est en phase avec soi-même. On trimballe toujours toutes ces interrogations philosophiques. L’initiation se fait par paliers. On ne voyage pas, on est voyagé. On apprend de soi. Le quotidien dans cette forme de voyage pauvre est souvent compliqué. Les trajets sont longs, souvent harassant. On ne sait parfois où dormir. On met le corps et l’esprit en contrainte. Et forcément on découvre. On apprend aussi des côtés noirs de nous, que l’on ne soupçonnait pas. On est un apprenti en voyage. On devient certainement meilleur, sans être sage, cette notion de sagesse m’ennuie. On parvient même à se pardonner ; on s’améliore humblement dans son humanité.
Lecture d’extraits de « Echappée ».
INDE
Excepté
Excepté la fixité des choses souverainement appesanties, la lumière posée sur la pliure des jours et d’obséquieux palétuviers à caresser la vague, sauf le miroir lunaire dans les yeux de la mer comme coulées de lave sur le corps des volcans, moins d’excentriques poissons irisés de corail et d’improbables orgies de l’œil dans le vert de la jungle, excepté l’exceptionnel il reste trois fois rien il reste nous baignant dans le soleil.
Havelock island, Andaman, mars 2004 * Manque d’avoir
Devant nous l’absence de traces ivresse horizontale des profondeurs, pas à pas inventés des jours qui croissent décroissent décident parfois ;
Le temps présent absolu conjugue d’aléatoires nuits sans tain à ces jours incertains nous marchons dépouillés sur le ventre du monde ;
Il faut manquer d’avoir pour ne pas manquer d’être au luxe d’être pauvre l’immanence des choses effleurée de nos doigts, des citadelles à prendre que nous cueillons.
Chennaï, Inde, avril 2004
* Souviens-toi
Souviens-toi des coulures du soir quand les derniers spasmes secouaient la ville, arabesques oblongues qui dansaient sur la dune, l’haleine chargée du fleuve sa courbe sensuelle, il faudra que tu te souviennes la terrasse où claquaient des tablas et saignait un sitar, ces ruelles sombres et torrides gorgées comme des fruits mûrs et de ces ghat brûlants abandonnés aux âmes, il faudra que tu te souviennes, les morts piquaient nos yeux jusque tard dans la nuit et nous ne dormions pas, l’air était si épais, nous regardions les barques glisser entre les corps et nous étions heureux souviens-toi…
Bénarès, Inde, mai 2004 * Momo shaphali thupka gyathuk chowmein exhalés de la petite rue aux échoppes brinquebalantes dont on ne sait par quel miracle elles tiennent encore debout gargotes de poupées la tête inexpressive mais néanmoins amicale de la vendeuse de thé au croisement cinétique d’exhalaisons nocturnes nous couperons par le brouillard des pentes fildeféristes * Là-bas résonnent les oraisons funèbres les cloches teintées mâtinées de la bienséance coutumière le cor annonçant la curée et quelques basses messes qu’il sied à tout un chacun de ne point manquer là-bas réside le pouvoir incontestable de majorités effectives gorgées de silencieuses paroles * Tout cela semble si éloigné si indéfinissable je sais à présent où descendent les ombres reposent de furtives étoiles trajectoire fulgurante de fleurs fanées ne pas dévier je ne dévierai pas de la course aléatoire des astres * Darjeeling, Inde, juillet 2004 * A propos de Bénarès, Christian Saint-Paul évoque la figure de Chantal Maillard, poète espagnole de Malaga qui a longtemps séjourné aussi à Bénarès et qui en a aussi rapporté un livre de poèmes : « Hainuwele y otros poemas » (Tusquets editores, 16 €). En mai, poursuit, Didier Thurios, à Bénarès, on procédait à la crémation de cinq cents corps. Il est impossible de ne pas se poser de questions philosophiques par rapport à la mort. C’est une ville qui chamboule, qui attire. Autour d’un bûcher, je n’ai jamais vu quelqu’un pleurer. La mort est gaie. On voit des vieux qui ont traversé le pays à pied et qui, assis en tailleur au bord du Gange, attendent la mort. C’est pour eux un gage d’avenir meilleur. Maurice Blanchard a écrit « La poésie et la vie sont intimement nouées ; le poème écrit le poète. » Cela correspond à la posture de Didier Thurios. Ecrire un poème est quasi physiologique. « Pour écrire un poème, il faut recommencer sa vie, toutes ses vies » constatait Blanchard qui, poussait cette conclusion à son paroxysme puisqu’il avouait : « si j’écris, c’est pour ne pas me tuer. C’est ma transfiguration à moi. » A cela, Didier Thurios ajoute cette pensée de Marcel Jouhandeau : « vivre, c’est naître sans cesse. »
Lecture d’extraits de « Vents Arabesques / De Smyrne à El Fayoun ».
TURQUIE
EGRIDIR
Vingt-trois ans déjà et le souvenir diffus d’un séjour hors du temps. Têtes de pêcheurs taillées à la serpette, poissons exubérants et le calme plat surtout, cette impression que rien ne pouvait véritablement bousculer les lieux. Peu de choses ont changé, comme si l’eau douce et un vent irascible avaient bouté les promoteurs jusqu’à la côte... Main fermée posée sur l’onde, la presqu’île guette la moindre brise, escortée de canards au sillage parfait. Toujours ce turquoise sidérant à perte de sens, à contre couleurs, parfois ces barques multicolores à la coque tremblante n’attendant qu’une œillade mouillée du pêcheur pour aller s’égailler. Gosses ruisselants et piailleurs fracassant en splatches assourdissants le grand silence blanc.
Puis soudain, à écorcher l’âme, le souffle du muezzin,
à la bascule du jour. ** La nuit un vent frontal sème de vastes araignées à la surface du lac. Toute une vie qui s’agite au royaume des ombres, un monde parallèle qu’on devine et qu’on frôle, dans le meilleur des cas, mystérieux et hermétique. Même le contour des montagnes semble osciller, se détacher du halo céleste. Comme si les éléments, pris d’une espèce de pudeur magnétique, ne s’autorisaient plus dorénavant que le mouvement nocturne, fermaient rageusement, définitivement la porte à l’entendement. ** Moiteur. J’entends au loin une musique tirée du fond des âges, racée, élégante, le pépiement facétieux des sous pentes, chaque bruit, chaque son touche à vivifier l’âme, chaque péripétie du jour réveiller l’ombre de mon ombre, me désempêtrer de mes peaux, réenfanter celui qui dormait il y a peu dans un clair-obscur.
Mue. J’entends au loin la musique dans le dedans, notes récurrentes et enfouies sevrées d’oreilles, cet autre moi délesté d’auditoire, de fenêtres à franchir et d’océans à rêver, de sentiers à convaincre.
Peau éponge. Corps girouette aux quatre vents. Un rien suffit à ça. Sortir de soi. Renaître à soi. Retrouver le mouvement. Aboutir. *
SYRIE
ALEP
Citadelle pendue aux lèvres de ciel des pigeons écrèment le parvis soyeux des mosquées, il n’y a plus guère d’ombre que dans l’âme humaine.
Fraîcheur fugace des souks, au coude à coude mules et Toyotas braient d’une même impatience, l’histoire a creusé des ravines sur la peau parcheminée des vieillards (les femmes elles-mêmes résident à mi-chemin).
Fourmilière humaine agitée de toutes parts, l’ostentatoire est de mise, des oraisons d’épices et de baklavas, fumées obliques de kebabs, bijoux découpant la poussière sage des ruelles…
Percement épisodique de lumière. Des gosses ployés happent de frêles instants d’accalmie, parviennent à s’enfuir l’espace d’un regard.
On se perd dans les limbes d’une aurore parallèle. * Al Raqqa
Comme si la terre en lambeaux avait sassé la lumière, si les couleurs s’étaient diluées dans l’Euphrate.
Il n’y a plus de contraste ne subsiste qu’une ébauche de ville, l’esquisse avortée d’un semblant d’avenir.
A trois heures de l’après-midi pas l’ombre d’un sursaut, les humains ont quitté les murs pour d’autres chimères, emportés eux aussi par un long fleuve d’ennui.
Le temps manque d’assurance. * Vers Deir Ez-Zor
De part et d’autre l’Euphrate jette des langues de verdure, coups de canif dans le djebel aux teintes silencieuses.
Que l’on s’écarte à peine de la rive et le désert reprend ses droits.
Temps de révolte, temps de récolte. Femmes chevauchant de minuscules ânes bâtés émergeant des chemins, bariolées et opiniâtres.
Quelques enfants pouilleux assis sur le cuivre du pisé. * Le désert est une mer où se mirent les âmes on y trouve des humains qui n’en ont plus trop l’air des vivants au regard bleu qui parlent aux étoiles plus attachés au vent que des ailes d’oiseaux, il est des hommes hors espace hors du temps que les sirènes plastiques n’ont pas su démembrer, plus amoureux du ciel qu’une pincée de nuages les Bédouins se rappellent le sel des caravanes les soieries de Lanzhou et les vins libanais les épices des Indes et les brocarts de Perse, il est des hommes debout qui du matin au soir ne désirent rien d’autre que contempler les dunes. * LIBAN
A Baalbek, ceux qui consomment du voyage comme une boisson gazeuse, (ceux qui ont vu avant de voir, ceux qui savent avant de savoir, les rois de l’ellipse et du condensé, du trois en un et du résumé, ceux pour qui cabotage ou flânerie sont des mots obsolètes, les boulimiques de visas, les sourds et mal voyants, ceux qui élaborent échafaudent développent tranchent assènent enseignent directivent, les champions du survol et de la glisse, ceux qui pensent que l’élégance est forcément une question de vestimentaire, les fashionables high-tech avec en guise de doudou mobile computer Ipod, les vingtenaires surdiplômés, internetisés, science infusés, les vieux cons faussement empreints de sagesse, les aventuriers de la charentaise, ceux qui tiennent la Terre dans leurs mains jusqu’au jour du cancer, ceux qui ont oublié de ne pas oublier qu’ils sont faits – aussi - d’urine et de merde, ceux qui ne voient dans l’autre que des sparring-partners, qui passent à travers ou qui rebondissent, les fous de la performance et du record auto homologué, les héliocentrés égocentrés nombrilisés, ceux qui n’ont pas appris à douter, d’autres encore, il y a tout ça en raccourci sur les routes du monde, plus quelques types un peu en colère qui persistent à croire qu’il reste encore du rêve et de l’amour à moudre) ne se bousculent pas au portillon. * Peut-être en filigrane derrière l’aube insoumise ce point cardinal sur la carte du souvenir, le pouvoir d’émerveillement. Ce sentiment de liberté ne nous est pas inconnu, il suffit de le puiser au delta de l’enfance, avant la grande dilution.
L’errance nous restitue. * JORDANIE
Le désert n’est pas le désert. Celui dont je parle n’est pas l’autre, l’absence de tout, le vide révolté soufflant sur des braises mortes. Le vrai désert, ce qui nous ravine et nous déconstruit, c’est l’oubli du temps présent, l’incertitude d’être.
Chercher l’issue ne dispense pas de tolérer la tenaille du temps. Ni de souscrire aux vents arabesques. * EGYPTE
LE CAIRE
Tour du Caire
Je suis allongé sur le dos, quelques morceaux de verre dans les trouées d’un gommier, des perruches caméléon crachées en pointillé et un busard audacieux qui brasse l’air tel un ventilateur de chambre, je perçois par instants des klaxons venus du pont de Zamalek, la tour du Caire ne va pas tarder à masquer le soleil, je dois être là depuis plusieurs heures, immobile et souriant aux trouées de l’arbre, dans la cacophonie des volatiles, dans la chlorophylle de ce parc dont j’ai sauté les grilles, parfois mes yeux se brouillent inexplicablement, je ne bouge pas d’un cil de peur que ça s’arrête,
et je pense à ces perruches qui l’air de rien ont compris tout ça depuis longtemps. * A l’évocation d’Alep, l’émotion est forte et tous les participants à l’émission de radio ont une pensée fraternelle pour le peuple d’Alep.
Didier Thurios continue ses explications. J’ai retrouvé par rapport à l’Inde plus d’humain. En Inde, c’est plus compliqué d’entrer dans une maison, d’y être accueilli. Au Moyen-Orient, c’est immédiat. L’hospitalité est incroyable. Ces peuples sont magnifiques. Et le désert renvoie à soi-même. Le désert parle de toi, tu le ressens très fort. A Raqqa, chez des gens adorables qui m’avaient reçu, avec lesquels j’avais conversé et bu toute la nuit, au matin, j’ai eu une surprise : mon hôte me dit en me montrant ses beaux enfants qu’ils auront bientôt l’âge de franchir la frontière avec une belle ceinture autour de la taille pour les Américains ; et il lui ressert un verre de whisky. C’était une famille du Hezbola prête à sacrifier ses enfants. Et il y avait beaucoup d’amour entre les enfants et leurs parents. Choquant ! Le voyage, c’est ça. Moi, j’étais accepté parce qu’ils sont curieux de nous, occidentaux, curieux de l’étranger, et toujours hospitaliers. C’est un pilier de l’Islam, l’hospitalité. Je l’ai connue avec les Talibans. Ce contraste fait partie de l’enseignement du voyage. La poésie dénonce et transcende ce que le voyage nous montre.
« Je reverrai le jour, car je tracerai inlassablement le chemin » certifiait Maurice Blanchard. Didier Thurios va repartir et tracer inlassablement son chemin. Nous saurons le retrouver pour lire ses carnets de route. |
|
15/12/2016 22/12/2016
|
Christian Saint-Paul reçoit la soprano d’origine sévillane Sandra Hurtado-Ros et le compositeur Gérard Zuchetto. Gérard Zuchetto est un interprète de musique médiévale spécialisé dans les chansons des troubadours occitans des XIIe et XIIIe siècles. il est aussi compositeur et parolier, et auteur d'ouvrage sur les troubadours. Depuis ses premiers enregistrements en 1985, Gérard Zuchetto se base sur les manuscrits médiévaux et dans les sonorités des instruments anciens reconstitués, tels : ûd, citole, guiterne, psaltérion, Vièle à archet, rebec ou organistrum. les ornementations de la musique vocale et des créations musicales originales (quand les poèmes n'ont pas de musique) pour interpréter et reconstituer les chansons des troubadours. Avec les musiciens qui forment Troubadours Art Ensemble, Gérard Zuchetto donne de nombreux concerts en Europe (France, Espagne, Italie, Allemagne, Roumanie, Pologne, Hongrie, Estonie, Slovaquie, Suède…) ou au Moyen-Orient (Tunisie, Irak, Jordanie, Syrie…) ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. Après avoir créé et dirigé le CREMM-Trobar Na Loba de Pennautier, il a fondé l'association Trob'Art Productions et le label discographique Troba Vox, consacrés à la diffusion de l'art des troubadours. Il crée plusieurs festivals dont "Terra dels trobadors" en Catalogne et "les troubadours chantent l'art roman" en collaboration avec la région Languedoc-Roussillon. En 2010, avec Marisa Galvez, il initie un programme consacré à l'interprétation des troubadours "Performing Trobar" en collaboration avec le Department of French and Italian de la Stanford University of California. Il est l’auteur de deux anthologies et d’un CDRom consacrés au Trobar, "Le livre d'or des troubadours" et "Terre des troubadours" (éditions de Paris), de La Troba, la grande anthologie chantée des troubadours(2007-2011) et de plusieurs autres enregistrements CD ainsi que de films pour la télévision. Ses publications : Gérard Zuchetto Camins de Trobar Vol. 1 - 2 - 3 Editions Troba Vox, 2013 Gérard Zuchetto Terre des troubadours Les éditions de Paris 1996 (ISBN 2905291567) Gérard Zuchetto Terre des troubadours CDROM, Éditions Presses du Languedoc Multimédia(distr. Studi - Le Seuil) 1998 Gérard Zuchetto et Jörn Gruber Le Livre d’or des troubadours, Éditions de Paris-Max Chaleil (dist. Harmonia Mundi) 1998 Gérard Zuchetto About Trobar and the troubadours, Éditions Troba Vox-Stanford University, 2010. Gérard Zuchetto - Articles dans les revues «Esprit du Sud Ouest» ; «Histoire médiévale, «Cathare magazine», « Verdon ». * Dans une interprétation expressionniste et colorée, Sandra Hurtado-Ròs enflamme les cansos des troubadours et les chants séfarades. Son album « Otra Mar Sephardic and Troubadours songs » a marqué fortement le public. Dans cette création, avec sa passion intense pour la mélodie, elle nous offre dans la clarté diaphane de son timbre de voix le chant profond de son Andalousie natale. Les chansons séfarades sont des monodies issues de la musique populaire en vogue dans les communautés juives installées en Espagne depuis l’Ancien Testament et jusqu’en 1492, époque de la chute de Grenade et du début de la Reconquista. Ces ballades, qui ont été colportées en Méditerranée, Turquie, Maroc, Bosnie, Grèce ou Bulgarie, sont en Ladino, vieux Castillan, et chantent le quotidien d’un peuple déraciné. Aujourd’hui elle vient présenter deux nouveaux albums : Se canta... de la prima a Nadal ( 1 CD digipack avec livret réf. TR046) Sandra Hurtado-Ròs, chant Pour redécouvrir le répertoire traditionnel des chants de Noël occitans et catalans, un hommage au travaux de Cécile Marie et de Françoise Dague. Navidad villancicos populares de Andalucia (TR009) Dans cet album elle retrouve les chants traditionnels de l’Andalousie mais elle les interprète en ne les hispanisant pas, selon sa propre expression. On remarque dans les deux CD la similitude de thème, celui de Noël bien-sûr, mais aussi la similitude des instruments. Il en résulte un cousinage troublant. Diffusion d’extraits des deux CD. Des concerts seront donnés avec les Chants de Noël occitans et catalans dans l’Aude les 16, 17 et 18 décembre 2016. * Christian Saint-Paul dit à Gérard Zuchetto le plaisir qu’il a à diffuser des extraits du CD « Les Poètes du Sud » lors d’émissions pour illustrer de façon sonore nos poètes occitans et méditerranéens comme Bardou, Bousquet , Rouquette etc. "Poètes du Sud", ce fut une création originale Troubadours Art Ensemble, en avril 2012, donnée au Théâtre-Scène Nationale de Narbonne ; un spectacle pluridisciplinaire consacré à la poésie occitane en Méditerranée avec la mise en scène, musique, paroles et danse... de grands textes fondateurs de la pensée du Génie d'Oc (Troubadours, Maquam, Jacint Verdaguer, Ausias March, Charles Cros, Pierre Reverdy, René Nelli, Joë Bousquet...). Cette fois, c’est du CD : Oda a Montsegur ( 1 CD digipack avec livret réf. TR045) texte de René Nelli (oratorio), musique de Gérard Zuchetto, qu’il vient parler. Le grand poète, philosophe et historien du catharisme, René Nelli (1906-1982), nous a légué une œuvre majeure avec son Oda a Montsegur. Ecrit en vers composés sur l’alternance de pentamètres et d’hexamètres, ce récit est une ode à la liberté à travers l’évocation du Château de Montségur, des hérétiques cathares et de « l’âme occitane ». C’est une œuvre intemporelle qui traduit le tempérament bouillonnant de cet « occitaniste » de la première heure. Aujourd’hui, Gérard Zuchetto et ses amis musiciens ont choisi de rendre hommage au poète en mettant en musique ses textes de façon vive et colorée. Pour cette création, Gérard Zuchetto a dû d’abord entrer dans le costume de l’auteur. Car la poésie, en principe, n’a pas besoin de musique. C’est pourquoi il faut l’aborder avec beaucoup d’humilité. Le compositeur se réjouit de ce que le CD ait été très bien accueilli. Or, l’œuvre poétique de Nelli aujourd’hui est très peu lue. Et cette création va donner une nouvelle force à cette œuvre. Ce fut la même chose lorsque Paco Ibanez a remis les poètes espagnols au centre de la poésie à notre époque. Zuchetto lui, a chanté les poètes occitans, espagnols et italiens. Diffusion d’un extrait d’Oda a Montsegur. * Gérard Zuchetto précise que ses éditions Tròba Vox est un label indépendant dédié aux productions de Troubadours Art Ensemble et à la création poétique occitane en Méditerranée. Dans le cadre de Tròba Vox il vient présenter trois ouvrages. « alenadas » respirations de Jaumes Privat, 90 pages, bilingue français occitan, illustrations de l’auteur, 15 €. Jaumes Privat est né à Espalion (Aveyron) en 1953. Ses premières poésies remontent à 1968 : en français, dessinées, peintes. En 1970, il passe à la langue d'oc à la suite d'une rencontre avec Roland Pécout. De 71 à 75 il vit la période militante de Lucha Occitana. Il continue à écrire et à peindre, mais refuse la publication. Il écrit des chansons pour les groupes Cardabèla et Ara. Il arrête d'écrire de 75 à 82, année où il expose pour la première fois des peintures à la Mòstra del Larzac. Cet événement est lié à sa rencontre avec Félix Castan, animateur de cette importante manifestation artistique et pilier de l'occitanisme contemporain.
En 83, Privat publie pour la première fois des poésies dans les revues Òc et Jorn. Dans la même année, il rencontre Bernard Manciet dont le soutien « sans faille » le pousse à créer, bien qu'il continue à rester en marge de l 'édition. Dès ce moment, Il multiplie les présences comme plasticien et comme poète, en passant de l'exposition au happening. À partir de 1995 il commence à fabriquer une série de livres d'artiste reliés à la main (los Faisses) qu'il réalise dans son atelier de la Taillade. En 1996 il publie son premier recueil de poésie, Talhs, à Jorn. De novembre 1997 est le spectacle Cantas de luna e de pèiras, dont il est l'auteur et l'un des acteurs. Les critiques les plus compétents de l'aire occitane ont donné d'importants témoignages et lectures de son œuvre. Privat collabore avec des articles et des textes de création aux principales revues occitanes. Il a en outre dirigé Poesia Occitana Contemporània (1940-1990), numéro spécial de la revue catalane Reduccions (1991). Il écrit aussi des textes pour des compositeurs de musique contemporaine comme Nicolas Wohred (Ascla del jorn, 2003), et poursuit sa collaboration avec le chanteur Luc Aussibal (CD Ici-même, 1996, et Dedins, 2003). Il effectue son passage en l'an 2000 en Éthiopie. La découverte de cet ailleurs le conforte dans l'exploration de l'aicí-mai (ici-encore-ici-ailleurs) qu'il déplie et déploie en mots, en bois et en peinture. Dans « alenadas » Jaumes Privat poète artiste peintre a illustré ce livre qui, comme tous les livres de ces éditions, est un véritable livre d’artiste. Lecture d’extraits. mouvements vers la vile, dans le matin encore obscur. lentement ils commencent à marcher.et les chants s’élèvent, les échos des prières, les hauts-parleurs à la musique aigre. Les voix des hommes, les poids-lourds dans la côte raide. un bruit, non, le monde. le sommeil t’abandonne, tu as froid, le jour s’ouvre. * tu parlais dans une langue que je ne comprenais pas. sur tes mains je comptais les points bleus, les croix - points et croix en croix - . le café que tu avais apporté était trop sucré. deux mouches y nageaient. puis tu nous as donné du pain, nous l’avons partagé. au-dessus du toit de fer ondulé il y avait le ciel, le ciel. * « Coma un aubràs estrifat per l’auristre / Leberon Comme un Arbre déchiré par la tempête / Lubéron » de Roland Pécout, en occitan, français, italien, anglais, 83 pages, 15 €.
Né en 1949 à Châteaurenard de Provence, où il passe son enfance, Pécout vit ensuite en Bourgogne, dans le Jura et dans la région lyonnaise. À l'époque de mai 68, il oscille entre Lyon et Paris et passe ensuite à Montpellier, pour poursuivre ses études (lettres, histoire de l'art, linguistique). Comme on peut le lire dans une note biographique, « il travaille dans trente-six métiers en préparant celui qu'il s'est choisi : l'écriture ». En fait, depuis 1978, Pécout fait profession d'écrivain en occitan et en français et de journaliste indépendant. Il collabore à la presse écrite et parlée, et il a signé des réalisations vidéo. Sa vocation pour le voyage l'a conduit à plusieurs reprises jusqu'en Extrême-Orient, expérience qui l'a marqué en profondeur.
Sa production écrite est riche et variée. On peut citer notamment Avèm decidit d’aver rason (4 Vertats, 1969), les deux récits de voyage Portulan I. Itinerari en Orient (Vent Terral, 1978) et Portulan II (Tarabuste, 1980, Prix Méridien 1981), et Mastrabele, recueil de poésies édité en 1999. Lecture d’extraits. Le lent parcours qu’ont fait les hommes écrit l’espace. Ici ou là, les hameaux sont devenus sable, le sable fleurit les hameaux,
quand le sulfate sur les treilles, le grès d’un mur, et l’alchimie qui les lie, bientôt se réveillent quand luit l’Etoile du Berger.
Les mutations qui nous traversent, à chaque instant nous hanteront. Bientôt la sève sèche ou verse, et se séparent les essaims.
Insecte que broie le rouleau quand on l’a vidé de son miel, le pauvre chardon ascétique s’illumine dans le soleil. * Aux défilés de terre d’ocre, Genèse aux viscères ouverts, la Cité en couleur se glisse, la nuit en rêvant du Désert.
Lits pierreux, canaux, résurgences, fontaines pour bêtes et gens, apaisent la soif qui consume. Le ciel est tombé dans les sources.
Pourtant, l’eau se fait souterraine, comme à nos actes nous le sommes. Pour me laver des eaux croupies, j’ai plongé aux gouffres anciens. * « Cançonièr d’un temps esperdut Chansonnier d’un temps éperdu » de Franc Bardou, occitan et français, 75 pages, 15 €.
Franc BARDOU, né à Toulouse en 1965, enseignant et poète, écrit en occitan depuis 1989, collabore à la revue Òc. Il est depuis 2011 le rédacteur en chef de la revue Gai Saber. Auteur d’une thèse de doctorat sur l’œuvre et la pensée de René NELLI (1907-1982), il est membre de l’Académie de Jeux Floraux de Toulouse et l’Acadèmia Occitana. Auteur de recueils de poèmes tels que Filh del Cèrç 1995), prix Paul Forment 1996, Cant del Cèrç (1996), La crida (2003), Atlàs londanh (2006), L’arbre de mèl (2010), et d’un manifèste littéraire consigné par les écrivains de sa génération au sein du Mouvement descobertista (1998). Sa pratique poétique, de forme et d’inspiration troubadouresque, s’articule autour du rythme, dans une perspective hallucinatoire ou visionnaire qui ouvre l’imaginaire des textes à tous les possibles. En prose, il a aussi publié deux recueils de nouvelles, D’ara enlà (1999) et Qualques balas dins la pèl (2009), et un roman d’inspiration jungienne, La nuèit folzejada (2003) traduit et publié en catalan en 2004. Lecture d’extraits. à Gérard Zuchetto et Fawzi Al’aiedy VII Les blocs noirs armés de ciments qui pesaient leur douleur de nuit et la clameur du mauvais sort qui répandait ses vanités ne pouvaient éteindre l’espoir.
Dans la terre on avait creusé des trous pour y ranger l’outil et le siècle, trop à l’étroit, y oubliait ses affronts passés sans plus y savoir son espoir.
Trois amis pour l’heure assemblés qui cherchaient parfaite lumière de sons, de mots et d’amour fait, riaient de s’y voir prisonniers, messagers qu’ils étaient d’espoir.
Aucun trou ne descend ailleurs qu’en ton cœur quand l’espoir n’y est plus : pour rire de cage et trépas, frère de lumière, à jamais, chasse des cœurs le désespoir ! * IX
L’aube s’assombrit dès lors que le roi se cache et monte dans les cercles de splendeur aux cimes desquelles est sens, et laisse un peuple en souffrance.
Huit siècles de chagrin, d’oubli, pour que plomb en or se change et, sous un ciel d’amertume, que le feu d’enfer s’éteigne en droit d’être rétabli ?
Huit suffisent, ou davantage pour que mort revienne à vivre de cercueil jusqu’en lumière, et pour que l’ancienne école rappelle Amour ça et là ?
Mort t’est ce qui va sans grâce : toute grâce vient d’Amour. Pour en humer le parfum, t’enivrer de Sa saveur, fais-toi miroir de Sa face !
*** |
|
Jacques Arlet
08/12/2016
|
Profitant de ce que la librairie Ombres Blanches à Toulouse, programme une présentation du livre de poèmes d’Abbas Kiarostami, Christian Saint-Paul, qui invite les auditeurs à se rendre à cette animation, en profite pour rappeler l’excellence du travail réalisé par les éditions érès de Toulouse qui ont publié dans la collection Po&Psy « des milliers d’arbres solitaires » de l’artiste iranien, courts poèmes illustrés des collages de Mehdi Moutashar (840 pages, 20 €). Une émission a été consacrée à cet ouvrage et est toujours accessible sur le site : les-poetes.fr. Poèmes épurés proches des formes du japon et de la chine. Lecture d’extraits. quand je n’ai rien dans la poche j’ai la poésie quand je n’ai rien dans le frigo j’ai la poésie quand je n’ai rien dans le cœur je n’ai rien * dans les vieux souliers de mon enfance toujours se sont dissimulés deux trois ébauches de poèmes * le cerf-volant que petit j’avais lâché au vent s’est aujourd’hui posé sur mon poème * face au joug du temps le havre du poème face à la tyrannie de l’amour le havre du poème face à la criante injustice le havre du poème * sur la corde à linge on a étendu de la neige par ce froid elle ne sèchera pas de sitôt la neige * le corbeau noir se regarde avec perplexité dans le pré couvert de neige * Christian Saint-Paul reçoit son invité le Professeur Jacques Arlet , professeur émérite de médecine de l’Université Paul Sabatier, biographe, écrivain, romancier, qui a consacré de nombreux ouvrages à l’histoire de Toulouse. Membre de plusieurs sociétés savantes, il est Mainteneur de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Il vient ce soir parler de « La vie à Toulouse sous Louis XIV » titre de son livre publié aux éditions Loubatières, collection Histoire, 287 pages, 25 €. Christian Saint-Paul explique pourquoi il a tant tenu à réaliser cette émission sur cette période de la cité moundine car, beaucoup d’hommes de lettres, occitans comme français semblent considérer cette époque comme celle du déclin de la ville. Ils la dépeignent comme un temps d’endormissement qui a duré presque jusqu’à la première moitié du XXème siècle ! Or, il suffit de lire le livre de Jacques Arlet pour avoir la démonstration qu’il n’en est rien, qu’au contraire Toulouse fut florissante, et que cette période nous a légués de nombreux chefs d’œuvres. Le 14 octobre 1659, Louis XIV entre à Toulouse par la porte de L'Isle, dans le quartier Saint-Cyprien, et comme l'ont fait ses aïeux, jure devant les huit capitouls de respecter les privilèges éternels de la ville. Le roi est en chemin pour Saint-Jean-de-Luz où il va épouser l'Infante d'Espagne. Il séjourne plusieurs semaines à Toulouse et découvre l'une des plus grandes villes de son royaume. Comme dans ses ouvrages précédents, Jacques Arlet aborde les grands thèmes qui font le quotidien de Toulouse sous le règne de Louis XIV : le pouvoir, la justice, la religion, l'enseignement, le commerce, les arts, ;les grands événements et la petite histoire. L'ensemble compose un tableau vivant de cette période phare de l'histoire de France et de l'influence du règne du Roi Soleil sur l'ancienne capitale du Languedoc. Une plaque de marbre blanc immortalise cette entrée de Louis XIV au 10, place du Pont Neuf à Toulouse. En 1659, Mazarin réussit un coup de maître en alliant la France à l’Espagne qui était la grande puissance de l’Europe. Cette halte à Toulouse avant de rejoindre l’Infante, va durer deux mois et demi. Pour entrer dans Toulouse, Louis XIV comme ses ancêtres rois de France avant lui, doit jurer fidélité à la Charte de la Ville. Ce qu’il fait sans vergogne. Mais le jeune roi, a déjà en lui, les germes de l’absolutisme qu’il portera à son paroxysme. Très vite, profitant de ce que siègent les Etats du Languedoc, il va augmenter les impôts dus à la trésorerie royale. De plus, alors que les Capitouls étaient élus, il va les désigner lui-même. Pendant cette longue période, il va voyager aussi en Languedoc. Dans la ville, cette intrusion des troupes royales va engendrer des désordres. Les toulousains se plaignent des mousquetaires. Un bourreau est assassiné ; un mousquetaire est exécuté pour calmer les ardeurs de la soldatesque. Il faut dire qu’il n’y avait pas de casernes pour les troupes et que celles-ci étaient souvent livrées à elles-mêmes. Louis XIV gracie un condamné à mort que l’on menait au supplice place du Salin, un parricide et un voleur de tabernacles. Toulouse était alors, une ville importante de 30 000 ou 40 000 habitants. C’était déjà une ville très grande en superficie et divisée en deux zones appelées des gardages. Les huit Capitouls se partageaient ces gardages. Toulouse était une ville agricole. Elle nourrissait ses habitants. Sous le Capitoulat, le pouvoir du Comte de Toulouse était assisté des huit Capitouls. Cela était voulu par les Comtes qui pouvaient ainsi s’absenter souvent sans perturbation, la ville étant toujours tenue et administrée par les Capitouls. Ceux-ci étaient élus pour un an, mais pouvaient être réélus. Il y avait quatre pouvoirs à Toulouse : 1 - Les Capitouls ; 2 - Les Comtes de Toulouse ; 3 - Le Parlement ; 4 - Le pouvoir royal et le pouvoir de l’Eglise. Le Parlement rend la Justice mais détient aussi un pouvoir politique puisqu’il doit ratifier les édits du Roi. En effet, ce n’était pas un pouvoir absolu que détenait le Roi, ce qui déplaisait fort à Louis XIV qui avait souffert de la Fronde, et qui avait la volonté de s’affranchir de cette tutelle. Les Capitouls ont à cette période aménagé les locaux nécessaires à leur administration. Ils créent une prison, une tour des archives et même un restaurant. Leur personnel rassemblait deux cents personnes. Le Parlement contrôlait les Capitouls. Mais certains membres du Parlement étaient aussi Capitouls. Les Capitouls étaient, avant le XVIème siècle dans l’ensemble protestants et le Parlement catholique. Les Capitouls ont voulu carrèment prendre le pouvoir à Toulouse. Le Parlement a alors fait appel à la troupe pour rétablir son ordre, manu-militari. Toulouse est restée alors catholique. Sa voisine, Montauban, elle, est demeurée protestante. A Toulouse, la guerre de religions fut très triste et très sombre. Et il fallut ensuite, restaurer la religion et le XVIIème siècle fut un siècle catholique. La ville fit appel pour orner somptueusement ses églises, à des artistes de premier plan. Et aujourd’hui, elle s’enorgueillit à juste titre de ce riche patrimoine. Sous Louis XIV, il y avait à Toulouse trois justices : la municipale, celle des Capitouls, celle du Parlement et la Justice Royale qui était dirigée par un sénéchal. Par ailleurs, la Trésorerie (l’actuel Temple protestant de la place du Salin) abritait les réserves financières et servait de logement au Roi lorsqu’il descendait à Toulouse. Le Gouverneur et l’Intendant dépendaient de la Couronne. Les Intendants inspectaient, rendaient compte et le Gouverneur, lui, était le Lieutenant du Roi et avait un rôle militaire. Les prêtres étaient jugées par la Justice Ecclésiastique. Cette période sous le règne de Louis XIV fut appelée « L’âge d’or de la peinture ». A Toulouse, l’activité artistique fut remarquable. Les meilleurs artistes vinrent à Toulouse qui leur offrait du travail. Il y eut de grands chefs-d’œuvre. Le Baroque Occitan rayonne. Ce fut une prospérité artistique indéniable. L’influence de Caravage se ressentit fortement. L’Eglise voulait restaurer ce qui avait été détruit et restaurer aussi la piété catholique. Cette période a vu aussi la disparition de la Navarre comme Royauté. Henri IV était Roi de Navarre avant d’être Roi de France. Quand il dît sa messe à Paris, il devint Roi de France et de Navarre, tout allait bien. Or, la Navarre était un refuge de Protestants autour d’Orthez. Ils mettaient la main sur les églises et les transformaient en temples. C’est, du reste, encore un lieu de protestantisme. Ceci déplaisait à Richelieu. En 1623, il se rend dans la Navarre avec Luis XIII et fait disparaître la Navarre comme entité propre. Toulouse, sous Louis XIV, c’est une période prospère pour l’économie. La ville fournit avec ses nombreux moulins sur la Garonne, la farine à toute l’Europe. Elle œuvre aussi dans la métallurgie mais c’est surtout une cité commerciale. Toulouse tournait le dos à Paris et son activité s’adressait à l’Espagne. En réalité, c’est vers l’Espagne que Toulouse a toujours été tournée. Tout ce qui arrivait d’Espagne passait par Toulouse, le plus souvent par voie fluviale. De plus, les bois des forêts d’Ariège arrivaient aussi à Toulouse par le fleuve, par bordage comme on l’a pratiqué ensuite au Canada. Même les marbres des Pyrénées étaient transportés sur radeaux le long de la Garonne. Le fleuve rendit riche le port à Saint-Michel. Pour aller en Espagne, à l’inverse, il fallait aussi passer par Toulouse. Des milliers de mulets pour franchir les Pyrénées circulaient dans les deux sens. Cette richesse est également une richesse intellectuelle. Toulouse a son académie savante. On considère qu’elle a commencé en 1323. Les troubadours étaient florissants. L’Académie des Jeux Floraux créée par Louis XIV comptait 35 fauteuils. Elle fut longtemps l’apanage des magistrats. De nos jours, elle compte 40 fauteuils et elle promeut la poésie et la littérature. Sous Louis XIV les opéras deviennent à la mode. La musique est partout. Toulouse donne ses premiers opéras dans la salle du Jeu de Paume, rue Montardy, à l’emplacement du cinéma actuel Utopia. La danse n’est pas oubliée. Le Mainteneur Jean-Pierre Lassalle a trouvé dans le fonds de la bibliothèque municipale de Toulouse, l’argument de deux ballets joués à Toulouse au XVIIème siècle. Le premier « Pour le ballet du bureau d’adresse » mettait musique et danse dans ce fameux bureau d’adresse qui mettait en contact les gens en recherche de personnel ou d’objets utiles. Le deuxième intitulé « Ballet nouveau du mariage de Panurge » fait surtout référence à la question du cocuage. En voici un extrait : Si tu veux entrer dans la danse Du nombre infini de cocus Prends-moi quelque Beauté qui gagne force escus, Et tes Cornes feront des Cornes d’abondance... En conclusion, le pouvoir royal n’a pas endormi Toulouse. Les Facultés du XVIIème siècle sont brillantes. L’Hôpital de La Grave est un très grand hôpital. A l’Hôtel Dieu, les soins sont gratuits et on accueille les étrangers dans les mêmes conditions. Il y avait une Ecole Royale de Chirurgie. Quand elle fut supprimée sius la Révolution, médecins, chirurgiens et pharmaciens ont créé une Ecole de Médecine avec beaucoup de courage et avec leurs propres deniers. Le livre de Jacques Arlet comporte in fine une liste des Toulousains remarquables de cette époque et la liste est longue ! Pour ne pas les oublier et savoir ce que Toulouse leur doit, il faut lire « La vie à Toulouse sous Louis XIV » un livre écrit dans une langue claire, facile, qui se lit comme un bon roman. |
|
01/12/2016
|
Christian Saint-Paul, en préambule, cite Max Jacob qui déjà en 1922 écrivait dans son essai « Art poétique » : « la poésie moderne saute toutes les explications. La poésie moderne est une preuve qu’en matière de poésie, la poésie seule importe.» Plus tard, Max Jacob dans ses « Conseils à un jeune poète » poursuivra : « Les idées n’ont rien à voir avec la poésie : c’est l’inexprimable qui compte. » Pour lui, la poésie était l’art de transformer les idées en sentiments. La poésie est un humanisme comme l’ont assuré des poètes comme Meschonnic ou Pierre Emmanuel qui à la fin de la seconde guerre mondiale, affirmait : « Être poète, c’est d’abord être un homme. C’est assez dire que la poésie, comme tout effort humain véritable, doit être progrès de l’homme dans son futur, donc prophétie ». Les prophéties, nous les découvrons dans les livres qui sont signalés dans cette émission : Daniel Martinez, ce poète et plasticien qui dirige la revue Diérèse et les éditions « Les Deux Siciles » fait paraître aux éditions Le Lavoir Saint-Martin, « Le Temps des yeux », préface de Bernard Demandre, 118 pages, 20 €. De la belle ouvrage, de la belle édition, grand format, mise en page parfaite, texte aéré pour une lecture agréable, dessin de couverture de Pacôme Yerma qui nous entraîne d’emblée dans un univers onirique où se révèlent les prophéties, cette succession de poèmes qui, comme le voulait Ramuz, immobilisent l’espace et le guérissent de sa maladie qui est le temps. « Vision de l’instant, espace d’un regard, voire théâtre des yeux » nous dit le préfacier. Le bonheur est présent dans ces poèmes, dans ces « Lettres à Gaëlle » sa fille. L’auteur s’était ouvert à Christian Saint-Paul de ce bonheur quand il a fondu sur lui, mais le retenir dans le poème, est encore un autre bonheur. Il semble qu’un Martinez nouveau soit arrivé, et du meilleur crû. « Le Temps des yeux, comme pour tenter de garder en soi et dans l’extension de tout cette sorte de grandeur qui nous établit dans la vie, dans ses menées, ses mille et mille nuances où se concentrent nos tensions et se réconcilient nos turbulents antagonismes. S’il se peut, en réanimant l’image dans sa fuyante matérialité, à l’envers du voir, justement » précise l’auteur. Lecture d’extraits. [ ...] Ses cheveux châtains lui flottent sur le front Gaëlle rêve des ondulations de la mer venues s’époumoner sur les rochers de mon enfance elle partage mes souvenirs ceux de longs murs au bord des chemins
par-dessus lesquels on voyait des oliviers puis des femmes aux yeux brillants en ramasser les fruits sur de vastes draps de couleur pour les replier ensuite ils ont l’étrangeté de corps vivants ces oripeaux d’Ouranos
à ce moment de la nuit aussi pleins de nous-mêmes et si peu maîtres de ce qu’éveillent la respiration cellulaire l’universelle mouvance
dans les échancrures de l’horizon redécouvert
* Avant de présenter les derniers numéros de la revue Encres Vives, Christian Saint-Paul revient sur un livre de poèmes de Michel Cosem, qui dirige cette revue et les éditions éponymes. Il s’agit de « L’Encre des Jours » aux éditions Alcyone, 85 pages, 20 €, avec un commentaire en 4ème de couverture de Gaëlle Josse et un dessin acrylique et encre de Silvaine Arabo. Tous ces poèmes sont des regards intenses et souvent des louanges à des lieux familiers, ou que traverse notre poète, au cours d’incessantes promenades « au pays de la poésie » comme il le nomme lui-même dans la dédicace à Saint-Paul. Le lieu est un élément vivant de la poésie de Michel Cosem. Il a du reste, créé une collection « lieu » aux éditions Encres Vives et qui thésaurise aujourd’hui un fonds particulièrement riche, démontrant ainsi que le lieu est une préoccupation essentielle du poète. C’est à partir du lieu que se joue l’histoire, l’avenir ; un lieu n’est jamais vide de sentiments. Il les fait advenir ces impressions qui nous marquent et qui recèlent un sens caché que les mots dévoilent avec innocence. Le langage mieux que l’appareil photographique cerne et fixe le lieu. Lecture d’extraits. Départ/ Departure/ Arrivée/ Retard/ Tapis roulant/ Reflet/ Pause café/ Tête d’imbécile/ Femme voilée pour Alger/ Transport/ Flights/ Boarding/ Parc Auto 1/ Arrivals/ Débarquement : les mots se bousculent et clignotent en rouge en orange dans la pénombre de l’aérogare. On rêve d’une destination : Istanbul/ Taba/ Marrakech/ Kos/ Rhode/ La Valette ou Lanzarote. Et l’on compte le temps qui passe dans l’attente. Départs et arrivées se ressemblent encore faut-il être parti... (Aérogare de Blagnac, Haute-Garonne) * Le pauvre vent sort tout humide de la rue Bayard. Il se heurte à l’immense gare après avoir léché les façades roses aux fenêtres closes et entre malgré les mendiants dans le hall des départs. Tous les trains sont à l’heure. Des moineaux picorent des miettes et se moquent des platanes qui se sont habillés après un hiver nu. Quelques nuages hésitent entre Atlantique et Méditerranée mais veulent quitter l’ennui. Attention au départ. (Gare Matabiau, Toulouse) * Eric Barbier, notre ami poète bibliothécaire de Tarbes, heureux montagnard, attaché pareillement aux lieux, vient de publier aux éditions toulousaines du Contentieux « Ellipses » 58 pages, 8 €, livre d’une vraie originalité, chroniques en forme de poèmes en prose. L’émission « les poètes » en reparlera avec l’auteur au micro de Radio Occitania. Lecture d’extraits. Certains collectionnent des cactées des reptiles des orchidées des discours des ombres des ossements des cartes postales. Lui pour se distraire s’est constitué tout un trésor des vents. De vrais et beaux descendants d’Eole qu’il garde dans d’appropriées vitrines où il peut à loisir les admirer. Cet homme les nourrit d’obligeantes paroles, d’images inédites. Et note leurs noms et origines sur des étiquettes collées sur le verre épais de ses meubles.
Quelques pièces de la collection :
Le Bèn d’Autà (Landes)
Le Drailhets (Aubrac)
Le Mendebala (Pays Basque)
Les Zef de la Muette et Suroît du Bois (Paris)
Le Zéphiroun (Marseille)
Le Venge Barriques (Salezan)
Paisible gardien de ces vents il peine à garder d’autres liens. *** Le n° 458 d’Encres Vives est constitué du recueil de Chantal Danjou « Inutilité de voir venir », l’illustration de couverture étant réalisée d’après une encre d’Henri Yéru, 6,10 € à adresser à Michel Cosem, 2, allée des Allobroges 31770 Colomiers, abonnement 34 €. Cet ensemble fait partie d’un recueil plus vaste, « Formes », encore inédit. Le rapprochement d’un lieu avec ses traces humaines et des formes géométriques aperçues dans la fugacité du passage d’un avion qui sillonne le ciel, interroge Chantal Danjou, qui cherche le sens aux formes qui se dessinent et s’estompent. Allégorie de la vie et de la mort intrinsèquement liées. Les mots se succèdent, brefs comme des battements de paupières qui hacheraient le paysage. Il en résulte une constante intensité. Le lecteur est pris dans les filets resserrés de cette poésie aux mots concentrés. La réponse aux interrogations peut être fulgurante : « Les arbustes ? Une conscience. » Récits de la guerre ; récits du lieu ; récits du feu ; récits d’horizon. Les couleurs, les formes, les objets (l’hélicoptère) sont la trame du langage qui dessine l’impression, le sentiment, qui, eux, ne sont jamais nommés. C’est peut-être cela un poème réussi : donner à penser, à sentir par la seule vision, la seule peinture des décors. Le décor sentimental se glisse subrepticement chez le lecteur et devient un fait personnel. L’autre, avec les mêmes mots, s’appropriera un décor certainement différent et sans contre-sens, puisque le sentiment n’est jamais imposé. « Inutilité de voir venir » ce titre à l’accent fataliste dénonce la cruelle inadéquation de l’homme avec sa destinée qu’il n’a pas le pouvoir de changer. Nous attendons la version complète de « Formes » et nous en reparlerons. Lecture d’extraits. Arbres Fruitiers. Vantail Ouvert. Enfance. Et quelque chose de clair qui passe. Que dit-on de cela ? Qu’une présence... Une forme. A imaginer. A se rappeler. L’été. Le jardin entrait dans la maison. Portes closes. Murs. Et cette poussière. Et ce sable. Et ces pétales. Et ce chapeau de paille accroché à la patère. Tout s’est amoncelé. La brise s’est enroulée autour du lustre. Du fond de la chambre parvenait. D’un peu félin. Pas. Frôlements. Ce n’était pas le chat pourtant. Il faisait siffler l’air comme une épée ! La... la, forme. Silhouette. Colonne. Présence. On ne savait qui. Chantonnait. Un rai de lumière. Puis un oiseau. Affolement de lignes d’un bout à l’autre. Une robe vaporeuse suspendue. Devant la fenêtre à descendre. Plis, dentelles, rayures. Autour le bruit d’hélice du vide. Et du noir. Et de cette uniformité, lieu, gouache, tissu. Un jour, le dimanche où la robe * N 7 Deux maçons et un peintre. Happés par la fourmilière. Charpentier enterré. Dans taupinière. Petite cueillant des fleurs. Ils chantent : Ah ! Mon beau château, ma tant’tire lire lire ! Rançon. Et les corps. Portant collier, bracelet. Couronnes de fleurs, boucles. Voici la mort. Formes et stupeurs. Perfection
* Le 459ème Encres Vives est constitué du recueil de Michel Lac « Une autre forme d’amour » 6,10 € à adresser à Michel Cosem, 2 allée des Allobroges 31770 Colomiers, abonnement 34 €. C’est Jacqueline Saint-Jean qui signe la quatrième de couverture : « L’écriture de Michel Lac est toujours ce face à face avec l’essentiel : avec soi-même, son histoire et son devenir. Avec l’altérité. Avec la mémoire et l’oubli. Ce qui reste. Ce qui revient. Ce qui advient. Ici les mots émergent des fonds, dans le vide blanc de l’heure et de la page, îlots de langue dénudés par le temps, archipel intérieur où « l’âme s’essouffle à rendre la vie ». Ecriture elliptique et troublante, dont l’étrangeté familière s’ouvre à l’imaginaire. Travaillée par la tension entre ce qui veut vivre et ce qui meurt. Habitées par les présences premières, Je, Il, Elle, ou la jeune fille, aussi réelles qu’incertaines, figures de l’humain souvent doubles, ou multiples. [...] La terre, la nuit et la mer accompagnent ce poème baigné d’ «une autre forme d’amour ».
Poèmes parfois minimalistes « ne rien voir/ du temps qui passe/ se perdre » les mots économes prennent toute leur puissance. Le poète donne sa parole à lui-même, à elle, à eux, à l’autre. Le poète est l’inventeur d’ « une autre forme d’amour », cet inventeur nom utilisé par la loi pour désigner celui qui a découvert une chose qui existe indépendamment de lui et de sa volonté. C’est l’inventeur d’un trésor, de la grotte de Chauvet etc. Le poète dans sa quête inépuisable cherche les trésors qu’il ignore, et découvre cette autre forme d’amour qu’il invente ainsi. Les poèmes, comme des îles fragiles émergeant de l’océan de la pleine page blanche, sonnent comme des coups de gong séparés de longs silences marqués par leur distance de l’un à l’autre. Lecture d’extraits. Il part au-delà de la lumière. la peur vissée au ventre ** L’humidité cache l’ombre en plein midi. Il l’aime. ** Il s’éloigne du bord ne parle plus, écoute la vague qui roule sur le dos de sa main. ** Les mots se mélangent à l’encre. Il peut commencer. ** Il écrit l’amour de la nuit, le refus du sens donné amour. ** Le numéro 460 d’Encres Vives est constitué par le recueil d’Arnaud Chemin-Bocage « Epos », 6,10 € à commander à Michel Cosem, 2 allée des Allobroges 31770 Colomiers, abonnement 34 €. La quatrième de couverture nous apprend que « ces poèmes de forme brève sont autant de cris d’amour, de solitude, en quête de sens. Si l’amour n’existe pas en vain nous vivons. Je sens un frémissement, explique le poète, une inspiration fulgurante me submerge, qui m’incite à écrire la joie et la douleur d’être un homme. Puis apparaît l’apaisement, comme une source sur la pierre. Sous le Soleil vertical, résistent et franchissent les hommes debout. Comment vivre ? Il faut surmonter le réel. Comment écrire ? Il faut beaucoup souffrir. René Char et Paul Celan montrent la voie. Encre de survie dans un carnet d’oubli. » Arnaud Chemin-Bocage (Arnaud Duchemin) a fait paraître aux éditions des Vanneaux « Fragments » en 2005. Encore des poèmes courts, dans lesquels chaque vers prend ses distances vis à vis de l’autre dans la page, comme pour détacher chacun et faire valoir que chacun est à lui seul une image et en dresse le constat. Lecture d’extraits. Les vagues roulent les crânes je marche sur la craie d’origine traversé par le souffle. Remontée vers l’intérieur le Soleil submerge nos ombres nous marchons doubles. ** Amour sans brisure l’aube afflue dans nos replis brûlure d’Absolu. Capture de Hasard à des branches de promesses attache mon chant. ** Cercles de l’être multiples figures d’éphémère une seule demeure. Le Monde est Chaos submergés nous l’organisons nous-mêmes tombons en morceaux. ** L’Arbre du Monde abattu ampute mon codeur privé d’espoir mon cri déchire le vent. Nu retrouvé au retour d’exil armoise éclose à l’acmé du désir déflagration de mémoire. ** Enfin l’émission est consacrée à Jean Joubert particulièrement pour son livre posthume : Longtemps j’ai courtisé la nuit précédé de : Les Lignes de la main, préface de Frédéric Jacques Temple, aux éditions Bruno Doucey, 160 pages, 16 €. La vie de Frédéric Jacques Temple, né à Montpellier en 1921, mériterait à elle seule un long métrage. Son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, son travail de journaliste, ses voyages, l’amitié qui le lia à de grands écrivains du monde entier, ses traductions de l’italien et de l’anglais, la prodigalité de son oeuvre littéraire font de lui un géant de la littérature. L’Anthologie personnelle qu’Actes Sud fit paraître en 1989 est l’arbre qui cache la forêt d’une œuvre gigantesque composée de recueils poétiques, d’essais, de récits et de traductions. Son recueil Phares, balises et feux brefs suivi de Périples est publié en novembre 2012 aux Éditions Bruno Doucey. Il a reçu le Prix Guillaume Apollinaire en 2013 pour l’ensemble de son œuvre. Jean Joubert est né dans le Loiret en 1928. Après de longs séjours à l’étranger, il s’installe à Montpellier, dans ce pays de garrigue qui marquera profondément son écriture. Longtemps professeur de littérature américaine à l’université, il est l’auteur d’une oeuvre qui comporte des recueils de nouvelles, des romans – dont L’Homme de sable, Prix Renaudot en 1975 – des contes et des nouvelles, des livres pour la jeunesse, dont Les Enfants de Noé (L’École des Loisirs, 1987) qui lui vaut un très grand succès, sans oublier des recueils de poèmes, comme Les Lignes de la main (Seghers, 1955) ou l’Anthologie personnelle qui paraît chez Actes Sud en 1997. Une œuvre où le vécu se mêle aux voies de l’imaginaire. Son recueil de poèmes, L’alphabet des ombres est paru aux Éditions Bruno Doucey en avril 2014. Il meurt en novembre 2015. Son dernier recueil posthume, Longtemps j’ai courtisé la nuit, a paru en août 2016 aux Éditions Bruno Doucey. Le mot de l’éditeur : « Jean Joubert nous a quittés en 2015. Sa voix nous manque, « c’est en silence désormais » qu’il nous parle. Mais avant de partir, le poète a pris soin d’adresser à ses amis les poèmes qu’il écrivait au fil des jours, depuis la publication de L’alphabet des ombres, comme autant de lettres pour conjurer l’absence. Ce sont ces poèmes inédits, fidèlement rassemblés, qui constituent ce livre. Pour avoir longtemps « courtisé la nuit », le poète n’ignore pas celle qui « s’avance à pas de louve ». Mais son inquiétude est ailleurs, dans la brutalité qui s’est emparée du monde, la violence faite aux femmes ou le « grognement des tueurs souterrains », menaces auxquelles il objecte une « promesse d’aube » et un « parfum d’enfance », fidèle en cela aux vœux de son premier recueil, Les Lignes de la main. » Frédéric Jacques Temple dans sa préface avec la pertinence qui le caractérise, remarque que tous les poèmes de Jean Joubert, « jusqu’au dernier recueil, « L’alphabet des ombres » (Bruno Doucey éditeur), nous permettent de sonder les mystères d’une vie. Veilleur, alerté par les bruits inquiétants du jour et de la nuit, sollicité par les contradictions de l’homme et de la nature, et sachant qu’elles sont le propre de l’être, il entendait monter des abysses la rumeur de forces primordiales qui sont un des ferments de la poésie. La sienne est riche de clairs-obscurs, de lumières voilées, d’aubes liquides et de soleils fanés.[ ... ] Jean Joubert a laissé des inédits en héritage. Les voici reliés à ses premiers poèmes, comme pour annuler le temps. La fin rejoint le commencement. L’œuvre est close ; à nous d’aller cueillir les fruits de son jardin secret. » Jean Joubert laissait souvent à Michel Cosem, son ami de longue date, le soin d’éditer dans Encres Vives, un de ses recueils. Il est devenu ainsi un familier d’Encres Vives. C’était une figure incontournable pour les poètes gravitant dans le Sud de la France et dans ce Languedoc où ce résident de Montargis avait décidé de s’établir. Beaucoup se souviennent de ses prises de parole aux journées de Rodez, de sa silhouette élégante, de la noblesse de ses postures. Celui qui avait reçu le Prix Renaudot pour « L’Homme de sable » en 1975, continuait à faire chanter images et mots, dans une écriture accessible à tous. C’est la force d’un grand poète de s’adresser à chacun dans une clarté intime. Merci à Bruno Doucey d’avoir rassemblé ses textes publiés dans diverses revues et ses inédits ainsi que son premier livre de poèmes et de nous les offrir dans ce livre « Longtemps j’ai courtisé la nuit ». Lecture d’extraits. « Le temps mincit. La nuit apprête ses linceuls. Respire encore un peu le parfum du soir. Dans ta main qui écrit rassemble les dernier désirs. » ** L'alphabet des ombres de Jean Joubert COURS, POÈTE ! Cours, poète, cours dans la forêt du verbe, respire, inspire, avale au vol une virgule, souffle une métaphore. Cours, poète, cours, cours plus vite encore, car la nuit tombe et tu entends, derrière toi, courir toujours plus vite, toujours plus près, courir, souffler et geindre une grande ombre sans visage. * La Maison du poète de Jean Joubert Écoute ! Entre dans la maison, assieds-toi, ferme les yeux, écoute ! Je te dirai l'éloquence du poisson rouge, la grâce du crapaud, la bonté du moustique, la souplesse de l'escargot, la politesse du serpent, l'élégance de l'araignée. Écoute ! Je te donnerai la clef de ces splendeurs secrètes longtemps cachées sous une pierre que nous aurons enfin levée. ** Le gros Lucas Le gros Lucas, fermier breton, un dimanche tua une poule et, l’ayant rôtie à la broche, sans plus tarder la mangea entièrement jusqu’à la crête. Puis, le ventre comme un tonneau, Maître Lucas fit un rot, un rot bien rond, un rot tout blanc qui tomba dans son assiette et se brisa. Il en sortit un poussin dorveteux et pépicharmant qui s’écria : « Assassin ! » (Longtemps j’ai courtisé la nuit) ** Masqué La forêt grogne assiège la maison. Pour t’affoler, enfant, ton chien s’est déguisé en loup, il porte un masque des gants de fer mais sous ses gants les griffes crissent et sous le masque les crocs luisent de vraie fureur. Et le voici dehors, qui laboure le seuil, mord le vent, hurle à la lune. Sois vigilant, ferme la porte, pousse bien le verrou, garde ta main du père. (Longtemps j’ai courtisé la nuit)** Table rase Enfant, vois-tu, il n’y a plus d’Enfer. Les grilles sont fermées, les feux éteints, la rouille a dévoré fourches, pinces et lames, les démons ont fondu comme graisse au soleil, le Grand Satan n’est plus qu’un roc enlisé dans la boue. De même en vain tu chercheras le Paradis, noyé, perdu dans l’océan de brume. Guichet fermé, faillite, propriétaire en fuite, nul repreneur en vue. Il ne te reste ici que le bel aujourd’hui, l’arbre chéri, l’oiseau rêveur et, sur ton front, le baiser d’une mère. ** |
|
Jacques ARLET
17/11/2016
|
Connaissant l’intérêt porté par l’invité de la semaine, Monsieur le professeur Jacques Arlet, à Brigitte Maillard, poète, qui a obtenu il ya trois ans un prix de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse, celui du poème mis en musique, Christian Saint-Paul évoque de nouveau les publications de cette auteure qui vit en Bretagne, et qui a créé les éditions Monde en poésie. Rappelant à Jacques Arlet combien il avait été séduit par les textes de « À l’éveil du jour », Monde en poésie éditions, septembre 2015, il rappelle que Brigitte Maillard est auteur interprète et que « les poètes » lui ont consacré deux émissions toujours en ligne sur le site « les-poetes.fr ». Elle a publié : Poésie : La simple évidence de la beauté 2011 Atlantica Soleil vivant soleil préface Michel Cazenave Librairie Galerie racine 2014 Livres d’artiste : La beauté à l’air libre Serge Marzin, Atelier Awen 2016 Chant de nuit Denise Pelletier Atelier Engramme – Québec 2015 Réminiscences Denise Pelletier Atelier Engramme – Québec 2016 A propos de « À l’éveil du jour » publié le 13 juin 2016, elle répond : « Pourquoi j’ai écrit ce livre ? Je témoigne par ce livre de mon expérience intérieure. À l’éveil du jour est une autobiographie poétique, tant Poésie a guidé mon chemin au travers des épreuves. N’avons-nous pas chacun notre blessure inouïe (Reverdy). Par sa façon de saisir les rapports entre les choses, Poésie est un efficace moyen de libération (Reverdy). Poésie en véritable médiatrice crée l’espace du dialogue de l’être avec lui-même. Son soutien ne s’est jamais démenti. Un état d’émerveillement m’a ainsi conduit à la naissance d’une conscience nouvelle. À l’éveil du jour est le fruit d’une maturation profonde, d’un travail d’écriture assidu pour « réfléchir » une expérience. Ecrire vers l’intérieur. S’inquiéter de l’âme et des dieux. Ainsi s’ouvre le chemin spirituel. La douceur d’une communion avec la vie en soi. Il me paraissait aussi essentiel de dire l’acte qui conduit à l’écriture, l’acte poétique. Les poèmes ne tombent pas du ciel, ils appartiennent à une histoire. Faire ressentir cela, c’est peut-être ouvrir la poésie à un plus large publique. Ainsi se tressent dans cet écrit prose et poésie, le poème du soleil et la prose de la blessure comme le souligne à sa lecture, Christian Bobin. Je ne sais plus comment parler de la vie Elle vient de me rester dans les mains ». Une expérience humaine vécue comme un appel à la « vraie vie » pour que naisse le jour. Une aventure en poésie qui conduit l’auteur aux portes du silence. Ce récit témoigne par la douleur et la joie de cette clarté vibrante qui nous entoure. Une vie dont nous sommes avant tout le vivant poème. Mais c’est « La simple évidence de la beauté » qui retient l’attention cette fois-ci. Ces poèmes ont été édités en 2011 par les éditions Atlantica, suivi d’une réédition en juillet 2013. C’est maintenant Monde en poésie éditions qui fait paraitre cette nouvelle édition en juin 2016 dans sa collection L'écriture du poète, 60 pages, 8 €. Il suffit de savoir regarder pour se rendre à « La simple évidence de la beauté ». Cette beauté qui nous submerge n’appelle qu’à l’amour. Ce livre de poèmes, dans une écriture resserrée, conquise par la précision juste des mots et de leur enveloppe de silence, est un hymne humble à l’amour : O toi la vie regarde-moi Mon doigt se pointe l’amour est là Mon pied avance l’amour est là Mon regard s’ouvre l’amour est là Je danse dans la spirale de l’amour je tourne l’amour est là A droite l’amour A gauche L’amour Est Là * Le livre de Jean-Luc Pouliquen : « Georges Pompidou Un Président passionné de poésie » préface du Professeur Alain Pompidou, éditions L’Harmattan, 76 pages, 11,50 € est également cité, car il fait référence à une époque que connaît bien l’invité le Professeur Arlet qui est, comme Alain Pompidou, professeur de rhumatologie. Qu’un grand homme d’Etat, arrivé au sommet de sa vocation politique, demeure un vrai amoureux de la poésie a, aujourd’hui, de quoi donner le vertige. Espérons que l’exemple de Georges Pompidou, comme de son ami le Président Senghor, se répète et que nos fauves politiques pratiquent une relation à la langue qui ne soit pas celle des tout puissants « communicants » qui anesthésient le peuple sous d’intenables promesses. * Simone Alié-Daram, que connaît bien Jacques Arlet et qui est maître ès-jeux de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse où notre invité siège en qualité de Mainteneur depuis 2006, a fait paraître un livre de poèmes « Désinvolte Eros » Poésie, 31 pages, 10 € à commander à daramalie@free.fr Ce livre, qui a impressionné Jacques Arlet, est remarquable par la maturité avec laquelle, cette poète, maîtrise avec naturel la langue poétique. C’est comme un resserrement sur soi et sur le monde, mais pour mieux le recevoir, en savourer l’essentiel. Même si cette saveur a des goûts nostalgiques, si la tristesse voile la vue. Aller au fond des choses, voilà bien la vocation de la poésie et celle de Simone Alié-Daram. Elle regarde le monde en face, sans ciller, dans une lucidité que la noblesse du regard dépouille du désespoir sordide. Sauvée elle aussi par la « simple évidence de la beauté » et par le don de poésie. Après « Syllabes », paru chez Cosem à Encres Vives, Simone Alié-Daram, signe là son livre le plus marquant. Nous attendons tout du prochain. Lecture d’extraits.
Maladie de tendresse Maladie de tristesse Spectre libidineux Des grands lacs d’autrefois Enfouis de brumes Aux solitudes suspendues
Aller dans les déserts Sous un ciel plein d’étoiles Aux histoires oubliées Et un soleil spumeux. * Les larmes sont au bord de moi Elles me dissolvent Elles m’englobent Je n’ai plus de corps Plus de cellules Je suis un lac empli De dévastation de toi Perdue Quand tu me parlais grec Je buvais les phonèmes Et nous étions vivants D’amour et de lettres. * Le temps passe Je m’en veux trainant des ailleurs Où tu n’es pas Peut-être Je suis en toi encore Tu es en moi toujours
Peau de chagrin Peau de bonheur Heures Si frêles, si douces Si intenses Si nécessaires Ne pas les oublier
Désinvolte éros Eros diabolique Qui égratigne l’agapè Bouscule les tranquillités Les griffes de pluie sur les carreaux brillent Comme les pleurs de mon amant sur ses joues Mes lèvres se gonflent sur les miennes C’est l’heure du jamais plus.
La nuit bleuit les fenêtres * Enfin Christian Saint-Paul reparle du livre de Jean Joubert « Longtemps, j’ai courtisé la nuit » qui, après « L’Alphabet des morts » est publié aux éditions Bruno Doucey. Premiers et derniers textes de ce grand de la poésie qui a disparu dans l’été 2015 mais qui ne cesse de grandir et d’envahir nos esprits, notre histoire de la poésie qui est l’histoire de l’humanité. Heureux le poète qui ainsi nous hante et nous habite. Une émission et d’autres seront consacrées à Jean Joubert. Lecture d’extraits. L’émission se poursuit ensuite avec l’invité le Professeur Jacques ARLET venu parler de son roman : « Le secret d’Horace Saint-Clair » aux éditions L’Harmattan, 180 pages, 18,50 €. Jacques Arlet est Professeur émérite de l’Université Paul Sabatier, Faculté de Médecine, ancien Président de la Société Française de Rhumatologie. Président fondateur de l’Association Internationale de Recherches sur la circulation osseuse. Docteur Honoris Causa de l’Académie de Dublin. Archiviste adjoint de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. Auteur de livres sur l’histoire de Toulouse au XIXe siècle et de biographies. Ses publications : Jacques Forestier. Des stades aux Thermes.NPP et Privat, Toulouse, 1988 Curé en Ariège et ami des poètes. La vie de Casy Rivière, Loubatières, Toulouse, 1992 La vie à Toulouse sous Louis-Philippe, Loubatières, Toulouse,1994 Le Second Empire à Toulouse, Loubatières, Toulouse, 1996 Toulouse à la Belle Epoque, Loubatières, Toulouse, 1999 Deux siècles de progrès dans le traitement des rhumatismes, 1999 Des Toulousains remarquables, Loubatières, Toulouse, 2002 Rémusat, 2003 Poètes Toulousains de la Belle Epoque, Loubatières, Toulouse, 2005 Les journaux satiriques toulousains de la Belle Epoque, Accord Editions, Toulouse 2007 Le Général Lafayette, Gentilhomme d’honneur, L’Harmattan, Toulouse,2008 La vie à Toulouse dans l’Entre-deux-guerres, Loubatières, Toulouse 2010 La vie à Toulouse sous Louis XIV, Loubatières, 2012 Contes sans Provisions I et II © JacquesARLET,2015. * « Le secret d'Horace Saint-Clair » est un roman historique qui plonge le lecteur au cœur de la Monarchie de Juillet (1830-1848) : Lucien Saint-Clair, originaire de Sainte Lucie, dans les Antilles, fait ses études de médecine à Paris. Il va fréquenter toute une galerie de personnages hauts en couleur de la société bourgeoise d'alors ; il deviendra l'ami d'un certain nombre de romanciers et auteurs de l'époque ; il sera notamment l'intime de Théophile Gautier. Il est amoureux de la douce Hélène. Mais une lettre de son père mourant le pousse à rechercher sa demi-sœur, Serène, née en 1812 ; une quête qui le mènera dans le sud de la France, en Espagne et même à Cracovie en Pologne pour un dénouement des plus inattendus ! Le récit est fait par un ami intime de Lucien et Hélène qui nous partage l'affection profonde qu'il nourrit pour les deux héros et nous permet de découvrir les notes intimes de Lucien. Voici l’« Avertissement au lecteur » : Ce livre n’est ni un roman, ni un livre de souvenirs ; encore moins mérite-t-il le titre de Mémoires, comme celles qu’ a écrites le Général Marbeau par exemple. D’abord, ce livre ne parle que d’une partie de la vie de Lucien Saint-Clair ; ensuite, si j’ai beaucoup puisé dans le journal et les notes de mon ami, j’ai voulu « remplir les blancs » si j’ose dire, car ce journal et ces notes sont fragmentaires et j’ai désiré montrer le vrai visage de mon ami et la façon dont il a vécu, au milieu des événements politiques et artistiques si nombreux et si importants de cette première moitié du siècle. Lucien m’honorait de son amitié ; mais j’ai aussi une dette de reconnaissance à son égard car il a fait, tout comme moi, des études de médecine et il m’a appris l’essentiel de mon métier. Je l’ai toujours admiré, je l’ai souvent accompagné dans son activité médicale, je l’ai parfois suivi dans ses aventures et j’ai, dans toutes les circonstances importantes de sa vie, reçu ses confidences. Je ne l’ai plus revu depuis son retour à Sainte-Lucie, bien qu’il m’ait souvent invité, dans ses lettres, à lui rendre visite dans cette petite île dont il avait toujours gardé la nostalgie pendant son long séjour en France. J’ai longtemps hésité à raconter l’histoire de cet homme ordinaire parmi tant d’autres ; la mode serait plutôt d’écrire la vie des généraux d’Empire, des grandes comédiennes ou des coquins de haut-vol; mais je m’y suis décidé, pour apporter un témoignage sur ces hommes de l’ombre dont personne ne parle, qui n’ont pas les honneurs des gazettes et qui, pourtant, font aussi l’histoire. Je n’ai jamais compris comment on pouvait écrire l’histoire, la vraie, en parlant seulement de la poignée d’individus qui dirigent les affaires ou croient les diriger ! En vérité, leurs décisions n’ont de sens, que dans la mesure où elles sont suivies par la foule des gens qui sont la substance d’un peuple : on imagine mal Napoléon et ses maréchaux, tous très braves, bien entendu, se promenant seuls à travers l’Europe, comme sur un théâtre de marionnettes. On les aurait pris pour une troupe de baladins ! En fait, comme on le verra, Lucien a vécu, sans les avoir cherchées, des aventures peu banales, mais cela est arrivé à des centaines d’autres. Lucien Saint-Clair aimait écrire : il a écrit des livres médicaux ainsi que deux romans qu’il m’a confiés et que je ferai peut-être éditer, surtout si ce livre est bien lu et si de nombreux lecteurs se reconnaissent en lui. Lucien m’a confié aussi son journal, avant de partir ; je lui avais demandé la permission de le recopier. J’ai moi-même écrit plusieurs romans ; mais j’ai toujours pensé que la vie de Lucien était un roman mais qui a dit déjà que la vie était un roman ? -et qu’il suffisait de l’écrire, tout simplement, dans sa vérité pour intéresser et, pourquoi pas, instruire le lecteur. Paris, 27 octobre 1860 *Jacques Arlet raconte la genèse de ce roman né de l’envie d’écrire une fiction à partir de la vie d’un de ses ancêtres en Vendée. On devine que l’écriture de ce roman a été jubilatoire pour l’auteur, qui a rassemblé avec une enviable facilité, son talent d’écrivain accompli attesté par ses nombreux ouvrages, ses connaissances historiques et son expérience médicale de haut niveau. Il fallait tout cela pour écrire « Le secret d’Horace Saint-Clair ». Il en résulte un livre plaisant, qui se lit d’un trait, tellement la langue est alerte, et qui nous entraîne dans cette époque romantique passionnante qui laissait tant d’espace à l’aventure. Roman d’aventure donc, mais aussi biographie fiction, genre littéraire très moderne. Et l’on voyage avec ce livre, Les Antilles, Paris, Toulouse, Bordeaux, Agen, Grisolles, la Suisse, l’Espagne, la Pologne. Et les figures du siècle s’incarnent dans le roman : Théophile Gauthier, Dominique Larrey, Emile Littré, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas qui a mangé un beefsteak d’ours... L’Histoire est conviée, celle d’une France en crise, en proie aux émeutes de juin 1848. Celle d’une France où la province et notamment la région toulousaine située à quatre jours de diligence de Paris, peinait à suivre le rythme des changements politiques de la capitale. Celle d’une France en proie aux épidémies de choléra et qui prenait en charge les malades et les indigents dans un dénuement de moyens mais où l’éthique médicale était déjà puissante. Celle d’une France dévorée de créations, littéraires, musicales et scientifiques. Mais ce roman si intéressant par ses digressions, est surtout le roman d’une intrigue. Il s’agit d’une enquête, d’une recherche, d’une personne à retrouver et d’une histoire familiale à reconstituer pour comprendre l’énigme. Et le suspense est réussi. A lire et à offrir. Le plaisir est assuré.
|
|
Michel
ECKHARD-ELIAL
17/11/2016
|
Christian Saint-Paul signale la parution de « Georges Pompidou, un président passionné de poésie » préface du Professeur Alain Pompidou de Jean-Luc Pouliquen aux éditions L’Harmattan, collection Questions contemporaines, 76 pages, 11,50 €. Jean-Luc POULIQUEN est poète et critique littéraire. Il a notamment publié aux mêmes éditions Mémoire sans tain (Poésies 1982- 2002), avec une préface de François Dagognet, Gaston Bachelard ou le rêve des origines et, avec Wernfried Koeffler, Le poète et le diplomate, préfacé par Adolfo Perez Esquivel, prix Nobel de la Paix. Ses poèmes, son activité de critique littéraire, l’édition (il a dirigé les Cahiers de Garlaban de 1987 à 1997), les ateliers d’écriture qu’il anime ainsi que les différents événements culturels auxquels il participe (après avoir été membre de 2001 à 2009 du comité du festival des Voix de la Méditerranée de Lodève, il a été membre du comité international de coordination du festival Voix vives, de Méditerranée en Méditerranée de Sète de 2010 à 2014) s’inscrivent pour lui dans une même tentative pour remettre la poésie au cœur de la Cité. Il a gardé en cela les préoccupations sociologiques qu’il avait développées en suivant les enseignements de Michel Crozier et Henri Mendras à l’institut d'études politiques de Paris. Par sa formation, ses goûts, ses rencontres, ses écrits, sa réflexion et son action, Georges Pompidou, qui fut président de la République française du 15 juin 1969 au 2 avril 1974, après avoir été le Premier ministre du général de Gaulle du 16 avril 1962 au 10 juillet 1968, nous permet de mettre en lumière une préoccupation poétique au centre même du pouvoir. Il s’agit ici de la saisir dans toute son ampleur, de la suivre dans le développement d’une vie, de montrer comment elle chemine avec l’action politique et comment elle peut l’inspirer. Comme le note le Professeur Alain Pompidou dans sa préface, ce livre « s’attache à faire ressortir l’un des traits de caractère d’une personnalité dont les rouages sont actionnés par le sens du devoir accompli et une passion pour la poésie comme élément fondateur de l’expression culturelle : "l’art est comme l’épée de l’archange, il faut qu’elle vous transperce". « La poésie est, pour moi, la forme d'art la plus parfaite, en tout cas celle qui me touche le plus » Georges Pompidou. C’est un travail original qu’a réalisé Jean-Luc Pouliquen. En poète, il regarde Georges Pompidou aimer les poètes. C’était difficile et il réussit un livre dont l’intérêt indéniable fait qu’on le lit d’un trait et qu’on regrette alors de l’avoir si vite lu. Peut-être ceux qui ont vécu cette époque où le modernisme était impératif - à telle enseigne qu’il fait dire à notre ami le poète chanteur Jacques Ibanès que si Pompidou était allé au bout de sa volonté de bâtisseur, on ne pourrait ni flâner, ni rouler à vélo à Paris - reconnaissent cet engouement artistique qui régnait alors. La passion de Georges Pompidou pour l’art contemporain est celle d’un « honnête homme » dans le sens ancien, c’est à dire celle d’un homme de savoir, qui connaît la littérature. Cette qualité, qui était quasi générale chez les hommes politiques, s’est un peu perdue de nos jours avec cette accoutumance à la bouillie que nous servent les medias. La poésie ne peut être mâchée, prédigérée pour le consommateur comme dans les émissions télévisées d’informations ou culturelles. Elle oppose toujours ce miraculeux pouvoir de résistance au façonnement de la pensée. Georges Pompidou avait cette passion de la poésie. En lisant ce livre on sait qu’elle ne l’a jamais quittée. Loin d’être insignifiant, cet amour de la poésie met en lumière la personnalité exceptionnelle de l’homme sensible touché par la puissance de la langue et qui se réalisa en homme politique. Le Professeur Alain Pompidou conclut dans le même sens sa préface par ces mots : « Jean-Luc Pouliquen conforte ainsi l’image d’un homme érudit et engagé, sans rien sacrifier de cette inspiration poétique qui se situe au plus profond de lui-même. » Ce livre comporte des textes de Georges Pompidou sur la difficulté d’écrire son anthologie de la poésie et sur « Poésie et politique » une réflexion à la fois sur le politique et sur le poète. Eclairant ! L’émission « les poètes » reviendra avec l’auteur sur l’enseignement de ce livre « Georges Pompidou, un Président passionné de poésie ». L’émission est ensuite consacrée à Michel ECKHARD-ELIAL poète, traducteur, directeur de la revue et des éditions Levant qui présente son dernier ouvrage de traduction : Le baiser de la poésie 24 poèmes d’amour de Yehuda Amichaï et Ronny Someck Choix et traduction de l’hébreu par Michel Eckhard Elial éditions Levant ; couverture : gravure de Robert Lobet, à commander sur le site : https://editions-levant.net Dans Le baiser de la poésie, 24 poèmes d’amour de Yehuda Amichaï (1924-2000) et de Ronny Someck (né en 1951) sont réunis par leur traducteur français, Michel Eckhard Elial. Un choix qui établit, dans la rencontre de deux générations de la poésie israélienne contemporaine, la présence d’une filiation poétique et sa célébration de l’amour : amour du proche, qui est aussi l’amour du monde. Cette livraison constitue un numéro hors série de la Revue Levant
Michel Eckhard Elial est poète et traducteur de poésie hébraïque moderne. Il dirige la Revue Levant - Cahiers de l’Espace Méditerranéen, dont la vocation est de promouvoir un dialogue pour la paix entre les trois rives de la Méditerranée. Pour lui il faut pratiquer la Politique des poètes. Penser la paix est le rôle du politique, à l’intérieur et à l’extérieur de la Cité. Nous tenons, affirme-t-il, que notre Méditerranée porte, dans son devenir humain et poétique, cette « politique des poètes ». Habiter le monde en poètes, en continuant de porter l’étincelle du dialogue, tel fut l’itinéraire de Mahmoud Darwish, poète palestinien né en Galilée, et d’Alain Suied, poète juif né à Tunis. Ils illustrent bien que l’énergie du poète reste, malgré tout ce qui s’oppose furieusement à elle, celle de l’espoir. * Robert Lobet est artiste peintre. Il édite des livres d’artistes (Editions de la Margeride). * Dans la Bibliothèque du Levant : Michel Eckhard Elial, Exercices de lumière, 2015. Hagit Grossman, Poèmes d’amour, 2015 et 2016 (2 e édition) Diti Ronen, La maison qui revient, 2016 Soyons le changement - Nouvelles tendances dans la littérature italienne contemporaine, 2016 (coédition Euromédia) Matiah Eckhard, Lontani canti sacri di dove, Sono nato, 2016
* Michel Eckhard-Elial présente ce livre :
La poésie est une célébration.
Au cœur de la poésie, l’amour est un thème universel qui traverse, d’un bout du monde à l’autre, sa riche histoire. L’un des grands fleuves qui irrigue cette tradition naît dans la culture hébraïque et juive : du Livre des Livres aux poètes de l’Age d’Or espagnol. La poésie israélienne s’inscrit dans la continuité de cette tradition entrelacée d’échanges et de contacts millénaires avec d’autres cultures, d’autres langues en d’autres temps. Confrontée à la réalité politique et culturelle de la modernité d’Israël, elle s’intègre aux dimensions existentielles et collectives de l’histoire du pays, qui pose de nouveaux enjeux et de nouvelles frontières au projet poétique. La reconquête d’une langue et d’un territoire est un acte poétique majeur. Habiter ce territoire c’est affirmer amoureusement et difficilement son existence dans un espace aussi bien réel qu’imaginaire de tensions et de rencontres. C’est aussi à partir de cette parole reconquise parler au monde de sa présence et de ses attentes. Le poète a le devoir de rêver, et, à la manière du prophète aussi, de célébrer.
Dans leur voix et leur écriture propre, deux poètes hébraïques, des plus populaires parmi leur génération, Yehuda Amichaï (1924-2000) et Ronny Someck (né en 1951) portent l’éminent et bouleversant message d’amour au proche et au proche lointain du monde. Avec eux, c’est une rencontre de filiation : deux générations s’emboîtent le pas (des années 50 aux années 80), pour célébrer l’amour et la présence dans le pays d’Israël.
Il s’en suit un long entretien avec Saint-Paul autour du livre et de la vocation de paix de la poésie commune à tous les peuples.
Michel Eckhard-Elial brosse ensuite un portrait synthétique des deux poètes du livre :
Yehuda Amichaï
Poète national, si l’on en juge par la place centrale qu’il occupe dans l’institution et la culture israélienne, Yehuda Amichaï est né à Würzbourg, Allemagne, en 1924. Il réside à Jérusalem jusqu’à sa disparition en 2000. Internationalement reconnue et célébrée dans son pays, l’oeuvre d’Amichaï reçoit en 1982 le Prix Israël de Littérature.
Ses publications :
Poèmes de Yehuda Amichaï, Schoken, 2002-2004 (hébreu) The Poetry of Yehuda Amichaï, edited by Robert Alter, Farrar, Straus & Giroux, 2015 (anglais) Une première anthologie poétique en français (Poèmes) est publiée en 1985 aux Editions Actes-Sud ; elle est suivie de plusieurs recueils (Actes-Sud ; Gallimard). Ce sont les Editions de l’Eclat qui publient les dernières œuvres parues en français : Poèmes de Jérusalem, 1991 ; Début fin début et Les morts de mon père, en 2001. * Lecture d’extraits :
L’endroit où nous avons raison A l’endroit où nous avons raison, ne pousseront pas les fleurs du printemps. L’endroit où nous avons raison est piétiné, hostile comme le monde extérieur. Mais comme des taupes et les labours les doutes et nos amours rendent le monde friable. On entendra un murmure s’échapper de la maison qui a été détruite. * Comme une feuille je connais mes limites je ne veux pas m’épancher au-delà, m’unir à la nature, couler dans le grand univers. A présent si apaisé que je ne peux imaginer avoir crié un jour de douleur, comme un enfant mon visage est ce qu’il reste après qu’on l’ait taillé pour l’amour des pierres d’une carrière désertée. * Ne deviens pas une épine. Prends exemple sur les pleurs, le grain de blé, ou l’oblique de tes yeux : toi. Nous ne sommes pas immunisés contre le défaut des choses. Toujours partir. Monde de séparations, le cœur, les vêtements approvisionnent les valises. Quand nous élargissons jardins et visages, nous détruisons la règle des temps: futur et passé, mort et usage du temps, seul le sourire dans le sommeil compte. * Soixante kilos d’amour pur, conçu à la perfection qui se conçoit seule sans plan d’architecte, sans début ni fin, de féminité nette, passionnée, de génétique pure, indépendante: de cellules d’amour qui s’engendrent l’une l’autre. Ni l’environnement, ni les changements ne peuvent rien pour toi. Ils te rendent plus belle de l’extérieur, comme un soleil couchant; de l’intérieur, ils te chatouillent, te font rire. Je t’aime. * Cadeaux d’amour A ton oreille, à tes doigts, j’ai mis de l’or, l’or pour le temps, sur ton poignet. J’ai fixé beaucoup de brillants pour que tu glisses dans le vent en tintant doucement au dessus de mon sommeil. Je t’ai régalé de pommes, pour que nous nous roulions, comme dans le Poème, sur un lit de pommes rouges. J’ai caressé ta peau d’un tissu rose aussi transparent qu’un petit lézard, ses yeux sont un diamant noir dans les nuits d’été. Tu m’as permis de vivre quelques mois sans autre besoin de religion ni de vision du monde. Tu m’as donné un ouvre-lettres d’argent, mais de telles lettres ne s’ouvrent pas, on les déchire, elles se déchirent. *
Ronny Someck
Né à Bagdad, en Irak, en 1951, il étudie la littérature hébraïque et la philosophie à l’Université de Tel-Aviv, et le dessin à l’Académie d’art Avni. Il enseigne la littérature et anime des ateliers d’écriture. Il a publié 11 livres de poésie, des livres pour enfant et a été traduit en 41 langues. Il a reçu de nombreux prix dont le prix Yehuda Amichaï pour la poésie hébraïque. Figure populaire de la culture israélienne, il travaille avec des musiciens (Elliott Sharp, Yaïr Dalal). Ses œuvres graphiques (gravures, collages) ont été exposés au Musée d’Israel et aux Musée d’art israélien de Ramat Gan et Van Leer de Jérusalem.
Ses publications :
En traduction française : Nés à Bagdad – avec Abdelkader El Jannabi, Stavit, 1998 ; Constat de beauté, Phi, 2007 ; Bagdad-Jérusalem, à la lisière de l’incendie – avec Salah Al Hamdani, Bruno- Doucey, 2012 ; Le piano ardent, Bruno-Doucey (à paraître, 2017).
*
Pour moi, traducteur, explique Michel Eckhard-Elial, deux œuvres, à la croisée de deux générations, ont ensoleillé ces dernières années israéliennes : celles de Ronny Someck, qui - à l'égale de la poésie de Yehuda Amichaï -, couvre le champ de la culture et de l'expérience israélienne, et celle de Hagit Grossman qui porte le jeune avenir de la poésie contemporaine. On pourrait citer cette phrase de Hildegarde de Bingen : "J'ai entendu une voix émanant de la Lumière Vivante."
* Lecture d’extraits
Parce que les ouvriers du bâtiment caressent encore les briques de leurs mains, pour le baiser défectueux sur les épaules de la maison, parce que la clé de l'amour est toujours coincée sur la porte et que même un mur mal fait n'oublie pas les lèvres humides d'un baiser de ciment. *
Sa beauté Il me restait 21 mots pour décrire sa beauté. J’en avais déjà gaspillé 7, les autres sont cachés dans un bonnet qui dissimulera mon visage quand je viendrai dévaliser l’amour. *
Le monde est en feu, je l’aime En feu la laisse du chien qui m’a conduit aveugle dans un amour ancien, en feu le chacal qui hurle dans une chambre de soldate face à une porte fermée à clé, la queue de cheval derrière une nuque hollandaise, les lèvres où s’étale un lipstick canadien, en feu le glaïeul qui a griffé la tête d’une poétesse de Kiryat Ono, en feu les vers de celle qui a toujours écrit sur les roues du camion qui a fini par l’écraser, en feu le sol qui garde les traces de ma première danse, en feu la lune et ses dunes de sable, la tempête, la mer dont les vagues se mettent à genoux devant l’allumette qui met le feu aux poudres. * La revanche de l’enfant bègue Je parle aujourd’hui en souvenir des mots coincés dans ma gorge en souvenir des roues dentées qui écrasaient les syllabes sous la langue et sentaient la poussière des incendies entre le gosier et les lèvres noircies. Je rêvais alors de sortir les mots en contrebande comme des marchandises volées dans les cavernes de la bouche de déchirer les paquets de carton et extraire les jeux d’alphabets. Main posée sur mon épaule, la maîtresse me dit que Moïse lui-même bégayait et arriva néanmoins au Mont Sinaï. Ma montagne à moi était une fille assise en classe à côté de moi, aucun feu dans le buisson de ma bouche ne brûlait, devant elle, les mots consumés par mon amour. * Pour connaître l’âge du cheval. Poème d’amour C’est en regardant ses dents qu’on reconnaît l’âge du cheval. A six mois il a quatre molaires. A deux ans il en a six, et elles continuent à grandir jusqu’à ce que les dents définitives remplacent les dents de lait. A dix une fissure apparaît dans les dernières molaires, elle atteint la mi-longueur de la dent quand le cheval a quinze ans. puis dès la vingt-cinquième année elle se met à disparaître. Pour connaître l’âge de l’amour il faut regarder ses dents de lait. Une petite cicatrice indique ce qui a été abandonné ou retiré. * Réponse à la question : quand as-tu senti la première fois la force de la poésie ?
Alors que tous les soupirs n’avaient réussi à sortir un seul oui de sa bouche, je lus la « Lamentation pour Ignacio Sanchez Mejias ». Elle me prit le cou dans sa main qui essuyait une larme, approcha la tête le plus près possible. Oh Lorca, pensai-je, ce n’est pas juste, mais sans la chaux du poème versée sur les taches de sang du matador, je n’embrasserai pas cette fille à cinq heures de l’après-midi. Ses vêtements militaires étaient plus froissés que les falaises du canyon. que nous appelions empreintes flamenco du désert. Aux derniers rayons du jour échappés de la tête dorée du taureau, nous étions le dernier vers au moment de grâce de l’obscurité.
** |
|
Philippe
Dazet-Brun
10/11/2016
|
Christian Saint-Paul rend hommage au travail constant des éditions Cardère à Avignon qui publient également des livres de poésie. A signaler qu’une des dernières publications « L'enfant fini » d’Édith MSIKA, 136 pages, 12 €, est un récit d’une grande originalité et très remarquable de la part de cette auteure qui a publié « Une théorie de l’attachement » chez P.O.L. en 2002 et « Introduction au sommeil de Beckett chez publie.net en 2013. L’émission « les poètes » reviendra sur cette publication.
Au bord de l'Hudson à Manhattan, Jasper, né au moment où les tours du World Trade Center viennent d’être percutées, fasciné par l’Europe et la peinture hollandaise du XVIIe siècle, écrit dans son cahier pour ne pas oublier ce qu'il vit. Il y a aussi Clemence, supposément européenne, avec laquelle il invente quelques conversations où figure parfois un jeu d'échecs.
" Jasper aimerait bien reparler avec Clemence Valenti, en savoir davantage sur elle, pour cela il doit faire l'effort de l'inventer, comment pourrait-il réellement, et serait-elle là, à l'attendre, c'est absurde, comment ? " * Le dernier livre de poèmes publié aux éditions Cardère est : Poèmes sans amarres d’ Émilie DAVID, 56 pages, 12 €.
Dans une autre vie, j'étais un serpent nu, une chose sans corps, une vie sans armure… Auteur d’un blog sur le voyage, Émilie David cherche les clés de la liberté dans le mouvement (expédition, errance), la communication (non-violence), le ton (écriture). L’intuition dicte ses écrits, également traversés par des intrusions de Charles Baudelaire, André Breton, Sylvain Tesson, Jack Kerouac. Sa poésie du quotidien est celle qui s’offre au regard de côté ; elle aime les mots toilettés comme un dimanche… et jouer de l’accordéon.
Lecture d’extraits du livre.
Je rêve mon départ assise en jungle car. Les étoiles, mes aïeux, ont annexé mes yeux. Libre comme la voile d’une nuée d’étoiles Je libre l’énergie d’un cargo sans ami Vociférant jaguar s’enrouant sous la Lune La lumière est saphir, l’horizon est enclume Sifflez les morts! Oyez les gens! Trouez la mort! L’écran est mort. S’éteint l’histoire dans nos mémoires L’écran s’endort au crépuscule Fabule encore, éther et nue Choisis mon corps, le voici nu. Versez la nuit dans une chope et buvez-la sans petit-lait. La galaxie fuit doucement Souriez!
* Danser la vie sur le fil des nuages. Repousser l’aube, ignorer l’horizon. Et rire. Rire pour repousser la mort, et pour vivre plus fort. Tisser des liens de rire de toi à elle et de vous à nous. Narguer l’ennui dans un sourire, écarter le chagrin, oublier d’être sérieuse. Enfin. Et ramasser les éclats de rire, collectionner les instants de grâce et les fragments de glace. Le Petit Prince l’avait compris: « C’est véritablement utile puisque c’est joli. » Comme Thoreau, suivre scrupuleusement le journal du temps, noter les gouttes de pluie, surveiller la santé du vent. Soigner un rameau d’églantier. Rendre hommage aux peintres préraphaélites, baptiseurs de nuages. S’incliner devant le soleil, respecter le pèlerinage vers les cimes du temps. Et s’endormir. **
Christian Saint-Paul reçoit le Secrétaire perpétuel de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse, Monsieur Philippe Dazet-Brun élu en 2009 au 34ème fauteuil.
Il est Chevalier de l’Ordre national du Mérite, Chevalier des Palmes académiques. Docteur ès Lettres, professeur d’histoire contemporaine à l’Institut catholique de Toulouse, doyen émérite de la Faculté libre des Lettres et des Sciences humaines, ancien directeur-fondateur de l’Institut universitaire de langue et de culture françaises (IULCF). Ancien vice-président de l’Association universitaire des Facultés et d’Instituts de l’Enseignement supérieur catholique (AUFIESCA). Ancien directeur-gérant de la revue universitaire Chronique. IHEDN (169e session, Toulouse-Saragosse). Maître ès Jeux floraux. Responsable du Cercle de Poésie de l’Institut catholique de Toulouse et Président du Jury Paul-Jean Toulet.
Il est également membre titulaire de l'Académie de Béarn. *
Il brosse l’histoire de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse :
A l'origine, 7 troubadours.
A la Toussaint 1323, sept personnages, que l'on nomme depuis "les sept troubadours", mais qui étaient un damoiseau, Bernard de Panassac, un habitant du Bourg de Toulouse, deux changeurs, deux marchands, et un notaire, se réunirent avec les capitouls pour créer un concours de poésie, doté d'une violette d'or que les capitouls s'engagèrent à payer. Ce prix fut donné pour la première fois le 3 mai 1324.
Les suites de ce premier concours ne sont connues que trente ans après. Le caractère ludique n'a pas disparu, mais les Sept ont transformé ce qui n'était guère qu'un patronage en un véritable magistère, sous la forme gaiment simulée d'une institution universitaire, avec un chancelier, un bedeau-notaire et un massier. Deux nouvelles fleurs sont au concours, l' « églantine » (probablement une ancolie) et le souci. On charge le chancelier, Guillaume Molinier, de fixer par écrit les règles de la rhétorique et de l'art poétique. Il s'en acquitta en rédigeant un copieux ouvrage, précieux par les exemples qu'il donne, qui fournissent parfois des allusions aux préoccupations de l'époque (1356). Le siècle s'achève sur les derniers lauréats de langue d'oc.
Les comptes de la ville de Toulouse pour l'exercice 1388-1389 font état d'une dépense de dix sols payés à un peintre pour "l'inscription de dame Clémence":
"Item a pagat a Jacmes Mostier, pintre, per far le pitafle del portal de la gran porta e le pitafle de dama Clemensa, come apar per lo mandament que monta: X sols."
Plusieurs textes généralement liés aux comptes municipaux font état, au début du seizième siècle, de libéralités de cette dame Clémence et lui attribuent une fondation pour le paiement de trois fleurs annuelles, la violette, l'églantine et le souci.
Au cours du siècle, cette dame Clémence deviendra Clémence Isaure. Son gisant, relevé du cimetière de la Daurade, puis remanié avant 1549, après avoir orné le Consistoire, puis le salon octogone du Capitole où se réunissaient les mainteneurs jusqu'à la fin du XIXe siècle, domine de nos jours la salle des conférences de l'Hôtel d'Assézat. Le Collège de rhétorique
Le seizième siècle verra la disparition de la poésie occitane : les derniers poèmes en oc seront couronnés en 1513. Les Sept du Gai Saber sont devenus le Collège de la Gaie science, puis le Collège de rhétorique.
Les travaux de la compagnie sont connus par le Livre rouge, qui conserve, après une lacune initiale, les comptes-rendus des séances de 1513 à 1641 et les pièces primées.
Avec le temps, les mainteneurs seront de plus en plus cooptés parmi les membres du Parlement, qui auront souvent à s'opposer à une désignation par les capitouls, en se prévalant d'un testament de Clémence Isaure qui ne sera jamais montré. Les capitouls ne pouvaient guère le contester, puisqu'il leur permettait de garder dans leur budget un petit chapitre ludique qui échappait à la rigueur du fisc royal.
Le Collège décerna des récompense exceptionnelles à des poètes de renom, comme Baïf, Maynard, Ronsard ou Robert Garnier, et recruta toujours quelques hommes de lettres à côté des hommes de loi.
Les poèmes récompensés pendant cette période sont entachés d'un académisme pesant. Les formes en sont le Chant royal et l'Ode, le style un véritable amphigouri.
De cette époque date un cérémonial dont la plupart des éléments subsistent de nos jours. Le 1er avril a lieu la Semonce, au cours de laquelle les membres du Collège somment les Capitouls (la municipalité) de faire les frais de la fête. Ceux-ci répondent qu'ils « feront leur devoir ». Le 3 mai sont distribuées les trois fleurs et reçus maîtres les poètes qui ont été récompensés trois fois. Les fleurs ont été déposées à l'église de Notre-Dame de la Daurade, d'où elles sont amenées au Capitole en procession.
En 1549 apparaît une ballade de Pierre de Saint-Aignan sur l'épitaphe de Clémence Isaure, et en 1557 un sonnet de Pierre de Garros lui est dédié. Mais son éloge ne deviendra rituel qu'au XVIIe siècle, et sera laissé à un étudiant, qui le prononcera parfois en latin. A la suite des troubles qui mettront la ville à feu et à sang en 1562 apparaît l'ode à la Vierge.
Les membres du Collège donnèrent par ailleurs l'exemple de la sérénité. Les Jeux ne furent supprimés et les fleurs déposées près des Corps saints de St-Sernin que trois fois au cours du siècle. Deux mainteneurs furent victimes de la populace : Jean de Coras pour les protestants et Étienne Duranti pour les catholiques.
Le XVIIe siècle pousse l'académisme jusqu'au ridicule. Les fleurs ne récompensent que le Chant royal ; l'éloge de Clémence Isaure ne gagne rien à être rituel, et n'a d'ailleurs pas les honneurs du Livre rouge. A cette médiocrité fait pendant un cérémonial excessif, pimenté de querelles de préséance. A côté de l'élection apparaissent les résignations et les survivances. Le jugement, par ailleurs, est l'aboutissement de trois jours de banquets et de beuveries.
L'Académie :
Par lettres patentes du 26 septembre 1694 était créée une académie de 36 mainteneurs qui par la suite devinrent quarante, et de maîtres de l'un et l'autre sexe, chargés de perpétuer les traditions remontant à 1323, mais aussi de se consacrer à des travaux réguliers.
L'Académie conserva pieusement l'héritage du passé, et de nos jours les mêmes fleurs sont décernées le 3 mai après un choix rituel et avec un cérémonial plusieurs fois séculaire. Mais l'intervention royale apportait un changement et un progrès.
Le changement était, avec le nombre de membres, la tenue de séances régulières au cours desquelles les mainteneurs présentaient des travaux sur un sujet de leur choix.
Le progrès était l'impression d'un Recueil annuel des poésies primées, qui jusque-là n'étaient qu'enregistrées dans des registres internes. Sa diffusion donnait aux Jeux une audience nationale, Sa collection, de la fin du XVIIe siècle à l'heure présente, permet de saisir l'évolution du goût et de la mode dans la création poétique.
L'habitude prise à la Renaissance de distinguer des poètes célèbres qui n'avaient pas concouru se perpétuait par la désignation de maîtres. C'est ainsi que Voltaire fut nommé maître en 1747, Marmontel en 1749.
Pendant près d'un siècle, la nouvelle académie n'eut à récompenser que des œuvres qui de nos jours ne sont plus guère lisibles. Voltaire, avec ingratitude, raillait "Toulouse, avec son ridicule recueil des Jeux floraux et ses Pénitents des quatre couleurs". Mais ses propres vers sacrifiaient à la même grandiloquence. Ces défauts étaient aggravés par le recrutement des mainteneurs, pris en général dans la noblesse de robe, qui se cooptaient quand ils ne résignaient pas leur dignité à un membre de leur famille.
Les trois capitouls-bayles avaient été conservés, ainsi que la Semonce d'avoir à payer les fleurs, mais les magistrats municipaux multipliaient les querelles d'argent ou de préséance. Par un édit d'août 1763, Louis XV codifia dans le moindre détail un mélange d'anciennes pratiques et de règles nouvelles, qui régit encore de nos jours le recrutement des membres de l'Académie, son fonctionnement interne et le cérémonial de l'attribution des fleurs.
Un instant supprimée par la Révolution, l'Académie fut rétablie par le Consulat et vit sa composition simplifiée par la disparition des capitouls-bayles et du Chancelier. Ce dernier fut remplacé par le Préfet de la Haute-Garonne, mainteneur de droit, tandis que le Maire de Toulouse avait également un fauteuil réservé.
Le romantisme et la mode du genre Troubadour furent bénéfiques pour l'Académie. Victor Hugo, récompensé à dix-sept ans, était maître en 1820. Chateaubriand le fut en 1821, Baour-Lorman, un toulousain, en 1824, Chênedollé en 1827. Divers membres de l'Académie s'attachèrent à lire et à publier les vieux manuscrits de l'Académie, tandis que le goût de l'époque pour les faux faisait apparaître des registres imaginaires de poésies vantant Clémence Isaure.
Frédéric Mistral fut nommé maître en 1878, mais il fallut attendre 1895 pour que fussent rétablis les prix de poésies en langue occitane.
En cette fin de siècle, l'Académie eut à souffrir de la démolition d'une partie du vieux Capitole, où elle était hébergée, avec la statue de Clémence, dans le "salon octogone". Elle fut logée au Conservatoire, mais il s'avéra vite que la municipalité ne lui assignerait pas de local convenable. Un mécène, le banquier et mainteneur Ozenne, acheta et fit restaurer l'hôtel d'Assézat, un chef d'œuvre de la Renaissance, et en fit don à la Ville, à charge pour celle-ci d'y abriter les Académies, et au premier rang celle des Jeux floraux, l'hôtel prenant le nom d' « hôtel d'Assézat et de Clémence Isaure ».
Récemment, les Académies ont dû partager les lieux avec le Musée Bemberg, en échange d'une rénovation de leurs locaux. Celle-ci n'a pas affecté l'Académie des Jeux Floraux, dont le Salon blanc date des années 1760. *
L’entretien mené sur l’histoire ce cette prestigieuse et vénérable Académie, la plus ancienne d’Europe, est émaillé de lecture de poèmes de Simone Alié-Daram, maître-ès-jeux ainsi que de l’audition de poèmes mis en musique par Gérard Zuchetto de Franc Bardou, également maître es-jeux. *
Je cherche le vent du fleuve Dans l’entonnoir du blues de dix huit heures Je ne veux pas ressusciter Je ferai des fleurs comme une plante en souffrance Au milieu des chameaux et des bœufs ambulants Des fleurs poèmes que je t’offrirai les mains nues Que tu éparpilleras sur les hétaïres de passage. Flûtes et larmes aigües Vibrations glaciaires Accroches bleues Je pleurerai de vous mes hommes au loin Combien de sons combien de transparences Avant que je m’effondre Des meurtrissures données de vous ? * Est-ce que l’amour s’oublie Est-ce que les cœurs cassés se plâtrent Est-ce que les fêlures se spiralent en gouffres ? Je n’ai plus ni mains ni bouche Je ne suis qu’une transparence Qui voudrait te suivre en haut là-bas.
Simone Alié-Daram « Désinvolte Eros » Poésie , 10 € ** Matin verd
Benlèu per un matin mai verd, benlèu pel respir del desèrt, passarem beure l’aura fera de l’autra man de la grand sèrra.
Benlèu per un ausuèlh mai blau, benlèu per i trapar tresaur, passarem fugir la misèria de l’autra man de la grand sérra.
Benlèu per un dieu mai gadal, o per amor, son fuoc brandal quitarem de somiar ço qu’èra de l’aura man de la grand sèrra.
Benlèu per un solelh mai caut, benlèu per un palais tan naut, passarem culhir lo mistèri de l’autra man de la grand sèrra.
Franc Bardou
* Rectus
C’était terre de blé, de miel Son sang de vin, cheveux de vent, Monts pour élever jusqu’aux cimes Tout amour de l’Autre et de toi, C’était ma terre, satisfaite De n’être que ce qu’elle devait être.
Dans sa chair mère, je semai Le plus humble des luminaires Qui, entre Torah, Coran et Bible Germait, langue des origines.
Inversus
Me voilà de boue, de poussière, Brut acier d’armes et de mort, Couteau luisant de sacrifice, Pierre rude, pavé lancé Rugissant contre les hordes De corbeaux à travers les rues.
Tu m’as là, caillou rouge sang, Cri ultime à la face du monde Sans espérance ni désir Que d’en exploser la folie.
Franc Bardou, extrait de « Lai out non l’esperavas pas / Là où tu l’attendais le moins » traduction française de l’auteur. **
Philippe Dazet-Brun expose l’organisation des travaux de l’Académie. D’abord, les membres se réunissent en séances privées au cours desquelles sont présentées leurs communications. Ensuite, les séances publiques s’adressent à un large public reçu dans la salle Clémence Isaure pour des conférences données par les Académiciens ou par des intervenants extérieurs, généralement des personnalités prestigieuses. De la même manière, l’Académie organise à l’Hôtel d’Assézat des colloques sur un thème littéraire ou culturel. C’est ainsi que le samedi 19 novembre 2016 aura lieu le colloque : " Les Jeux floraux et la culture en Languedoc" avec au programme :
14 h 45 Mot d’accueil de M. Philippe Dazet-Brun, Secrétaire perpétuel de l’Académie
- 15 h 00 M. Jean-Claude Maestre, Premier Censeur de l’Académie. La Compagnie du « gai savoir » : la renaissance de la poésie en langue d’oc.
- 15 h 30 M. Jean-François Courouau, Maître de Conférences à l’Université Jean-Jaurès Avant et après Godolin : les Jeux floraux et l’occitan (XVIe – XVIIe siècles).
- 16 h 00 M. Pierre Bouyssou, Secrétaire aux assemblées de l’Académie. Un Languedocien méconnu : Simon de La Loubère, mathématicien, ambassadeur de Louis XIV au Siam, agent secret en Espagne et au Portugal, académicien, réformateur des Jeux floraux. PAUSE
- 16 h 45 M. l’abbé Georges Passerat, Bibliothécaire de l’Académie. Le rôle des Jeux floraux au réveil de l’Occitanie : Félibres et mainteneurs main dans la main !
- 17 h 15 M. de Laportalière, Second Censeur de l’Académie. Un mainteneur des Jeux floraux, promoteur de culture en Languedoc : Mgr Loménie de Brienne.
- 17 h 45 M. Laurent Stéfanini, Ambassadeur, délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO, Maître ès Jeux floraux Unesco, Occitanie et Patrimoine mondial de l’Humanité.
Enfin, l’Académie des Jeux Floraux remet chaque année, le 3 mai, ses prix lors d’une séance solennelle dans la Salle des Illustres du Capitole, l’Hôtel de Ville de Toulouse.
Le Secrétaire perpétuel conclut sur l’importance des deux notions fondamentales qui animent l’Académie : le maintien de la tradition littéraire depuis les troubadours et le rayonnement de la littérature et de la culture d’aujourd’hui. Le prix de la chanson poétique initié par le regretté Docteur André Bes, est une synthèse de ces deux vocations : maintenir, les troubadours chantaient leurs vers ( lo canso), et s’inscrire dans la contemporanéité qui fait une large place à la chanson.
L’Académie est fidèle à sa mission de maintien mais elle ne se complaît pas dans le passé qu’elle honore, elle est de plein pied dans le présent. « Nous respirons dans le temps qui est le nôtre » assure le Secrétaire perpétuel.
L’émission s’achève sur la diffusion d’un poème de Franc Bardou mis en musique et chanté par Gérard Zuchetto, publié par Troba Vox : « Poètes du Sud, Gérard Zuchetto, Sandra Hurtado-Ros, « Chemin tournant ». |
|
3/11/2016
|
Les éditions Ad Solem ont réservé une collection Poésie. Il convient comme il se doit de saluer ces éditions qui se présentent elles-mêmes ainsi : « Ad Solem, « vers le Soleil » : un nom, un esprit aussi, résolument tourné vers la « Lumière qui éclaire tout homme en ce monde ». Depuis quinze ans, chacun de nos livres veut à sa manière être un éclat, une étincelle pour faire rayonner le sens, un espace entre le monde et Dieu, pour permettre la rencontre du Verbe à travers les mots. Rencontre directe, par le biais de la littérature spirituelle, où l’écriture essaie de faire partager le mystère d’un face à Face. Rencontre indirecte, par la réflexion théologique ou l’expression poétique, qui essaient chacune à leur manière, comme les deux supports de l’échelle de Jacob, de se rapprocher de la source de toutes choses – de la Parole. Pendant quelques instants, le temps de lire une ligne ou une page, le lecteur abandonne sa volonté propre pour suivre la trace laissée par les mots sur la surface de la page. Moments de communion avec l’auteur, connu ou non, avec un frère en humanité dont les mots veulent réveiller en nous le désir de l’éternité inconnue. On ne ressort jamais le même de la lecture d’un livre. Comme la nourriture, comme l’eucharistie, les mots entrent en nous et nous changent. Entre le livre et le lecteur, nous sommes là, pour préparer le chemin typographique qui doit permettre cette rencontre avec le Verbe, qui s’est fait écriture dans le Livre; qui s’est fait homme en Jésus-Christ. Si l’édition est un art, elle est aussi un métier. Un savoir-faire qui doit communiquer un savoir-vivre. Le livre, pour nous, n’est pas un moyen parmi d’autres de transmettre savoir et sagesse. Si le codex a remplacé le volumen aux premiers siècles du christianisme, c’est que sa forme exprimait symboliquement le contenu de la foi dont son apparition est solidaire. Au déroulement infiniment répété du rouleau a succédé l’arrêt sur la page, la fin de la ligne. Au cycle de l’éternel retour a succédé la Nouvelle et éternelle Alliance, qui met fin non à l’histoire mais à son déroulement linéaire. Est-ce un hasard si aujourd’hui, dans une société déchristianisée, les textes se déroulent sur l’écran des ordinateurs ? Culturellement, nous sommes revenus à la civilisation du rouleau. Dans ce contexte, la nouvelle évangélisation est aussi une nouvelle civilisation. Elle doit se déployer dans deux directions : vers les hommes d’abord, mais aussi vers les formes culturelles, par lesquelles depuis l’origine des temps l’homme accède à son humanité et en même temps laisse la trace de sa quête d’éternité. Parmi ces formes, le livre occupe une place privilégiée. Lieu de la mémoire, du temps retenu, il est aussi pour le lecteur croyant mémorial de la Présence. La lecture devient alors exercice spirituel. Comme l’a écrit le poète du Verbe silencieux,
« Il se tait Ces vers de Jean-Pierre Lemaire condensent l’esprit qui préside à nos choix de publication, comme à celui de notre travail éditorial. » Dans cette belle collection, l’émission « les poètes » fait entendre ce soir par le truchement de la lecture, les voix d’Anne Goyen, de Janine Modlinger et de Gérard Bocholier. Anne Goyen fait paraître « Paroles données » préface de Gérard Bocholier (Ad Solem collection Poésie , 95 pages, 19 €.) Anne Goyen a longtemps enseigné la littérature française. Elle partage aujourd'hui sa vie entre la poésie, le dessin et la musique. Arbres, soyez était son second recueil de poèmes, le premier ayant paru en 1998 aux éditions Saint-Germain-des-Prés. Dans ce précédent livre, la poète contemple fréquemment les arbres de sa région, arbres auxquels elle accorde d’être bien plus que de simples végétaux, à la fois des axes de vie et des symboles de ce qui est dans le réel. Elle le sait bien, elle, Anne Goyen, que « les arbres sont les plus vieux amis des hommes », ainsi que le dit la quatrième de couverture de ce recueil de toute beauté. Il y a beaucoup à apprendre des arbres, en les regardant ou en posant simplement la main contre leur bois. Ils sont enracinés dans le sol et tendus vers le ciel, la base dans la terre et la tête dans les étoiles. Nous sommes peut-être des arbres, la supposition parcourt souterrainement l’ensemble du livre. À moins que ce ne soit le contraire, que les arbres soient des humains, des parties de nous peut-être. Sans doute s’agit-il des deux, comme en une forme de réciprocité elle aussi complémentaire. Le dernier recueil de poèmes « Paroles données » est celui d’une âme touchée par le souffle d'éternité qui fait entendre la parole délivrée par son propre souffle. La quatrième de couverture qui reprend la préface de Gérard Bocholier avertit : Feu vivant né du cœur / Si tes mots étaient vrais / Ils brûleraient la page.
Une quête exigeante et inquiète attise
la flamme du poète "en mal de ciel", claire et sombre à la fois, comme ces
beaux arbres que le livre précédent de Anne Goyen, Arbres, soyez,
célébrait. Quelque chose de ce que certains écrits spirituels appellent
une "âme avancée" résonne dans ce recueil. Une âme touchée par le "souffle
d'éternité", qui fait entendre dans ces pages la parole délivrée par son
propre souffle en écho - parole qui est un Amen, un Oui d'accueil et
d'amour. Qu'est-ce de nous / Qui se creuse / Pour qu'au fin fond / Vienne habiter L'Hôte ? Comme précédemment dans sa contemplation des arbres, Anne Goyen recherche le divin et le loue dans « chaque parcelle de réalité » pour citer la belle expression de Gérard Bocholier. Les « paroles données » sont paroles rapportées et paroles de joie. Ces paroles se révèlent à tous ceux qui savent écouter. Anne Goyen nous en avertit déjà par les citations qu’elle met en exergue du livre, dont celle, explicite d’Angelus Silesius : « Ne crie pas vers Dieu, car la source est en toi ; / Si tu n’en combles l’issue, elle coule à jamais. » Ne pas combler l’issue, se sentir les « Invités éblouis / De la vie » telle est la vocation de l’auteure qui appelle à la suivre dans cette posture où la joie sereine comble le vide. Sa poésie de contemplation se double d’une poésie de jubilation, l’une étant la conséquence de l’autre. Ce que le lecteur perçoit, au delà du plaisir de la langue, de l’art, c’est une raison en faveur de la quiétude ; c’est un souffle d’espérance. Lecture d’extraits.
Mon chant provisoire Soupir ou murmure Pour conjurer Le péril des jours Et faire obole A l’univers. * Du silence A la parole Comment Renaître neufs Ensemble ? * Parole faite chair Dans notre nuit Souffle divin Langage d’homme
Arbre du monde Où toute feuille Est louange Où tout fruit Est mystère
Silence Au cœur de l’arbre Aubier de grâce Effacement du grain D’où jaillira la vie
Silence d’homme A l’écoute Pour cheminer Des profondeurs Jusqu’à la source. * LE POETE
De main divine A ton insu s’opère L’enfantement Où tu n’es autre Qu’un messager Brûlant du feu Qui t’a créé. * En réponse A nos profanations Nos faux-semblants Le lumineux sourire De la beauté Sa secrète brûlure Qui réveille Dans nos silences Une flamme En mal de ciel. * Et je vais Vers un Dieu A qui mon regard Donne visage Celui de chacun Et de tous Quand tombe le masque Des idoles. * Janine Modlinger fait paraître, toujours aux éditions Ad Solem, « Beauté du presque rien », 75 pages, 19 €.
Janine Modlinger a longtemps enseigné à Paris. Son premier recueil, Eblouissements, a paru chez Ad Solem. Des extraits de ses Carnets ont paru dans la revue Arpa.
Voici ce qu’en dit Paul FARELLIER de la revue « Les Hommes sans Epaules » : « Si elle ne laisse guère passer de jours sans écrire, Janine Modlinger (née en 1946) publie peu (Veille, L’Harmattan, 1998 ; De feu vivant, Éclats d’encre, 2008; Une lumière à peine, Carnets, Éditions de l'Atlantique, 2012 ), ne semblant s’y résoudre que sous la bienveillante pression d’amis ou de proches. Mais des inédits circulent, parfois une rencontre-lecture réunit des fidèles. De nouveaux recueils ne tarderont sans doute pas à paraître, dans la foulée de ces récents Carnets, Une lumière à peine, dont nous avions dévoilé quelques extraits dans Les HSE 28 (2009). Parmi ceux qui ont remarqué l’authenticité de cette voix, nous citerons Anne Perrier, Georges Haldas, Gérard Bocholier, Henri Heurtebise, Josette Ségura, Jean Bastaire et Robert Marteau. Celui-ci, dans son prière d’insérer de Veille, soulignait que Janine Modlinger « ne force pas sa voix, n’impose pas ses vues : à pas comptés, […] elle va à l’écoute de la musique née de la solitude et du silence. » Cette œuvre, si on veut bien l’approcher avec l’attention recueillie qu’elle mérite, recèle pour son lecteur comme une sorte de chance : chance de renaître à soi-même dans la parole d’autrui, chance d’éprouver cet étonnement d’une retrouvaille inattendue. Ce poète, pourtant, ne cesse de dire «Je», mais ce «Je» est partout en fusion totale avec la lumière du monde, si bien que l’aventure de ce «Je» devient aussitôt la nôtre, à la fois enjeu et garantie de notre propre étrangeté. Loin que sa confession permanente nous rejette dans le désert d’une altérité, nous sommes fraternellement accueillis dans ce «Je». »
La quatrième de couverture de « Beauté du presque rien » résume :
C'est comme la parole lorsqu'elle vous traverse. On ne sait rien. On l'écoute. La parole "parle" dans le poème. Dans la prière aussi. Il faudrait se la représenter par cette image qu'emploie Janine Modlinger pour évoquer ce geste vers l'autre : la parole comme des "mains du silence". "Tel l'oiseau qui fulgure, tel le regard de l'aimé, quelque chose de ténu et d'insistant nous annonce la Présence". Après Eblouissements, Beauté du presque rien recueille ces éclats de la Présence perçus dans un instant, une rencontre, un visage - un paysage. "Presque rien" : c'est ainsi que nous découvrons le passage de l'Autre, dans l'écart de la distance que la parole cherche à rattraper. Un peu comme Maurice Blanchot, Janine Modlinger invite son lecteur à faire "ce pas au-delà" du nom donné, jusqu'à cet état que l'on appelle prière : pour que dans les "mains du silence" la Parole vienne se poser. Elle s'approche, c'est comme si elle connaissait ce geste depuis toujours.
Janine Modlinger a mis en exergue dans un de ses poèmes, cette si belle phrase de Paul Celan : « Je ne vois aucune différence entre une poignée de mains et un poème. » Elle qui avoue : « Dans l’enfance déjà, le monde m’avait sauvée », n’en finit pas de s’émerveiller ; pourtant elle ne s’épuise pas à en chercher le mystère : « On ne sait rien de la beauté. Il en sera toujours ainsi. Nous devons veiller sur cette ignorance ». Pourquoi chercher, alors que s’impose l’évidence ? « Tel l’oiseau qui fulgure, tel le regard de l’aimé, quelque chose de ténu et d’insistant nous annonce la Présence. » Cette Présence la comble de joie. Beauté et joie partout ! L’amour pour celle qui rayonne de la chaleur de cette Présence, est forcément simple. Cette simplicité fait la force de ce livre. A contre-courant de tout pathos, de toute déploration, de tout combat certifié juste, qui définissent la production poétique de notre période troublée (comme toutes les périodes pour qui sait avoir du recul), elle bâtit une œuvre d’apologie de la vie, dominée par la Beauté. A nous, d’apprendre la joie. De savoir l’accueillir, de ne pas manquer son passage : « Si grande est la joie. Nous ne savons pas la porter. » Il faut laisser advenir. A l’origine de la joie : « l’Arche Sainte de la parole divine ». Le Livre. « Rien ne nous détournera de la promesse » assure-t-elle.
Lecture d’extraits.
Ce rien - mais comment le savons-nous - est lieu de haute flamme.
Il y aurait là-bas, à l’horizon de tout visible, quelque forge inconnue, seulement pressentie, d’où tout rayonne. * L’invisible, comme une prière approchée. Ce sont des sables murmurants, allongés entre ciel et mer. C’est le monde grand ouvert. C’est une phosphorescence humble et pauvre.
Un dieu peut-être, caché entre ces sables, saurait me dire d’où vient la joie.
La joie, devenue folle à force de ne pouvoir se dire. On s’éreinte à parcourir ces espaces d’où viendrait, un jour, le mot juste.
Joie ailée, murmurante. Joie comme des larmes. Joie comme une eau qui lave, espiègle, rapide, glissant vive entre les coins du corps.
Seulement cela, peut-être : balbutier. * Ecoute ce chant qui ne cesse. Ecoute cet invisible qui chante.
Ce chant de pauvreté. Ce jour où je tombe, jetée loin du chant.
Jetée, reliée à la douleur.
Toute parole est de trop. Tout silence aussi. *
Empoignée par le deuil. Déployée par la joie. Est-ce pour cela que je cherche la Source ? Un brin d’herbe, venu de Source, suffit à ma joie. * Tous ces arpents de terre que nous avons foulés. La haute besogne du vivre ! * Je vais, je viens, dans ce périmètre nu. La folie du vent me secoue. L’ivresse me prend au détour. Le poème surgit à pleins poumons, pour tenter de dire. * Nous ne savons rien. L’amour sait à notre place.
Tout en ce monde est une question d’écoute, de silence, d’amour. * Gérard Bocholier publie, toujours aux éditions Ad Solem, « Nuits » Poésie, 80 pages, 19 €.
Gérard Bocholier est né à Clermont-Ferrand en 1947 dans une vieille famille de vignerons de la Limagne, originaire de Monton (commune de Veyre-Monton, dans le Puy-de-Dôme) et est franc-comtois par sa famille maternelle (Les Fourgs, dans le Doubs).Il a passé son enfance et son adolescence à Monton, que les poèmes en prose du Village emporté évoquent avec ses habitants. La lecture de Pierre Reverdy à qui il consacrera un essai détermine en grande partie sa vocation. Il reçoit en 1971, des mains de Marcel Arland, directeur de la NRF, le prix « Paul Valéry » réservé à un poète étudiant. Agrégé des lettres la même année, il a enseigné d’abord 4 ans à Aurillac avant d’être nommé professeur en hypokhâgne au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et conseiller pédagogique. Il a participé en 1976 à la fondation de la revue de poésie Arpa, dont il est directeur depuis 1984.Des rencontres ont éclairé sa route: celle de Jean Grosjean, puis de Jacques Réda, qui l'accueillent à la NRF, dont il devient chroniqueur régulier de poésie à partir des années 90, mais aussi l'amitié affectueuse d'Anne Perrier, poète de Suisse Romande, Grand Prix National de Poésie en France, dont il préface les œuvres en 1996. Il se consacre à une œuvre poétique et critique, tout en collaborant à de nombreuses revues littéraires : Revue de Belles Lettres (Genève), Chemin des livres, NRF, Thauma, Patchwork... Depuis 2009, il se consacre essentiellement à l'écriture de "psaumes". Le premier volume, préfacé par son ami Jean-Pierre Lemaire, paraît en 2010 chez Ad Solem, le deuxième volume en 2012 avec un envoi de Philippe Jaccottet. Il a publié trois livres numériques: L'Ordre du silence (extraits de deux livres anciens épuisés), La marche de l'aube (poèmes inédits), ainsi qu'un essai, Les chemins tournants de Pierre Reverdy, en 2014 et 2015 sur le site Recours au poème Il tient une chronique de poésie intitulée Chronique du veilleur sur le même site internet Recours au poème. Il est membre du jury du prix Louis-Guillaume. Il collabore à l'hebdomadaire La Vie dirigé par le poète Jean-Pierre Denis, comme critique de poésie.
De ses nombreuses publications, citons les dernières :
Psaumes de l'espérance, Ad Solem, 2012 Le Village emporté, L'Arrière-Pays, 2013 Passant, La Porte, 2014 Le poème exercice spirituel, Ad Solem, 2014 Figures et miracles, bois gravés de Clément Leca, La Fenêtre ouverte, 2015 Chant de patience, gravures de Philippe Chassang, Les Cahiers des passerelles, 2016 Les Etreintes invisibles, L'herbe qui tremble, 2016 Nuits, Ad Solem, 2016 Les chemins tournants de Pierre Reverdy, Editions Tituli, 2016.
La quatrième couverture de « Nuits » nous guide : Après deux recueils "psalmiques" (Psaumes du bel amour et Psaumes de l'espérance), Gérard Bocholier découvre dans Nuits ce qui constitue l'horizon poétique en même temps que spirituel de son écriture. Pourquoi "nuits" ? Parce que la vraie Présence se donne dans l'absence - dans une "nuit d'Emmaüs" -, dans le retrait qui appelle la parole et la laisse comme suspendue devant ce qui s'est évanoui à peine donné. A peine nommé. "Nuits", parce que c'est à travers l'interstice de nos blessures qu'entre le Consolateur. Promesse de toutes nos résurrections -"nuit de Saul". Là résonne toute parole vraie.
La nuit est celle de Saul en route vers Damas ; sa chute de cheval et cette obscurité qui va l’aveugler et dans laquelle il découvrira la vraie lumière, lui qui était tout ébloui des ténèbres. Saul réconcilie la lumière et les ténèbres. Sa chute fait de lui, le grand initié de Dieu. La nuit le retient mais il « va devoir traverser / L’immense page de lumière / Ecrire sur elle / Ce qui se lève / Dans l’invisible ». L’écriture de Gérard Bocholier est puissante, virile. Resserrée, elle n’en demeure pas moins essentiellement lyrique. On s’attend à l’épopée avec un telle aisance dans l’émotion sans emphase, et elle arrive avec la « nuit de Saul ». Il mêle, avec une dextérité de langage qui en fait un des plus grands poètes de langue française, la trivialité des scènes de la vie rustique, à l’énonciation d’intuitions mystiques les plus bouleversantes. La nuit est toujours celle de la paille et de la poutre. Apprendre à voir, à connaître, à se connaître, telle est la leçon de la nuit. Et dans la nuit, « Saisir un peu / Du feu de joie » qui nous est tendu. Savoir accueillir ce qui nous est tendu sera le sens du long voyage qu’à l’instar de Saul, tout homme, tout cherchant de lumière, devra entreprendre en terrassant sa peur et son angoisse pour aller au bout de lui-même. L’espérance pointe son nez vainqueur dans ce livre, qui n’est pas l’achèvement d’une seule poésie de célébration, mais au contraire celle d’une louange de la liberté de faire, de suivre la voie divine avec effort et sacrifice. Dans cette réalisation, l’homme devra « serrer les mâchoires ». Rien ne se donne sans éveil. Les « Nuits » aussi nous éveillent et elles nous ouvrent à la miséricorde.
Lecture d’extraits.
Comme il est bien Le chevrier près de ses bêtes !
Son vieux chien Reprend sa course en dormant
La fourche des vents soulève Au fil des herbes Toute une fièvre
Un incendie D’air et de neige *
Le feu n’avait aucun regard Pour les éteules sous les ombres
La paille soudain s’embrase La grange en deuil Le ciel tournant
Le sel des astres Crépitant *
Ô nuit Vieille nourrice J’aime ta chanson de silence Sur tes genoux j’ai posé ma tête close
Ô nuit Je veux tes mains creusées D’humble source Non pour l’oubli Mais pour la route *
La nuit me retient Comme un enfant qui va tomber Plus tard monte l’essaim de l’aube Avec la rumeur du troupeau Ebaudi sur le seuil
Il va devoir traverser L’immense page de lumière
Ecrire sur elle Ce qui se lève Dans l’invisible *
Mon voyage est plus long Plus dur que ceux des bêtes Massées derrière les portes
Cette voix qui appelle Traverse le rocher Désarçonne les pins
Bien après vibre encore Sa nervure secrète Sa musique tremblée De lueurs sur les eaux *
Il n’est pas d’eau pour cette soif Pas de plage pour cette course Qui me pousse au bout de moi-même
Je serre les mâchoires Sur ce très long vertige Où rien ne me ressemble Sinon la chaux des murs La pierre du tombeau *
Puisqu’il faut de la nuit Pour naître avec le feu Une tombe au mitan De la terre en sommeil Puissé-je aller au bout De ce corridor sombre Où vacille une lampe Si petite Et si frêle *
J’ai besoin de la nuit Pour m’ouvrir à l’averse Des plus infimes grâces Comme on s’attache au cou D’une ombre sur le seuil Qui ne sait que répondre A l’ami inconnu Qui voudrait tant qu’elle entre Et partage le pain De la miséricorde * Le silence est mon maître La nuit est ma maîtresse Ta parole ô mon Dieu Brûle avec ton silence Il vibre dans l’étau Tend la corde au secret
Il continue en moi sa quête de racines Je ne tiens que son fil dans la ville interdite Je sais où il m’entraîne Plus fort que la douleur
Tout ce que j’ai appris de vrai lui appartient En lui je bois le plein aveu de la lumière *
Enfin l’émission s’achève sur la lecture du poème « Le Christ après la crucifixion » de Sayyâb, poète iraquien (1926 - 1964) extrait de son livre « Le Golfe et le Fleuve » poèmes traduits de l’arabe par André Miquel aux éditions Acte Sud.
[ ...] Hier, je me refermais, comme une pensée, comme un bourgeon. Sous mon linceul de neige se gonflait une fleur de sang, et j’étais comme l’ombre entre les ténèbres et le jour. Mais ensuite, de mon âme explosée j’ai tiré des trésors, je l’ai dépouillée comme autant de fruits. Du jour où mes poches découpées sont devenues langes et mes manches manteau, du jour où ma chair a réchauffé les os des enfants, du jour où ma blessure mise à nu a pansé une autre blessure, le mur est tombé entre le Dieu et moi. Les soldats ont surpris jusqu’à mes blessures, jusqu’aux battements de mon cœur, tout ce qui n’était pas la mort, fût-ce en un cimetière, ils l’ont surpris, comme un vol d’oiseaux affamés surprendrait le palmier en fruits dans un village désert. Les yeux des fusils dévorent mon chemin, grands ouverts. Le feu y rêve de ma croix. Mais s’ils sont de fer et de feu, les yeux de mon peuple sont lumières de ciel, de souvenirs, d’amour qui prennent sur eux mon fardeau, et ma croix devient source. Ah ! Comme est peu de chose, cette mort, ma mort ! Et que de choses elle rassemble !
Quand ils m’ont cloué, quand j’ai jeté les yeux sur la ville, à peine ai-je reconnu la plaine, le mur, le cimetière : il y avait, partout, une croix avec une mère en détresse. Saint est le Seigneur ! Voici que la ville enfante.
*** |
|
27/10/2016
|
Il y a 80 ans, débutait la Guerre d’Espagne. Elle allait durer 3 ans et elle annonçait le cataclysme de la seconde guerre mondiale. 40 000 étrangers combattirent dans les Brigades Internationales, sans toutefois que leur effectif dépasse plus de 18 000 hommes à la fois. La France constitua le groupe national le plus nombreux avec 10 000 hommes. 3 000 furent tués. Toulouse fut une des villes françaises les plus marquées par cette guerre civile. Les réfugiés ont imprimé à jamais leurs traces dans la ville qui en revendique toujours fièrement l’influence culturelle. L’émission « les poètes » se devait de donner la parole aux poètes qui ont été les témoins et les acteurs de cette épopée tragique. Federico Garcia Lorca fut assassiné dans les premiers jours. Miguel Hernàndez combattit. Le péruvien César Vallejo participa au 2ème Congrès des écrivains antifascistes à Barcelone, Valence et Madrid en 1937. Il lança un cri d’alarme : « Les responsables de ce qui se passe dans le monde, c’est nous, les écrivains, parce que nous possédons une arme formidable, qui est le verbe ». Il séjourna ensuite à Paris et écrivit fin 1937 un des plus puissants poèmes sur la guerre d’Espagne : « Espagne, écarte de moi ce calice ». C’est ce long poème « Hymne aux volontaires de la République » et ceux de Miguel Hernàndez extraits de « Mon sang est un chemin » qui illustrent cette émission dédiée à la Guerre d’Espagne. **** Lecture de « Espagne, écarte de moi ce calice », de poèmes de Miguel Hernàndez extraits de « Mon sang est un chemin », diffusion du « Passage de l’Ebre », de « La balade de celui qui ne fut jamais à Grenade » de Rafael Alberti, de « Vents du peuple » et d’ « Andalous de Jaén » de Miguel Hernàndez. HYMNE AUX VOLONTAIRES DE LA REPUBLIQUE Volontaire d’Espagne, milicien, aux os de haute foi, quand ton cœur marche pour mourir, quand il marche pour tuer avec son agonie mondiale, je ne sais véritablement que faire, je ne sais où me mettre ; je cours, j’écris, j’applaudis, je pleure, je guette, je détruis, tout s’éteint, je dis à ma poitrine qu’elle en finisse, au bien qu’il advienne, et j’ai envie de me déchiqueter ; je découvre mon front impersonnel jusqu’à toucher le vaisseau du sang, je me retiens, mon corps retient ces fameux effondrements d’architecte dont s’honore l’animal qui m’honore ; mes instincts refluent vers leurs cordes, la joie fume devant ma tombe et une fois encore, sans savoir que faire, sans rien, laisse-moi, depuis ma pierre en blanc, laisse-moi, seul, quadrumane, plus proche, beaucoup plus loin, puisque je ne peux tenir dans mes mains ton long moment d’extase, en habit de grandeur, si petit, je me brise ! Un jour diurne, clair, vigilant, fertile oh, ces deux ans de lugubres et suppliants semestres, où la poudre allait se mordant les coudes ! oh, dure peine et silex plus durs encore ! Oh, freins rongés par le peuple ! Un jour le peuple a enflammé son allumette captive, prière de colère et plénitude souveraine, circulaire, il a clos sa naissance de ses mains électives ; déjà les despotes traînaient leur cadenas et dans le cadenas, leurs bactéries mortes… Batailles ? Non ! Passions. Et passions précédées de douleurs aux barreaux d’espérance, de douleurs de peuples aux espérances d’hommes ! Mort et passion de paix, que celle des peuples ! Mort et passion guerrières parmi les oliviers, comprenons-nous bien ! Comme dans ton souffle, les vents changent d’aiguilles atmosphériques et dans ta poitrine les tombes changent de clef, ton os frontal s’élevant au degré le plus haut du martyre. Le monde s’exclame : « Histoires d’Espagnols ! » Et c’est vrai. Considérons, le temps d’un bilan, à brûle-pourpoint, Calderón en dormi sur la queue d’un amphibien mort Ou Cervantès disant : « on royaume est de ce monde, mais Aussi de l’autre » ; et d’estoc et de taille en deux rôles ! Contemplons Goya, à genoux et priant devant un miroir, Coll, le paladin, dont le pas mesuré en son assaut cartésien Connut une sueur de nuées, Ou Quevedo, cet ancêtre immédiat des dinamiteros, Ou Cajal, dévoré par son petit infini, ou encore Thérèse qui, femme, meurt de ne pas mourir, Ou Lina Odena, sur tant de points opposés à Thérèse… (Tout acte ou parole de génie vient du peuple et va vers lui, directement ou transmis par d’incessants filaments, par la fumée rougie d’amers mots d’ordre toujours remis en cause) Ainsi toi, milicien, exsangue créature Malaxée par une pierre immobile, Tu te sacrifies, tu t’écartes, Tu te consumes par le haut et montes par ta flamme incombustible, montes jusqu’aux faibles, distribuant des espagnes aux taureaux, des taureaux aux colombes… Prolétaire qui meurs d’univers, dans quelle harmonie frénétique s’achèvera ta grandeur, ta misère, ton tourbillon centrifuge, ta violence méthodique, ton chaos théorique et pratique, ton envie dantesque, tellement espagnole, même en trahissant, d’aimer ton ennemi ! Libérateur chargé de chaînes, sans ton effort, aujourd’hui encore, l’espace n’offrirait pas de prise, les clous erreraient acéphales, le jour serait ancien, lent, pourpre, les crânes qui sont chers seraient sans sépulture ! Paysan tombé pour l’homme avec tes feuilles vertes, avec ton bœuf qui reste seul, avec ta physique, et ta parole aussi, attaché à un pieu, et ton ciel en fermage, avec l’argile incrustée dans ta fatigue et celle qui reste sous ton ongle, dans ta marche ! Constructeurs agricoles, civils et guerriers, de l’active, fourmillante éternité ; il était écrit que ce serait vous qui feriez la lumière, yeux mi-clos à l’heure de la mort ; qu’à la chute cruelle de vos bouches, l’abondance viendrait sur sept plateaux, que tout dans le monde d’un seul coup serait d’or et l’or, fabuleux mendiants de votre propre sécrétion de sang, et l’or lui-même enfin or ! Tous les hommes s’aimeront, ils mangeront ensemble, se tenant par les coins de vos mouchoirs tristes, et boiront au nom de vos gorges malmenées ! Ils se reposeront de leur long cheminement, ils pleureront, pensant à vos périples, ils se réjouiront au son de votre atroce retour, fleuri, inné, ils ajusteront demain leurs labeurs, leurs figures rêvées et chantées ! Les mêmes souliers iront à celui qui, sans chemins, montes jusqu’à son corps, et celui qui descend jusqu’à la forme de son âme ! Enfin de retour, les aveugles verront Et, cœur battant, les sourds entendront ! Les ignorants sauront, les savants ignoreront ! On donnera tous les baisers que vous n’avez pas pu donner ! Seule la mort mourra ! La fourmi portera des morceaux de pain à l’éléphant enchaîné à sa brutale délicatesse ; les enfants avortés renaîtront, parfaits, spatiaux et tous les hommes engendreront, tous les hommes comprendront ! Ouvrier, sauveur, notre rédempteur, pardonne-nous, frère, nos offenses ! Comme dit dans ses adages un tambour qui bat : que jamais ton dos ne soit plus éphémère ! Qu’aussi changeant, toujours, soit ton profil ! Volontaire italien, parmi tes animaux de bataille un lion abyssin va boitant ! Volontaire soviétique, marchant à la tête de ta poitrine universelle ! Volontaire du Sud, du Nord, de l’Orient et toi, l’Occidental, fermant le chant funèbre de l’aube ! Soldat connu, dont le nom défile au son d’une accolade ! Combattant que couvera la terre, en t’armant de poussière, en te chaussant d’aimants positifs, avec toute la force de ta foi personnelle, ton caractère distinct, ta férule intime, ta peau immédiate, marchant, ton idiome sur les épaules et l’âme couronnée de pierres ! Volontaire nimbé de ta région glaciale, tempérée ou torride, héros de partout à la ronde, victime en colonne de vainqueurs : en Espagne, à Madrid, on appelle à tuer, volontaires de la vie ! Parce qu’en Espagne ils tuent, d’autres tuent l’enfant et son jouet qui s’arrête, Rosenda la mère, rayonnante, le vieil Adán qui parlait tout haut avec son cheval et le chien qui dormait dans l’escalier. Ils tuent le livre, ils tirent sur ses verbes auxiliaires, sur sa première page sans défense ! On tue le cas exact de la statue, le savant, sa canne, son collègue, le barbier du coin – il m’a peut-être coupé en me rasant, mais c’était un brave homme et, de plus, malheureux ; le mendiant qui, hier encore, chantait en face ; l’infirmière qui, ce matin, est passée en pleurant, le prêtre droit sur la hauteur inflexible de ses genoux. Volontaires, pour la vie, pour les bons, tuez la mort, tuez les mauvais ! Faites-le pour la liberté de tous, de l’exploité et de l’exploiteur, pour la paix indolore – je crois la voir quand je dors au pied de mon front et plus encore quand je circule en hurlant – et faites-le, je vous le dis, pour l’analphabète à qui j’écris, pour le génie qui va pieds nus et pour son agneau, pour les camarades tombés, leurs cendres étroitement mêlées aux cadavres d’une route ! Pour que vous veniez, vous, volontaires d’Espagne et du monde, j’ai rêvé que j’étais bon, et c’était, volontaires, pour voir votre sang… De cela, il y a force poitrine, bien des angoisses, d’innombrables chameaux en âge de prier. Aujourd’hui avec vous marche le bien des flammes, vous suivent avec amour les reptiles aux cils immanents et à deux pas, à un, le fil de l’eau qui court vers sa limite avant de s’embraser. César Vallejo (traduction François Maspero) **** de Miguel Hernàndez Les vents du peuple m’emportent Les vents du peuple m’emportent, les vents du peuple m’entraînent, ils éparpillent mon cœur et répandent ma gorge. Les bœufs baissent le front, éduqués à l’impuissance, devant les châtiments : les lions l’élèvent et, en même temps, ils châtient avec leurs griffes triomphantes. Je ne suis pas d’un peuple de bœufs, je suis d’un peuple qu’innervent des gisements de lions, des défilés d’aigles et des cordillères de taureaux avec de l’orgueil dans la corne. Jamais on n’a eu peur des bœufs dans les landes d’Espagne. Qui parla d’imposer un joug au cou de cette race ? Qui a jamais mis un joug ou des entraves à l’ouragan, et qui encore retint prisonnier l’éclair dans une cage ? Asturiens, la bravoure, Basques, pierres fortifiées, Valenciens, la joie et Castillans, l’âme, labourés comme la terre et gracieux comme des ailes ; Andalous, les éclairs, nés parmi les guitares et forgés sur des enclumes comme des torrents de larmes ; ceux d’Estrémadure, des seigles, Galiciens, pluie et calme, Catalans, la fermeté, Aragonais, la race, Murciens, la dynamite multipliée par les fruits, ceux de Léon, les Navarrais, seigneurs de la faim, de la sueur et de la hache, rois des mines, princes des labours, hommes qui, entre les racines, comme de vaillantes racines, allez de la vie à la mort, allez du néant au néant : ils veulent vous mettre le joug, les gens de mauvaise graine, jougs que vous devez secouer brisés sur leurs dos même. C’est le crépuscule des bœufs, l’aube est en train de poindre. Les bœufs meurent vêtus d’humilité et d’odeur d’étable : les aigles, les lions et les taureaux meurent pleins d’orgueil, et derrière eux, le ciel ne se trouble ni ne se termine. L’agonie des bœufs fait piètre figure, celle de la bête mâle agrandit toute la création. Si je meurs, que je meure avec la tête très haute. Mort et cent fois mort, la bouche contre le chiendent, j’aurai les dents serrées et le menton décidé. J’attends la mort en chantant, parce qu’il y a des rossignols qui chantent au-dessus des fusils et au milieu des batailles. Miguel Hernàndez
(Mon
sang est mon chemin,
traduction de Sara Solivella et Philippe Leignel) |
|
13/10/2016 20/10/2016
|
Christian Saint-Paul revient sur le n° 55 de la revue « Nouveaux Délits » qui consacre quatorze pages à Laurent Bouisset qui a publié entre autres « Dévore l’attente » aux éditions Le Citron Gare de Patrice Maltaverne, traduit les poètes latino-américains inconnus souvent en France et que l’on peut lire sur son blog : www.fuegodelfuego.blogspot.com Il enseigne dans les quartiers nord et va écrire un diptyque avec le poète Samaël Steiner qui a notamment publié lui aussi chez Maltaverne « Seul le bleu reste » (10 €).
Lecture de poèmes de Laurent Bouisset.
Abuela
les si longs doigts d’abuela cousent abuela c’est grand-mère en espagnol abouèla abouèla je perds mon temps à répéter ce mot en miel abuela, elle, a plus urgent : elle doit vêtir elle doit vêtir à temps l’enfant à naître elle doit le vêtir chaudement et vite elle se dit ça elle le répète
ils ont débarqué pour sa fille enceinte il y a un mois ils ont débarqué pour la vie en elle elle a vu ça elle le revoit l’entend crier le corps fendu de son enfant du sexe aux seins
elle coud pourtant elle coud quand même et ne pleure pas ou bien si peu
elle voudrait que l’aiguille tue ses pensées elle voudrait ne plus discerner que le seul fil et le jeu des motifs sur la manche difficile
elle va s’en aller tout à l’heure elle dit cela elle le répète encore plus bas mais je l’entends je le lis sur ses lèvres bleues que l’adieu est pour l’aube et ses feux roux
un souffle encore je vois ses doigts je vois ses longs doigts gourds œuvrer en vain je touche son front et son dos lourd je lui dis que je suis à ses côtés
je cherche aussi à préparer malgré tout une naissance
* A lire dans « Nouveaux Délits » n° 55, 6 € le n°, 28 € l’abonnement annuel à adresser à : Association Nouveaux Délits, Létou - 46330 Saint Cirq-Lapopie. * Francis RICARD vient de faire paraître aux éditions toulousaines Editions Hors Limite animées par notre amie Jacqueline Poueyo : « Arthur Rimbaud poste restante Marseille » avec une préface de Serge Pey, 78 pages, 12 €. Francis Ricard est un poète et auteur toulousain, professeur de lettres, aficionado, photographe et plasticien. Il a publié un essai : Éclipse(s) (l’Épure, 2002) et signe en 2003 un recueil sur la tauromachie, La corrida des ombres (Atlantica). Paraissent par la suite Le sang (2005) et En un seul souffle (Cheyne, 2007). En 2012, il coécrit plusieurs chansons du spectacle « 3 voix ensemble » des Grandes Bouches. Il réitère à quatre mains avec Philippe Dutheil, parolier et chanteur du groupe, pour leur nouvelle création Jaurès ! Le bal républicain. En avril 1891 le poète Arthur Rimbaud, alors inconnu, a quitté la France depuis plus de quinze ans. Il vit au Harar, en Abyssinie (Ethiopie), où il s'est installé comme négociant pour une firme d'import-export située à Aden. Victime de violentes douleurs au genou droit qui l'empêchent de marcher Rimbaud décide de rentrer à Aden pour se faire soigner, puis en France où il mourra en novembre, à trente sept ans. Dans une langue poétique, hachée comme la douleur, fugace, désordonnée et vagabonde comme toute méditation en action, l'auteur transcrit les délires et les réminiscences du « poète aux semelles de vent » soudain réduit à l'immobilité. L'auteur suit les pensées qui traversent le cerveau du poète entre passé, présent et futur durant ce terrible retour. C'est toute la vie de Rimbaud qui défile à travers ses souvenirs : sa famille, sa jeunesse, son aventure avec Paul Verlaine, ses amis, ses voyages, ses poèmes, parfois ses propres mots, ses bonheurs, sa souffrance, ses regrets. Seul un poète pouvait s'immiscer dans ce crâne pour faire revivre cette vie pleine de mystères du poète incompris. « Estropié », comme il l'écrit, Rimbaud est emporté pour un ultime voyage. Ce livre fera l’objet d’une prochaine émission avec la participation de son auteur. Lecture d’extraits de la préface de Serge Pey. Ce poème, habité et aigu de Francis Ricard, arraché des intestins de l’espérance, est un mystère fracturé, joué sur le parvis singulier d’une cthédrale de la poésie. Il en est le Hérault. Il incarne une fraternité qui interroge le voyage de la parole et son articulation au genou de la vie. La sienne, la nôtre, et aussi celle du poème, qui pour ressusciter dans ce temps des assassins, doit être mis à mort et raconter son sacrifice inlassable de langue. [...] Chaque poète devient le Rimbaud que Rimbaud aurait pu être, et non celui qui s’est arrêté d’exister.
Lecture d’extraits du poème.
le soleil noir a des ailes de moulin à vent / je n’ai donné aucune clé de mes poèmes / si un jour j’ai des lecteurs ils s’interrogeront / s’ils savaient / les professeurs n’expliquent jamais tout / les poètes peut-être / parfois / j’aurais dû ne pas naître / je ne souffrirais pas / les étoiles au ciel ont perdu leur doux froufrou / mes nuits / toutes ces nuits au babil hystérique / ces rêves / ces cauchemars / ces insomnies / je suis épuisé / qu’on me sorte de là / vite / ou que je meure / je n’en peux plus / pourquoi naît-on / pourquoi vit-on / pourquoi meurt-on / l’autorité militaire me recherche parce que je n’ai pas fait mon service militaire / personne ne doit savoir où je suis / il ne faut pas qu’on me retrouve / ils me jetteraient en prison / Paul / on ne pensait pas à mal / encore moins au lendemain / on voulait juste choquer le bourgeois / surtout vivre / vivre en poète / habiter la poésie / s’amuser / aujourd’hui je ne pense qu’à demain / la poésie s’en est allée / elle ne console pas / je fais l’acrobate sur mes béquilles / j’arrive presque à courir/ * C’est la figure d’un autre poète toulousain qui est ensuite évoqué, car décidément Toulouse demeure la cité des poètes ; c’est le livre d’artiste de Claude Barrère avec des encres d’Antoine Voisin que Saint-Paul se plait à retrouver. « Cendres & Lucioles » aux éditions réciproques, a fait l’objet d’une émission lors de sa parution, mais il est bon de revenir sur cette complicité du poème et de l’image (les encres en l’occurrence). Antoine Voisin décrit en plasticien ce mariage heureux : « Ma main dépose l’encre qui diffuse avec lenteur. Les pigments les plus lourds restent sur le rivage. Des formes légères prennent vie et créent autour d’elles air, espace, et peut-être temps. En fin de compte, je fais très peu et j’observe beaucoup. La poésie se pose là comme un souffle... » Et Claude Barrère répond : « Au gré des accalmies et des intempéries de l’encre, les pigments ensemencent le temps des mots du poème ; de leur ascendant d’âme et de corps viennent « habiter » ce lieu insoupçonné du Livre, à la croisée des éléments et du paysage. » Lecture d’extraits. en mémoire des limbes lucioles au pré d’encre étoilée vocables matinaux * ombres mutantes manches d’air à rythmer le départ des ailes * la nuit alors se désenlace de pigments à lever dans l’avivement des aurores * cueilleuses de varech goémonières du deuil de linges défaits dans le vent * Indépendamment du couple image-texte, ces poèmes trouvent une identité forte, comme les encres d’Antoine Voisin hors textes d’ailleurs, et créent un univers insoupçonné dont les formes nous attirent comme des lucioles dans une nuit de cendres. * Serge Pey publie chez le poète Bruno Doucey « Venger les mots », préface de Bruno Doucey, collection Soleil noir, 112 pages, 14,5o €. Le mot de l’éditeur : Venger les mots… Serge Pey aura écrit ce livre comme on érige une barricade face au maintien de l’ordre. Ici, il nous invite à multiplier les foyers de poésie pour « mettre le feu à la plaine » ; là, il en appelle à la libération de Leonard Peltier, militant de l’American Indian Movement emprisonné depuis 1976. Ailleurs encore, il compose une «prière punk» pour les Pussy Riot, collectif de féministes russes violemment malmenées par le pouvoir de Vladimir Poutine, ou un hommage aux héros du réseau Sabate qui bravèrent la dictature franquiste par des actions à visage découvert. D’un texte à l’autre, un même appel à l’insoumission. Une même conviction que la poésie est action. Un même désir de venger les mots et les morts, ceux qui « nous tiennent les jambes pour que nous restions debout. » « Les combats de Serge Pey n’ont pas cessé, nous dit Bruno Doucey dans sa préface, il s’agit toujours de venger les morts et de venger les mots. D’orienter la flèche de la parole poétique, non vers le miroir où se consume tièdement son image, mais vers les douze haches que le poète, revenu sain et sauf de ses batailles antérieures, espère atteindre pour libérer le monde des prétendants qui l’assaillent. Car les combats d’aujourd’hui valent ceux d’hier. » On retrouve dans ce dernier livre de Serge Pey, l’univers familier du poète. Sa mise en scène des mots, dans l’oralité et dans l’image qu’ils fixent sur la page. Son utilisation des lettres en majuscules, ses va et vient entre l’encre noire et l’encre rouge, ses chiffres romains ; tout le catéchisme poétique de Pey surgit encore dans ce livre. Et dans l’incessant combat qu’il mène pour libérer le monde qui est une façon plus urgente de le changer, le monde, le poète devient fatalement Sisyphe qui roule le rocher de la révolte à toute oppression. Le travail est sans fin, c’est pourquoi il l’entreprend. Et l’on doit imaginer Pey -Sisyphe heureux ! Lecture d’extraits. « Parce que les mots ne veulent plus rien dire et vomissent leurs lettres Parce que les verbes sont tués par des policiers de la poésie au service de l’oppression de la poésie Parce que nous voulons venger les mots Parce que nous demandons aux morts d’exister contre les mots qui sont morts (…) GRÈVE GÉNÉRALE DE LA POÉSIE CONTRE LA MORT DE LA POÉSIE ! * DEPART A Renato Pira, mon ami cuisinier de Gavoi (Barbagia) Quand mon camarade est mort j’ai pensé que tout le monde était mort Mourir est une capacité jumelle à celle de vivre Tout est affaire de point de vue Mais il faut savoir être vivant pour penser que tout le monde est mort et aussi son contraire il faut savoir être mort pour penser que tout le monde est mort et aussi son contraire il faut savoir être mort pour penser que tout le monde est vivant La résurrection est de cet ordre dire à ceux qui se croient vivants autour de nous de ressusciter mais pas dans les cimetières Quand après la bénédiction il a fallu embrasser mon camarade à travers le cercueil fermé je me suis trompé j’étais un peu saoul comme lui je me suis perdu je ne savais pas dans quel sens était son corps Et ce n’est pas sa tête que j’ai touchée pour lui dire au revoir mais ses pieds Je me suis dit que je faisais décidément toujours les choses à l’envers mais que c’était peut-être bien ainsi car nous ne nous arrêtons jamais de marcher même morts J’ai pensé aussi que la route était longue même pour tous les vivants qui étaient autour de lui dans le cimetière Qu’il n’y avait peut-être ni mort ni vie mais que des pieds infiniment des pieds Des pieds qui ne savaient même plus s’ils étaient des pieds tellement ils avaient marché Et que peut-être le cercueil de mon ami n’était qu’un soulier qu’il avait oublié en partant sur la route comme un vieil oiseau saoul dont il fallait encore cirer les ailes dans le ciel infini de la ville au milieu des nuages remplis de bière et de vin noir * Ce poème, révèle Saint-Paul, lui fait se souvenir de l’hommage que rendit Serge Pey à Félix Castan le jour de son inhumation à Montauban. Ce jour là, il avait offert un soulier à son ami défunt lors de sa déclamation de poème. * L’émission est ensuite consacrée à Bob Dylan qui vient de recevoir le Prix Nobel de Littérature. Saint-Paul rappelle que le 9 juin 1970, Bob Dylan, en robe noire, à l’université de Princeton avait reçu le diplôme de Docteur ès Musique. Sa musique qui était selon l’expression du président de l’université qui lui décernait ce titre honorifique : « l’authentique expression de la conscience troublée de la jeune Amérique ». La biographie de Bob Dylan est développée à l’antenne. Retenons que Bob Zimmermann, dit Dylan, est né le 24 mai 1941 à Duluth, au bord du lac Supérieur et a grandi près du Canada à Hibbing. Ses parents étaient issus de la petite bourgeoisie. Il ressent un terrible ennui à Hibbing dans sa jeunesse, ville qui selon lui « était en train de mourir ». Mais il fait l’expérience de l’injustice sociale qui le hantera toute sa vie. C’est l’incohérence du système politique américain qu’il dénoncera. Refusant de s’intégrer socialement comme tout le monde, il fuit ses parents, l’université, le quotidien routinier et morne. Il fugue et parcourt les U.S.A. le plus souvent raccompagné chez lui par deux policiers. Ces expériences l’enrichiront dans l’apprentissage de sa vie d’homme et dans sa culture musicale en formation. C’est l’époque de Chuck Berry et d’Elvis Presley ; le rock n’roll s’ancrera dans sa musique. Mais c’est le blues qu’il joue tout jeune à la guitare et plus tard à l’harmonica. Sa première chanson à 15 ans est dédiée à Brigitte Bardot. Ayant fui l’université, il vit dans la précarité loin des aspirations du « rêve américain » qu’il rejette. C’est un « révolté » doué d’une forte et très riche personnalité. Il va voir Woodie Gutrhie qui chanta avec un talent sublime les malheurs de la crise de 1929, tous les malheurs sociaux qui frappèrent l’Amérique et dont ses chants de révolte ne pouvait laisser Dylan insensible. L’artiste méconnu et désargenté, sans maison qu’il était a la chance dès 1961 de signer un contrat avec CBS ; il s’assure dès lors une sécurité financière. La richesse de ses textes, sa voix rauque, l’émotion qu’il véhicule immédiatement le distinguent des autres chanteurs. Ses textes ne proposent aucune solution. Il demeure dans la lignée de Woodie Guthrie : un chroniqueur. Après une émission de télé en 1963 sa popularité explose. Il devient à son insu le porte-parole de la jeunesse américaine. Lucide il amorce un « désengagement » et donne un nouvel aspect à ses textes. Ils deviennent philosophiques et poétiques. Dylan écrit : « les paroles sont bien plus importantes que la musique et je les compose en premier ». Au cours de l’été 1966 il eut un grave accident de moto et put mesurer qu’il était déjà devenu un personnage aussi célèbre qu’Elvis Presley ou Jimi Hendrix. Ses disques se vendent de façon vertigineuse. Il se tourne ensuite vers la country n’western qui est le genre spécial des américains blancs. En août 1969 lors du festival de l’île de Wight, il ne reste qu’une heure en scène et déçoit le public nombreux venu le voir. Il est devenu une idole qui semble s’éloigner du jeune homme révolté qui criait avec génie son refus de la société américaine. Il enregistre des disques qui déçoivent encore. Il erre dans des genres musicaux très variés. Bob Dylan ne revint jamais à ce qu’il avait représenté. Mais ce qu’il a laissé en héritage est l’œuvre d’un poète, d’un musicien qui fut l’expression de la conscience troublée de la jeune Amérique et surtout il demeure aujourd’hui où Ginsberg, Kerouac, Burroughs ont disparu, le symbole encore vivant de la Beat Generation. C’est au delà du personnage mythique de Bob Dylan, toute la littérature et surtout toute la poésie de la Beat Generation qui est magnifiée par ce Prix Nobel de littérature 2016. Lecture de textes des chansons de Bob Dylan On assiste à quelques changements Approchez les écrivains et les critiques Et autres prophètes de la plume Gardez vos yeux grands ouverts L’occasion ne se reproduira plus Et surtout ne parlez pas trop vite Car la roue est encore en mouvement Et on ne peut pas encore dire qui Sera appelé Car celui qui perd aujourd’hui Demain gagnera Car on assiste à quelques changements... Approchez sénateurs et députés Faîtes attention s’il vous plait Ne bouchez pas l’entrée N’encombrez pas le hall Car celui qui sera blessé Sera bientôt au rancart La bataille fait rage Dehors et ça va sauter Faisant voler en éclats vos vitres Ebranlant vos murs Car on assiste à quelques changements... Approchez les conseils de famille De tous les coins du pays Et ne commencez pas à critiquer Ce que vous ne pouvez pas comprendre Vos fils et vos filles Echappent à votre contrôle Le vieux tracé N’a plus cours Evacuez la nouvelle route Si vous ne pouvez pas vous rendre utiles Car on assiste à quelques changements... ** Blues de Menphis encore (extraits) ..... Voilà que le météorologiste me refile deux médicaments Et il dit, monte là-dessus Le premier est une pilule du Texas Le deuxième, du gin pour galoper Comme un fou, je les ai mélangés Et ça m’a défoncé la tête Et maintenant les gens sont encore plus horribles Et j’ai perdu la notion du temps Oh, Mama, est-ce que c’est pas bientôt fini D’être bloqué à l’intérieur de Mobile Avec encore et toujours cette angoisse de Memphis, encore ? Ruthie me demande de venir la voir Au fin fond de sa lagune beuglante Où je peux la voir valser gratis Sous son clair de lune de Panama Et je dis, « en voilà assez Tu sais que je sors avec une débutante » Et elle dit, « ta débutante elle sait ce qu’il te faudrait Moi je sais ce que tu veux » Oh, Mama, est-ce que c’est pas bientôt fini D’être bloqué à l’intérieur de Mobile Avec encore et toujours cette angoisse de Memphis, encore ? Maintenant il y a des pavés dans la Grand’Rue Bariolée des tiges grimpantes des néons Les pavés volent à la perfection Tout est si bien programmé C’est là que je suis assis avec tant de patience Attendant de trouver le prix que tu vas payer Pour n’avoir plus à subir toutes ces choses deux fois Oh, Mama, est-ce que c’est pas bientôt fini D’être bloqué à l’intérieur de Mobile Avec encore et toujours le blues de Memphis, encore ? ****
|
|
06/10/2016
|
Christian Saint-Paul signale la parution de « Le Chemin des correspondances et le champ poétique - A la mémoire de Michael Pakenham - » sous la direction de Steve Murphy aux éditions CLASSIQUES GARNIER, livre dans lequel le poète surréaliste Jean-Pierre LASSALLE consacre huit pages à « Ange PECHMEJA, linguiste et poète (1819 - 1887) ». L’émission « les poètes » du 15 décembre 2011 avait été consacrée à Jean-Pierre LASSALLE professeur émérite de l’Université de Toulouse, biographe, écrivain, poète, qui fût membre du groupe surréaliste et proche de Breton, qui est depuis des décennies membre de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse, venu parler de la réédition par les Amis du Pays de Saint-Céré (Contact courriel : contact@saint-cere.org courrier : AAPSC - B. P. 60028 - 46400 SAINT-CERE) de « ROSALIE » Nouvelle d’Ange PECHMEJA 237 p 14 €, qui avait été publiée initialement à Paris (librairie A ; Franck) en 1860. La préface de cette réédition est en effet signée Jean-Pierre LASSALLE. Voici le compte-rendu de cette émission : Avec sa verve coutumière et son sens aigu de la pédagogie, l’érudit sans fioriture mais pratiquant l’ironie aimable qu’est LASSALLE, cet homme de lettres accompli, explique pourquoi cette nouvelle offre un intérêt incontestable à être lue et connue. Pechméja dans ce récit autobiographique nous fait pénétrer dans bien des univers. Tout d’abord celui de la bourgeoisie étriquée d’une petite ville de province du XIX siècle conservatrice et conformiste ; la mère est bigote et le père, vaincu par l’obstination de son épouse, finit par être un « pratiquant » modèle. Cette influence de la religion catholique qui dicte sa loi, heurte le jeune PECHMEJA qui fait sienne les idées progressistes de l’époque et s’affirme comme un républicain invétéré. Ce sont d’ailleurs ses opinions politiques et son militantisme qui révèleront les qualités intellectuelles profondes du jeune homme. En effet, celui-ci sera amené à remplacer au pied levé le rédacteur en chef du journal local républicain « L’Eclaireur », lequel journaliste avait été emprisonné au moment du fameux complot de Lyon. LASSALE explique les circonstances historiques de cette ferme répression. A son tour Ange PECHMEJA devra s’exiler pour fuir l’emprisonnement ou la déportation en Algérie. Il se réfugiera en Belgique où il rencontrera Victor HUGO, lui-même fuyant sa patrie. Puis, ne pouvant être toléré plus longtemps à Bruxelles, Jean-François, nom du héros de cette nouvelle, mais qui est en réalité Ange PECHMEJA doit reprendre la route de l’exil. Il se rend à Vienne puis au fin fond de l’empire ottoman dans ces contrées comme la Moldavie, qui deviendront ensuite la Yougoslavie. Et enfin, il atteindra Constantinople. Le récit de cette fuite est doublé de la description de l’amour romantique qui le lie à la jeune Rosalie, éperdument amoureuse qui le suit dans son périple jusqu’à sa mort en couches dans ce proche orient où le couple illicite était réfugié. La nature de cet amour est d’une grande modernité et prend le contrepied des mœurs bourgeoises de la famille honorable du jeune amant. L’attachement final de PECHMEJA à son lieu natal, à ses origines, où il finira les 20 dernières années de sa vie à son retour d’exil est aussi révélateur des préoccupations majeures de cet auteur qui nous apprend tout sur les mœurs sociales, politiques et médiatiques pour utiliser un terme d’aujourd’hui qui, au XIXème siècle ne recouvrait que la presse. La forme atypique de cette nouvelle « ROSALIE » qui si elle comporte peut-être quelques légères maladresses est surprenante : on y trouve des lettres, des chansons et même de l’occitan (langue d’Oc phonétique). PECHMEJA s’est illustré aussi par la publication de « L’œuf de Kneph » livre ésotérique qu’il publie en 1864 et qui a été réédité en 1995. « ROSALIE » est à lire comme un récit alerte qui nous éclaire sur l’histoire de la société du Second Empire et sur le sentiment amoureux d’un homme en avance sur son temps. L’explication de Jean-Pierre LASSALLE donne à cette nouvelle inclassable tout son intérêt. Dans son article de 2016, Jean-Pierre LASSALLE rappelle qu’il faut attendre 2001 pour voir PECHMEJA entrer dans une Anthologie des Poètes du Quercy, publiée par Gilles LADES aux éditions du Laquet, et 2011 pour voir son roman en grande partie autobiographique Rosalie (publié en 1860) réédité par les soins de l’Association des Amis du Pays de Saint-Céré, pour lequel il a signé la préface. Rosalie, précise Jean-Pierre Lassalle, est le prénom de la jeune fille lotoise que l’auteur a connue, aimée. Roman sentimental, donc, mais aussi roman régionaliste, roman exotique, et avant tout roman autobiographique. Rosalie nous montre Ange Pechméja évoluant très à l’aise dans le milieu turco-roumain des provinces danubiennes dont il décrit les mœurs, les usages, ce qui fait de lui une sorte de précurseur de Pierre Loti, de Claude Farrère, de Pierre Benoît. Le roman d’amour n’est pas oublié pour autant, puisque la jeune fille de Bétaille (village au nord du Lot), parlant patois, qu’il a séduite, l’a rejoint dans son exil. En marge, l’auteur de l’article a tenu à indiquer qu’Ange Pechméja, polyglotte, s’intéresse aussi à sa langue natale, et de nombreux mots et tours occitans sont présents dans le roman. L’article englobe une étude sur la totalité de l’œuvre de Pechméja, poète, linguiste et philosophe. Il avait même une vision de la création préfigurant le Big Bang ! Pechméja a combattu l’ignorance, l’obscurantisme, avec un désir parfois naïf de justice sociale, sans oublier les grands enjeux de la poésie visant à la description et à l’évocation du cosmos et des hommes qui l’habitent avec leurs idées et avec leurs rêves. L’œuvre du poète saint-céréen mérite, en tout cas, d’être sorti d’un oubli immérité, conclut Jean-Pierre Lassalle. * * Le numéro 55 de la revue de poésie vive Nouveaux Délits vient de paraître. Un numéro soigné que sait parfaitement réaliser son animatrice, poète, critique, plasticienne, éditrice et en tout cela, exemplaire militante de la poésie. A lire, donc. Voici ce qu’elle écrit dans son éditorial : « Nous sommes chacun comme un écran tout sauf blanc, sur lequel les autres viennent projeter leurs propres films. Parfois les superpositions s’harmonisent plutôt bien, peuvent être source d’inspiration, de joies, d’illuminations, mais trop souvent, cela ne créé que confusion, malentendus, cacophonie, indigestions. Dans ce cas, il est parfois préférable et même nécessaire de baisser l’écran, éteindre les projecteurs. Se recentrer sur soi, pas de façon obtuse et égoïste, mais pour aller chercher en soi cette source où se dissout toute image préconçue. Tout simplement parce que nous sommes chacun bien plus qu’une somme de projections et que nous ne pouvons servir de support permanent à tous ceux qui ne se connaissent qu’au travers d’écrans interposés et qui peuvent de ce fait vite paniquer, se montrer intolérants, vindicatifs, quand ils ne reconnaissent pas leur propre film, leur propre scénario sur les écrans des autres. Les couleurs, la luminosité, le son, ne leur conviennent pas, ils voudraient pouvoir tout régler, contrôler. Chacun de nous le voudrait. Après les éblouissements de l’été, l’automne est la saison pour entamer ce lent repli sur soi, pour nettoyer écran et projecteurs, laisser partir ce qui doit partir, laisser sève et énergies redescendre pour mieux se concentrer, se régénérer, puiser à cette source en nous qui n’a rien à voir avec le mental, les désirs, les peurs et les aspirations égotiques. Une source qui, tout comme la poésie en amont du langage, met en résonance l’intérieur et l’extérieur. Un poème naît du frottement des mots entre eux, le poète peut faire naître l’étincelle qui fera prendre feu au langage tout entier. Éclairer, réchauffer, consumer s’il le faut. Si le sens d’un mot est perverti, la poésie peut le réduire en cendres. Sensations, émotions, sentiments, autant d’argiles à modeler et à cuire. Toutes les formes sont possibles, simplement certaines seront plus solides que d’autres et tiendront plus longtemps, mais tout est voué à se briser et retourner à son état originel. La création est recommencement perpétuel et donc destruction perpétuelle. Le cœur en bat le rythme, la respiration harmonise. Un cycle, un cercle, une spirale. Cette source en nous qui sait, saura alors nous faire jaillir en de nouveaux printemps, à chaque fois plus riches, plus fertiles d’un humus qui nourrit nos racines. D’innombrables racines entremêlées, enlacées, qui font de chacun de nous un être à la fois unique et profondément relié aux autres. » Cathy GARCIA Le n° 6 € + port, abonnement 28 € (4 numéros), chèque à l’ordre de : Association Nouveaux Délits, Létou - 46330 St Cirq-Lapopie. * Le numéro 68 de la revue Diérèse poésie & littérature vient également de paraître. Il s’agit d’un véritable livre très bien composé, très bien illustré, mis en page au cordeau, de 303 pages au sommaire brillant comme toujours, avec notamment Pierre Dhainaut, des lettres de Jean Malrieu, Inger Christensen, Pierre Bergounioux, Isabelle Lévesque, Gilles Lades, Jeanpyer Poëls, Jean Chatard, Claude Albarède, Jean-François Mathé pour ne citer que quelques auteurs. Hélène Mohone, notre artiste regrettée, est toujours présente dans ce numéro avec trois reproductions en couleurs de ces œuvres. Des poètes danois, américains et sud-africains sont à l’honneur dans ce numéro qui consacre une cinquantaine de pages (un record parmi nos revues !) à des notes de lecture de livres de poésie. Et Daniel Martinez dans son éditorial de présentation de ce numéro insiste sur l’importance de la traduction en poésie qui redimensionne le champ littéraire ; il nous fait découvrir un poète oublié des anthologies : Jean-Marie Gibbal. Lecture de poèmes de Gilles Lades. * Le reste de l’émission est occupé par la diffusion des interventions d’une table ronde sur le thème : « Où niche la poésie ? », tenue à Toulouse le dimanche 2 octobre 2016 dans le cadre du Salon du Livre des Gourmets de Lettres, sous un chapiteau, place Saint-Pierre, en bord de Garonne. La table ronde était présidée par Christian Saint-Paul et les intervenants étaient par ordre de prise de parole : Simone Aliè Daram, poète, maître es-jeux de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse, Francis Ricard, poète, Franc Bardou poète, essayiste, plasticien, maître es-jeux de l’Académie des Jeux Floraux, Philippe Dazet-Brun Secrétaire perpétuel de l’Académie des Jeux Floraux et Jacques Arlet, écrivain, mainteneur de l’Académie des jeux Floraux. Christian Saint-Paul a présenté un travail de recension et de réflexion dont voici le contenu : Où se niche la poésie ? Simone ALIE-DARAM a eu bien raison de choisir ce thème de réflexion sur la poésie : « où se niche la poésie ? ». Répondre à la question va nous permettre de tordre le cou sans appel à bien des préjugés qui engluent l’idée de poésie dans une gangue de guimauve écœurante. Il nous appartient donc de faire sortir la poésie de cette nasse d’ornements de pacotille dans laquelle le lieu commun l’emprisonne.
Les médias, aujourd’hui sont les
premiers gardiens involontaires, c’est-à-dire inconscients, de cette
prison. Alors que la quasi-totalité d’entre eux ne rendent aucun compte de
la production actuelle de la poésie, ils ne cessent d’illustrer leurs
propos en se référant à la poésie et à l’adjectif poétique. La « poésie », dès lors, devient un paysage, un objet, un geste, un personnage. Et tout naturellement, ce que nos médias qualifient de poétique, devient le lieu même de la poésie. La poésie nicherait donc dans ce qui est nommé poésie ou poétique. Déjà, en 1950, cette hérésie de jugement, mortifère pour la poésie, nous le voyons bien aujourd’hui, était si partagée que Pierre Reverdy dans son essai « La fonction poétique », avait dû affirmer : « La poésie n’est pas dans les choses – à la manière où la couleur et l’odeur sont dans la rose et en émanent – elle est dans l’homme, uniquement et c’est lui qui en charge les choses, en s’en servant pour s’exprimer. Elle est un besoin et une faculté, une nécessité de la condition de l’homme – l’une des plus déterminantes de son destin. Elle est une propriété de sentir et un mode de penser ». Pierre Reverdy développe de façon très explicite que devraient lire ou relire nos inévitables journalistes, chroniqueurs obsessionnels de notre quotidien, dans son essai : « Cette émotion appelée poésie ». Ecoutons le : « La poésie n’est pas plus dans les mots que dans le coucher du soleil ou l’épanouissement splendide de l’aurore – pas plus dans la tristesse que dans la joie. Elle est dans ce que deviennent les mots atteignant l’âme humaine, quand ils ont transformé le coucher du soleil ou l’aurore, la tristesse ou la joie. Elle est dans cette transmutation opérée sur les choses par la vertu des mots et les réactions qu’ils ont les uns sur les autres dans leurs arrangements – se répercutant dans l’esprit et sur la sensibilité ». La poésie niche donc dans le travail de la langue. C’est la conclusion de Pierre Reverdy : « Ce passage de l’émotion brute, confusément sensible ou morale, au plan esthétique où, sans rien perdre de sa valeur humaine, s’élevant à l’échelle, elle s’allège de son poids de terre et de chair, s’épure et se libère de telle sorte qu’elle devient, de souffrance pesante du cœur, jouissance ineffable d’esprit, c’est ça la poésie. » La poésie niche dans une jouissance ineffable d’esprit. En 1970, lors de l’épreuve orale d’un concours d’accès à une fonction publique, j’ai été confronté à cette question du président du jury : « qu’est-ce que la poésie ? Je citai d’emblée Paul Valéry, non sans une certaine ruse, car j’étais sûr au moins que cet auteur classique était connu du jury, ce qui était moins sûr des poètes contemporains que je pratiquais. Paul Valéry avait écrit dans « Tel quel » en 1910 : « La plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. » Terrible lucidité de Paul Valéry. Plus d’un siècle plus tard, cette déploration est toujours d’actualité. D’ailleurs, 26 ans plus tard, le constat pessimiste de Paul Valéry s’était aggravé : « Il est exact, insistait-il, que depuis trois cents ans environ, les Français ont été instruits à méconnaître la vraie nature de la poésie et à prendre le change sur des voies qui conduisent tout à l’opposé de son gîte. » La poésie ne niche pas là où beaucoup de gens la croient. Mais l’homme possède ce don merveilleux qui est celui de l’imagination couplé à celui de la parole. Et Reverdy est convaincu que le sens poétique est inné chez l’homme et a même certainement été la source de toutes les religions. C’est dire combien la poésie est présente dans l’esprit de l’homme ! Nous savons que les mots sont un assemblage, une transposition, un symbole, car le mot « maison », par exemple, ne montre pas une maison quand nous prononçons ce mot. C’est comme cela qu’est née la poésie, car en même temps que le mot désigne une maison, il dit plus que la maison en elle-même. C’est en ce sens que Rabindranath Tagor peut dire que « la poésie et les arts entretiennent la foi profonde de l’homme dans l’union de son être avec tout ce qui existe et dont la vérité finale est la vérité de sa personnalité. La poésie niche dans la vérité de notre personnalité. Par le levier du langage, la poésie naît de la rencontre de l’imagination et de la réalité. C’est dans la complexité de ce rapport de l’imaginaire à la réalité que niche la poésie.
Depuis que le vers libre a supplanté la
rime et la métrique, le poème fonctionne, si l’on peut dire, avec des
images. Et l’image est une représentation indirecte de l’esprit d’une
chose. Eriger le langage, Paul Valéry y excelle par son image mythique : « la terre est bleue comme une orange ». Cette juxtaposition de mots change notre rapport au monde. Mais nous savions déjà, obscurément, que la terre était bleue comme une orange. Dès la lecture du vers, l’incongruité première disparait.
La poésie niche dans la révélation
d’une chose que nous portions obscurément en nous. Longtemps, des mots ont été employés plus facilement que d’autres et ont servi à tout propos de trame, de fil conducteur de la poésie. Ces mots, termes de l’intime de l’être, tels que cœur, âme, se sont considérablement usés et sont devenus aujourd’hui suspects. Mais pour citer encore Reverdy : « Il n’y a pas de mots plus poétiques que d’autres. »
Chaque poète use de son propre
vocabulaire, de la résonnance qui s’établit entre leur intime perception
des choses et l’alliance plus ou moins tacite des mots. En cette matière, il n’y a pas de vérités. Entre l’esprit et le poème, aucun intermédiaire. Le langage appartient à l’être et la complexité de l’être constitue la complexité de la poésie. On peut donc en déduire que la poésie niche dans l’image de l’homme. Mais la poésie n’est pas un acte gratuit. Exprimer ses obsessions sous forme de poèmes qui sont des objets d’émotions intelligentes, répond à une nécessité. C’est la nécessité qui donne sa légitimité au poème. Le poème d’ornement ou poème de circonstance n’est pas poésie. « Le poète écrit parce qu’il a à dire des choses essentielles », affirme avec beaucoup d’autres, Marie-Claire Banquart. Rilke disait qu’il fallait être contraint d’écrire. La poésie niche dans la nécessité.
La nécessité d’écrire de la poésie a
toujours son origine dans la finitude de la condition humaine. La poésie est une réponse à la détresse de la destinée humaine. Elle signe la révolte face à notre finitude. L’acte même d’écrire est une forme de liberté. « … même au creux du fond du noir, écrire ou lire un poème est encore un geste de vivant », affirme Antoine Emaz. Ce geste est un geste de résistance. La poésie niche dans la résistance.
La « résistance » de la poésie, nous
explique Jean-Luc Nancy, est en somme la résistance du langage à sa propre
infinité. La résistance à la démesure que le langage est par lui-même. La
résistance poétique peut tout aussi bien aller au silence (qui n’est
« exact » que par défaut, précise Jean-Luc Nancy), que se prendre
elle-même au bavardage et à la démesure. Mais, constate James Sacré avec son expérience de la vie et tout son travail de poète : « La poésie ne peut sans doute pas grand chose contre ce qui inquiète ou effraie notre esprit. Il nous met en garde : « ce n’est pas en se saisissant de cette inquiétude, en la prenant comme motif d’inquiétude, que le poème va la faire disparaître, mais peut-être va-t-elle mieux en prendre conscience et parvenir, quelque peu, à la comprendre. James Sacré avance une autre origine de l’acte d’écrire de la poésie : « Un poème nous vient dans les doigts souvent à cause d’un manque, ou d’un désir (qui creuse un manque entre ce que nous sommes et ce qui est désiré) ». La poésie niche dans le désir et dans le manque. Mais également, James Sacré éprouve du plaisir à écrire de la poésie. Claude Vigée m’avait certifié qu’écrire un poème ou faire l’amour relevait du même plaisir. « Le plaisir d’écrire, précise James Sacré, n’est pas forcément lié au sentiment que nous serions en accord avec le monde, mais au moins au bonheur d’être dans les mots, dans la langue, avec cette part du monde qu’elle est. » La poésie niche dans le manque. La poésie niche dans le plaisir. L’apitoiement (bien discret) que certains se plaisent à accorder à la poésie est-il justifié ? Il existe une misère de la poésie, très spécifique de notre époque. L’effacement historique qu’elle connait peut laisser croire à un naufrage. Ce naufrage apparent agit comme un puissant stimulant chez les poètes qui nourrit leurs interrogations et leurs images. Ils y assoient alors leur force de résistance et leur grandeur. Cette pauvreté forcée induit des formes poétiques adaptées à ce peu qu’on accorde à la poésie. « Ce que je veux dire / Ce n’est pas grand-chose », avoue James Sacré dans l’émission « les poètes » de Radio Occitanie. Mais dans ce pas grand-chose, se niche une concentration intensive de sens. Le paradoxe de notre époque, c’est la multiplication de très bonnes publications de livres de poèmes. La poésie n’est pas exsangue. Elle est simplement oubliée des médias et c’est ce qui la sauve. Cette pauvreté de notoriété la fortifie. Elle exige un effort du public, N’y viennent que les plus disponibles à la poésie. C’est Federico Garcia Lorca qui a raison : « Ce n’est pas de partisans que la poésie a besoin, mais d’amants. Elle se couvre de ronces épineuses et d’éclats de verre, afin que celui-ci qui étend sur elle sa main s’ensanglante. » * Simone Alié-Daram fait valoir que la poésie n’a pas besoin de niche ; elle n’a pas de lieu puisqu’elle est partout. La poésie, cela peut être un rayon de soleil entre deux orteils d’un nouveau-né. La poésie est avant tout une émotion. Il y a deux intervenants dans la poésie, celui qui lit et celui qui écrit. La poésie se réinvente par la lecture. L’émotion peut être ressentie complètement différemment par le lecteur. Francis Ricard s’interroge sur le mot « niche » anagramme de « chien ». Comme « singe » et « signe », « trace » et « écart ». Le poète est celui qui voit ce que la plupart des gens ne voient pas. Mais il le leur montre. Il a un rôle de guide. Michel Deguy a écrit « Le sens de la visite ». Je lui ai dit : « En réalité, c’est la visite du sens » et il m’a répondu « évidemment ! Vous avez tout compris. » Il faut trouver des choses que les autres ne trouvent pas. Les surréalistes allaient à la chasse aux trouvailles. Mallarmé disait : « La plus belle fleur, c’est l’absente de tout bouquet » et « le plus bel arbre, c’est l’arbre entre deux arbres », c’est-à-dire l’absent. La plus belle chose est absente, à nous poètes de la trouver. C’est l’épitaphe sur la tombe de Rimbaud : « Je cherche l’or du temps ». Ce décalage de la vision fait que le poète voit des choses que les autres ignorent. Francis Ricard lit un de ses poèmes sur les traces de crues d’un fleuve. Franc Bardou s’enthousiasme : la poésie est une femme ! La poésie n’est pas dans les mots, elle est dans les images que ces mots et ces langues accueillent avec plus ou moins de bonheur et généralement malgré le poète. Elle est nécessité . Il faut écrire, quand ça prend, c’est comme éternuer ; c’est aussi comme faire l’amour. C’est une femme radicalement autre, mais délicieusement intime. Je n’ai pas son adresse. C’est toujours elle qui me trouve ; elle, sait où je suis. Alors c’est impératif. Il n’y a pas d’un côté un imaginaire poétique et de l’autre, une réalité prosaïque. C’est un je(u) de miroirs. C’est l’intérieur qui se reflète sur l’extérieur et parfois l’inverse. C’est la subjectivité qui cueille les poèmes. L’histoire du poète (sa biographie) peut alors avoir une utilité pour interpréter le poème. Car ce qui lui advient, l’anecdotique de sa vie a un rôle à jouer dans sa création poétique. Il dit ce qu’il ressent en le vivant. Il y a là un espace, un trou où le troubadour vient déposer l’or du temps. Mais l’extérieur peut s’imposer et dicter les mots. Chaque poème est unique, chaque poème est la caresse de cette femme. Le poème, c’est comme un rêve, je l’oublie aussitôt que je l’ai écrit. Ce qui fait que chaque fois que j’écris un poème, c’est le premier poème et peut-être aussi, le dernier. Philippe Dazet-Brun considère que la poésie est finalement partout et en chacun. La poésie n’est pas que dans les textes. Elle est aussi prose. Elle se niche dans la peinture, le cinéma ; partout elle se niche. Parce que la poésie est un regard. Le regard que nous portons sur la chose. La poésie est réveillée par la subjectivité. Ce qui est poétique pour l’un peut ne pas l’être pour l’autre. Rimbaud qui publie son premier ouvrage n’est pas reconnu comme poète. Il a fallu attendre des génies comme Claudel pour que cette reconnaissance devienne universelle. Mais la subjectivité doit être éduquée. Et là, il y a une responsabilité du collectif et de l’Education Nationale. Or, parfois celle-ci fait curieusement son travail. Philippe Dazet-Brun lit alors un poème extrait d’un manuel scolaire pour une classe de « petite section ». Des allitérations mais où se niche le sens ? Il faut une convergence de regard pour arriver à un critère. C’est lui qui fait émerger ce que la postérité nous donne. Certains poètes peuvent disparaître. Par exemple, Pierre Emmanuel qui a toujours été un grand poète, peut être oublié. Il importe donc d’être vigilant et toujours attentif à son œuvre aujourd’hui. Heureusement, conclut Philippe Dazet-Brun, les regards d’enfants voient de la poésie partout. Le professeur Jacques Arlet cite Brigitte Maillard qui a écrit « A l’éveil du jour » (monde en poésie éditions) qu’il a beaucoup aimé. Celle-ci a eu recours à la poésie à la suite de la maladie. « Si tout se défait autour de moi, une porte s’ouvre à l’intérieur. Elle se nomme poésie » dit-elle. Il conclut sur cette interrogation de Max Pol Fouchet : « de tous les poèmes écrits au cours des siècles, que reste-t-il des cris du cœur ? »
|
|
29/09/2016
|
Christian Saint-Paul introduit l’émission par une réflexion sur l’utilité de la poésie. Dans « La mémoire de l’être » Horia Badescu affirme que « depuis ses débuts, la poésie civilise l’homme en apprivoisant son cœur, en domptant ses démons instinctuels qui retranchent l’ego de l’harmonie universelle et le poussent à retourner à son égoïste besoin de soi qui lui-même le rejette hors de la lumière, de la compréhension et de l’amour ». La connaissance des poètes contribue à « civiliser » l’homme. L’émission est entièrement consacrée à : Miguel HERNANDEZ (1910 - 1942). Saint-Paul brosse une biographie complète mais qui peut se résumer à des circonstances essentielles : Miguel Hernàndez est né à Orihuela dans la province de Murcie, en Espagne dans une famille pauvre de marchand de chèvres. Les chèvres resteront une occupation noble pour le poète qui savait les soigner. Il entame des études secondaires chez les jésuites jusqu’à l’âge de quinze ans. Plus tard, une vraie mystique originale, aux accents populaires de haute élévation se retrouvera dans ses poèmes. La vocation de Miguel Hernàndez a été marquée par son amitié avec José MARTIN qui prend le pseudonyme de Ramon Sijé (anagramme de son nom). Sa première tentative en 1931 de sefaire reconnaître à Madrid et de lier amitié avec des poètes, se solde par un échec. Il revient auprès de ses chèvres à Orihuela. En 1933 il publie à compte d’auteurs « Perito en lunas » livre demeuré sans écho. Il s’en plaint à Lorca qui lui répond et l’encourage à travailler. En 1934 il retourne à Madrid, fait la connaissance de Pablo NERUDA et pénètre les milieux intellectuels de la capitale. La même année il collabore avec six poèmes à la revue « El Gayo Crisis » dirigée par Ramon Sijé d’un catholicisme militant. Il se fiance avec Josefina Manresa qu’il épousera civilement en 1937 pendant la guerre. En 1935 il vit de son travail de secrétaire particulier de l’écrivain et journaliste taurin José Maria de Cossio, lequel publiera une édition posthume de « El rayo que no cesa » en 1949. Il rentre cependant à Orihuela. Pablo Neruda le rappelle à Madrid pour participer à sa revue « Caballo verde para la poesia ». La même année son ami Ramon Sijé meurt brutalement. Miguel Hernàndez rédige une élégie dans la revue du philosophe Ortega y Gasset « Revista de Occidente » qui lui vaut un accueil chaleureux et l’attention du poète Juan Ramon Jiménez. En 1936 première publication de « El rayo que no cesa ». C’est ensuite la guerre civile avec le soulèvement militaire du 18 juillet. Miguel Hernàndez s’enrôle dans les milices du Parti Communiste. Il s’occupe de propagande sur le front de Madrid et à la fin de l’année 1936 achève une pièce dramatique « El labrador de màs aire » qui ne peut cependant être représentée. En 1937 il combat sur le front de Madrid et récite des poèmes aux soldats. Il est plus tard affecté au front sud. Il publie « Viento del pueblo » aux éditions communistes. Il participe à Valence au Congrès des Intellectuels en Défense de la Culture. Il fait paraître « Teatro en la guerra ». Il se rend la même année en Russie pour le festival de théâtre soviétique. Il traverse l’Europe et revient déçu et indigné du désintérêt que manifeste l’Europe pour la tragédie espagnole qu’est ce conflit. C’est alors la décisive bataille de Teruel à laquelle il participe. Sur le front il apprend la naissance de son premier fils Manuel Ramon qui mourra dix mois plus tard d’une infection intestinale. En 1938 sa pièce « El pastor de la muerte » lui voit le Prix du Concours National de Littérature. Il commence la rédaction de « Cancioneroy romancero de ausencias » qui restera inachevé. En 1939 naît son deuxième fils manuel Miguel ; il publie ses derniers poèmes de guerre « El hombre acecha » dédié à Neruda. Mais c’est l’année de la défaite. Il ne peut fuir au Portugal et est arrêté. Il sort de prison à Madrid grâce certainement à une intervention de Neruda. Il travaille alors à ses poèmes intimistes « Cancionero y romancero de ausencias » qu’il remet au crayon à sa femme qu’il retrouve à Orihuela fin septembre. Dénoncé il est arrêté à Orihuela le 29 septembre 1939. En 1940 il est condamné à mortle 18 janvier avec 29 autres détenus. Six mois plus tard toujours grâce à l’intervention de Neruda sa peine est commuée à 30 ans d’emprisonnement. En 1941 à la prison de Palencia il contracte une pneumonie. Transféré enfin à Valence, son père refuse de venir le voir, mais il peut faire connaissance pour la première fois avec son fils. La tuberculose succède à la pneumonie. Il finit par obtenir une autorisation de transfert pour un sanatorium, mais sa famille ne dispose pas de l’argent nécessaire au transport. Le 4 mars 1942 il épouse religieusement Josefina Manresa, le mariage civil n’ayant aucune valeur juridique pour le régime de Franco. Le 28 mars 1942 il meurt à l’âge de 21 ans. Il est inhumé au cimetière civil de Alicante. * L’homme ne se repose pas... L’homme ne se repose pas : ce qui se repose est son habit quand, accroché, il balance sa solitude avec le vent. Or, une vie inconnue comme un vague tatouage remue un souffle sous l’habit retiré. Le cœur cesse d’être une fleur de marée. Le front, son poulain, n’est plus régi par le firmament Bien que le corps, approfondi de quiétude, travaille, dans le repos central le mouvement est cerné. Il n’y a pas de morts. Tout vit : tout palpite et avance. Tout est un souffle extatique d’activité mouvante. Peau inférieure de l’homme, son habit n’a pas expiré. Visiblement immobile, le cœur se met à émouvoir le monde qu’a parcouru le front. Et l’univers tourne comme un sein lent. (Cancionero de ausencias) * Christian Saint-Paul lit des extraits de deux œuvres majeures : - d’une part : « El rayo que no cesa » dans la version magistralement traduite par Pedro HERAS, poète espagnol qui incarnait l’avenir de la poésie espagnole et trop tôt disparu. Il vint réaliser une émission dans nos studios et nous lui avons consacré une émission posthume, émissions toujours disponibles sur notre site. C’était notre ami et l’hommage qui lui fut rendu à sa mort est aussi disponible dans la marge gauche de notre page d’accueil. Pedro HERAS avec ses moyens de bord avaient édité des livres aux « éditions hegipe » dont une traduction de « El rayo que no cesa »( L’éclair sans cesse). Pedro HERAS ramène cette fraîcheur de l’authentique, de l’humilité qui signe les œuvres en eaux profondes comme celle de Miguel HERNANDEZ, qui connut le vrai combat, et mourut dans une vraie prison. - d’autre aprt : « Hijo de la luz y de la sombra » (Fils de la lumière et de l’ombre) dans l’édition magnifiquement illustrée par Joan Jordà des éditions toulousaines « Sables » dans une traduction de Sophie Cathala-Pradal. Extraits de « El rayo que no cesa » Guidant un tribunal de squales, comme avec deux faux éclipsées, deux sourcils ternis et coupés à force de ternir et de couper les cœurs, dans le mien tu es entrée où tu poses un filet de racines irritées qui, avidement accaparées, sur son territoire éprouve ses passions, Sors de mon cœur dont tu as fait un tournesol jaune et soumis au verdict solaire que ton oeil envoie, une terre inassouvie à jamais, un poisson embouteillé, un maillet fatigué de tinter dans la forge. * Après avoir bêché cette jachère, sur le chiendent je m’accorderai un repos, et sur la branche je boirai l’eau qu’augmente en ma faveur sa neige prisonnière. Je sens mon corps refait à neuf, fumant du feu juteux de l’incendie, et la création que j’adore, comme un lit, sous ma fatigue immense se répand. Le jardinier s’accordera un répit et il distraira ses chagrins assailli par le soleil salubre et le temps serein. Puis penchant corps et main, face à la terre de nouveau, il poursuivra traqué par l’ombre du dernier repos. * Depuis leur création déjà, peut-être, un pré paisible, champêtre pare le caroubier, le pin, le chêne, le hêtre qui doit fournir la matière de mon cercueil. Peut-être y travaille déjà et la combat le bûcheron au zèle assassin et par la pente, peut-être, du chemin sanglante elle monte et résonnant elle descend. Peut-être la réduit déjà à géométrie, à plis aplanis celui qui apprête la dernière retraite des êtres. Et sûr et sans peut-être, la sombre patrie se dispose de toute éternité à recevoir mon adieu définitif. * Je sais : entendre et voir un malheureux exaspère, quand il va et vient de sa gaîté comme d’un océan méridien vers une baie, vers une contrée fuyante et désolée. Tant de souffrance mais rien , tout n’est rien, tant il me reste encore à souffrir la rigueur de cette agonie, de ce couteau présent à cette épée qui vient. Je me tairai, je m’en irai si je peux avec mon chagrin instant, constant et plein, où tu ne m’entendras pas, ou je ne te verrai. Je pars, je pars mais je demeure, or je pars, désert sans sable : adieu, amour, adieu jusqu’à la mort. * Extraits de « Hijo de la luz y de la sombra » Tu es la nuit, épouse : la nuit dans le moment Où son pouvoir domine, lunaire et féminin. Le milieu de la nuit où l’ombre est culminante Où culmine le rêve et où l’amour culmine. Forgé avec le jour, j’ai le cœur qui s’embrase. Il porte sa foulée de soleil où tu veux, Dans un élan solaire, une absolue lumière, Sommet de nos matins et de nos crépuscules. J’assaillirai ton corps quand la nuit jettera Son avare désir d’aimant et de puissance. Un astral sentiment fébrile me saisit Et avec un frisson incendie mon squelette. * Ah ! la vie, quel fardeau splendide et moribond ! Ombres et linges apporta celle de ton fils. Ombres et linges portent les hommes par le monde. Et tous, toujours laissent des ombres : linges et ombres. Fils de l’aube tu es, fils du milieu du jour. Tu dois tirer de toi des lumières puissantes Tandis qu’à l’agonie allons ta mère et moi, Eveillés et dormant avec pour faix l’amour. Je parle et c’est mon cœur qui part avec mon souffle. Si je ne disais tout, je pourrais étouffer. De lavande et résine je parfume ta chambre. Epouse, tu es l’aube. Moi, le milieu du jour. * |
|
22/09/2016
|
En préambule
Christian Saint-Paul attire l’attention des auditeurs toulousains sur les
événements des 23 et 24 septembre :
* Revenant aux publications de poésie, Saint-Paul évoque une définition du texte poétique de Lorand Gaspar : « Le texte poétique est le texte de la vie, travaillé par le rythme des éléments, construit, érodé par tout ce qui est ; fragmentaire, plein de lacunes, laissant apparaître dans les failles des signes plus anciens. Trame d’ardeur et de circulation : chacun peut y lire autre chose et aussi la même chose. »
Voulant saluer le travail de Rémy DURAND, poète, romancier, traducteur, et celui de Michel COSEM qui diffuse inlassablement la poésie contemporaine et sait relayer les passeurs de poésie, qui a ouvert sa revue « Encres Vives » et ses éditions, au travail de traduction de Rémy DURAND, en publiant un poète uruguayen et une femme poète espagnole.
Rémy Durand est né à Caracas, dans cette Amérique indo-afro-européenne qui devait le marquer profondément et où il a longtemps vécu et travaillé ; il a parcouru le monde –Venezuela, Colombie, Inde, Équateur, Irlande, Mexique, Pérou, Sénégal… pour promouvoir la langue et la culture françaises, la Francophonie, les identités culturelles nationales et le dialogue des cultures. Poète, écrivain, il a publié de nombreux recueils. (Guy Chambelland, Les Amateurs maladroits, VillaCisneros…). Critique d’art et critique littéraire, nombre d’articles sous sa signature sont parus dans la presse latino-américaine (Colombie, Équateur). Il publie chez « Recours au poème », « La lettre sous le Bruit », « Les Carnets d’Eucharis », « Aurora Boreal » (revues numériques) Il est l’hôte de Festivals de poésie en Amérique latine (Festival international de poésie de Barranquilla (Colombie), Festival international de poésie de Guayaquil (Équateur), entre autres. Il est l’initiateur avec Ramiro Oviedo de rencontres poétiques mensuelles : les Jueves poéticos (Équateur), les Poetry Thursdays (Irlande) et les Rencontres de poètes à Toulon-France : les Jeudis poétiques, puis Les Mercredis du Carré (en partenariat avec le Revue numérique La Lettre sous le Bruit dirigée par Gilbert Renouf) dans le cadre de l’Association littéraire Gangotena qu’il a fondée en 2001. Traductions : anthologie bilingue Séparer le blanc de la lumière , 33 poètes Équatoriens du XXIe siècle (Senami, Quito 2011) ; Fadir Delgado Acosta (Encres Vives n° 612), Maitalea Fé, Ileana Diaz (Colombie), Pedro Rosa Balda (Équateur) en 2015 (éditions Villa-Cisneros) : Sergio Laignelet (Colombie) – Cuentos sin hadas / Contes à l’envers ; Augusto Rodríguez (Équateur) – El libro de la enfermedad / Le livre des fièvres ; Ramiro Oviedo (Équateur) – La ruta de piscis / La route du poisson ; et en français : Julio Olaciregui (Colombie) – Parfois danse Prochaine publication de Rémy Durand : « La Vertu des ombres » aux éditions L'Une & L'Autre.
Il a traduit de Rafael COURTOISIE : « Sainte Poésie / Santa Poesia » Des extraits viennent d’être publiés dans la collection Encres Blanches des éditions Encres Vives. ( à commander à Michel Cosem, 2, allée des Allobroges 31770 Colomiers, le n° 6,10 €, abonnement à Encres Vives 34 €).
Rafael COURTOISIE est né à Montevideo. Il est poète, romancier et essayiste. C’est un des écrivains les plus importants de sa génération. Universitaire et conférencier émérites. Il est membre actif de l’Académie nationale des Lettres de l’Uruguay et Membre correspondant de l’Académie royale d’Espagne. Ecrivain uruguayen de grands parents français, il est le digne héritier de poètes de France tels Lautréamont, Jules Laforgue et Jules Supervielle, tous nés à Montevideo, dans ce pays situé sur le Rio de la Plata, en Amérique du Sud. Aventurier, il a vécu dans la forêt amazonienne Avec des communautés indiennes, au Mexique, dans le désert du Néguev et aux Etats Unis ; il a toujours associé son travail avec sa passion pour les sports extrêmes - comme l’attestent ses nombreuses cicatrices - et l’amour de sa vie : la poésie, pour laquelle il ne cache pas sa passion charnelle et spirituelle. Il a reçu de nombreux Prix, parmi lesquels le Prix international de poésie José Lezama Lima (Cuba 2013), le Prix national de Littérature (2013), le Prix International Casa de América (Madrid, 2014).
Lecture par Christian Saint-Paul des extraits. En exergue du recueil, ces vers de José Emilio Pacheco :
La chienne puante, la poésie pouilleuse Variété risible de la névrose, Prix que d’aucuns payent Parce qu’ils ne savent pas vivre. La douce, l’éternelle, la lumineuse poésie.
* Le silence
Il entre par les yeux La nuit chante.
Ils s’embrassent sur la bouche C’est demande du sel Et la réponse de l’eau. *
Droit du travail
Nous les poètes nous travaillons Dans les dépotoirs du monde.
Le fumier à pelletées Devient chant de blé.
Les putes nous embrassent sur la bouche Les enfants nous saluent à notre passage A coups de pierres, les gérants Crachent dans l’assiette Dans laquelle nous mangeons
Ton travail consiste à toucher La merde Et à en faire de l’or. * A l’envers
La tristesse est faute de syntaxe
Le syntagme de Dieu Sautille Entre paradigmes Sujet et verbe Séparés
Substantif et adjectif Rivaux et frères
La tristesse Est une anomalie De la grammaire humaine
Un séisme, le coup de queue D’un dragon D’une hyperbate En rage Laisse le monde
Les pattes en l’air *
Un poème est un dessin du néant
L’orange découpée Déjà avalée, morte Laisse un autre fruit dans l’assiette Plus vivant :
L’arôme de la pensée. * Théologie
La poésie c’est perpétuer la guerre Par d’autres moyens
Il n’y a pas de morts. Tous ressuscitent.
Le crucifié lave Les caillots De la nuit lacérée Il oublie à jamais La blessure sur le flanc Et la langue des clous.
L’Esprit Saint Danse une rumba. * Le 457ème numéro d’Encres Vives est consacrée à Veronica ARANDA qui publie là, sous le titre « Tatouage (Tatuaje) des extraits de ses livres Tatuaje et Café Hafa, en édition bilingue, toujours sur une traduction de Rémy DURAND à laquelle elle a, elle-même, collaboré. Verónica Aranda est née à Madrid en 1982. Licenciée en Philologie espagnole. Master de gestion culturelle à l’université Carlos III de Madrid. A étudié la “flamencologie”. Études de doctorat à l’université Jawaharlal Nehru de New-Delhi avec une bourse du Gouvernement indien (2006-2008). Bourse de création (2005-2006) à la Fondation Antonio Gala pour jeunes créateurs à Cordoba. Stages à l’Institut Cervantes de Tanger (2009-2010). Bourse (2011) du Ministère de la culture. Traductrice. Directrice d’une collection de poésie hispano-latino-américaine pour les Éditions Polibea (Madrid). Elle participe à de nombreux Festivals de poésie, à des Fêtes du livre, et à des séminaires dans son pays et à l’étranger. Participe à des programmes de développement (poésie) pour des collèges dans les pays où elle est invitée. Verónica Aranda a obtenu de nombreux Prix de poésie. Publications: Poeta en India, Editorial Melibea, Talavera de la Reina, 2005 Tatuaje, Hiperión, Madrid, 2005 Alfama, Fundación José Hierro, Getafe, Madrid, 2009 Postal de olvido, El Gaviero, Almería, 2010 Cortes de luz (Accessit au Prix Adonais 2009), Rialp, Madrid, 2010 Senda de sauces (99 Haikus), Amargord, Madrid, 2011 Café Hafa, Tres Fronteras, Murcia, 2012 Lluvias continuas. Ciento un haikus, Polibea, Madrid, 2014 La mirada de Ulises, Corazón de Mango, Colombie, 2015. Inside the Shell of the tortoise (Antología bilingüe español-inglés), Nirala, Delhi, Inde, 2016. Traductions: Poemas de los Himalayas, Yuyutsu RD Sharma, Juan de Mairena, Córdoba, 2010 Claros, Antonio Ramos Rosa, Polibea, Madrid, 2016 Verónica Aranda est invitée cette année au Festival international de poésie de Camps-la-Source (Var) – 23 et 24 avril 2016 Contact : veronicaaranda@hotmail.com Blog: http://veronicaaranda.blogspot.com
Lecture par Christian Saint-Paul du recueil “Tatouage” extraits Encres Vives.
Les poèmes de Veronica ARANDA :
TATUAJE
Llegó desde el Mar Rojo en un barco febril, a la deriva, cargado de naranjas, y en su mástil se alzaban las mezquitas más azules, en donde convergían los caminos de Persia y el puerto de llegada, donde ondea el lienzo claroscuro del susurro, el súbito tambor de las verbenas y la nieve de marzo, amaneciendo, que siempre cierra el ciclo de las sedas y sus remotas rutas. *
TATOUAGE Il est arrivé de la Mer Rouge sur un voilier fébrile, à la dérive chargé d’oranges, et, en haut de son mât se dressaient les mosquées les plus bleues où se croisaient les chemins de Perse jusqu’au port d’arrivée, où flotte la voile d’un murmure clair-obscur, le soudain tambour des kermesses et la neige de mars, au petit matin qui toujours achève le cycle des soies et ses routes lointaines * III Aún recuerdo el encuentro en una plaza hostil frente a unos cines. Era quizá el septiembre de los barcos anclados y tomamos asiento en aquel banco donde los vagabundos se tumbaban de día tan desoladamente, porque era una ciudad de brumas muy propensa a perderse en sus noches de cerveza y billares, rodeando la Grand Place por los antiguos barrios de artesanos. Las fachadas flamencas invitaban a ir enlazando historias con el registro más confesional. Venías de la tierra de los grandes pintores del quinientos, y tu nombre tenía algo de mito griego y de caballos soltados a la luz de la Toscana. Éramos disidentes y vencimos por una sola noche aquel trágico hastío de Bruselas. *
III Je me souviens encore de la rencontre sur une place hostile en face de cinémas. C’était peut-être le septembre des bateaux au mouillage et sur ce banc nous nous sommes assis là où, de jour, les vagabonds s’affalaient exténués, car c’était là une ville de brumes prête à se perdre dans ses nuits de bière et de jeux de billard, autour de la Grand-Place dans les vieux quartiers des artisans. Les façades flamandes invitaient à raconter sans trève des histoires sur un ton de confession. Tu venais de la terre des grands peintres du XVème siècle et ton nom possédait un peu de mythe grec et de ces chevaux qui filent vers la lumière de Toscane Nous étions des dissidents et nous avons vaincu pour une nuit ce tragique ennui de Bruxelles. * Casablanca Hago mío el dolor de esta ciudad, sus edificios Art Decó y todas sus intrigas y sus mendigos ciegos. No tengo miedo ni ambiciones. No espero demasiado del amor ni de sus desencuentros. Bebo cointreau en la barra, busco a Bogart, recuerdo la buhardilla de París. Mientras el tiempo pasa entre tabaco americano. As time goes by, las notas del piano de Sam, los fugitivos. Presiento que comienza una gran amistad. Quizá algún día muera en Casablanca. * Casablanca Je fais mienne la douleur de cette ville, ses constructions Art Déco et toutes ses intrigues et ses mendiants aveugles. Je n’ai pas peur je n’ai pas d’ambition. Je n’attends rien de l’amour ni de ses désenchantement. Je bois du Cointreau au comptoir, je cherche Bogart, je me souviens de ma mansarde de Paris. Pendant que le temps passe entre des cigarettes américaines. As time goes by, les notes du piano de Sam, les fugitifs. Je devine que s’engage une grande amitié. Un jour peut-être je mourrai à Casablanca. * Muerte en Venecia Dejar que el tiempo sea esta evasión en la sala de cine, esta mezcla de planos y ciudades de agua, cuando contamos a desconocidos una verdad desconcertante después de haber estado frente al mar, frente a la duda y la desidia, frente a amantes que observan a través de biombos. Esta penumbra del cinematógrafo nos restituye lo dejado atrás: un estío remoto, la costumbre de ascender las colinas de gladiolos salvajes donde te revolvía los cabellos. Aschenbach come fresas, el tinte le chorrea por las sienes, su delirio está hecho de música y efebos. Busca el último soplo de embriaguez. Pasa a cámara lenta la Belleza. * Mort à Venise Laisser au temps devenir cette évasion au cinéma, ce mélange de cartes et de villes aquatiques quand nous racontons à des inconnus une vérité déconcertante après avoir été face à la mer, face au doute et à l’apathie, face à des amants qui observent à travers des paravents. Cette ombre du cinématographe nous restitue ce que nous avons laissé derrière nous : un été lointain, l’habitude de monter sur les collines aux glaïeuls sauvages où je te décoiffais. Aschenbach mange des fraises, La teinture coule sur ses tempes son délire est fait de musique et d’éphèbes. Il cherche la dernière bouffée d’ivresse. La beauté passe au ralenti. *
El cítrico esplendor El cítrico esplendor, la desnudez gestada bajo lámparas de aceite tras una larga espera; madrugada portadora de esencias de tomillo y el roce de los torsos que escondían la alquimia y sus secretos minerales. * La citrique splendeur La citrique splendeur, la nudité née sous les lampes à huile après une longue attente, aube qui apporte des senteurs de thym et le frôlement des torses qui cachaient l’alchimie et ses secrets minéraux.
© Verónica Aranda © Traductions: Rémy Durand
* Et puisque les auteurs retenus à cette émission sont de langue espagnole, il est naturel de rendre hommage à un de nos plus puissants poètes français, génial traducteur aussi de la poésie de langue espagnole qui est Jacques ANCET. Merveilleux traducteur chez José Corti d’Antonio GAMONEDA entre autres. Poète du souffle, loin de la mode minimaliste, poète lyrique et d’une modernité qui prolonge la tradition. Ce sont des poètes comme Jacques ANCET qui sauvent la poésie de l’ornière qui la guette dans un monde livré tout entier à la seule loi du marché.
Jacques ANCET est né le 14 juillet 1942 à Lyon. Études secondaires et supérieures dans cette même ville. “Lecteur” de français à l’Université de Séville, puis agrégé d’espagnol qu’il a enseigné pendant plus de trente dans les classes préparatoires aux Grandes Écoles littéraires et commerciales avant de se consacrer à son travail d’écrivain et de traducteur près d’Annecy où il réside. Notre regretté ami Gil Pressnitzer disait de lui sur son excellent site espritsnomades : Sa poésie est une attente aux bords du silence, quelque chose va enfin venir que l’on ne sait pas. Dans ce monde incertain, entre chien et loup et homme contre homme, quelque lumière sourd lentement de ses poèmes qui semblent être en suspension :
« La lumière suffirait-elle ? Les ombres sont plus nettes, les couleurs plus vives, mais ce qui vient ressemble à la tempête. Peu importe. Je ne vois pas plus loin que le bout d'un instant qui sans cesse m'échappe, sans cesse m'appelle. C'est pourquoi je suis perdu. Entre la montagne et la tasse, le ronflement de la pelleteuse et le craquement du radiateur. Entre ce que je vais dire et ce que je dis. Entre le regard et les choses, le matin et le soir. Entre, toujours. Entre les mots comme entre les pierres du torrent. Entre ton corps et le mien, entre ma vie et ma mort. » Chronique d'un égarement (2003-2006, inédit).
Jacques Ancet définit lui-même parfaitement sa poésie comme envers de l’invisible : « Et écrire, ce désir à chaque fois de réparer l’imperceptible accroc ? De recueillir dans un léger tissage des paroles ces figures éparses du devenir et les rendre un instant solidaires. De telle sorte que recouvert, effacé par l’afflux de mots, le monde finirait par venir y renaître, surgissant de ce mouvement même qui d’abord l’a annulé et qui, maintenant, lui offre cette vivacité dont jusque-là il paraissait privé. Oui, écrire ce serait d’abord cela : s’asseoir pour voir se lever le monde dans le jour du langage. Et, d’une voix presque muette — d’un souffle engendré par les mots et qui les porte —, ne cesser de célébrer cette beauté, répétant comme une prière muette cette phrase si simple de Beckett : « Je regarde passer le temps et c’est si beau » ( Un homme assis et qui regarde).
C’est un livre écrit entre 1998 et 1999 que choisit de lire Saint-Paul, « La brûlure » paru aux éditions Lettres Vives. De son livre voici ce que nous révèle son auteur :
« D'où m'est venu ce poème ? Je dis bien ce poème, non pas ces petites choses éparpillées sur la page auxquelles on donne aujourd’hui ce nom, mais ce qu’autrefois on appelait ainsi : ce mouvement de langage vaste et réglé – près d’un millier de vers répartis en dix-huit chants – explicitement inscrit pour moi dans la tradition, européenne mais peu représentée en France, de la poésie de la méditation, dans laquelle il s’agit toujours de « sentir la pensée et penser le sentiment », selon la belle formule de Miguel de Unamuno. Oui, d'où m'est venu ce poème ? De cette « brûlure », peut-être, qui lui donne son titre, de ce passage du souffle qui vous traverse et, quel que soit le nom que vous lui donnez – amour, poésie ou vie –, qui vous emporte plus loin que vous et vous met dans la bouche une voix que vous ne vous connaissiez pas, une voix où s’est mise à résonner, comme un écho lointain mais obsédant, l'immensité sans forme ni limites de l'épouvantable, du merveilleux de l'indescriptible réel. » * ..... tu ne sais rien et tu sais que quelque chose t'attend c'est comme un matin plein de lumière un silence ou un visage qui se penche mais c'est le soleil tu ne peux pas le voir ou cette blancheur tu marches à la rencontre tu as un corps si léger qu'il est le monde il y a la montagne comme une main l'air qui passe une colline de fraîcheur il y a dans chaque mot une brûlure et tu dis tu es cet air cette colline tu es la vie contre la mort tu me brûles je n'écris pas pour demain pour dans cent ans mais pour maintenant pour que le oui traverse le non que le non soit la force du oui * ... Je m’approche de toi l’usure des jours Nous marque au coin des yeux je te prends les mains Elles sont froides je souffle tu me brûles Chaque fois c’est comme la dernière fois Je te serre je veux être cet instant Je ferme les yeux tout est présent le monde Est un seul éclat il brûle lui aussi On voudrait toujours garder cette brûlure Pour s’y consumer et comme le phénix En renaître illuminés de tout ce feu Je me demande encore ce qu’est l’amour Cette folie de faire tourner le monde Autour d’un même centre rose et mortel Je sais qu’il n’est pas de réponse je sais Que c’est se vouer à la perte et aux larmes Mais malgré tout j’ouvre les bras je dis oui
*** |
|
Jacques Canut
Brigitte Maillard
15/09/2016
|
Christian Saint-Paul débute son émission par des réflexions d’Andrée Chedid dans « Terre et poésie » publiée en 1956 : « La poésie suggère. En cela, elle est plus proche qu’on ne le pense de la vie, qui est toujours en deçà de l’instant qui frappe. » Cet « instant qui frappe » nous allons le retrouver avec les poètes de cette émission. Tout d’abord, Roland Nadeau, qui a été mis en musique et chanté par Lucienne Deschamps, comme de nombreux poètes contemporains dont notre ami Bruno Doucey. De Nadeau, elle chante « ne meurs pas » ; diffusion de cet extrait du CD « poètes XXI », production Vive Voix, distribué par EPM/SOCADISC.
Jacques Canut poursuit inlassablement son œuvre poétique. Nous avons toujours rendu compte de ses « Carnets confidentiels » de cette écriture centrée sur l’essentiel d’un instant de vie saisi comme une vie entière. Une pensée épurée, désencombrée de toute fioriture désormais pesante, qui fait le constat d’un bonheur que l’on croyait perdu, mais qui transparait dans un quotidien qui, au fond, nous sauve de l’habitude. Jacques Canut est un homme lourd d’un vécu impossible à renaître, mais ce n’est pas un homme habitué. La poésie qui n’a cessé de l’habiter, lui donne à voir le monde dans son étrange beauté. Même si elle se cache dans la tendresse toujours vive pour le chat, pour le paysage familier, l’amour des mots et la dépendance à la pensée. Tous ces dizaines de Carnets confidentiels seront, c’est à espérer, un jour réunis dans une anthologie. Il faudra y inclure ses autres livres, dont certains écrits en espagnol et publiés à Pampelune, à Palencia ou à Buenos Aires.
Lecture d’extraits des recueils de Jacques Canut.
Un dimanche aux nuages opaques, pour effacer une profonde torpeur je partis en auto voir je ne sais quoi... des champs boueux, des collines écrasées par le ciel d’hiver. J’arrivai en cette petite bastide * dont le nom se rencontre fréquemment dans la péninsule ibérique et me ramène en ces cités lointaines où tant de souvenirs m’interpellent avec émotion. Dans les trois rues principales et sur la place centrale quelques ombres ou silhouettes seulement. Au fond des bars l’œil du téléviseur clignotait pour de rares clients désemparés comme s’ils n’avaient pas quitté leur morne demeure...
Coupé de l’agitation du monde dialoguer avec son passé ?
*Mirande (extrait de Palabras recobradas / Paroles retrouvées édition bilingue Calamo) *** Capter le mouvement perpétuel des vocables.
La pelote des mots heurte le fronton de la lumière brise la coupole des pensées, et sentiments. S’évader avec ses ailes de cristal. *** D’Europe, pendant la prison de la guerre, l’Argentine : Terre promise où attendaient des nuits d’espérance et de paix veillant à travers le clignotement de la Croix du Sud ; et des jours, magnétiques reflets parcourant la pampa.
(extrait de Indomables palabras / Indomptables paroles éditions Calamo, bilingue) *** Comme ce poète a(d)mi(ré) disséquer en syllabes si peu de mots ? Atteindre le fond ultimement secret de soi-même ?
(extrait de Copie Blanche - 5) *** Tous les livres de Jacques Canut sont à commander chez lui : 19 allées Lagarrasic 32000 Auch. *** Dans une précédente émission consacrée à Brigitte Maillard, le compte-rendu de l’émission se terminait par ces mots : Brigitte MAILLARD : une artiste qui a trouvé une fidélité, une matrice, une constance dans l’expérience de la vie, qu’elle a su traduire dans une langue qui la transcende. A lire et à suivre !
C’est tout naturellement que nous revenons vers ce poète qui a fait paraître aux éditions Monde en poésie : « Couleur poème » avec le peintre Thibault Germain (10 €).
Une nouvelle publication de Monde en poésie éditions. Un dialogue entre Brigitte Maillard et le peintre Thibault Germain, une rencontre à la croisée des Arts dans cette nouvelle collection, Dialogue en poésie.
Avec Couleur poème, poème et peinture font route ensemble. D'accords en désaccords, de miroirs en reflets naissent ainsi nos dialogues humains, notre quête fervente de savoir. Le dialogue est la parole qui traverse les amis du chemin. Cette nouvelle collection de Monde en poésie éditions sera ouverte à la rencontre humaine. Au-delà des Arts, avec la Vie et ses artisans de paix.
Une résonance, un chemin se crée entre les mots et la peinture de Thibault Germain et la poésie de Brigitte Maillard. Elle amorce le dialogue :
Du bout des doigts je dessine la lune le jour apparaît quelques montagnes un arbre ou deux et puis des fleurs une rivière quelques pierres (...)
Il poursuit :
Oui, comme une nuit sabotée de l'âme aurait fait naître l'amour d'un cauchemar. des collines qui jettent une ombre musicale dans nos yeux. (...)
Brigitte Maillard reprend également aux éditions Monde en poésie « La simple évidence de la beauté » illustré des photos de l’auteure, 8 €.
Son activité poétique ne se borne pas à l’édition ; elle participe activement dans sa Bretagne, à Quimper, à des animations et fait partie des instigateurs du salon du livre de sa ville. Voit sur notre site : http://les-poetes.fr/acctualite/actualites.html
Lecture d’extraits des livres de Brigitte Maillard.
Tu n’iras pas à Rio mais vers le Monde Tu verras comme il s’ouvre Et la terre comme elle tourne Tu verras l’amour qui passe et sa galère Le chant des mots et des sirènes La tour membrée au point d’attache La valse vienne pour te le dire
Tu verras dans l’entre-deux de tes passions Courir le coq dans la basse-cour Tu verras Le chant des âmes au bord des dieux Plonger la mer dans les détails Porter secours au bras qui pousse À la douleur du tyran Tu verras vivre la folie au bout du sein Et tu verras la tête qui se décolle Dans l’atmosphère des senteurs Il y fait doux
Tu verras le monde se prendre à son revers Danser le vide autour du rien La mer courir après les flots Se défaire de l’abri et y poser sa main *** Donne-toi à l’espace Il est ta nature
Qu’il te déchante Ou te reprenne dans les airs
Il est de pluie tu es de rêve Tu danses sous la mer Au doux chant des baisers
Quel regret a porté ta mémoire ? *** L’onde court dans ma main Chatoie au cœur de la fibre Se soumet-elle au vent qui passe ? Elle est Regard vers l’ordinaire Lumière des yeux dans la tempête ***
Pose ton visage Sous le vent des ramiers
Ecoute
Le monde de demain
Absolu
On garde le silence Le souffle tient lieu de vie *** |
|
Christian Saint-Paul à Totana en Andalousie, un des lieux "d'Indalo" paru à Encres Vives
Christian Saint-Paul
08/09/2016 01/09/2016
|
Après « Syllabes » qui constituait le n° 450 d’Encres Vives (le n° 6,10 €, abonnement 34 € à adresser à Michel Cosem, 11, allée des Allobroges 31770 Colomiers), Simone Alié-Daram fait paraître « Désinvolte Eros » Poésie , Copy Media, 10 € à commander par mail : daramalie@free.fr Ce nouveau livre de poèmes prolonge cette vision nostalgique, qui dominait dans « Syllabes » et fatalement douloureuse du monde qui s’enfuit, mais toujours avec cette lucidité digne, presque stoïque, où tout pathos est banni, comme tout ce qui est superflu. « Désinvolte Eros » avec sa couverture en lettres rouges et sa plume de paon en illustration, semble fixer les intuitions prophétiques gravées dans « Syllabes ». La plume remplace fièrement la plante qui sème à tous vents qui illustre « Syllabes ». C’est que le temps a déjà fait sa besogne. Il ne s’agit plus de semer, mais de récolter : de dire ce qui fut et ce qui est. Le poème gagne alors en intensité. Et tout le livre s’inscrit dans une haute densité qui en fait le plus grave de toutes les publications de Simone Alié-Daram. Le renoncement comme un repli sur soi, est un acte d’une grande spiritualité chez cette auteure qui est viscéralement amoureuse de la vie. Le poème se fait bref. Il jette aux orties tous les accoutrements inutiles de la langue, pour dire la douleur, l’effort, mais aussi la certitude d’avoir su garder l’essentiel : Je suis en toi encore / Tu es en moi toujours. La mémoire, celle des sens est toujours vivace, et offre ce bonheur que rien ne peut atteindre, de revivre les « heures si douces / si intenses ». Oui, Eros est bien désinvolte. Comme tout puissant, il règne avant tout, sans regarder ses ravages : Les larmes sont au bord de moi Elles me dissolvent Elles m’englobent Je n’ai plus de corps Plus de cellules Je suis un lac empli De dévastation de toi Perdue Quand tu me parlais grec Je buvais les phonèmes Et nous étions vivants D’amour et de lettres. * Flotter dans une espèce d’absence Cuirassé de questions insolubles Presque mort, tout à fait rien, Grignoté de désirs empruntés Hors de soi dissous dans une eau saumâtre Donner un coup de pied dans le fond de l’oubli Et se retrouver noyé par la pluie Quand les souffles font les lettres danser Et les avenirs pavés de coquelicots. * Mais chez cette poète, qui a tant appris de la vie, et qui lui a tant donné - et pas seulement par le langage comme hélas tant de nos poètes régnants, mais aussi par son engagement épique de médecin - la coutumière fréquentation du gouffre, n’a pas détruit sa volonté tenace d’Espérance : Je suis l’épouse ultime La dernière empreinte La dernière connivence La dernière fusion Le dernier embrasement Je sais que tu m’attends. * A lire sans attendre ! * Les éditions Cardère publient : la parole comme un cristal de sel de Marie-Françoise GHESQUIER, illustrations de l’auteure, 82 pages, 12 €.
Cerceau du poème, la parole tourne sur elle-même, sans fin nous dit cette artiste à la fois poète et plasticienne, que l’on avait découvert à Encres Vives avec son recueil « Aux confins du printemps ». Un très beau livre, d’une mise en page parfaite que les illustrations confirment en livre d’artiste dans sa forme (pour 12 € !). « Le poème est toujours marié à quelqu’un » proclamait René Char qu’elle cite. On ne sait à qui sont mariés ces poèmes de Marie-Françoise Ghesquier, à la nature, au vent, aux oiseaux, aux cygnes comme aux signes. Une poésie ample, de célébration et d’interrogation. Une fascination pour le pouvoir des mots même si ceux-ci sont là : Les grands sentiments repliés en mouchoirs de poche, tout froissés, très petits, dans les fleurs blanches au bord du talus. * Lecture d’extraits.
Neige de fleurs tremblantes. Contre l’ivresse des prés d’un vert d’herbe neuve, l’aubépine vacille en nuages de poudre blanche. La paupière mauve des nuages se lève sur l’œil flamboyant. On regarde le monde comme s’il brûlait le cœur. Les saules au sourire penché se vêtent d’une lumière salée. Peu à peu l’aube monte aux paupières à travers les reflets d’ailes moirées. * Les chauves-souris inscrivent dans leur ronde fébrile un cercle de ronces grises au-dessus des prés sombres. Les boucles de leur valse d’épines attachent la parole aux buissons taciturnes. À mesure que se fane le rose du jour, les cursives illisibles se brouillent derrière la ligne obscure des arbres. L’ombre bleuie du ciel bascule cobalt et les mots glissent sur la pente raide de la nuit. * Tourterelle au collier noir dans sa tourelle de feuilles crénelées. Son chant roux à la verticale des arcs qui brisent les certitudes. Les branches en croisées d’ogives happent le vide. Les diagonales nervurées cisaillent la nef aux poignets. Les vitraux bleutés du ciel coulent en lumière profonde. Rayons de sang clair le long des arcades cintrées cerclant les peurs empierrées. * Une poète à suivre. * Le n° 456 d’Encres Vives est consacré à Eric Chassefière qui y publie « L’inaccessible ici » 6,10 € à commander à Michel Cosem, 2, allée des Allobroges, 31770 Colomiers, abonnement 34 €. Illustration de couverture : Catherine Bruneau
Éric Chassefière, né en 1956 à Montpellier, habite Paris. Directeur de recherche en physique au CNRS, il étudie l'évolution du système solaire et des planètes, et dirige un laboratoire de géosciences à l'Université Paris-Sud. Il a très tôt écrit de la poésie, mais n'a commencé à publier qu'à la fin des années 2000. Sa poésie a été longtemps (et est encore) imprégnée par les émotions ressenties dans la nature, héritages de l'enfance. Il s'agit pour lui de reconstruire cette enfance perdue, en l'enrichissant des multiples prolongements de sa mémoire dans l'instant présent suscités par le travail d'écriture. Sa poésie est sensuelle, proche du corps qui sans cesse cherche à habiter l'espace autour de lui jusque dans les moindres détails, à s'agrandir. Autrement dit, vivre sempiternellement en poésie au sens littéral, en s'ancrant dans une relation secrète et forte au monde qui l'entoure. Il a publié ses textes dans plusieurs revues de poésie : M25, L'Arbre à Paroles, Verso, Poésie/Première, Décharge, Friche, Comme en Poésie, À l'index, Traction-Brabant, Pages Insulaires, Fermentations, ainsi que dans trois anthologies : Parterre verbal anthologie n° 2 (Visages de Poésie), Anthologie tome 5 (Jacques Basse, éd. Rafael de Surtis), Anthologie des auteurs des éditions de l'Atlantique (429e Encres Vives). Il a obtenu en 2015 le prix Giorgios Sarantis pour Le Peu qui reste d'ici (Rafael de Surtis) et a créé avec Jacques Fournier l'action Poeziences de la Diagonale Paris-Saclay destinée à faire se rencontrer scientifiques et poètes. Dernières parutions : Jusqu’au bout de la vie et Carnets du Vietnam, en co-écriture avec Catherine Bruneau (Encres Vives), Déambulations du sable (Alcyone) et L’Absent (La Porte, 2016). Lecture d’extraits. Sur quel chemin me suis-je égaré / quelle main m’a parlé / a tenu au secret de sa paume / ma tempe bruissante encore / de l’aube intérieure du rêve / en quel nulle part de ma conscience / où pour un instant / s’étaient joints les deux fleuves / me suis-je éveillé hésitant / entre ce personnage que j’étais encore / et l’être de mémoire qui perçait / reprenait corps à la matière des choses . * Le dimanche 10 octobre 2015 eut lieu la remise du Grand Prix de Poésie des Gourmets des Lettres sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Le lauréat Christian Saint-Paul reçut de Francis Grass, maire-adjoint à la Culture de la Ville de Toulouse le diplôme et la médaille de la Ville de Toulouse pour son recueil INDALO (Encres Vives, 6,10 € à commander à Michel Cosem, 2, allée des Allobroges, 31770 Colomiers) qui est un regard sur les terres andalouses de la province d'Almería. Après « El barranco de la sangre suivi de Lanjaron » toujours à Encres Vives, Christian Saint-Paul poursuit sa démarche de créer des poèmes radiophoniques sur les lieux qui façonnent sa vie. « El barranco de la sangre » qui a pour cadre toujours l’Andalousie, très exactement La Alpujarra, lieu d’origine d’Isabelle son épouse, est toujours à écouter sur le site « les-poetes.fr » : http://les-poetes.fr/doc%20sonore/son/saint%20paul/index.htm Et un CD rassemble 3 poèmes radiophoniques publié en 2003, aujourd’hui épuisé, mais que l’on peut emprunter à la médiathèque José Cabanis de Toulouse. Indalo se situe toujours en Andalousie, mais dans le région côtière d’Almeria.
L'indalo est une figure préhistorique qui se trouve dans l'Abri des Ruches (Abrigo de las Colmenas) et dans la grotte de los Letreros, dans la municipalité de Vélez-Blanco (province d'Almería, Espagne). Il s'agit d'une peinture rupestre de la fin du Néolithique ou Âge du cuivre, qui représente une figure humaine avec les bras étendus et un arc en ciel sur ses mains. Durant des siècles, avant qu'il ne soit catalogué, ce symbole était vu comme un symbole de chance et considéré comme un totem dans le nord et l'est de la province d'Almería, et particulièrement à Mojácar, où il était peint en ocre sur les maisons pour les protéger des orages et du mauvais œil. On l'appelait le muñequillo mojaquero. Depuis de nombreuses années, l'indalo est le symbole de la ville d'Almería, de sa province et de ses habitants. (extraits de Wikipédia)
Christian Saint-Paul a publié plus d'une vingtaine de recueils dont dernièrement à Encres Vives : Les ciels de pavots, Pour ainsi dire, Akelarre la lande du bouc, L’essaimeuse, Ton visage apparaît sous la pluie, Des bris de jours, L’enrôleuse, Tolosa melhorament, Les plus heureuses des pierres, Hodié Mihi…, J'ai les ailes de L'Aigle Blanc; chez d'autres éditeurs : L’unique saison (Poésies Toutes éd.) Entre ta voix et ma voix (Revue Multiples N°73 éd.,) Vous occuperez l’été (Cardère éd.). Il vit à Toulouse où il anime depuis 1983 une émission hebdomadaire "les poètes", le jeudi de 20 h à 21 h sur Radio Occitania (93,8 Mhz) rediffusée sur http://les-poetes.fr.
Voici ce qu’écrit la poète plasticienne revuiste Cathy Garcia : Indalo de Christian Saint-Paul – Encres Vives n°441, avril 2015. Format A4, 16 pages, 6,10 €. C’est à une très belle flânerie andalouse que nous convie Christian Saint-Paul dans ce 441ème Encres Vives, placé sous le signe de l’indalo, la figure préhistorique qui est devenu le symbole de la ville et de la province d’Almeria, et qu’on pouvait déjà voir peint sur les maisons en guise de protection contre les orages et le mauvais œil. Christian Saint-Paul a le don de nous faire vivre les paysages, les lieux et leur histoire au travers de son regard de poète doublé d’un talent de conteur, et il ne fait pas que raconter ce qu’il a vu, il nous le fait voir, littéralement, c'est-à-dire ressentir aussi.
« La nuit encore/le soleil étouffant/mutile la fermentation du sommeil/Nous vivons désormais/lovés dans ce désert/où la terre n’est que/poussière montant au ciel/ » Christian Saint-Paul a le regard d’un poète convaincu, tel Machado, de l’absolu nécessité d’être homme, en toute humilité, un homme à qui rien n’échappe, ni la beauté des lieux ni « des îlots d’immeubles/parsemés le long d’avenues/vides – sans utilité-/témoignent de la chute folle de la finance. » Le poète ne fuit pas le malaise, il l’affronte, le dénonce et ainsi « Nous apprenons à apprivoiser le vide/créé par l’appétence de l’homme. » Pas d’Andalousie sans l’ombre de Lorca, pas d’Espagne sans le souffle fiévreux d’un Don Quichotte, les eaux fortes de Goya et les « yeux noirs de feu névrotique » d’un Cordobès. Christian Saint-Paul nous emporte à la rencontre de l’âme andalouse, du duende tapi dans ses tréfonds. Une âme trempée « dans le souffre du soleil ». Ombre et lumière, voilà l’Andalousie et « la Bible infinie des étoiles ». Des pierres, des fantômes et des Vierges tristes, des enfants vifs sous des peaux brunes, de la ferveur et des brasiers lumineux. Des plaies de guerre, le sang des fusillés et des religions qui se côtoient dans de grands jardins, où coulent des fontaines, des forteresses et « les indénombrables châteaux en Espagne ! », des prières et « des rancœurs d’un autre âge qui agitent les cargos aux amarres. Indalo est un beau périple, oui, qui ne peut laisser indifférent, car pourrait-il y avoir meilleur guide qu’un poète amoureux de la terre qu’il foule, et dont il sait voir, tous temps confondus, l’endroit et l’envers, le visible et l’invisible, le bonheur comme les larmes ? Cathy Garcia Lecture in extenso d’Indalo, poème radiophonique pour Radio Occitania. Extraits : INDALO 1- La nuit encore le soleil étouffant mutile la fermentation du sommeil. Nous vivons désormais lovés dans ce désert où la terre n'est que poussière montant au ciel en d'étranges colonnes. Des îlots d'immeubles parsemés le long d'avenues vides -sans utilité- témoignent de la chute folle de la finance. D'immenses panneaux mendient un regard de compassion pour des paradis ruinés mort-nés. Nous apprenons à apprivoiser le vide créé par l'appétence sans mesure de l'homme. Le soleil dilue ces territoires abîmés dans la fusion de midi et enlace la mer qui console. Elle règne ici à un kilomètre de nous dans ce lieu abusivement nommé Vera Playa. Le soir du balcon dans les collines sèches qui mènent à elle nous guettons les lapins leur queue blanche réfléchissant la lune. Le vent charrie les mauvais jours une odeur de fosse ouverte. Quelle blessure inflige ce deuil continu de cadavres fantômes ? 2 - Vera ville où culmine le soleil dans une purulence torride. Mais l'ombre dans un jardin public l'éclaire généreusement d'une note avenante sur la magnificence des villas volets clos dépitées d'un réel toutes à leur silence. Et il n'y a que le silence l'après-midi pour rendre la ville à elle-même. Plus tard l'intime reprend pied dans l'alternance de l'ombre et du soleil. Ombre ou soleil selon sa fortune l'aficionado s'installe dans la houle des arènes. Sang mêlé des taureaux dans le sable doré où s'étire la tragédie. Ombre des grands figés dans leurs photographies bons aujourd'hui pour le musée taurin. El Cordobes et son visage soudain fermé à la joie démente de la foule des yeux noirs de feu névrotique qui défient la mort rature d'une misère vaincue. Dans le passage surplombant le toril je heurte ma tête à l'arche de pierre et m'affale sonné comme le taureau qui n'a pas vu venir l'épée. Se peut-il que la mort dissipe toute question ? 3 - Dimanche de fête à Vera. Les éclairs cinglants du soleil de septembre lacèrent la ville. L'anodin n'a plus cours dans les rues désertées. Tous attendent à la sortie de l'Ermitage la Vierge des Vergers. Cette forme qui s'approche submerge le destin d'un été qui décide de survivre à sa propre saison de secouer l'éternité par la liesse et l'étourdissante chaleur. La lumière vient du Tout elle dévisage la ville qui célèbre l'absolu du simple. Dans la fournaise tirée par un tracteur la Vierge des Vergers sublime le charivari des fidèles et des sans dieu de Véra. La vie se fête dans ce masque rayonnant où chacun clame sa faim de l'unique. Cette incise ardeur résonne comme une pluie miraculeuse. Le vent léger la porte à la mer avec le crépitement des sabots des cavaliers andalous. Comme au carnaval des chars fleuris précèdent la Vierge et des fillettes ravies en robe longue et talons hauts dansent. Les fandangos et autres bulerías martèlent de grâce la Romería de Vera. Les chants achoppent sur les rêves endormis et la procession marque le pas devant l'église Santa Maria de las Angustias. La Vierge des Angoisses qui prédit le bonheur dans les cieux fond toujours en larmes sur son socle dans le chœur de l'église. Une grille empêche d'approcher la statue couronnée en robe bleue et or. La douleur ce dimanche est jetée au puits la Vierge des vergers impose la béatitude des chants profanes et des rires à gorge déployée. Deux religieuses une blanche et une noire en habits et foulards gris sortent de l'église saluer l'autre Vierge et s'épongent abondamment le front. Des poncifs s'échinent dans le chaos fraternel des antinomies. Pour dissoudre tant de chaleur le soir nous nageons dans la mer agitée apaisés par le vent et les vagues et sur le sable refroidi tard après le coucher du soleil nous élisons une présence dans la Bible infinie des étoiles. *
16 - Est-il vrai que c'est la rivière qui a décidé de bâtir la ville au pied des grottes et de lui donner son nom : Cuevas de Almanzora ? Cette rivière asséchée dans l'air inflammable de l'été. Les maisons troglodytes du Moyen-âge ont été cédées aux gitans et à ces nouveaux immigrants venus de la mer vendre leurs bras dans les champs. La ville fut riche de l'exploitation des mines de plomb puis des mines d'argent. Et le marbre de Macael n'est pas loin. Vestiges du faste passé deux maisons éclairent les rues de leurs azuléjos - mosaïques au mur jusqu'au toit -. Et ces faïences impriment au regard la Bible selon Cervantès l'incarnation de l'Espagne : Don Quichotte flanqué de Sancho Pença. Don Quichotte qui savait que chacun est fils de ses œuvres : "nadie vale mas que nadie" que sa Dulcinée est fille de ses œuvres et que les vertus corrigent le sang. Le "Quijote" désarçonné mordant la dure poussière de l'Espagne vaincu par les moulins à vent. La ville aussi cogne sa noblesse à l'impossible. Près de l'église aux deux clochers rehaussés d'un obélisque et sous l'horizon remarquable d'une girouette et d'une croix trois hommes blanchis et tannés par tant d'années palabrent gravement : la patronne de la ville la Vierge Carmen sera-t-elle canonisée en mai 2015 ? Interrompant la dureté de leurs chuchotements l'un d'eux vient me taper sur l'épaule. Dans un aparté généreux il m'invite mieux qu'à courir au Pérou à me rendre à la mairie qui est dit-il plein de piété la fierté de la ville. La belle bâtisse apprêtée comme une reine appartint au curé de Cuevas de Almanzora. Loin des livres de messe il passa là toute une vie penché sur la beauté de l'Art. Avant de rejoindre le reflet des ombres peintes par Andrea Juliana artiste italien de son siècle et de se disperser dans les cendres en 1844 il fit don à la ville de sa riche demeure différant ainsi les dévoiements du temps. Le peintre italien a laissé à la postérité et aux citadins une Descente de la Croix un Jugement de Salomon et au plafond du bureau du maire un Char de la Victoire tiré par des paons. Mais quelle victoire s'avance dans cet accoutrement dans l'eau nuageuse du plafond ? Celle de José Maria Muñoz qui fit don de dix mille douros à la ville pour panser ses blessures lors de l'inondation de 1879 et qui après l'accomplissement de son philanthropique dessein fut appelé le Santo Negro : sa statue en bronze sur la place de la Constitution ayant pris la couleur de la nuit épaisse des jours sans lune. Au château du Marquis de los Vélez - le plus beau du Levant - maintenant mausolée de l'art contemporain Francisco Abuja proclame que "l'Art alimente la paix". La paix Goya la trouvait-il dans ses eaux fortes ? Celles exposées au château sur la tauromachie les vociférations de la foule comme décor dans l'arène. Toute la couleur d'Espagne est dans les eaux fortes de Goya et l'Espagne pure couleur se résume dans la corrida. Engeance des toreros les tourbillons des capes brûlent de folie leurs bras armés. Saignée rouge des bêtes et des hommes. Virilité ancrée à la mort. Chevaux mules chiens tués au combat et ce maestro les pieds attachés assis sur une chaise leurrant le taureau avec son sombrero. Et ce fauve minotaure enragé qui atteint les gradins tue le maire de la ville et Charles V qui fourrage de sa lance royale le garrot vacillant de la bête brave au-delà de l'insolence des cornes. Regard goyesque promontoire du langage de l'opaque vanité meurtrière où s'embue le courage. * Ce poème radiophonique, ainsi, a été lu sur les ondes de Radio Occitania.
|
|
04/08/2016
|
|
|
Bruno Durocher
28/07/2016
|
Les éditions Caractères dirigées par Nicole Gdalia poursuivent avec succès la publication de l’œuvre complète de Bruno Durocher. A ce jour les trois tomes ont été publiés et les lecteurs ont ainsi accès à tous les écrits de cet auteur majeur du XXème siècle qui a marqué de son empreinte indélébile la poésie française et le quartier latin où il vivait et travaillait. A l’occasion de la parution de cette œuvre complète, Christian Saint-Paul revient sur la vie et l’héritage de cette figure unique de la littérature du siècle dernier, écrivain, dramaturge, poète, philosophe et éditeur. « Je suis Polonais. Juif. J’ai vécu dans les camps. Je m’appelle en poésie Bruno Durocher. » Celui qui se présente ainsi un soir d’octobre 1950 à Claude Couffon et aux jeunes poètes de Lettres Mondiales n’a pas encore trente ans. Il a pourtant tant vécu. Il a souffert, pleuré, prié, il s’est soumis au destin et puis s’est arraché, dans le hasard des êtres, à « la gueule de l’épouvante ». Ses années passées à Sachsenhausen et à Mauthausen ont changé son regard sur le monde. Pourtant, avec une espérance têtue, il n’aura de cesse d’ouvrir en grand ses mots sur une vie neuve et battante. A conquérir et à partager. Il est né le 4 mai 1919 à Cracovie sous le nom de Bronislaw Kaminski. Elevé dans le catholicisme paternel, il se convertira violemment au judaïsme de sa mère. C’est un jeune homme précoce, dévoré de poèmes. Bruno Durocher (1919-1996) Les livres de l’homme Œuvre complète Tome 1 À l’image de l’homme - poésie - À dix-sept ans, son recueil Przeciw (Contre) lui vaut d’être appelé « le Rimbaud polonais ». Pour lui, tout cela, très vite, sera histoire ancienne. À sa sortie des camps, il va choisir la France. C’est en 1945 qu’il arrive à Paris. En quatre années à peine, il apprend à écrire la langue de son nouveau pays. En 1949, Pierre Seghers publie ses premiers textes, Chemin de couleur. « Vous êtes un des nôtres », va lui dire Paul Eluard. Et sûrement pas des moindres… Embarquant ses mots dans un tourbillon d’hallucinante humanité et de proximité de l’extrême sensible, Bruno Durocher est un des grands poètes de ce difficile XXème siècle. Mais il se veut aussi passeur. Cette même année 1949, il fonde avec Jean Follain, André Frénaud et Jean Tardieu, la revue Caractères dont il sera bien vite seul responsable. Elle À paraître le 30 avril 2012 Depuis 1950 Editions deviendra aussi sa maison d’édition. Bruno Durocher a publié Pierre Jean Jouve, Fernando Pessoa, Tristan Tzara, Raymond Queneau, Jean Cocteau… Il fait aussi appel à Picasso, à Braque, à Arp, à Villon. Son travail d’éditeur ne doit pas faire oublier son œuvre. Plus d’une trentaine de titres, de sa grande fresque poétique (À l’image de l’homme), à un roman largement autobiographique (Le livre de l’homme), à son théâtre, son témoignage poignant sur les camps de la mort, ses textes en prose, ses essais. Jérôme Garcin, en 1979 dans Les Nouvelles littéraires écrivait : « Bruno Durocher possède plus d’une raison pour combattre, à coups de phrases cinglantes et nues, le silence et la nuit. Son travail d’éditeur mériterait l’attention du grand public. Un jour peut-être… » Il est temps. Une des préoccupations majeures de Bruno Durocher fut la privation de la Liberté. Si essentielle qu'elle en est oubliée par ceux qui la possèdent ou croient la posséder. Il faut probablement avoir éprouvé son absence, son manque pour l'évoquer comme le fait Bruno Durocher, avec une si vive émotion. Bruno Durocher, né Bronislaw Kaminski le 4 mai 1919 à Cracovie (Pologne), a été un météore de l’avant-garde poétique polonaise. Surnommé à 17 ans “le Rimbaud de la poésie polonaise” pour ses recueils Poèmes barbares et Contre, il n’aura pas le temps de publier son texte La Foire de Don Quichotte, qu’il avait lu à ses amis au Théâtre Cricot. En effet, il est arrêté en septembre 1939 à Gdansk, au bord de la Baltique, où les allemands venaient de débarquer pour envahir la Pologne. S’en suivent six longues années de camp de concentration comme prisonnier politique, dont l’essentiel à Mathausen… Libéré le 5 mai 1945, il arrive à Paris, ayant perdu toute sa famille. Il décide de devenir écrivain français. En 1949, Pierre Seghers publie son premier recueil de poésie, Chemin de couleur. Il est alors salué par Eluard, Cendrars, Reverdy, Supervielle, Char, et beaucoup d’autres de ses pairs. Il décide ainsi de fonder en 1950 avec Jean Tardieu, Jean Follain et André Frénaud, la revue Caractères, qui se doublera très vite de la maison d’édition du même nom. De grands auteurs français et étrangers y seront publiés. Décédé en 1996, Bruno Durocher, Prix Europe posthume en 1998, figure aujourd’hui dans de nombreuses anthologies et dictionnaires, dont le Dictionnaire des Écritures migrantes, parût à l’automne 2010. Certains de ses livres sont traduits et publiés à l’étranger, et un hommage lui a été rendu en 2006 par la BNF pour les dix ans de sa mort. Des travaux universitaires en France et à l’étranger sont même consacrés à son œuvre. La publication de tous ses écrits a été réalisée pat les éditions Caractères sous la forme d’une anthologie de trois tomes et d’un album. Le tome III ( 602 pages, 32 €) consacré au théâtre et essais, comporte une partie d’humour sur les histoires du monde communiste, « comme un souffle de survie, de résistance active par le rire » commente Nicole Gdalia dans son introduction du livre, mais aussi des « Propositions » dont elle précise qu’il s’agit de « constats de moraliste qui jouent de la provocation et de l’humour, aboutissent toujours à la poésie, « besoin primordial de l’Homme... là où la quête de l’Eternité fusionne avec l’amour et la solidarité... pousse à la révolte, contre toutes les contraintes ». Les livres de Bruno Durocher : Œuvre Complète Tome I: les livres de l’homme - poésie - Tome II: les mille bouches de l’homme - prose - Tome III : métamorphoses de l’homme - théâtre et essais - Tome IV : album de la vie de Bruno Durocher Lecture d’extraits de « les livres de l’homme » tome III, Théâtre et essais « métamorphoses de l’homme » Dans la société capitaliste, la concentration des capitaux donne une puissance encore jamais égalée à l’argent. Ce rouleau compresseur écrase tout élan, toute énergie qui ne sont pas dirigés vers l’efficacité commerciale. L’esprit se meurt. La société dite « socialiste » fait du monde qu’elle gouverne une caserne où l’on défend de penser au nom de principes abstraits. Le rêve est défendu ici et là. Le désordre qui règne dans la politique mondiale pousse les nations et les Etats à s’armer, à se haïr et à se battre. Au-dessus de ce spectacle, est suspendue la destruction atomique fabriquée dans les usines des grandes puissances. La révolte du subconscient humain, qui voudrait se sentir en sécurité, qui voudrait jouir de la vie, éclate depuis le début de ce siècle dans l’art et dans la littérature. Elle se manifeste par l’apparition de mouvements politiques de plus en plus aberrants. Le génocide entre dans les mœurs. Elle marque de son sceau les mouvements de la jeunesse : les beatniks, les hippies, la drogue. Et, sans doute, si la société ne se transforme pas, si elle ne met pas fin à la puissance de l’argent, à la menace de destruction atomique, à l’esclavage borné pratiqué par les communistes, la révolution déferlera sur le monde et détruira tout. Sauf à trouver une idéologie, une vision nouvelle de la société, car elle risque d’être uniquement dévastatrice. Pour moi, la seule issue salvatrice à l’impasse actuelle serait l’acceptation de la loi révélée, de la vérité de Dieu Un, de la spiritualité et de la justice de la religion mère de l’Occident. * Il n’y aura donc plus de Juifs en Pologne. Ce pays se blesse lui-même. Les meilleurs poètes, philosophes, scientifiques étaient des juifs. La Pologne s’appauvrit. Mais le sang juif est entré à jamais dans le sang de ce peuple. Il restera enjuivé. Quels sont les détours du destin ? Les générations se suivent, les peuples se combattent. Les individus apparaissent et périssent. L’instinct de posséder, d’accaparer, d’engloutir dirige les mouvements des êtres vivants. Où est la place d’un sage ? Où est la place d’un vrai Juif ? * Les fesses humectées du sang de la virginité luisent dans le crépuscule comme l’indice du péché. Le plaisir est égal au plaisir. C’est pourquoi les navires naviguent entre les yeux et les châssis des fenêtres lointaines. Ils apportent le froment, l’or et les duvets des caresses. Ils arrivent par les chemins, par les mers, par les cols de montagne de tous les coins de la terre. Les travées des ponts les portent sur leur dos. Un millier d’yeux les guettent dans chaque paysage. Mais la visière est fermée devant le visage du sourire. Les pauvres animaux ne peuvent pas fléchir le sort. Ils passent à gué par les couleurs des fleurs et meurent emprisonnés par le venin des étamines. Alors ils rentrent dans la somnolence. Entre-temps un espiègle joufflu engendre les vesses-de-loup et rissole la frimousse de son sosie découpé dans un miroir. C’était vraiment un morceau friand. Pouvoir disséquer son propre corps, sauver le cœur de son altération, trier les nerfs, farfouiller dans l’estomac, entrelacer les veines, siffler dans l’œsophage, se connaître. * |
|
21/07/2016
|
|
|
14/07/2016
|
Christian Saint-Paul signale la parution de « À l'éveil du jour » de Brigitte Maillard, éditions Monde en poésie, 130 pages, 12 €. A l'éveil du jour de Brigitte Maillard est publié dans un agréable format poche dans la collection «L'écriture du poète». Brigitte Maillard, auteur interprète, vit sur la côte sud du Finistère. Elle a publié deux précédents ouvrages de poésie : La simple évidence de la beauté (Atlantica) et Soleil, vivant soleil, préfacé par Michel Cazenave (Librairie Galerie Racine). Elle livre dans ce récit une expérience humaine, son expérience, qui l'a menée, pas à pas dans un parcours douloureux, de la maladie à la «vraie vie» et à la force vivifiante de la poésie. Un témoignage intime du retour à la vie qui a valeur universelle. Prose et poésie, ponctuées de citations puisées dans les lectures qui la ressourcent (Novalis, Tagore, Apollinaire, Char, Guillevic, Cheng...), cheminent ensemble et transcendent les limites génériques du récit. C’est la relation poétique d’une expérience humaine vécue comme un appel à la « vraie vie » pour que naisse le jour. Une aventure en poésie qui conduit l’auteur aux portes du silence. Ce récit témoigne par la douleur et la joie de cette clarté vibrante qui nous entoure. Une vie dont nous sommes avant tout le vivant poème. Brigitte Maillard auteur interprète raconte son combat contre un cancer du sein, puis une leucémie. Un témoignage intime du retour à la vie. "Un appel à laisser tomber les masques, les histoires figées de nos vies humaines. Un appel à vivre la beauté". Lecture d’extraits. Le regard intérieur met en route un nouveau ressenti. Est-ce folie ? Non, tout cela est surtout beaucoup plus grand que nous. L’émission « les poètes » reviendra sur ce livre et sur cette auteure. *** Christian Saint-Paul reçoit Hervé TERRAL qui vient parler de son dernier livre : « L’Occitanie en 48 mots » aux éditions IEO, 218 pages, 14 €. Professeur émérite de sociologie à l'université Jean Jaurès de Toulouse, il a publié plusieurs ouvrages sur la culture occitane, dont La langue d'oc devant l'école, aux éditions IEO et Figures(s) de l'Occitanie. XIXe-XXe siècles. Voici ce qu’écrit l’éditeur : 48 mots choisis pour, du néophyte curieux au militant, avoir plus qu'un aperçu des différents aspects de la langue et de la culture occitanes, qui font ce socle commun sans lequel il n'y a point de débat. 48 mots, comme autant d'entrées dans la pensée et les enjeux de la langue et de la culture occitanes. Pour mieux (se) comprendre et se connaître. Pour tous. 48 mots. Savant ou léger, sérieux, ironique ou caustique, Hervé Terral dresse, sans en avoir l'air, un état des lieux de la culture occitane, de ses aspirations et de ses contradictions, qu'il nous fait partager avec talent. Et voici l’excellent article rédigé par Colette Milhé, « Hervé Terral, L’Occitanie en 48 mots », Lectures dans http://journals.openedition.org/lectures/14805 : « Hervé Terral, sociologue de l’éducation à l’université Toulouse le Mirail, est l’auteur de plusieurs livres touchant aux questions occitanes. Il propose dans cet ouvrage de « faire mieux connaître la civilisation d’oc, celle d’hier, celle d’aujourd’hui, au lecteur quel qu’il soit » (p. 11), du simple curieux au militant convaincu. Pour ce faire, il a choisi la forme du dictionnaire puisque le livre rassemble 48 articles (en fait 49), rangés dans l’ordre alphabétique. Cette forme autorise donc plusieurs types de lecture, linéaire ou entrée par mots. L’auteur n’indique pas ce qui a présidé au choix de ces mots-là. On peut cependant les classer sommairement en quelques grandes catégories : « art de vivre » (gastronomie, chants populaires, jeux traditionnels, taureaux…), religion (protestants, juifs, croisades…), histoire, fêtes, arts (littérature, chanson, arts visuels…), « mythologie occitane » (Cathares, Montségur, paratge…), militantisme occitaniste… L’auteur définit ainsi le terme : « Paratge dérive de par, égal : les hommes sont égaux. Terral recourt pour l’essentiel à des sources bibliographiques diverses (littéraires, historiques, militantes…) et construit ses articles de différentes manières. Il peut par exemple se placer dans une perspective historique, situant des phénomènes (le catharisme, les troubadours…) puis exposant les appropriations symboliques postérieures qui en sont faites. Ainsi, écrit-il : « Aujourd’hui les cathares sont partout… et nulle part, puisqu’ils ont été exterminés entre le XIIe et le XIIIe siècle ! » (p.46). Dans certaines entrées, l’auteur « cerne » le mot par une succession de citations. Dans un autre registre, il liste des personnages (musiciens, cinéastes, peintres, savants, hommes politiques…) nés en Occitanie. Dans ce livre érudit, dont le style fluide rend toutefois la lecture accessible, l’auteur évite un écueil de taille par rapport à son ambition scientifique : écrire un ouvrage militant. S’il connaît parfaitement l’histoire du militantisme, des félibres (Mouvement né en 1854, pour l’essentiel littéraire, dont le chef de file était Frédéric Mistral) aux occitanistes, et les conflits violents qui opposent ou opposèrent les deux tendances (voire les conflits internes), Terral évite de s’y immiscer, d’abord en adoptant une perspective historique, ensuite en avouant lire indifféremment dans les deux graphies (la graphie félibréenne proche de celle du français, la graphie classique utilisée par les occitanistes s’appuyant sur celle des troubadours) Ce point peut apparaître comme une hérésie à certains puisque le choix d’une graphie est un des marqueurs de l’engagement dans un camp ou dans un autre et la graphie cristallise en grande partie le conflit entre les deux mouvances… Ensuite, Terral ne plaque pas un discours prêt à l’emploi mais le déconstruit parfois. Par exemple la remise au goût du jour de la littérature des Troubadours (XIe au XIIIe siècle) est l’œuvre des Romantiques au XIXe siècle : « Comme l’Ecosse chère à Ossian […] l’Occitanie devint une terre bénie pour les Romantiques » (p. 183). De même le Catharisme est valorisé par ces mêmes romantiques puis par les félibres et les occitanistes). Soulignons toutefois que, comme l’auteur n’expose pas clairement son projet, qui n’est pas plus explicité par la juxtaposition d’articles, on ne sait pas bien si c’est lui qui caractérise « la civilisation occitane » (qu’entend-il par là ?) entre autres par les Troubadours et les Cathares ou si ce sont les Occitans, ou encore les militants de l’Occitanie, qui se réfèrent à ces critères. Cela pose un certain nombre de problèmes, inhérents à l’idée même d’Occitanie, car il s’agit de phénomènes très localisés, à mettre en regard avec l’immensité du territoire (33 départements). Plus largement, ceci montre la difficulté à unifier un vaste ensemble qui n’a jamais eu de réalité étatique ou politique et dont l’unité linguistique n’est pas admise par tous. Terral en a conscience en évoquant dans son article « Occitanie » la pertinence du choix du terme : « Le problème majeur de cet ensemble est, bien évidemment, celui de son unité, de la conscience et de la reconnaissance de son unité à vrai dire » (p. 168). La forme même du livre ne contribue pas vraiment à le doter d’une cohérence : d’abord, un classement thématique aurait pu amener davantage de cohésion que le classement alphabétique. Ensuite, le projet de l’auteur, présenter la civilisation occitane, repose sur l’idée latente qu’elle existe et présente donc une unité. Plusieurs articles ne manqueront pas alors d’engendrer de la perplexité : les viticulteurs bordelais se reconnaîtront-ils dans les luttes de leurs confrères languedociens ? Les références multiples à Toulouse, où réside l’auteur, parleront-elles aux autres régions ? Les conflits récurrents entre militants motivés par des accusations centralistes permettent d’en douter… Mais en plus, certaines tentatives apparaîtront « tirées par les cheveux » : citons par exemple l’article « Jeux traditionnels » : « L’Occitanie ne se limite pas aux sports consacrés […], même si ceux-ci y tiennent toute leur place – structurante des identités locales » (p. 110). Terral énumère alors les grands clubs de foot, rugby et basket (en omettant au passage Antibes) ; or, rien ne lie en particulier les basketteurs rivaux de Pau-Orthez et de Limoges, surtout pas une quelconque occitanité ! Cet exemple illustre un autre problème de taille : une certaine prétention à l’exhaustivité se manifeste par une tendance au catalogage et à l’empilement. On retrouve ainsi au fil des pages une liste de plasticiens, de cinéastes, d’hommes politiques… dont le seul lien avéré avec l’occitanité, pas toujours assumée d’ailleurs, est d’être nés au-dessous de la Loire. Peut-être eût-il été plus fécond de s’attacher plus spécifiquement à ceux qui se revendiquent ou se disent occitans, pour exprimer ce lien qui fait vivre l’idée de civilisation occitane, sans se départir de l’exigence scientifique. « L’enjeu de ce travail est, on le voit, vaste, un peu démesuré peut-être. Ce sera au lecteur de faire son miel (ou sa critique) en toute liberté. Cela va de soi… Et encore mieux en le disant » (p. 12). Terral invite donc à l’expression. Pour conclure, certains articles, par le foisonnement des détails ou des digressions, reposant souvent sur de l’implicite ou de l’ironie, ne sont pas très clairs pour le simple curieux. Par contre, le livre regorge d’informations et la multitude de références sera une mine pour qui veut faire une recherche sur tel point particulier. » *** Pour Hervé Terral l’Occitanie vit dans l’illusion catalane. Le miroir de la Catalogne, c’est ce que n’ont pas réussi les occitans. Quand on diffuse le feuilleton Dallas en langue catalane, c’est la preuve de l’existence d’un parler catalan généralisé et populaire. L’Occitanie est une illusion mais il n’est pas interdit de faire des rêves. Malgré le cousinage des langues occitanes et catalanes, Barcelone regarde aujourd’hui plus vers Frankfort ou Milan que Toulouse. La posture de l’Occitanie est la formule de Maine de Biran : le moi se pose en s’opposant, formule reprise par ailleurs par les psychologues pour définir les enfants de trois ans. Il existe une forte littérature occitane d’écrivains de langue française, comme Pagnol ou Giono, lequel était farouchement opposé aux félibres. C’est une question d’enracinement. Beaucoup de gens, nous dit Hervé Terral, ont l’occitan derrière le français. En résumé « L’Occitanie en 48 mots » est le livre idéal pour comprendre et cerner le phénomène occitan dans notre culture française. Loin de s’opposer ou d’être une voie parallèle, la sensibilité occitane rayonne dans la langue française elle-même par l’intégration d’un important vocabulaire, mais surtout incarne des valeurs éthiques et culturelles qui honorent notre pays. Ce livre a l’énorme mérite de nous en faire prendre conscience. |
|
Danièle FAUGERAS
30/06/2016
|
Christian Saint-Paul invite les auditeurs à lire :
Anthologie manifeste – Habiter poétiquement le monde, Frédéric Brun (conception, choix de textes et avant-propos), Poesis, mars 2016, 368 p. – 24,00 €
POESIS réunit dans cette anthologie plus de cent auteurs qui rappellent la nécessité d’« Habiter poétiquement le monde ». Cette expression, empruntée à un célèbre vers du poète allemand Hölderlin, n’a jamais cessé depuis deux cents ans d’être citée ou commentée par des écrivains, des poètes et des philosophes de tous les pays. Voici la présentation de son concepteur Frédéric BRUN : « Habiter poétiquement le monde. Cette phrase me revient souvent à l'esprit. Elle circule parfois dans l'air du temps grâce au poète allemand Hölderlin qui a affirmé il y a deux cents ans dans l'un de ses poèmes "Plein de mérites, mais en poète l'homme habite sur cette terre". Selon Hölderlin, l'homme habite naturellement la terre en poète. Novalis, au même siècle que lui a affirmé: "La poésie est le réel véritablement absolu. C'est le noyau de ma philosophie. Plus c'est poétique, plus c'est vrai". Dans ses livres, Novalis nous propose un voyage dans le royaume de la poésie originelle. La courte vie de cet être non seulement poète, mais aussi religieux, philosophe, et scientifique est passionnante. De nos jours, l'attitude poétique est bien absente des sujets traités par les média. La rareté de cette présence ne doit pas faire oublier pour autant sa profonde nécessité. Plus de deux cents ans ont passé depuis la création du poème de Hölderlin. Il ne connaissait pas le matérialisme. Il connaissait la guerre mais il n'a pu imaginer les deux conflits mondiaux du vingtième siècle, ni l'univers concentrationnaire, ni les ravages de Hiroshima, ni le naufrage de notre monde nucléaire à Fukushima. Hölderlin se posait pourtant déjà la question : "Et pourquoi des poètes en temps de détresse?". Cette phrase a fait également coulé beaucoup d'encre. Une grande partie des êtres humains sur terre vivent en état de détresse en raison des inégalités économiques. L'habitat poétique exige une éthique, une manière de vivre qui ne place pas l'économique au centre de l'existence. Ceux qui cherchent le profit à tout prix pourraient partager davantage s'ils habitaient ainsi. Il faut habiter poétiquement le monde pour qu'il ne court pas sans arrêt après la croissance et retrouve l'essence de son existence. Nous ne pouvons y parvenir que quelques instants seulement, car il est bien souvent impossible dans la spirale globale de faire autrement. Il faut tenter de le faire avec le plus de réceptivité possible, en contemplant les beautés qui nous entourent, s'en nourrir, s'en inonder l'âme et les yeux en regardant plus attentivement chaque jour, le ciel, la mer, l'écume, les arbres, le sourire d'un enfant avec les yeux et l'esprit du poète. Cette attitude poétique pourrait, si nous étions plus nombreux à en prendre conscience ou à l'adopter, devenir également un acte politique et écologique afin de participer au changement du monde ». Des nombreux commentaires suscités par cette très intéressante anthologie, retenons celui de François Xavier : « Qu’elle est loin, si loin, perdue semble-t-il, envolée, dissipée oubliée disparue la fameuse sentence de Malraux, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas – ou religieux ou mystique –, selon les variantes, car, en effet, jamais ô grand jamais le ministre de la Culture du Général de Gaulle ne prononça unetelle phrase. Cela provient d’une légende qui s’est construite depuis les années 1960, et obscurcit sa réelle « vision » qui réclamait un « supplément d’âme », selon l’idée de Bergson, plutôt qu’un vil retour au communautarisme (sic). En effet, l’urgence de la situation requière une prise de hauteur, autant dire une prise de risque, un lâcher-prise me glisse dans l’oreille mon ange gardien, puisque le marché financier décide de nos vies, que le politique a failli, que les militaires traînent encore les pieds pour remettre la maison en ordre, demeure, mes amis, ne demeure plus que l’utopie, la poésie en autre terme, et avec elle l’immense cortège de plaisirs qu’elle véhicule, transmet, libère… Oui, ne vous en déplaise, puisque tout s’effondre, soyons fous, dignes, et avec honneur, en souvenir de l’orchestre du Titanic, lisons, buvons, chantons, aimons-nous jusqu’au bout de la nuit, fumons notre dernière cigarette (en musique), et feu d’artifice !
Frédéric Brun y croit, lui, encore un petit peu ; il a sans doute – certainement – raison : « Il faut que l’homme habite poétiquement ce monde, qu’il cesse de courir après la croissance pour retrouver l’essence de son existence. […] Il doit tenter d’exister avec le plus de réceptivité possible, en contemplant les beautés qui nous entourent, en s’en nourrissant, s’en inondant l’âme et les yeux, en essayant chaque jour de regarder plus attentivement le ciel, la mer, l’écume, les arbres, le sourire d’un enfant, avec les yeux et l’esprit du poète. »
Lu comme cela, j’entends déjà les cyniques dire que c’est cul-cul, sortant Gombrowicz de leur chapeau, magicien de l’instant, sans l’avoir lu sans doute, mais cela fait bien dans le dîner en ville aux frais du contribuable. Alors laissons à Frédéric Brun sa candeur, car sans candeur point d’avenir. Se lever chaque matin est déjà un défi, et pas seulement pour ceux qui allument directement leur télévision pour suivre l’évolution de leur portefeuille sur Bloomberg-TV… Car, n’oublions pas que « la poésie fut créée en même temps que le monde » (August Wilhem), ce qui lui confère une certaine maturité, pour un medium de naïfs (sic), si bien que souvent la philosophie s’invite entre les vers, faisant de la poésie « l’institutrice de l’humanité » (Schelling), rien de moins !
Au-delà de son évolution, des querelles entre athées et provocateurs qui ont cherché à faire évoluer son langage, la poésie demeure hors champ, comme dirait un sociologue, car « sous la poésie des textes, il y a la poésie tout court, sans forme et sans texte » (Artaud) ; une manière de dire combien sa présence est indispensable pour le bien-être de l’Homme, son équilibre, son épanouissement ; sans doute une raison pour laquelle elle est galvaudée, décriée au profit de Facebook et d’émissions de télévision débilitantes. Tant que les gens regarderont Hanouna au lieu de lire, la société continuera à s’effondrer… Si la poésie « ne peut appartenir à aucun système d’idée » (Pierre Jean Jouve) elle offre la possibilité de « penser et se penser en images » (Reverdy). Ainsi, le crétin qui éteint enfin sa télévision recouvre par enchantement les capacités de son cerveau, puisque la poésie « ne dépasse pas l’homme. Elle le prouve » (René Ménard). Alors tout changera : un idiot de moins devant sa télévision c’est une voix de moins pour l’escroc politique qui est derrière et un mode de vie qui change, une manière de voir le monde – et donc les Autres – et d’apprécier autrement les possibles offerts. Faut-il encore savoir qu’ils existent ! Gaston Bachelard l’a écrit, pour s’ouvrir au Monde il faut donner « plus d’attention à la rêverie poétique » ! Ce que confirme Kenneth White quand il dit que le poète n’est pas mondain car il doit refuser le monde pour réintensifier son être… »
C’est en ressentant ce qui est poétique qu’on le connaît et qu’on le comprend. Giacomo Leopardi, 1821
C’est à la fois par la poésie et à travers la poésie, […] que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. Charles Baudelaire, 1857
Le monde dans un homme, tel est le poète moderne. Max Jacob, 1922
L’expérience poétique est une révélation de notre condition originelle. Et cette révélation se résout en une création : celle de nous-mêmes. Octavio Paz, 1956
La poésie est la fondation de l’être par la parole. Heidegger à propos d’Hölderlin, cité par Roberto Juarroz, 1980 ».
En lisant ce livre, nous retrouvons beaucoup de passages que nous avons lus, parfois il y a longtemps, et qui ont été très judicieusement mis en exergue. C’est un travail que tout poète ou lecteur passionné de poésie a commencé à entreprendre ou aurait voulu faire, et qu’il est heureux que quelqu’un, Frédéric BRUN en l’occurrence l’ait fait pour nous. Et l’originalité vient de ces ajouts de nos contemporains comme Edgar Morin, Hubert Reeves ou Pierre Rabhi. Un excellent outil de travail pour tous ceux qui poursuivent une réflexion sur la poésie. * Christian Saint-Paul signale également la parution de : « La cimenterie » de Christophe LEVIS aux éditions Encres Vives collection Encres Blanches (couverture d’André Falsen), 6,10 € à commander à Encres Vives, 2, allée des Allobroges, 31770 Colomiers. Nous retrouvons dans cette nouvelle publication, le style bien identifiable de Christophe Lévis. Un ton déclamatoire qui ne s’embarrasse d’aucun superflu ; pas d’adjectifs en trop, une économie de mots pour racler la langue jusqu’à l’os. Préférer l’os et sa moelle cachée à la chair. La parole est saccadée, heurtée comme si elle ne pouvait résister à un coup de gueule, mais qu’il faut simplement amener vers son chemin de vérité. Pour cela, il faut la retenir dans son élan qui pourrait être dévastateur. Il faut l’enfermer dans l’intimité d’un parler humain. Alors, Christophe Lévis innove un peu dans la forme qui est la sienne et il a recours aux parenthèses, pour assourdir la violence des mots qui jaillissent en prophéties. Les parenthèses servent aussi à l’extension des menaces par ce poète prophète à chacun et chacune :
(Si tu pars tu nous manques Tu sais tu nous vaux peut-être plus ou autant qu’un contrat malicieux
Comme chacun à chacune dans les lunes de nos cibles
Mets-toi en possession Tu refuses ? Tu seras puni(e) Oui puni(e) ! ) * Lecture d’extraits.
(Dans les décombres en scène des nations des fredaines
Les quolibets des colibris vantards foudroient le ciel leurs saisons hivernales
Par delà les retards du jeu mangent des histoires d’acides et de rouilles démembrés
Leur catatonie est infâme de lueurs sous les salières renversées, les coupes de peau brûlée) * (Carapace voulue du crabe duc arable dans les terres vertes d’ordre
L’orbe de la rose tendue vers l’ailleurs
Frémissement de la soie dans les froides contrées du sel du mors de l’âne bâté) * (Contritions malheureuses, le viaduc par là passé ne démord pas d’un brin
La recouvrance aride et l’aspic vénéneux capitulent face aux cent irrésolus viatiques) * (Ce qui est si petit étrange incertain
Un malaise au décor les ombres de pluies sadiennes
Ego démesure Un tatouage de passage
Ce petit bout de loi de roulis machinal) * L’émission est ensuite consacrée à l’invitée : Danièle FAUGERAS qui vient présenter :
« Polisseur d'étoiles » œuvre poétique complète de Federico García Lorca collection PO&PSY avec des encres de Anne Jaillette, dans une traduction nouvelle à une seule voix, la sienne, à elle, Danièle Faugeras. 1142 pages, 25 €.
Depuis longtemps cette directrice de la collection PO&PSY (avec Pascale Janot) chez éres éditeur à Toulouse, traduit les auteurs. La traduction de l’œuvre poétique complète de LORCA fut une tâche passionnante qui l’occupa de façon discontinue dix années. Il fallait en effet trouver la bonne condition pour restituer cette poésie une et variée... comme le poète lui-même "qui, au quotidien, se démultipliait en quatre ou cinq Federico - citadins, transfuges, cosmopolites, indolents, sensuels, tristes ou cérébraux "-, pour restituer cet "éclat pur du diamant de l'émotion" qu'il savait comme personne chercher dans une langue dont la modernité, la profondeur et la fantaisie s'accommodaient parfaitement de cette diversité. Federico García Lorca (1898-1936) fut tout à la fois poète et dramaturge prolifique et talentueux, peintre, pianiste et compositeur. Tous ceux qui l'on connu ont vu dans le poète un être génial. "Son œuvre maîtresse, c'était lui", a dit Buñuel, qui fut de ses amis comme maints autres créateurs : Salvador Dalí, Rafael Alberti, Manuel de Falla... Son œuvre, profondément ancrée dans les paysages naturels et humains de son enfance, tout imprégnés de culture andalouse, et néanmoins en perpétuelle recherche, comme en témoigne l’implication du poète dans le mouvement d’avant-garde connu comme « génération de 27 », est une des expressions littéraires déterminantes du 20e siècle. Il fallait une lecture à une seule voix pour tenter de restituer la richesse thématique et stylistique de cette écriture multiple et une, où se conjuguent modernité, profondeur et fantaisie. C'est ce que Danièle FAUGERAS s'est employée à faire avec cette première version française de l'intégralité de l’œuvre versifiée de Federico García Lorca. Federico García Lorca, né à Fuente Vaqueros, près de Grenade en 1898, est l’auteur d’une œuvre inachevée du fait de sa mort tragique, mais sur laquelle le temps n’a pas de prise. Il écrit des poèmes de façon ininterrompue, depuis ses premiers recueils de jeunesse : Livre de poèmes, Chansons (1920-1922) jusqu’à Poète à New-York (1929-1930, publié en 1940), en passant par le très célèbre Romancero gitan (1927). Son engagement pour la cause de l’art dramatique, pendant le bref épisode de la République espagnole (1930-36) produira une œuvre dramatique originale couronnée par sa trilogie rurale : Noces de sang, Yerma, La Maison de Bernarda Alba. La guerre civile de 1936 lui sera fatale : en août, il est abattu par des antirépublicains et son corps est jeté dans une fosse commune à Víznar. Il faudra attendre la mort de Franco, en 1975, pour que soit levé l’interdit de parole sur l’œuvre et la mort de Federico García Lorca. Lors de l’entretien avec Saint-Paul, Danièle FAUGERAS précise sa démarche. Traductrice, poète, elle avait découvert LORCA au lycée à Paris grâce à sa professeure d’espagnol Melle Bermejo (aujourd’hui disparue) qui affectionnait particulièrement les poètes contemporains espagnols en un temps où la barbarie qui a valu la mort à GARCIA LORCA sévissait encore en Espagne. En 2006, l’œuvre de Federico GARCIA LORCA est passée dans le domaine public. C’est alors que Danièle FAUGERAS a voulu réaliser ce souhait de traduire en français la totalité de l’œuvre poétique du poète assassiné. Il fallait donner une perception d’ensemble de la totalité de cette œuvre à la fois unique dans son corpus et exceptionnellement variée. En effet, LORCA a exploré les possibilités de la langue à toutes les époques de son parcours poétique. Alors que la parole de LORCA était interdite pendant la dictature franquiste, le travail de diffusion et de conservation de l’œuvre a toujours été fait par les éditeurs d’Amérique latine (Argentine et Brésil en particulier). Ce qui permettait à la plupart des foyers espagnols de posséder les livres écrits par LORCA. Le génie du poète a été d’allier les choses les plus disparates et les plus contrastées. C’était ancré dans la tradition d’une Andalousie, très mal en point à son époque, mais vivante. LORCA était l’incarnation de l’avant-garde tout en étant un des meilleurs connaisseurs de la tradition andalouse. Danièle FAUGERAS a recherché toutes les références des comptines espagnoles, européennes, d’Amérique du Sud, andalouses, avec lesquelles il utilise des rappels et fait des allusions dans ses poèmes. Il a fallu recouper tous ces éléments là. Les annotations du livre « Polisseur d’étoiles » permettent d’obtenir toutes explications sur le texte. C’est un grand travail pédagogique. Pourtant, révèle Danièle FAUGERAS, la volonté était de privilégier surtout les textes et d’inviter le lecteur à se faire lui-même son sentiment sur ces textes. Mais, malgré tout, il fallait bien expliquer certaines choses. J’ai voulu aussi, poursuit la traductrice, attirer l’attention sur des travaux récents sur LORCA qui apportent un éclairage très neuf. Saint-Paul évoque en citant Armand Guibert et Louis Parrot, la multiplicité des talents de LORCA musicien, peintre, poète, dramaturge, à qui il ne déplaisait pas de laisser croire à son origine gitane. La musique, la poésie ne sont qu’un seul moyen d’exprimer la pauvreté et la beauté des terres andalouses dont l’unité est faite de contrastes. Comme il y a plusieurs Espagne, il y a plusieurs Andalousie. Pour illustrer à la perfection ce sentiment si fort chez LORCA, Danièle FAUGERAS lit « Village » qui définit si bien l’Andalousie.
Village
Entre toi et toi va le haut fleuve du ciel.
Sur les vieux acacias dorment des oiseaux errants.
Et le clocher sabs cloches (sainte Lucie de pierre) s’ancre dans la dure terre. * LORCA est poly forme dans la poésie. En 2011, Po&Psy ont publié « Un grenier d’étoiles », poèmes les plus brefs et les moins connus de sa période de jeunesse. Mais il utilise aussi les formes longues, lyriques comme pour son ode à Salvador Dali, ou même classiques comme les sonnets, qui sont traduits en français avec les rimes. On écoute Vicente PRADAL dans « Gacela de l’amor improvisto ». En écho, Danièle FAUGERAS lit la traduction française :
Première Gacela de l’amour imprévu
Personne ne comprenait le parfum de l’obscur magnolia de ton ventre. Personne ne savait que tu martyrisais un colibri d’amour entre tes dents.
Mille petits chevaux de Perse dormaient sur le place baignée de lune de ton front, tandis que moi j’enlaçais, quatre nuits durant, ta taille, ennemie de la neige.
Entre jasmins et craie, ton regard était une pâle gerbe de semences. Moi, dedans mon cœur je cherchai pour toi les lettres d’ivoire qui disent toujours.
Toujours, toujours : jardin de ma souffrance, ton corps qui me fuira toujours, le sang de tes veines en ma bouche, ta bouche à présent sans lumière pour ma mort. * Lecture par Danièle FAUGERAS de sonnets, d’extraits du romancero, de poèmes à New York. * LORCA avait la prémonition de son destin. Il attrapait le monde dans sa réalité immédiate. Son destin n’a rien d’étonnant. Il ne pouvait vivre dans le monde qui se préparait alors. Quand il a quitté Madrid pour rejoindre Grenade qui aurait pu être un refuge, il était déjà persuadé d’aller au rendez-vous de la mort. N’était-ce pas, s’interroge Danièle FAUGERAS, un sordide règlement de comptes par des gens qui appartenaient à la milice ? Une des personnes à l’origine de sa mort s’était vantée d’avoir privé sa famille de son petit génie. Le franquisme a favorisé les pulsions de cette nature à s’exprimer. Mais LORCA a eu le temps de créer une œuvre ! Son théâtre est toujours joué dans le monde entier. Il appartient à la culture de l’humanité toute entière. Ses écrits ne vieilliront pas. Ils sont universels. Sous le temps très court de la République espagnole, il a fait connaître le théâtre espagnol jusqu’au fin fond des villages.
Beaucoup de ses poèmes sont adressés à quelqu’un. Ce sont des poèmes de circonstance ; les dédicaces sont scrupuleusement retranscrites. Et ce sont des poèmes intemporels ! Il introduit avec une habileté géniale des éléments de l’enfance, la sienne, celle des autres, l’enfance de l’Andalousie. La traduction de toute l’œuvre poétique de LORCA ne fut jamais ennuyeuse, se plait à préciser Danièle FAUGERAS. La passion est restée intacte pendant les dix années de ce travail, car elle avait toujours la curiosité de découvrir où le vers allait l’amener. J’ai essayé à chaque fois de rendre au poème, dans sa forme changeante, son parti-pris, se réjouit la traductrice.
Lecture d’extraits du livre. * MONDE
Angle éternel, la terre et le ciel. Avec bissectrice de vent.
Angle immense, le chemin droit. Avec bissectrice de désir.
Les parallèles se rencontrent dans le baiser. Ô cœur sans écho !
En toi commence et finit l’univers. * PAYS Jets d’eau des rêves sans eaux et sans fontaines !
On les voit du coin de l’œil, jamais face à face.
Comme toutes les choses idéales, ils balancent sur les marges pures de la Mort. * ADIEUX Je me dirai adieu au carrefour pour m'engager sur le chemin de mon âme.
Réveillant souvenirs et mauvais moments j’arriverai au petit verger de ma chanson blanche et me mettrai à trembler comme l’étoile du matin * ET ENSUITE Les labyrinthes que crée le temps se dissipent.
(Il ne reste que le désert.)
Le cœur, source du désir, se dissipe. (Il ne reste que le désert.)
L’illusion de l’aurore et des baisers se dissipent.
Il ne reste que le désert. Un onduleux désert. * Élégie du silence Juillet 1920
Silence, où mènes-tu Ton cristal tout embué De rires, de paroles Et des sanglots de l’arbre ? Comment laves-tu, silence, La rosée des chansons Et les taches sonores Que les mers lointaines Laissent sur la blancheur Sereine de ta cape ? Qui ferme tes blessures Quand au-dessus des champs Quelque vieille noria Plante son dard indolent Dans ton cristal immense ? Où vas-tu si te blessent Les cloches au couchant Et troublent ton eau dormante Les volées de couplets Et le grand bruit doré Qui tombe en sanglotant Sur les monts azurés ? L’air coupant de l’hiver Met ton azur en pièces, Et tes haies vives se brisent Sous la plainte retenue D’une froide fontaine. Où que tu poses tes mains, Tu trouves l’épine du rire Ou bien le brûlant coup De corne de la passion. Si tu vas vers les astres, Le bourdon solennel Des oiseaux de l’azur Rompt le bel équilibre De ton crâne caché. Et toi qui fuis le son Tu es le son lui-même, Fantôme d’harmonie, Fumée de cri et chant. Tu t’en viens pour nous dire Par les nuits obscures La parole infinie Sans souffle et sans lèvres. Tout perforé d’étoiles Et mûri de musique, Où mènes-tu, silence, Ta douleur surhumaine Douleur d’être captif De la toile mélodique, Aveugle à jamais, dès Lors, ta source sacrée ? Aujourd’hui tes ondes, Troubles de pensée, emportent La cendre sonore et La douleur de jadis. Les échos de ces cris À jamais en allés. Le vacarme lointain De la mer, momifié. Si Jéhovah s’endort, Monte sur son trône brillant, Casse-lui sur la tête Une étoile éteinte, Et finis-en avec L’éternelle musique, L’harmonie sonore De la lumière, et puis Reviens à la source Où dans la nuit pérenne D’avant Dieu et le Temps Calme tu jaillissais. * Un cri vers Rome Depuis la tour du Chrysler Building
Des pommes légèrement blessées par de fines épées d’argent, des nuages déchirés par une main de corail qui porte sur le dos une amande de feu, des poissons d’arsenic ainsi que des requins, des requins comme des larmes pour aveugler une foule, des roses qui blessent et des aiguilles placées dans les canaux du sang, des mondes ennemis et des amours couverts de vers tomberont sur toi. Tomberont sur la grande coupole qu’enduisent d’huile les langues militaires, où un homme compisse une éblouissante colombe en crachant du charbon concassé entouré de milliers de clochettes. Parce qu’il n’est plus personne pour partager pain et vin, plus personne pour cultiver des herbes dans la bouche du mort, plus personne pour ouvrir les draps du repos, plus personne pour déplorer les blessures des éléphants. Il n’y a plus qu’un million de forgerons à forger des chaînes pour les enfants à venir. Il n’y a plus qu’un million de menuisiers qui fabriquent des cercueils sans croix. Il n’y a plus qu’une foule gémissante qui s’ouvre la chemise dans l’attente de la balle. L’homme qui méprise la colombe devait parler, devait crier tout nu au milieu des colonnes et se faire une piqûre pour attraper la lèpre, et verser des larmes assez terribles pour dissoudre ses anneaux et ses téléphones de diamant. Mais l’homme vêtu de blanc ignore le mystère de l’épi, ignore le gémissement de la parturiente, ignore que le Christ peut encore donner de l’eau, ignore que l’argent brûle le prodige du baiser et donne le sang de l’agneau au bec idiot du faisan. Les maîtres montrent aux enfants une lumière merveilleuse qui vient de la montagne ; mais à l’arrivée ce n’est que ramas de cloaques où vocifèrent les nymphes obscures du choléra. Les maîtres indiquent avec dévotion les énormes coupoles embaumées, mais dessous les statues il n’y a pas d’amour, il n’y a pas d’amour sous les yeux de cristal immuable. L’amour est dans les chairs crevassées par la soif, dans la hutte minuscule qui lutte contre l’inondation ; l’amour est dans les fosses où luttent les serpents de la faim, dans la triste mer qui berce les cadavres des mouettes et dans le très obscur baiser lancinant sous les oreillers. Mais le vieillard aux mains diaphanes dira : amour, amour, amour, acclamé par des millions de moribonds. Dira : amour, amour, amour, dans son drap d’or frémissant de tendresse ; dira : paix, paix, paix, parmi cliquetis de lames et mèches de dynamite. Dira : amour, amour, amour, jusqu’à ce que ses lèvres deviennent d’argent. Pendant ce temps, pendant ce temps, ah ! pendant ce temps, les nègres qui vident les crachoirs, les enfants qui tremblent sous la terreur blême des directeurs, les femmes noyées dans les huiles minérales, la foule au marteau, au violon ou au nuage, doit crier même si on lui éclate la cervelle sur le mur, doit crier devant les coupoles, doit crier folle de feu, doit crier folle de neige, doit crier, la tête pleine d’excréments, doit crier comme toutes les nuits réunies, doit crier avec sa voix si déchirée jusqu’à ce que les villes tremblent comme des fillettes et que s’ouvrent les prisons de l’huile et de la musique. Parce que nous voulons notre pain quotidien, fleur d’alisier et pérenne tendresse égrenée, parce que nous voulons que s’accomplisse la volonté de la Terre qui accorde à tous ses fruits. * * * Une vraie aubaine ce livre « Polisseur d’étoiles » : tous les poèmes de Garcia Lorca réunis en un seul volume, agréable, magnifiquement illustré et peu encombrant, au format poche, qui trouvera une place naturelle auprès des autres livres du poète espagnol qui marque son siècle et ceux à venir. Merci à Danièle Faugeras pour son travail de traduction et son implication d’éditrice ! |
|
James Sacre
Photo
Jeanne Roux
James SACRE
24/03/2016 |
|
|
Georges Cathalo
16/06/2016
|
|
|
Gérard Zuchetto
09/06/2016 |
|
|
Gérard Zuchetto
02/06/2016 |
|
|
26/05/2016 |
|
|
Rebecca-Behar.
19/05/2016 |
|
|
Monique Lise Cohen
12/05/2016 |
Monique Lise Cohen Les Juifs ont-ils du cœur ? Une intime extériorité Éditions Orizons, 2016 Radio Occitanie, émission de Christian Saint Paul et Claude Bretin, Les poètes jeudi 12 mai 2016
Ce livre vient au terme d’une longue histoire. Il est la suite d’un doctorat de lettres écrit sous la direction d’Henri Meschonnic, et qui fut soutenu en 1989 à l’Université de Paris VIII. Le titre de cette recherche était : Le thème de l’émancipation des Juifs, Archéologie de l’antisémitisme. La soutenance se déroula au commencement des célébrations du Bicentenaire de la Révolution française, et le livre issu de ce doctorat - Les Juifs ont-ils du cœur ? Précédé d’un texte d’Henri Meschonnnic, « Entre nature et histoire : les Juifs » - parut en 1992 aux éditions Vent Terral, toujours pendant cette période de commémorations.
Le doctorat et le livre suscitèrent une profonde incompréhension. Comment critiquer la philosophie des Lumières en pleine commémoration de la Révolution française ? Les Lumières et la Révolution n’étaient-elles pas venues pour « écraser l’infâme », comme disait Voltaire, et laisser grandir la liberté, l’égalité et la fraternité ? On reprocha à ce livre d’être contre les Droits de l’homme et pour le droit à la différence, à la façon de ce qu’on appelait à l’époque « la nouvelle droite ».
Mais le livre ne parle pas de ces questions. Il explique que « la religion du cœur » des Lumières célébrée par Diderot, Rousseau et Kant refuse l’écriture à l’infini des Juifs, parce qu’elle refuse toute écriture et toute littérature, parce qu’elle est une gnose. Et les écrivains des Lumière, sur ce constat d’un excès de l’écriture juive, disent qu’il vaudrait mieux qu’il n’y ait plus de Juifs sur terre. À cause de leur écriture. Cette analyse découle d’une lecture attentive des philosophes et écrivains des Lumières. Henri Meschonnic considéra ce travail de thèse comme une véritable recherche philologique.
Cette recherche n’est pas un rejet des Lumières, ni de la Révolution française, ni des Droits de l’homme. Mais l’approche d’un problème précis, « la religion du cœur » qui, sans être « un détail » de l’histoire, imprègne d’une hostilité gnostique à la Bible et à tout écriture les avancées de l’esprit, de l’histoire et de la littérature. Jusqu’à obscurcir la lecture des grands textes de la tradition, et particulièrement la Bible. Or la Bible - Bible hébraïque et Nouveau Testament - dénonce très explicitement le chemin du cœur.
Que faire de ce double héritage : les lumières de l’esprit et la tradition biblique ?
Peut-être faudrait-il repenser notre tâche, à la manière dont en parlait Léo Strauss dans ses études sur Maïmonide ? La foi chrétienne maîtresse en Occident s’était développée loin des Lumières, et les Lumières avaient voulu bannir la foi au nom de la clarté rationnelle de l’esprit. Il faudrait aujourd’hui penser la foi et les Lumières en même temps, ce qu’avait fait en son temps Moïse Maïmonide. Et restaurer une pensée-parole prophétique, contre les chemins du cœur qui ont aboli ensemble la foi, la loi et les Lumières. Ce chemin passe par l’écoute renouvelée de l’appel biblique à la circoncision du cœur. Une « intime extériorité » qui serait une réponse à cette question étrange : Les Juifs ont-ils du cœur ? Quelle est la problématique du livre de Monique Lise Cohen ?
L’invitation à suivre son cœur apparaît aujourd’hui dans tous les discours, depuis le plus kitch jusqu’aux envolées sociales, politiques et historiques. Elle s’était déployée, à l’époque de la philosophie des Lumières, autour du projet d’une religion universelle et sans texte, que les Encyclopédistes et les Philosophes, Diderot, Rousseau et Kant, appelèrent du nom de « religion naturelle » ou « religion du cœur ». Dans toutes les descriptions et analyses de cette religion pour l’humanité émancipée et régénérée, chez Diderot, Rousseau et Kant, le judaïsme apparaît comme l’anti-modèle, et les Juifs comme porteurs de nombreuses tares devant être éliminées grâce à une « régénération ».
Or la Bible (Bible hébraïque et Nouveau Testament) nous enseigne, à l’inverse, que le cœur de l’homme n’est pas bon, qu’il est ambivalent et que son penchant doit être corrigé. Et cette correction porte le nom de « circoncision du cœur » Le principal reproche fait aux Juifs par les Lumières est celui d’un foisonnement littéraire qui obscurcit la bonne foi et entraine dans son sillage toutes les accusations antijuives et antisémites connues dans l’histoire. Car le chemin du cœur serait celui de la transparence immédiate hors texte et hors langue. Un laisser-faire-laisser-passer où s’abolit le devoir être mais aussi le temps de la lecture lente, difficile et créative. Où nous reconnaissons les attaques contre l’écriture qu’avait dévoilées Jacques Derrida dans ses premières œuvres. Comme l’écrivait Rousseau dans une lettre à Vernès : « La Bible est le plus sublime de tous les livres... mais enfin c’est un livre... ce n’est point sur quelques feuilles éparses qu’il faut aller chercher la loi de Dieu, mais dans le cœur de l’homme où sa main daigna l’écrire. » Le judaïsme serait l’anti-modèle de la religion du cœur des Lumières. Le refus de l’écriture se grossit du discours antisémite et de façon général anti-biblique.
Ce chemin du cœur ira en s’approfondissant dans l’histoire européenne jusqu’à faire du cœur, en l’absence des grands idéologies, religions et traditions qui ont forgé cette histoire, le lieu stable d’une divinisation de l’homme. Alors, nous rencontrons, pour notre temps, Heidegger qui affirme, comme les Lumières, que ce qui est stable et ferme en l’homme est le cœur, identifié au sacré et plus ancien que les dieux. Comment entendre ces résonances qui lient, au nom du cœur, les Lumières et Heidegger ?
Que s’est-il passé entre le cœur des Lumières et le cœur selon Heidegger ? Le mouvement qui emporte le cœur va se muer en une auto-divinisation de l’homme qui n’a plus de comptes à rendre et qui reste seul dans son autosuffisance. Avec Heidegger, cette divinisation est achevée puisque la question de Dieu est effacée. Reste le cœur ou le sacré plus ancien que les dieux.
C’est un long parcours à travers le texte biblique qui pourrait nous éclairer. La Bible enseigne que le cœur n’est pas bon, qu’il est malade et plein de détours. Et qu’il doit être circoncis. Quelle est la signification de cette étrange opération à laquelle Henri Meschonnic avait donné le nom d’une « intime extériorité » ?
Un parcours biblique peut nous éclairer sur ces questions
Depuis la Philosophie des Lumières, l’Occident laisse croire en la bonté du cœur « La Bible est le plus sublime de tous les livres... mais enfin c’est un livre... ce n’est point sur quelques feuilles éparses qu’il faut aller chercher la loi de Dieu, mais dans le cœur de l’homme où sa main daigna l’écrire. » Jean-Jacques Rousseau (Lettre à Vernes)
Les textes du Nouveau Testament évoquent la malignité du cœur en se référant à la loi de Moïse
« Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, débauches, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, ruse, dérèglement, regard envieux, calomnie, orgueil, déraison. Toutes ces vilenies sortent du dedans et rendent l’homme impur. » Évangile de Marc (7, 21-23)
« Ce que j’enseigne ne vient pas de moi mais de Celui qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra au sujet de ce que j’enseigne si cela vient de Dieu ou bien si moi je parle en tirant cela de mon propre cœur. Celui qui parle en tirant ce qu’il enseigne de son propre cœur recherche sa propre gloire, mais celui qui recherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est véridique et il n’y a pas d’injustice en lui. Est-ce que Moïse ne vous a pas donné l’instruction et la norme ? » Évangile de Jean (7, 16-19)
On traduit en général « de mon propre chef » ce que laisse penser le texte grec des Évangiles, mais Claude Tresmontant propose cette traduction « de mon propre cœur », à partir d’une rétroversion hébraïque évidente. Nous lisons en Nombres (16, 28) : « Alors Moïse dit : Par cela vous reconnaîtrez qui est l’Éternel qui m’a donné mission d’accomplir toutes ces choses, et que ce n’est pas de mon propre cœur (en hébreu : ki lo milibi). » Cette expression hébraïque a été traduite dans la Bible des Septante : « oti ouk ap emautou » = « en venant de moi-même » Or c’est la même formule que l’on retrouve dans le grec de l’Évangile de Jean : « poteron ek tou teou estin e ego ap emautou lalo. » Il paraît ainsi évident que le grec « de moi-même » ou « de mon propre chef » traduit l’hébreu « de mon propre cœur ».
Quelle est la loi de Moïse concernant le cœur ?
« Parle aux enfant d’Israël et dis-leur de se faire des franges aux ailes de leurs vêtements dans toutes les générations et d’ajouter à la frange de chaque coin un cordon d’azur. Cela formera pour vous des franges, vous les regarderez et vous vous rappellerez tous les commandements de l’Éternel, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux qui vous entraînent à l’infidélité. » Nombres (15, 39)
Le Livre des 613 commandements, Sefer Ha’hinou’h, classe ce commandement dans la rubrique « sorcellerie, relations avec les idolâtres » et précise que le penchant des yeux conduit à l’impudicité et le penchant du cœur à l’apostasie.
Le cœur de l’homme
« L’Éternel vit que les méfaits de l’homme se multipliaient sur la terre, et que le produit des pensées de son cœur était uniquement, constamment mauvais ; et l’Éternel se ravisa d’avoir créé l’homme sur la terre, et il s’affligea vers son cœur. Et l’Éternel dit : J’effacerai l’homme que j’ai créé de dessus la face de la terre ; depuis l’homme jusqu’à la bête, jusqu’au reptile, jusqu’à l’oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel. » Genèse (6, 5)
Que faire de son cœur?
« L’Éternel dit à son cœur » (Genèse 8, 21). Les scélérats sont prisonniers de leur cœur. Ainsi « l’insensé dit dans son cœur » (Ps. 14, 1), « Esaü dit dans son cœur »(Genèse 27, 41), « Jéroboam dit dans son cœur » (I Rois 12, 26), « Aman dit dans son cœur » (Esther 6, 6). Par contre les justes disposent de leur cœur. Ainsi « Hana parlait à son cœur » (I Samuel 1, 13), « David dit à son cœur » (ibid. 27, 1), « Daniel imposa à son cœur » (Daniel 1, 8), « L’Éternel dit à son cœur »... Midrach Rabba (Éditions Verdier, page 356)
Aimer Dieu avec tout son cœur
« Tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et avec tout ton pouvoir. » Deutéronome (6, 5)
Rachi commente ainsi ce verset : « De tout ton cœur (levavekha, avec deux v (beit) et non levakha) : avec tes deux penchants (= le penchant du bien et le penchant du mal). Autre explication : que ton cœur ne soit pas divisé à l’égard de Dieu. »
La circoncision du cœur « Le Juif ce n’est pas celui qui en a les apparences ; et la circoncision, ce n’est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Epître aux Romains (2, 28-29)
« Vous circoncirez donc le prépuce de votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. Car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand puissant et redoutable, qui ne fait acception de personne ; il est incorruptible. » Deutéronome (10, 16-17)
« Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, pour que tu vives. »
|
|
Jacques ARLET
5/05/2016 |
|
|
photo Louis Monier
Roland NADAUS
28/04/2016 |
Les troubadours ont marqué de façon indélébile la culture occitane. Des créateurs contemporains font revivre avec force leurs œuvres. C’est ainsi que Francis PORNON reprenant l’héritage de René NELLI publie un roman sur Ramon de Miraval, que Michel COSEM écrit sur le troubadour toulousain Peire Vidal et que le compositeur Gérard ZUCHETTO dirige avec génie le groupe TROUBADOURS ART ENSEMBLE et reprend les chants des troubadours. L’émission débute donc avec la vois de Gérard ZUCHETTO qui chante Peire Vidal « Pas tornatz » (TROBA VOX éd. « Performing Trobar Troubadours Art Ensemble Lirica Mediterranea »). L’émission est ensuite entièrement consacrée à l’invité : Roland NADAUS. Poète, romancier, pamphlétaire, conteur, Roland Nadaus a publié sous son nom une soixantaine d’ouvrages. Il collabore à de nombreuses revues en France et à l’étranger et figure dans plusieurs anthologies. Il a aussi bâti une ville dont il fut élu 31 ans, et où il a créé une Maison de la Poésie (Guyancourt/St—Quentin-en-Yvelines) qui vient hélas d’être fermée après 13 ans d’activité intense…. Il a animé une émission mensuelle sur RCF pendant ces six dernières années : « Dieu écoute les poètes », collabore à plusieurs revues francophones et est présent dans de nombreuses anthologies de poésie. Les plus récentes : « Poésie de langue française » (Jean Orizet, Le Cherche Midi) ; « L’insurrection poétique, un manifeste pour vivre ici » (Bruno Doucey) ; « Charlibre » et « L’insurrection poétique » (Corps-Puce). La revue Poésie sur Seine lui a consacré son n° de décembre 2015. Prix international de poésie Antonio Viccaro (« Prix des 3 canettes ») décerné lors du Marché de la Poésie de Paris en relation avec le Festival International de Trois-Rivières (Québec) dont il fut l’invité. Grand Prix de l’Académie de Versailles et d’Ile-de-France « pour l’ensemble de son œuvre ». Officier des Arts et Lettres. Chevalier de la Légion d’Honneur. Officier des Palmes Académique. Et il ajoute, en fin d’émission : abonné au gaz, à l’électricité, à l’internet, au téléphone et…à l’espérance. Dernières parutions : « D’un bocage, l’autre » (Editions Henry) « Un cadastre d’enfance –et quelques-unes de ses parcelles » (Ed. Henry, réédition) « Vivre quand même parce que c’est comme ça » (Ed. Gros Textes, réédition) « Pour le réalyrisme », manifeste-pamphlet (Corps-Puce éditeur, réédition) Il a publié à ce jour cette soixantaine d’ouvrages qui finissent par constituer une œuvre, dont voici la liste : POESIE : Maison de paroles, Mercure de France, 1969 *A un clerc de Babel, Lieu Commun, 1972 * Monde tel, préface de Pierre Leyris, Pierre Jean Oswald, 1975 * 21 placards en forme de poing et de main, Fond de la ville, 1976 * Petites comptines pour un gros cochon, Le Dé bleu, 1977 * Jours à la colle, La Surgeôlière, 1977 * Douze cocktails à servir pour réussir dans l'hexagonerie poétique (plus un treizième), Incandescence, 1978 * Pour un manifeste du réalyrisme..., 1978 * 39 prières pour le commun du temps, Jacques Brémond, 1979 Ecrits d'avant l'écriture, La Bartavelle, 1991* Premier cahier de préhistoire, Verso, 1991 * Je ne tutoie que Dieu et ma femme, Jacques Brémond, 1992 Dictionnaire initiatique de l'orant, préface d’Edmond Humeau ; La Bartavelle, 1993 * Lettre à Saint Glinglin, Jacques Brémond, 1995 Esopiennes, fables en prose, La Bartavelle, 1996* 19 quintils pour finir le siècle ici (plus un pour survivre), Clapàs, 1997 * 365 petits quintils (plus 1 pour les années bissextiles), Jacques Brémond, 1997* En cas d'urgence, quintils, Gros Textes, 1999* Prières pour les jours ordinaires, Editions de l'Atelier, 1999 Le chat (du Chester) d'Alice, Alain Benoît, 1999* Tableaux d'une exposition de Modest M., La Bartavelle, 2000* Giai-Miniet / Nadaus, Del Arco, 2000* Qu'la Commune n’est pas morte, Encres vives, 2001 Nadaus / Giai-Miniet, Ed. Ça presse, 2001* Le sentiment du pas grand-chose, Clapàs, 2002 Dieu en miettes, La porte, 2002 Con d’homme et autres jeux de langue d’ô, Revue Ficelle, 2002, illustrations de Scanreigh Vivre quand même parce que c’est comme ça (anthologie par Jacques Fournier) Le Dé Bleu, 2004, couverture de Ben-Ami Koller* Guérir par les mots (Poèmes médicaux médicinaux et pharmaceutiques), Cadex, 2004, vignettes de Lewigue Les grandes inventions de la Préhistoire, poèmes en prose ; Ed. Corps Puce, 2008 Prières d’un recommençant, poèmes ; Editions de l’Atlantique, 2009* Les escargots sont des héros, (illustrations de Sophie Clothilde) ; Soc et Foc, 2009 Vivre quand même parce que c’est comme ça(Le Dé Bleu), réédition augmentée (couverture de Giai-Miniet) Gros Textes 2012 Un cadastre d’enfance –et quelques-unes de ses parcelles (couverture Isabelle Clément) ; Editions Henry, 2013 Sonnet du masque à gaz (sur une gravure de Giai-Miniet) ; Editions du Nain qui tousse, 2014 D’un bocage, l’autre (couverture Isabelle Clément) ; Editions Henry, 2014 ROMANS, PAMPHLETS et autres :Journal-vrac, Rupture 1981 * Malamavie, Rupture 1982 * Papaclodo, Rupture 1982 * Lettre aux derniers mohicans de la République, Jacques Brémond, 1992 Dictionnaire du jargot des cibistes, Lacour, 1997* K.K. Boudin 1er, roi d'Etronie, La Bartavelle, 1997 * L'homme que tuèrent les mouches, Gaïa, 1996 Le regard du chien, Gaïa, 1997 Le cimetière des sans-noms, Gaïa, 1999 On meurt même au Sénat, Nykta, 1999 Je ne veux pas mourir yanki, Les Cahiers bleus, 2000* La guerre des taupes, Les Promeneurs Solitaires éd. 2007 Devine d’où je t’écris, « fablépîtres », Thomas Ragage éd.2008* Confessions d’un whiskymane français ; Monde Global éd., 2008 Pour le réalyrisme, manifeste-pamphlet, Corps Puce éd. (1981/2012) Les anonymes de l’Evangile, roman, Editions du Signe, 2012 CONTES ET CHANSONS :Contenrêves, Didascol 1980 * Contahue, Les Francas 1982 * Contadia, Les Francas 1982 * Tortue et la caverne, Utovie 1986* Mélodine et Amuselle, Armand Colin 1981 * Loup Gouloup et la lune, Bayard, 2002 et 2007 et 2013 (et 2011 pour la version italienne : Lupo Mangione é la luna). Dans l'oreille du géant, Atelier du poisson soluble, 2002 La pieuvre qui faisait bouger la mer, Soc et Foc, 2009 NOMBREUSES ANTHOLOGIES (*) Épuisés *****
L’entretien avec Christian Saint-Paul
s’amorce par la lecture d’un extrait de « Villes et Vies » publié
à Encres Vives. En effet dans « vivre quand même parce que
c’est comme ça » (Gros Textes éd.) l’anthologie réalisée par
Jacques Fournier, Roland NADAUS a mis en exergue cette phrase
d’Aimé CESAIRE : « Créer un poème et créer une ville, c’est un peu
la même chose ». Car Roland NADAUS est un poète atypique, de ceux qui
sont l’honneur de la poésie. L’image du poète éthéré dans ses limbes ou
dans la majesté de son œuvre en marche, n’est pas celle qui s’attache à
lui. Certains poètes reconnus sont avant tout des mystificateurs, même
si, au fond, leur création poétique, souvent bien supérieure à l’homme,
n’en souffre pas trop. Roland NADAUS, lui, s’est toute sa vie confronté
avec la dure réalité de la vie des hommes. Il les a servis. Il n’a pas
servi que la poésie. Ce fut le maire qui créa une des cinq grandes
villes nouvelles autour de Paris : Saint-Quentin-en-Yvelines.
Aimé Césaire, explique Roland Nadaus, a complètement transformé sa ville
Fort de France à la Martinique, en en faisant une tête de pont, au
moment même où il faisait une tête de pont de son langage. Aimé Césaire
ne peut être réduit à la seule idée de la négritude. Le poète comme le
bâtisseur de ville, dresse des plans, qui parfois le dépassent, c’est le
cas en poésie, mais il vaut mieux que ce ne soit pas le cas dans la
ville. Il y a un geste commun entre la poésie et le bâtisseur de ville,
Aimé Césaire l’a bien saisi. Roland Nadaus qui a exercé les mandats
politiques précisés en début de ce compte-rendu, est un homme d’action.
Une de mes vies a été une vie politique, dit-il. Mais je ne suis pas
venu au monde pour ça. Dès l’adolescence, j’ai perçu que j’étais venu au
monde pour être poète. Mais, issu d’un monde très dur, je me suis lancé
dans une autre orientation, mais les deux n’ont cessé de se combattre et
de se nourrir. Edmond HUMEAU que Roland Nadaus a connu à « La
Tour de Feu », disait : « la contradiction, c’est la vie ». Quand il
n’y a plus contradiction, c’est la mort. Et donc, poursuit Roland Nadaus,
cette contradiction a été parfois positive, parfois négative, mais ce
qui est sûr, c’est que sans la poésie, je n’aurais pas supporté la
politique, et sans la politique, je n’aurais peut-être pas continué à
écrire de la poésie. Des romans, des pamphlets, oui, mais la poésie
peut-être pas. « La poésie m’a sauvé de la politique » révèle Roland
Nadaus lors d’un entretien. Il développe : je suis entré en politique
après un long périple dans les mouvements d’éducation populaire, puis
dans les syndicats, mais sans envisager à l’époque d’avoir les
responsabilités que j’ai eues longtemps. C’était pas mon truc. Je
partais sur des idées simples, de justice, de fraternité, de culture,
d’amour de la langue et des langues, de leur histoire, avec l’envie de
devenir moi aussi un créateur. Puis la vie politique m’a rattrapé. Car
je vivais dans un territoire ancien qui est devenu d’un seul coup, une
grande agglomération. En une génération, nous sommes passés de 1000
habitants à 250 000 ! Tout cela aurait pu m’étouffer. J’avais une idée
un peu folle de l’humanité. Récemment, confie-t-il, j’en parlais avec
Michel Baglin. Nous sommes d’abord des humains humanistes, croyants
ou pas. Or, cette idée je la porte à l’incandescence avec la poésie. Il
y avait derrière : Baudelaire, Rimbaud, Saint Pol Roux et quelques
autres, et la politique de ce point de vue là, dans les tout débuts,
c’était une façon de vivre l’existence poétique quotidienne, puis j’ai
découvert au fur et à mesure que s’accumulaient les responsabilités, en
particulier dans le domaine de la gestion, qu’il n’y avait pas que des
poètes... Mais j’ai découvert bien plus tard que dans le petit monde de
la poésie, ce n’était pas tellement mieux ... L’idée convenue du poète
éthéré est une idée fausse. La poésie engagée a donné de grands poèmes,
notamment dans la Résistance, mais en même temps, elle a donné des gages
de servilité aux idéologies. Il y a eu des odes à Staline. 1. Et ce jour-là, Dieu-le-Verbe prit de la fine poudre d’argile qu’on nommait Kaolin, et il fit un homme blanc - et Il vit que cela était bon. 2. Alors Dieu dit : »Faisons un homme noir à l’image du blanc selon sa ressemblance, afin qu’il soit son frère d’ombre, 3.et Dieu prit une poignée de tourbe et Dieu fit comme il avait dit, et Il vit que c’était bon. 4. Dieu dit : « Il n’est pas sain que ce deux-là soient seuls. Je veux leur faire un autre frère de couleur afin qu’ils appartiennent à Me connaître sous toutes Mes formes et apparences » 5. et Il façonna une motte de lœss qu’Il prit sur les bords du Fleuve Jaune, et Il lui insuffla dans ses narines une haleine de vie, et Il vit que cela était bon. 6. Alors Dieu fit tomber une torpeur sur Ses trois créatures et, pour leur faire une bonne surprise à leur réveil, Il décida de leur donner un quatrième frère de couleur rouge 7. et Il prit un peu de marne en Ses mains d’où naquit l’indien, et Dieu vit que cela aussi était bon. 8. A leur réveil, les quatre frères commencèrent à se chamailler et Dieu, en Sa bonté, décida de leur offrir un autre être encore, afin qu’ils puissent apaiser sur celui-ci leurs colères 9. et faisant un mélange des restes de kaolin, de tourbe, de lœss et de marne, il créa le juif et Il vit que cela était bon 10. car les quatre frères ne se disputaient plus entre eux mais passaient fraternellement leur éternité à bâtir des pièges et à inventer des tortures pour que le juif y succombe 11. alors Dieu vit tout ce qu’Il avait fait, et voici qu’Il décida de chômer un peu et Il s’endormit, et Il vit que cela aussi était très bon. 12. A son réveil, Dieu dit : « Mon œuvre sent la merde : l’homme aurait donc été capable d’inventer quelque chose tout seul » et c’était vrai : Ses cinq créatures avaient tant et tant déféqué, pendant Son sommeil, que le Paradis n’était plus qu’une gigantesque latrine. 13. Alors Dieu prit entre Ses mains toute cette merde humaine, et Il en modela le poète ; et Il vit que c’était bon, que c’était même le meilleur parce que, enfin, la matière allait redevenir Verbe... *** Jacques Fournier qui préface avec brio l’anthologie « vivre quand même parce que c’est comme ça » chez Gros Textes, fait ressortir les principales préoccupations de Roland Nadaus : Dieu, la merde, la fraternité humaine, l’harmonie, la mort. Ce sont ses obsessions et quoi qu’il écrive, il les vit en poète. Jacques Fournier, précise Roland Nadaus, a été directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines où lui, était maire. Cette Maison a été fermée, une décision à 1 voix près, par la nouvelle gouvernance de la Communauté d’agglomération. Elle avait été inaugurée par Jean Rousselot le 14 février 2002, jour de la Saint-Valentin, avec la ministre de la culture et la grande Résistante Lise London. Jean Rousselot a donné son nom à la médiathèque. Elle était gérée en régie directe, comme celle de Paris, par la ville, alors que les autres Maisons de la Poésie sont gérées par des associations. Je l’avoue, dit Roland Nadaus, sans jouer un lyrisme d’escargot, passant devant cette Maison de la Poésie que l’on a fermé, j’ai pleuré. On peut bien le dire quand même !
Le jour de l’inauguration, Jean
Rousselot était déjà très malade. Nous avions mis en œuvre un système
d’assistance médicale. Mais à peine monté dans l’ascenseur, ce dernier
est tombé en panne entre deux étages ! Le 4 mai 2004, Jean Rousselot
décédait, juste après qu’on lui ait fêté son anniversaire. Rousselot,
qui laisse une œuvre et qui avait beaucoup travaillé pour cela, avait
une obsession : peut-être que très vite, il ne resterait plus rien de
cela. Donc, nous, nous avons une responsabilité, celle de contribuer à
faire survivre l’œuvre. La ville de Saint-Quentin en Yvelines, pour
l’inauguration de la médiathèque et Maison de la Poésie Jean Rousselot,
a financé un film sur lui. Nous avions des traits communs, reconnaît
Roland Nadaus. Je me suis fait voler en revenant de son domicile à
l’Etang-la-Ville, tous les livres qu’il m’avait dédicacés. Aujourd’hui
encore, j’ai mal de cela. Je n’ai pu lui avouer d’avoir été victime de
ce vol que quelques jours avant sa mort. C’était un personnage ! Il
avait été commissaire de polie, trotskyste, Résistant, fabricant de faux
papiers, Président de la SGL. Il découvrit que l’URSS n’était pas celle
à laquelle il croyait. C’était un vrai homme de lettres et un poète qui
a sa voix. Il fut très proche de René-Guy Cadou. C’est Jean
Rousselot, intervient Saint-Paul, qui m’a donné cette passion de
connaître tous les poètes. Il y avait, à cette époque, peu de
poètes comme lui, capables de s’intéresser à tout et de connaître un
très grand nombre de poètes, dans les détails. « La poésie ne m’a pas
fait vivre, elle a été pourtant à mes yeux la seule preuve que
j’existe » a-t-il écrit. Lecture de « De la poésie par les simples » ; les simples étant des herbes. La Poésie, traitement du mal par le beau, est une thérapeutique millénaire indistinctement utilisée par les derniers premiers hommes que par le dernier des derniers. Outre son aspect médico-sociétal, la Poésie prend une dimension cosmique à travers différentes pratiques, religieuses ou magiques, mais aussi en tant qu’élément de la vie chaotidienne. Don du Cierre ou de la Tiel, selon la posture ontologique de chacun -. Symbole de régénération autant que de fermentation autistique, manifestation de l’Energie Créative, la Poésie est partie intégrante de notre environnement surnaturellement réaliste : il y a en effet dans la Poésie des ressources que l’homme ne peut puiser ailleurs que dans la femme. Avec l’avènement des néo-post-modernes, l’homme a fait de grands progrès dans la non-connaissance des non-lois esthétiques. La médecine artistique s’est ainsi développée dans une certaine forme de non-pensée ma non troppo pensée, amenant de réels méfaits à l’humanité ma non troppo souffrante. Le petit-bourgeoisisme enculâtro-fellationnel a pu ainsi développer ses tantes-à-cul totalitaires. De nombreuses thérapeutiques empirico-révélées, en particulier l’utilisation des simples, disparurent de l’enseignement officiel et ne se transmettant plus que par la persévérance de certains praticiens du langage convaincus du bien-fondé de ces techniques d’amour qu’on nomme « poèmes ». Grâce à la non-demande d’un non-public non-déçu par ce qu’il ne connaissait pas, mais grâce à quelques belles approches revuistes, la Poésie, médecine par les simples, tend à retrouver la place qu’elle mérite dans le traitement des maladies d’être et la prévention des furonculoses existentielles. *** En conclusion Le principal reproche qu’on puisse adresser à la Poésie, c’est les poètes. Guérir par les mots (Poèmes médicinaux et pharmaceutiques), Cadex, 2004 **** Voici en quels termes Roland NADAUS évoque ce traumatisme de la fermeture de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines : SPLENDEUR ET MISERE D’ERATO Je sais bien que comme l’écrit Brice Parain « la vie privée ne saurait servir de preuve». Mais en l’occurrence vie privée et vie publique se sont croisées : la Poésie en fut cause. Je n’évoquerai ici que deux de ces occurrences : la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines et le sort fait à mon dernier recueil paru par certaine presse régionale. Mais d’abord cette douleur et cette colère ‒ cette preuve aussi que la poésie est bien située dans le champ social et politique : un des premiers actes de la nouvelle majorité qui, à une voix près, gouverne l’Agglo de St-Quentin-en-Yvelines (SQY) a été de fermer La Maison de la Poésie ! J’avais fait bâtir à cette maison il y a plus de quinze ans lorsque, président de l’agglo, j’avais décidé de démissionner pour passer le relais à un successeur. Les années précédentes j’avais inauguré plus de 150 équipements publics, une Université, un Théâtre scène nationale, etc. (et je ne compte pas les implantations d’entreprises comme le Technocentre Renault et tant d’autres). Mais si je n’ai accompli cet acte qu’en fin de mandat (alors que je venais d’être réélu) c’est parce que j’avais été sérieusement échaudé par des refus ‒ parfois virulents‒ lorsqu’il s’était agi d’édifier un nouveau théâtre et de créer une université, par exemple. Les attaques furent violentes et bien souvent mensongères voire calomnieuses. Alors vous pensez : une Maison de la Poésie ! ‒ Même si ce ne devait être qu’un modeste équipement adossé à la future médiathèque Jean Rousselot, à une maison de quartier et une salle d’exposition, mille fois plus grandes… J’obtins un vote positif avec l’assentiment (partiel mais solidaire) de la majorité et l’abstention d’une toute petite partie de l’opposition d’alors. Par contre le gros de celle-ci se déchaîna et, outre quelques injures sur « la danseuse de Nadaus », plusieurs mensonges répandus dans la presse, j’eus droit aux honneurs (!) du mensuel national « Capital » ‒ bien connu pour son attention à la Culture et sa très vive curiosité de la Poésie… Le refrain était le même mais le mensuel y ajouta la perfidie d’un bref extrait d’un de mes poèmes, érotique certes mais devenu pornographique puisque sorti de son contexte : un recueil autour de la… Préhistoire ! Mais j’eus la joie de voir cette Maison de la Poésie inaugurée par Jean Rousselot, en compagnie de Lise London et de la ministre Catherine Tasca. En présence de plus d’un millier de personnes. Et dans mon discours de réponse, j’ai même lu un poème : on m’a rapporté que le maire de Versailles accompagné de son adjoint à la culture, deux de ces rares hommes cultivés dans le paysage politique d’alors (mais ils sont encore moins nombreux aujourd’hui) eurent un échange sur le thème : «Ah, Roland a raison et il a bien du courage, les Versaillais sont trop cons pour accepter ça… ». Mais ce serait trop long à raconter ici : sinon que, preuve par neuf d’un équipement public aujourd’hui en friches, la Poésie a une dimension irrémédiablement politique. Dès l’origine. À moins de la cantonner dans sa version décorative, style pompier ou masturbation laborantesque : petits oiseaux, rimes d’infortune, gazouillis de salon ou incompréhensibles chiures de mouches à épater les gogos. Pendant une quinzaine d’années, sous la direction de Jacques Fournier (que recruta mon successeur) la Maison mena cent-mille actions, accueillit plus de trois-cents poètes (en les défrayant voire en les rémunérant, ce qui est plutôt rare n’est-ce pas ?). Sa petite salle de spectacles (une centaine de places) avec son bar et sa galerie-couloir, entendit et partagea des voix, des œuvres, des créations d’une grande diversité : le directeur jamais ne fut soumis à aucune injonction. Et surtout pas de ma part.
Mais voilà : les opposants hargneux d’hier deviennent en 2014 la majorité revancharde d’aujourd’hui. Et ayant commandé un audit (c-à-d ses résultats !) Ils décident de fermer la Maison, la seule en France, me semble-t-il, à être directement gérée par une collectivité publique. Et siège de la Fédération des Maisons de Poésie En prétextant, entre autres, qu’elle n’accueille qu’une centaine de personnes par spectacle, oubliant volontairement les 3500 autres, chaque année, dans les écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, maisons de retraite, établissements d’insertion, librairies, universités, etc. ‒dont la prison de Bois-d’Arcy ! Mais vous l’aurez compris : plutôt rien qu’une Vraie Maison ! la Poésie au trottoir ! Je suis passé il y a quelques jours devant le bâtiment : une toute petite porte vitrée fermée à clé avec, pour combien de temps, du mobilier urbain sur lequel on peut encore lire un poème. La médiathèque Jean Rousselot ne désemplit pas. La maison de quartier Théodore Monod vit une vie de ruche. La salle d’exposition accueille de très grands artistes autant que des écoliers et des amateurs. Mais la Maison de la Poésie, les « Ils » l’ont fermée. Employés licenciés sauf quelques titulaires reclassés. Toute une équipe démantelée. Un public déboussolé. Et après vous oserez dire que la Poésie n’a rien à voir avec la Politique ‒ ni la Philosophie‒ ? Ce matin-là, devant la porte close, un instant j’ai pleuré. Et puis je suis retourné dans mon bocage, vite fait. Mais bocage si vite défait lui aussi… C’est là ‒ « Ici » pour moi désormais‒ que j’ai écrit à trente ans d’intervalle ce recueil double « D’un bocage l’autre » (Ed. Henry). Dans la première partie, j’évoque ce paysage rural qui est aussi un paysage intérieur : j’ai écrit ça avant que l’imprimeur de mon éditeur d’alors ne fût emprisonné pour une des plus grosses affaires de fausse monnaie. Du coup, voyez ma chance, le recueil ne fut disponible que pour un modeste service de presse (élogieux au demeurant) tout le reste étant mis sous séquestre. Et donc aucune diffusion. Plusieurs années après, un site Internet me demande d’en publier des extraits. Je relis la chose. Et découvre avec horreur que mon bocage n’est plus du tout le même ! Alors j’écris quelques nouveaux poèmes en prose pour crier ma douleur et ma colère. Voici la version 1 de « Bocages » : ARCHIPEL DU BOCAGE C'est mon île. L'archipel de mes yeux. Tous ces prés entre haies vives -Et ces champs où marcher c'est revivre, parce que la boue colle à la vie comme cette herbe aux pattes des bêtes entre ruisseaux lourds et prés mûrs. C'est mon île. -Je n'y mourrai pas : on ne meurt jamais là où c'est déjà revivre -tous les ressuscités vous le diront. Mon île, mon bocage. L'archipel de ma vie. Mes îles vertes sous le vent, ma pluie. ‒J'en suis bête comme un amoureux. Et voici la version 2 qui commence ainsi : LE GRAND MASSACRE Le Grand Massacre a commencé. Ce matin nous avons été réveillés par le chant des tronçonneuses. Ont vite suivi les craquements des émousses et des chênes -qu'on abat. Puis le bruit sourd de leur effondrement. …/… Des engins de travaux publics ont poursuivi le carnage. J'ai bien cru que Jésus-la-Rouille, sur son calvaire de granit, allait y passer lui aussi. Mais le bulldozer s'est arrêté à ses pieds. À la fin de la journée, tandis que le cou du soleil rougeoyait encore, on voyait des fumées noires monter des bûchers. L'odeur violente des branches, des feuilles, des brindilles, arrosées d’huile de vidange pour mieux flamber, et le crépitement de la sève, brûlée vive, donnaient envie de vomir. Aucun corbeau, aucune corneille -pas même une buse : tous faisaient le détour. Dans la nuit clairsemée de braises, seule une dame blanche a traversé le champ de notre regard fasciné -et larmoyant. *** Eh bien même si un hebdo régional eut le courage de me consacrer presque toute une page, je m’entendis signifier par un rédacteur en chef gêné (qui avait pourtant recensé plusieurs de mes livres précédents) : « Non, vous comprenez notre journal ne peut pas se fâcher avec la FNSEA »… Quant aux autres de la PQR, ils n’eurent même pas le courage de m’avouer que c’était « ça ». Eh bien ce « ça » se nomme Poésie. Quand les mains ont des mots. Quand les mots ont des mains. Sans les confondre cependant. Sans les confondre. À la veille des élections départementales puis régionales, interrogé par une journaliste, j’ai proposé qu’il y ait dans chaque région au moins une Maison de la Poésie et, dans les grandes, au moins une par département. Aujourd’hui on en ferme. Roland Nadaus Une autre émission, plus spécialement orientée vers la lecture de poèmes, sera consacrée à Roland Nadaus.
Roland NADAUS
ses publications récentes :
Inauguration de la Maison de la Poésie à Saint-Quentin en Yvelines
par Jean Rousselot et Roland Nadaus
 photo Louis Monier
Roland NADAUS
|
|
jean michel tartayre
21/04/2016 |
Christian Saint-Paul sensibilise les auditeurs et tous ceux qui sont convaincus de l’importance intemporelle de la poésie du bienfait qu’apportent à celle-ci les revuistes. Leur rôle est indéniable dans la diffusion de la poésie aujourd’hui, comme hier. Merci à tous ceux qui consacrent leur temps, leur talent et souvent leur argent, à cette tâche essentielle. C’est ainsi qu’il faut lire la revue Diérèse poésie & littérature en son numéro 67 « Présences » qui rassemble 318 pages autour de poèmes, chroniques, notes de lecture. Un vrai livre, comme d’habitude, au sommaire prestigieux : Giancarlo Pontigia, Richard Rognet, Hélène Mohone, James Sacré, Isabelle Lévesque et tant d’autres. Daniel Martinez, son directeur, signe un éditorial de deux pages et s’interroge : « Serait-ce l’incapacité à demeurer en nous-mêmes qui nous motive ? Le poème soutient le face-à-face de soi et de l’autre, la relation dialogique d’un je et d’un tu. L’écrit nourrit l’amour, l’agapè, entre les êtres - de celui qui écrit à ceux qui le liront - dont la relation est sous la menace constante de la séparation et de la disparition. La poésie, pour approcher cette possibilité, cette aube de la plénitude et du contact avec l’Autre ou l’être-là du monde - avec ses rythmes, ses couleurs, ses concordances éprouvés dans l’immédiateté de leur existence - doit rester ouverte au monde et non pas seulement aux formes et aux mots par lesquels on la représente ou on l’exprime traditionnellement. »
Le n° 15 € , ABONNEMENT 45 € à adresser à Daniel Martinez, 8, avenue Hoche 77330 Ozoir-la-Ferrière *** Cathy Garcia poursuit inexorablement son sacerdoce de revuiste et fait paraître le n° 54 de « Nouveaux Délits » revue vive de poésie et dérivés avec le même succès : illustrations remarquables, qui font un peu de la revue un petit livre d’artiste pour les bourses modestes, sommaire toujours original, en phase avec le monde.
Cathy Garcia, poète, revuiste, photographe, blogueuse, plasticienne s’exprime par tous ses arts et demande à être écoutée et entendue au sens plein du terme : « Exister est un écartèlement permanent. Entre spleen et idéal pensait Baudelaire, mais savoir vivre c’est savoir accepter sans se résigner, savoir lâcher-prise sans lâcher la main de l’autre. Renoncer au bonheur mirage, ces innombrables projections du système sur l’écran de nos désirs jusqu’au viol même de notre intégrité. Achète, consomme, travaille encore pour acheter, consommer sans poser de question et tu seras heureux. Pas encore aujourd’hui, mais demain, oui c’est certain. C’est prouvé par la science. Demain sera le grand jour, demain tu seras riche, le héros de ta vie, admiré, adulé, envié, car tu le mérites. Avec ce qu’il faut de peur pour avoir besoin de se protéger derrière des remparts d’achats sécurisants. Il y a les belles choses, les savoureuses et ce ne sont pas des choses, mais des êtres et des sentiments, des émotions, des sensations, des échanges, des partages, des solitudes aussi, pleines et débordantes de vie. Il y a les peurs oui, innombrables, envahissantes, les mauvais pressentiments, les ennuis à répétition, les injustices, les coups du sort qui s’acharne et tout ce qu’il faudrait comprendre pour transformer, se transformer soi sans savoir s’il faut avancer ou reculer, s’il faut ci, s’il faut ça…. La mécanique enrayée du mental. L’envie de dormir. L’argent reste le problème omniprésent, omnipotent, un piège infâme, le plus toxique des mirages, la plus cruelle des machettes. Cette peur de manquer, de chuter encore plus bas, cette tache sur soi qui s’agrandit et nous définit plus que n’importe quoi d’autre : pauvre. C’est immonde d’être défini par cette tache, tout le monde le sait, mais rien ne change, une seule chose compte : en avoir ou ne pas en avoir. Dans une société aussi férocement individualiste que la nôtre, ce qui fait lien c’est « en avoir », ce qui ouvre toutes les portes, aussi vaines soient-elles, c’est « en avoir beaucoup ». Une seule planète, plusieurs mondes qui ne se côtoient pas. L’un d’eux est en train de dévorer tous les autres. » extrait de ©Ourse (bi)polaire
Le n° 6 € , ABONNEMENT 28 € à adresser à Association Nouveaux Délits Létou - 46330 Saint-Cirq-Lapopie. **** Jacques Canut fait paraître son « Copie Blanche - 5 », Carnets confidentiels - 47 .
Suis-je un auteur à facettes ? Tant d’éblouissements ; auquel me consacrer ?
A trop me connaître conserverai-je le pouvoir de m’exalter ? * Quelquefois je me lève d’un bon œil pour explorer le monde dont je serais le maître ?
Mon esprit, après quelle idée s’épuisera-t-il à courir ?
Des sous-entendus qui désintègrent... Faut-il se répéter pour être un écrivain enfin reconnu ? * Celui qui n’est plus mais fut célèbre, peut-on parler de lui au présent (de vérité générale) ?
Il a passé toute sa vie à penser. Il a redouté toute sa vie de passer. * A commander chez l’auteur Jacques Canut, 19 allées Lagarrasic 32000 Auch. *** Christian Saint-Paul reçoit son invité : JEAN-MICHEL TARTAYRE.
Jean-Michel Tartayre est né le 19 décembre 1966 à Toulouse, ville où il vit. Il enseigne le français, le latin et le théâtre au collège de Saverdun, en Ariège. Il collabore aux revues L’Arbre à paroles, Inédit Nouveau, Isis, L’Ours polar, Multiples, Phaéton, Lelixire et Encres Vives.
Il a publié dernièrement :
Pandore (Encres Vives, 2012). Blue walker (Encres Vives, 2013). Leghorns (Encres Vives, 2013). Marines (Encres Vives, 2013). Rythmes de Chinatown (Encres Vives, 2014). Chromatismes d’un cycle (Encres Vives, 2014). Junk (Encres Vives, 2014). Automne (Encres Vives, 2014). Cité corsaire (Encres Vives, 2015). Lumière crue (Encres Vives, 2015). Canicule (Encres Vives, 2015). Toulouse Blues II (Encres Vives, 2016). Vers l’été suivi de Fractions du jour (Éditions N&B, 2016). Toulouse Blues III (Encres Vives, 2016).
Ce jour il vient présenter son dernier livre paru aux éditions N&B (27 rue Fourcade 31100 TOULOUSE) :
VERS L’ÉTÉ suivi de FRACTIONS DU JOUR 97 pages, 13 €.
La simplicité apparente de ces courts poèmes, sobres et suggestifs, peut faire écho à la sensibilité de chacun. C’est une poésie du quotidien fine et subtile. Elle établit des correspondances entre des sensations, des lieux, des moments, des atmosphères, dans un style épuré et impressionniste. Sa musique, très contemporaine, peut nous accompagner longtemps.
La lumière dans les arbres, Leurs mouvements par elle projetés –
Reflets d’une eau qui danse Et se perd dans le cristallin.
Tel qu’absorbant
Chaque pulsation du bleu.
Au cours de l’entretien avec Saint-Paul, Jean-Michel Tartayre précise sa démarche. Il part des scènes du quotidien. C’est une poésie de sensation qu’il écrit. Car, insiste-t-il, nous sommes mobilisés par nos sens. Et il se fait une interaction entre le dehors et le dedans. C’est une part de soi que l’on creuse. Je crois, conclut-il, que l’on y trouve toujours l’enfance. Garder l’enfance c’est garder en soi la poésie. L’enfance est la pureté du regard sur le monde. Il cite un de ses poèmes : « agressé dans la rue ça arrive » ; oui, cela lui est arrivé, plusieurs fois. Ce sont les aléas du quotidien en ville. Cela a nourri le poème. Ce grand amateur de jazz est très sensible aux voix de baryton. Un collègue professeur de musique lui a révélé qu’il avait, lui Jean-Michel Tartayre, une voix de baryton martin. Ce n’est pas une voix sourde, elle a des nuances claires. Comme ses textes. Sur la forme de ceux-ci, qui laissent place aux marges, aux blancs, le poète Claude Barrère a évoqué une « typoscénie » ; cela lui convient parfaitement. Il se livre à une mise en scène des mots sur la page. Mais cela est sans excès, et surtout sans gratuité. Bruno Durocher, dans les années 70, se souvient Saint-Paul, considérait ces textes de quelques mots qui prenaient toute la page, genre alors en vogue, comme des poèmes en chiures de mouches. C’est loin d’être le cas pour ceux de Tartayre dont le modèle est André Du Bouchet. Tout ramener à soi détruit. La vie est un jaillissement, c’est aller vers l’autre. Les poèmes de JM Tartayre sont aussi des images. Par exemple, celui sur le canal du Midi, canal qui est l’illustration de la couverture du livre (photographie de Dominique Fernandez).
D’un pont à l’autre,
L’eau du canal a changé, vents levés, L’eau à sa surface - assombrie.
Les passants devenus silhouettes improbables Traversent, le temps d’un regard furtif.
La pluie en train de tomber.
Les arbres se découpent sur fond de ciel noir, Bougent leurs branches.
On tente d’échapper, le corps Déjà trempe.
Seuls quelques mots - automne ou printemps ? * L’émission se poursuit par la lecture de textes par Jean-Michel Tartayre.
Elle s’achève sur ce poème consacré au jazz, passion de l’auteur :
Le jazz et ce filet d’eau Quelque part. Ne sachant ni le lieu ni l’origine.
Odeur de neuf dans l’habitacle Du bicorps.
Seul avec soi et cette eau Qui glisse enfin le long des nerfs.
On roule sur l’avenue largo de nuit - Dans les clartés de l’éclairage public.
Le jazz source silencieuse
Où plongé. * Extraits de « Vers l’été » :
Fin de journée grise, quoique.
A la lisière des prairies, Le plafond a des interstices inégaux
Où filtre
un couchant, déjà.
Aux éclats de miel. * L’acte par absorption de la contrainte
Au regard des brisants Ou du gave dans son lit,
Porte au mélange.
On s’adapte, on s’efforce au moins. * Cette mélodie d’éclats dans la pinède.
L’espace se déplie jusqu’à la mer, vent Autour des palmiers - qui s’agitent et Penchent à peine - bruissant.
Souffle ténu, filet d’harmonie D’une sourdine -
Ajoute à la substance du lieu, couchant Au ras, lointain revenu.
Comme ça. * A qui ce beau livre Seul près du brin de muguet -
Elle suit la Seine. * Au bout du quartier,
La ligne de haute tension, son dédale, Ses pylônes froids comme creusant le ciel noir -
Seuil de l’orage. * Jean-Michel TARTAYRE un poète que nous avons toujours plaisir à suivre !
|
|
Brigitte Maillard
14/04/2016 |
|
|
07/04/2016 |
Christian Saint-Paul revient sur la
parution du dernier livre de
Marcel MIGOZZI :
« Des jours en s’en allant »
aux éditions Pietra , 75 pages, 12 € qui
a fait l’objet la semaine précédente d’un commentaire. Répondant à une des
nombreuses réactions suscitées par ce poète suivi par un large public,
Saint-Paul faisait valoir que : « ce n'est pas le côté "lamento" que je
retiens chez Marcel Migozzi, mais l'ellipse de sa parole ; son trobar
réussi, son économie de mots, la fulgurance avec laquelle il touche sa
cible, la crudité de la réflexion. Et puis, il se désespère depuis si
longtemps, qu'on finit par ne plus y croire. Et bien sûr, on aura tort.
L'inévitable surgira à coup sûr. Et le poète, comme toujours, aura eu
raison. Dans la vie, c'est quelqu'un d'une grande tendresse. »
Lecture d’extraits On s’approche d’un corps comme d’un sanctuaire. La porte donne chambre tremble.
La chair la blanche le bouquet, on était jeunes, On avait l’une sous la main Lisse sous le torrent du corps, L’autre fourrée dans les paumes, la neige.
Ah mange-moi La chair tuméfiée sous le désir à cru. Tu aimes ? Avant le dernier coup de foudre avant Qu’il ne s’éteigne outre-chevet.
Plus tard, viendront les souvenirs De ces dimanches à corps brûlants, Les lèvres comme des pétales dans L’eau claire de l’adieu. *
Marcel MIGOZZI vient de publier un nouveau recueil aux éditions Alcyone, (collection Surya) Ruralités, qui est une petite merveille. Marcel Migozzi est né en 1936 à Toulon dans une famille ouvrière d’origine Corse. Il vit depuis 1956 au Cannet des Maures (Var). Lauréat du Prix Jean-Malrieu en 1985, du Prix Antonin-Artaud en 1995, du Prix des Charmettes/Jean-Jacques Rousseau en 2007, il a publié de nombreux ouvrages de poésie chez différents éditeurs - en France et à l’étranger -, collaboré à plusieurs revues, ouvrages collectifs, anthologies et livres d’artistes. Il aime une poésie lisible, incarnée, en souci du monde quotidien. Pour vous procurer le livre de Marcel Migozzi, envoyez un courriel à l'adresse suivante : editionsalcyone@yahoo.fr Bien entendu l’émission « les poètes » s’attardera sur cette dernière publication. * Christian Saint-Paul reçoit le poète, romancier Francis PORNON. Il a obtenu en 2014 le prix de poésie des Gourmets de Lettres sous l’égide de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse pour « Chant Général » èd. Encres Vives, un long poème épique à la gloire du rude pays des Corbières. Une émission de radio avait été consacrée à cet ouvrage.
Après des études de philosophie,
Francis Pornon a bourlingué dans le monde et exercé divers métiers, dont
celui d’enseignant.
Ce soir il vient entretenir les
auditeurs de son dernier livre :
Avec ce roman historique, qui se lit d’une traite, Francis PORNON demeure dans le monde bien connu pour lui, de la poésie. Celle, universellement louée, des troubadours. Pour bien situer cette époque florissante et son cortège de chefs d’œuvres, il faut remonter l’histoire de notre Occitanie. Le mieux est de se référer à Francis PORNON lui-même, dans un article paru en 2013 dans les pages du journal L’Humanité : « Vers Muret, près de Toulouse, un sentiment d’étrangeté surprend le visiteur. D’où viennent l’« acceïn » des gens, leur dérision envers l’Église, celle envers les Parisiens ? Et cette attraction pour Barcelone et la Catalogne ? Regardons quelques siècles en arrière… Nous sommes en l’an 1213. En plein Moyen Âge. Les chevaliers passent leur temps à s’armer et à se barder de fer pour se battre, tandis que les seigneurs enferment leurs femmes dans leurs châteaux forts. Le Sud est peuplé, prospère, souvent cultivé. En pays de droit écrit où tout est occasion de rédiger et de signer contrats, mariages, successions, etc., on cohabite avec les juifs, côtoie ou fréquente les « bons hommes » cathares. Le vent nouveau de la poésie courtoise souffle de ce Sud jusqu’en Angleterre et en Allemagne, secouant l’idéologie et les pratiques des cours. Les troubadours écrivent en occitan, la langue commune à la moitié sud de la future France et au nord de l’Espagne. Or, voici que depuis des années (1209), la région allant de l’Agenais au Languedoc est dévastée par une croisade prêchée par le pape. Une armée est venue du Nord, envoyée soi-disant contre les cathares. Chevaliers et seigneurs en quête d’« indulgences » papales, ainsi que routiers et ribauds en mal de rapines, parcourent les terres, accaparent les châteaux, pillent, mutilent et tuent. Béziers est prise et incendiée, ses habitants violés et massacrés. S’ensuivent les prises de Carcassonne et de bien d’autres places et villes, presque toujours accompagnées de massacres et de bûchers. Le chef croisé Simon de Montfort se voit attribuer le vicomté de Carcassonne et brigue la conquête de Toulouse et de toute la région. Après maintes tergiversations et péripéties, Raymond VI (dit Raimon le Vieux) vient d’abdiquer pour son fils, Raimon VII, comte de Toulouse, afin d’obtenir l’arrêt de la croisade. En vain. Père et fils veulent alors, avec Pedro II, le roi d’Aragon, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier, mettre un coup d’arrêt au fléau. Ce roi sudiste serait sensible aux jupons. Les mariages des puissants s’effectuent pour raison d’État, afin de sceller alliances et pouvoirs, et la fidélité n’est pas matrimoniale, même pour les dames, puisque l’amour troubadouresque est adultère. Passion raffinée en plein temps brutal, il promeut le culte de la dame. Raimon de Miraval adresse à Pedro II des chansons l’invitant à défendre ses vassaux et sa gloire… et aussi vantant la beauté et la valeur d’Alazaïs de Boissezon, dame de Lombers (Tarn). Le roi arrive avec son armée… Soutenus par une résistance populaire citadine, ainsi que par la milice levée par les capitouls (représentants communaux toulousains), avec les seigneurs de la région, les deux Raimon et Pedro décident d’attirer le chef des croisés sur les rives de la Garonne devant la ville de Muret, non loin de Toulouse, le 11 septembre. Simon de Montfort accourt défendre la place. Mais les alliés provoquent la bataille en campagne. Alors se manifestent la furie et l’art guerriers de Montfort et les divisions du camp sudiste. Contrordres entre corps et défection de la milice font que, malgré leur supériorité numérique, les sudistes ne résistent pas aux guerriers du Nord, le 12 septembre. Les chevaliers de Montfort reconnaissent le roi qui s’est démasqué par défi et le tuent. C’est alors la débandade et un massacre des Toulousains et des Catalans. On dit que les morts fleurissent alors de rouge les prairies et que, le lendemain, la Garonne va charrier des cadavres traversant Toulouse. Le comte Raimon le Jeune fuit dans ses possessions provençales de Saint-Gilles et son père en Catalogne. Par la suite, le Sud ne se couchera pourtant pas tout de suite et, avec les faidits (bannis) et les deux Raimon, se battra encore des décennies durant contre les accapareurs de Montfort. Ce dernier trouvera la mort au cours d’un siège de Toulouse que lèvera son fils. Et ce n’est que plus tard, à la faveur d’un mariage, que le pays se ralliera au roi de France. Au terme d’une croisade qu’on oublie d’enseigner à l’école : génocide avec son cortège d’horreurs et d’éliminations, mais aussi désastre pour une civilisation, sa langue et sa culture et grande perte pour l’humanité. Cela n’empêchera pas les poèmes des troubadours de traverser les siècles jusqu’aux bibliothèques du début du troisième millénaire. Ainsi que le conte la Chanson de la croisade albigeoise (traduction Henri Gougaud, éd. Livre de poche.) : « Oui, ce fut un malheur pour la race des hommes./La fleur d’or de l’honneur fut en ce lieu brisée/Et le monde chrétien souillé de honte ignoble. » * Avec « Les dames et les aventures du troubadour RAIMON DE MIRAVAL »,
nous sommes aux XIIe et XIIIe siècles,
durant la « première renaissance » européenne des lettres et de l’amour.
Ce livre de Francis PORNON EST un roman
historique sur la vie de Raimon de Miraval, troubadour et chantre de
l’Occitanie médiévale au carrefour des XIIe et XIIIe siècles. Au cours de l’entretien avec Saint-Paul, Francis PORNON retrace non seulement la vie étonnante de ce troubadour, mais aussi par ce biais, l’apport de cette culture littéraire occitane à la civilisation en particulier en Europe. C’est une vision novatrice de la femme et de l’amour qui est initiée par les troubadours. La femme, n’est plus une personne « utilitaire » par l’alliance qu’elle occasionne, mais une personne centrale, qui existe pour elle-même et à laquelle l’élu se soumet avec délectation. C’est une vraie révolution de la conception féminine. La force brutale, virile, n’est plus le seul objet d’admiration pour la femme. L’exploit du chevalier bravant les dangers est remplacé par l’exploit de l’aspirant amant qui doit aussi braver des dangers, celui du mari par exemple, mais qui doit surtout réussi dans son art du trobar. Faire des poèmes, les chanter et plaire. L’entretien est entrecoupé de lecture d’extraits du livre par l’auteur. * Maintenant, me voici enfin dans la paix et la tranquillité de l’ombre, par-delà la montagne lumineuse. Il me fallut du temps pour jouir de la quiétude après le tumulte des batailles et des déroutes. Et cependant soufflent dans ma tête quatre vents chargés de tant de parfums féminins, tant de senteurs agrestes, tant d’arômes de cités merveilleuses, tant de souvenirs d’aventures et de voyages ! Et se pressent en ma bouche chansons mélodieuses et rythmées, images de chevauchées par forêts et garrigues, échos de castels pleins d’histoires, scènes de cours recélant des intrigues. Et encore, et surtout, flambent en mon cœur tellement de caresses de dames et tellement de passion d’elles que j’aime à en faire récit. « D’Amor es totz mos cossiriers… » D’Amour est toute ma pensée : Je ne me soucie que d’Amour… Ce début d’une de mes chansons, écrite il y a déjà longtemps, je ne puis en renier un seul mot, après tout le trajet accompli. Je ne sais ce qui me reste encore à vivre ni si cela me réserve toujours l’amour. Mais je sais que les mots et les faits de passion amoureuse sont ma seule richesse. L’amour est ce goût sans quoi la vie ne serait qu’une potion amère ou du moins un très fade brouet, alors qu’il est en fait un festin magnifique et délicieux. * Ses lèvres rougies et caressantes énoncèrent alors que la jalousie n’a de raison d’être en fin’amor que pour l’amant ou l’amante trahie. Une chose est la blessure d’orgueil du mari qu’il vaut mieux ménager et autre chose est la dévastation de la passion amoureuse par le défaut de l’amant qui laisse démuni et vide. Je devais le savoir, moi, le troubadour, rien d’autre ne méritait d’être vécu que l’amour. Sans doute, la bonne chère et le bon vivre agrémentaient-ils le chemin de la vie, semé d’ornières, d’obstacles et d’agressions. Mais rien, non rien du tout ne pouvait dispenser du Joi, la jouissance amoureuse qui allait croissant au fur et à mesure que l’on avançait vers l’amour partagé. * – Mon garçon, puisque tu veux être troubadour, connais bien d’abord le code de la fin’amor, l’amour courtois. Il est inutile d’espérer obtenir vite d’une dame ce que tout garçon peut désirer de l’autre sexe. Le « plus » que peut offrir la femme en se donnant ne peut venir qu’en fin de l’ascension amoureuse, laquelle doit commencer par le regard et s’ensuit du baiser, puis de la vue nue, ensuite du jazer et enfin, seulement enfin, du mélange des corps. Je demandai ce qu’était le jazer. Elle sourit devant mon ignorance et précisa que c’est le coucher en manière d’essai : l’assai, l’épreuve d’une nuit à passer nus côte à côte sans se pénétrer. Elle ajouta que, poète, je serais bientôt capable de chanter une bien-aimée. Si celle-ci me prenait comme amant il faudrait que je ne la déçoive pas, que je sache la faire accéder au Joi, joie et jouissance partagées. * « Les dames et les aventures du troubadour RAIMON DE MIRAVAL » est un roman historique, alerte, aux intrigues prenantes mais aussi un éclairage sur cette civilisation occitane, la plus puissante d’Europe par le bouleversement des valeurs qu’elle prônait. A lire !
|
|
Jean-Luc DOUSSET
Lauréat du prix d'Histoire des Gourmets des Lettres sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse
31/03/2016 |
Christian Saint-Paul signale la parution du dernier livre de Marcel MIGOZZI : « Des jours en s’en allant » aux éditions Pietra , 75 pages, 12 €.
Marcel Migozzi est né à Toulon, rue de la Fraternité, dans une famille ouvrière d’origine corse. Il lui restera toujours fidèle. Instituteur et poète, il a fondé son écriture sur le regard rapproché du silence, sur l’exigence sereine d’un mieux à vivre ou à mourir dans la fertilité de mots rabotés, sarclés, dépaysagés et sensible à l’humus comme à l’humain. Son œuvre a été célébrée par les prix Jean Malrieu, Antonin Artaud et Des Charmettes/Jean-Jacques Rousseau.
Je le devinais, sais. La blessure précède le bonheur, le suit.
S’enténèbrent les échecs Et les regrets, lichens humains. Seins blets, la main Renonce, automne, déjà soir.
Mais sous les feuilles d’un figuier à filles Se détache le souvenir D’une poitrine perlée sous la laine.
Eric Eliès nous livre cette belle note de lecture :
« Poésie profondément humaine, évoquant avec une grande sobriété le vieillissement du corps et la mort inéluctable .
Ce recueil de Marcel Migozzi inaugure, aux éditions Pétra, une nouvelle collection dédiée à la poésie sous la direction de la poétesse Jeanine Baude. L’édition est très élégante, sur un beau papier glacé qui met en valeur le texte et la photographie originale d’André Villers, qui a collaboré dans les années 50/60/70 avec de nombreux artistes peintres (principalement Picasso) et inventé de nouvelles techniques de tirages négatifs qui ont donné lieu à des expositions.
Ce recueil de Marcel Migozzi, placé sous l’égide d’une citation de Jaccottet (l’un des poètes admirés par l’auteur), est d’une très grande cohérence et s’inscrit dans la lignée des recueils précédents évoquant la progression inexorable de la vieillesse et le lent cheminement vers un décès que l’auteur sait inéluctable. Mais le ton est ici à la fois plus véhément et plus serein, comme si le poète détaillait explicitement les étapes et les symptômes d’une maladie incurable (la vieillesse) :
Rhumatismes déjà. / Os enrochés. Le sang / Passe en vieux. Le genou / est un témoin à charge.
Les bougies d’Alzheimer fument. / L’âme tarie, le sperme en moins, / Le corps composé de débris / De la couronne d’autrefois, / Peut-on donner une leçon d’indifférence / A la souffrance, vieille allumeuse ?
tout en ayant accepté l’issue fatale et l’engloutissement dans le néant de la mort :
Un jour tes jambes s’en iront, seules et / Faibles, vieilles d’os, / La douleur immobile en elles. / Tes jambes s’en iront dans la terre trouée / Définitivement. / Dernière promenade noire. / Pour tes os, ne t’inquiète pas, / Ils n’iront pas bien loin sans toi. / Dans peu de temps muet les mottes / recouvriront même tes mots / Ecrits de ton vivant.
Cette confrontation avec la mort provoque la résurgence des souvenirs d’enfance et suscite l'urgence de profiter des instants de vie, dans la contemplation des beautés que chaque jour apporte (le bleu du ciel, les fleurs du jardin, la présence des êtres aimés : Le thym fleurit le bas du ciel. / Aimons la terre ce matin / Pour que ce verbe-fleur aimer / Ne puisse se faner sur la motte du cœur ).
Toute chose est périssable ; c’est la leçon quotidienne qu’enseigne le jardin :
Les cyprès ne sont pas cardiaques. / Pourtant une branche s’éloigne / De son tronc, vieille et alourdie / De grelots secs, odeur caveau. / Ce matin, les oiseaux évitent cette branche. / Dans le très haut du ciel, / Le feuillage respire, bat. / Nulle ambulance en vue.
Néanmoins, le souvenir établit des ponts entre le passé et le présent et entretient quelque chose qui s’apparente à la survivance et empêche l’effacement. La mémoire des instants vécus, thème essentiel et récurrent dans l’œuvre de Marcel Migozzi, justifie l’écriture poétique qui s’assimile alors à un acte d’amour, à la fois charnel et mystique, envers le monde, envers les autres (notamment la femme aimée et les enfants nés de cet amour) et envers soi-même, par l’enfant qu’on a été, qui n’est pas mort et qui peut-être survivra :
(…) Bonheur ancien laisse des traces / Même amères, tant mieux. Les chairs / Peuvent en témoigner, / Et peut-être les mots en l’absence de corps.
(…) Ne dis rien. Tes paroles / Pourraient tomber dans le vieux pourrissoir / Adulte. / Sauve plutôt les meilleures de tes enfances. / Il en reste encore tant / A ressusciter, vivre, va.
La vie la mort et entre, quoi ? / Ce trou que font les mots. Pourtant / Dans le dernier inventaire : / La pomme d’amour bleue de bouillie bordelaise / La caisse en bois des morues sèches / Dans la cour de la boulangère / Les fagots qui patientent pour un gratin au four. / On sentait la douceur des nuages de poche / L’enfant les emportait au creux de son mouchoir. / En pleine guerre on mangeait peu mais bien content / De vivre à l’eau potable.
Ce pouvoir des mots, le poète le célèbre en même temps qu’il s’en méfie, car les mots se dérobent ( Les vivants savent de tout cœur / Que les mots peuvent les tromper / Que le premier en cache un autre, mort ), et en même temps qu’il s’en moque avec ironie ( Salle d’attente du poème. / Quelqu’un s’agite entre les mots. / Est-ce le nain / « Moi-Je » ? ), parce qu’il y a une vanité incongrue, pour l’homme qui a désappris le catéchisme de son enfance et ne croit plus dans les promesses de la religion, à espérer un salut quand le corps retournera à la poussière (même si ce retour à la terre s’apparente à une restitution fœtale à la terre maternelle : En terre, on y sera petit, / Tout petit tas, tétant / Du bout des os le sein de la poussière ).
Néanmoins, malgré sa fragilité, la feuille de papier, qui peut devenir poème ou bateau plié par un enfant (et auquel fait peut-être écho la photo d’André Villers représentant un papier froissé), reste la seule issue possible et le seul exutoire offerts aux mots. Marcel Migozzi, poète pétri de culture méditerranéenne, n’évoque pas la mythologie grecque mais je n’ai pu m’empêcher de songer à une barque flottant sur les eaux du Léthé, dont les eaux paisibles effacent le souvenir des vivants avant qu’ils n’entrent chez les morts.
Tout un jour à vieillir dans un poème ingrat (…)
Ivres de deuil, poètes / Vous regardez toutes ces barques de papier / Qui vous éloignent de vos corps. Puis votre peu / A peu silence sombre. / Votre bouillie de sentiments dérive. »
Lecture d’extraits
C’est sûr, on a dû l’être Aimé un jour Durant, peut-être plus, les chairs Présentes sous des os moins durs, y croire Au moins toute une nuit, peut-être Plus, la vie entière.
Bonheur ancien laisse des traces Même amères, tant mieux. Les chairs Peuvent en témoigner, Et peut-être les mots en l’absence des corps. * Christian Saint-Paul revient sur le livre de Jean-Michel MAULPOIX : « Le voyageur à son retour » éd. Le Passeur collection « littérature », 155 pages, 15 €.
Jean-Michel Maulpoix, agrégé de lettres modernes, enseigne la poésie moderne et contemporaine à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris III. Directeur de la revue Le Nouveau Recueil, il est l’auteur de nombreux ouvrages (poésie, critique littéraire, essais), parmi lesquels : Une histoire de bleu (1992), L’Instinct de ciel (2000), Chutes de pluie fine (2002), Pas sur la neige (2004).
Mais tu l’as bien compris : c’est pour cela que je m’en vais, que je m’envole, que j’en appelle au plus lointain. Ces étoiles au sol, ces feux roses de l’aube, ces forêts, ces rivages, ces toitures : la terre, la maison des hommes. Je ne connais pas de moment plus heureux que l’atterrissage. Ces départs, après tout, n’ont pour objet que le retour.
Pierre PERRIN a rédigé cette critique bien satisfaisante :
« Jean-Michel Maulpoix saisit les émotions fugitives qui naissent de tous les sens. Chez lui, ce sont les voyages qui conduisent à l’éveil d’une sensibilité poétique tissée entre l’intime et le tangible.
Après quelques années de silence, les mots du poète résonnent à nouveau dans ce recueil célébrant la joie infime des plaisirs partagés et les surprises liées au décentrement du voyage.
En fin de volume, un carnet accueille l’écho qu’ils ont laissé dans l’oreille de quelques lecteurs. Estampillé « littérature » plutôt que « poésie », ce volume invite le lecteur à le traverser, presque à l’ancienne, sur la lame d’un couteau. Dès le prologue, en effet, Jean-Michel Maulpoix se pose la question de l’authenticité, sans faux-fuyant, en dévisageant la seule qui vaille, la mort, la « finitude » comme il aime à dire. Le prix de ce livre est dans cette tension. « Se pourrait-il qu’à présent je fasse seulement semblant : prendre une plume et un carnet, écrire encore, raturer, recommencer et laisser croire que je m’en vais là-bas, vers un nouveau livre sans doute, quand ne demeure en vérité que la reprise vaine d’un vieux geste n’ayant plus d’autre raison d’être que de se répéter pour rien, ne partant plus nulle part et le sachant, mais poursuivant encore, comme pour connaître sa fatigue, et comme continue bêtement de battre le cœur de qui cessa d’aimer ? ». La marque de fabrique de Jean-Michel Maulpoix, et la place qu’il occupe dans le paysage poétique français depuis Ne cherchez plus mon cœur, chez POL voilà trente ans, l’atteste, c’est d’écrire en tendant du côté de la clarté. « J’ai le désir d’une écriture qui tire au clair : qui clarifie et qui conduise du côté de la clarté ». Le trémolo qu’il ajoute aujourd’hui, à sa façon de tenter un bilan, ne laisse pas de toucher : « Jamais je n’ai su toucher l’os. Ni vraiment fait sonner le vide. J’ai trop aimé les textes bien coupés, sans faux plis, doux au toucher, et qui enveloppent notre peau d’une douceur tiède ». L’ensemble, qui relève du carnet du voyageur, parfois immobile, en vrille sur ses interrogations, est relativement inégal. Du moins, c’est affaire de goût. « Observation à caractère général : en Amérique, méfiez-vous des sauces ». Ou bien : « plumer le touriste est un art ». De telles notations peuvent ne pas transporter le lecteur pris au dépourvu. Les 115 pages de Maulpoix réservent d’autres surprises – de meilleure qualité. Les 115, car les quarante dernières pages sont offertes à des amis tels que Jean-Marc Sourdillon, Gérard Noiret, Pierre Grouix et s’achèvent par une élogieuse critique du livre « à son retour », signée Michèle Finck. Heureuses surprises donc : « Tout bonheur est un sablier ». Le poème en prose Flamenco, quinze lignes, est épatant, comme les quatre pages qui, sous le titre Golgotha, font état d’un déplacement à Jérusalem : « Le nom de la capitale mondiale du monothéisme signifie en hébreu La paix viendra. La mort y est bon marché ». Maulpoix cite Hofmannsthal, dans un exergue : « Ce qui doit toucher l’âme, cela ne se laisse pas prévoir ». L’écrivain, tout exigeant qu’il soit avec soi-même, ne peut guère anticiper la réaction de ses lecteurs. Cette dernière s’enchante sans détour de ce vers blanc, au rythme ternaire, un paradoxe à valeur d’apophtegme, une réussite : « Être le témoin anachronique de son temps » et donne quitus à Maulpoix sur sa qualité d’écrivain. Ce volume vaut donc par les questions que se pose Jean-Michel Maulpoix. Les deux pages intitulées Une collection de phrases les résument assez bien, en deux temps distincts. « Je suis atteint d’un mal curieux : mon corps est plein de phrases. Troué de paroles et mangé de vers, il n’est plus remué que par ces créatures voraces qui le vident lentement de sa substance ». S’ensuit le doute qui le taraude : « Je ne suis plus une personne, mais une sorte de catalogue de formules et de visages. Autrui m’est plus proche que moi-même ». Au doute, la mort dévisagée, succède une sorte d’apaisement où « s’abandonner un peu, puis se reprendre à temps, ajuster l’amour au mourir, et s’appliquer à parler juste dans l’incertain », allant jusqu’à énoncer que l’important, dans une phrase, est moins dans ce que celle-ci dit que dans la distance à quoi elle se mesure. De même, écrit-il encore un peu plus loin dans Crayons de couleur : « La beauté du monde ne tient qu’à un fil : c’est parce qu’elle est d’une fragilité extrême qu’elle résonne parfois comme une corde parfaitement tendue qui rend un son juste ».
Pierre Perrin
Extraits : Plage de Tel Aviv On entend dans le ciel des avions invisibles. La guerre, apparemment, ne serait que cela : un bourdonnement lointain dans le bleu. La voici, la grande, la couchée, indifférente ici comme ailleurs à toute souffrance humaine, roulant ses vagues et projetant pour rien devant elle ses écumes. Peu importe que des hélicoptères ou des avions de chasse la survolent, ni que le sang des hommes parfois teigne ses eaux. La folie n’est pas son affaire, mais le mouvement lointain des astres.
- Les dieux, me disais-tu, ne sont pas morts. Ils ont vieilli. - Le septième jour n’a pas eu de soir. *
Christian Saint-Paul reçoit son invité Jean-Luc DOUSSET qui vient de faire paraître aux éditions Jeanne d’Arc : « Ferdinand le débile » 298 pages, 17 €. Cet auteur avait obtenu le prix d’Histoire des Gourmets de Lettres 2015, placé sous l’égide de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse, pour son livre : Giampretro Campana - la malédiction de l'anticomane - Jean-Luc Dousset, historien, qui était déjà venu présenter ses précédents ouvrages dont : Philibert Besson - le fou qui avait raison - , journaliste toulousain, nous invite cette fois à découvrir un empereur d’Autriche-Hongrie que l’Histoire passe sous silence. Un voyage dans l’Empire austro-hongrois du milieu du XIXe siècle en compagnie d’une personnalité méconnue.
Vienne, 1793, le palais de la Hofburg, la naissance de l'héritier de l'empire austro-hongrois. En principe... du successeur de son père l'empereur François 1er. Mais Ferdinand a de l'eau dans la tête, il est rachitique, il souffre d'épilepsie, il est un peu attardé... La consanguinité l'a accablé de tant de tares ! Survivra-t-il suffisamment de temps pour accéder au trône de la famille des Habsbourg-Lorraine. Monter ou descendre un escalier, se servir d'une carafe, signer de son nom... Autant d'épreuves ! Durant des mois, sa laideur doit rivaliser avec la beauté de l'Aiglon qui vit au Palais de Vienne, à Schönbrunn...Encore une épreuve pour lui, si disgracieux. Son père Sa Majesté François hésite. Lui succédera-t-il ? Un temps il lui préfère son fils cadet François-Charles. Un temps, il s'en tient au principe de légitimité, ce sera son fils ainé Ferdinand... Le Prince de Metternich veut sa marionnette ! Avec Ferdinand, il la tient... Il le forme, le modèle, le marie à la princesse Marie-Anne de Savoie. Nuit de noces mouvementée ! Ferdinand s'intéresse peu aux choses de la politique et à l'art militaire. Ses seules passions : la botanique, le jardinage, les sciences... On le prend pour un débile ! Le peuple l'aime. Il le surnomme Ferdinand le Bon. Le peuple le méprise. Il l'appelle du sobriquet de Ferdinand le Fini... La période est troublée. Le puzzle de l'empire austro-hongrois menace de se disloquer. La sœur de son frère, l'archiduchesse Sophie avide de pouvoir manœuvre pour que la couronne des Habsbourg revienne à son fils François-Joseph qui va épouser celle qui va devenir l'impératrice Sissi ! On prépare son abdication... Ferdinand, un incapable ? Il est un homme de progrès !
Comme pour les précédents ouvrages, c’est aussi une œuvre littéraire qu’a accomplie Jean-Luc DOUSSET avec cette biographie d’une grande originalité puisqu’elle est celle d’un acteur de l’Histoire qui demeure peu connu. Encore une fois, le mérite de notre écrivain historien est de retrouver des personnages ayant joué un rôle non négligeable dans l’Histoire, mais que les historiens pour de mauvaises raisons ont négligé. L’originalité de la vie de « Ferdinand le débile » et son rôle à bien des égards, positif pour son pays, n’a pas échappé à la vigilance de Jean-Luc Dousset.
Celui-ci dévoile au cours de l’émission le destin de ce monarque conscient de ses faiblesses mais toujours préoccupé par l’intérêt de son peuple, qui a été amené à prendre des décisions de la plus haute importance. Le récit, alerte, est conduit par un témoin, Ambrosius Nessehauer, qui était comme son père au service de la Maison des Habsbourg-Lorraine. Cette vie pleine de péripéties, de succès et d’échecs, est en réalité aussi romanesque que passionnante. Il faut écouter Jean-Luc Dousset parler de ce personnage comme s’il était lui-même le témoin : Ambrosius Nessehauer.
L’entretien avec Saint-Paul est entrecoupé de lecture d’extraits du livre :
J’ai vu Ferdinand grandir tant bien que mal entouré de soins inutiles. Son corps reste malingre, sa tête disproportionnée, énorme. Les médecins se succèdent près de lui depuis sa naissance, impuissants. Ils ne font que constater, leur diagnostic est invariablement le même : épilepsie, bégaiement, troubles de la parole, manque de coordination de ses membres, rachitisme, hydrocéphalie… « De l’eau dans la tête ! » prononce en jetant les yeux au ciel, sa mère l’impératrice lorsque l’hydrocéphalie lui fut expliquée… « Ne pourriez-vous point la lui vider ? » rajoute-t-elle avec son bon sens. Réunis en demi-cercle autour du lit du Prince héritier, les médecins se concertent. L’idée, un peu simple, au premier abord, peut-être saugrenue, de l’Impératrice les fait s’interroger ? Bien sûr, l’expérience a déjà été tentée avant… Bien sûr, bien sûr, mais sur d’autres qu’un héritier de la dynastie des Habsbourg. Sur des sujets quelconques, sans réelle importance! « Pour autant, que risque-t-on ? Regardez-le, hormis ses périodes de crises, il semble pour le moins végétatif », constate l’un des praticiens, négligeant la présence de Ferdinand. Subitement, celui-ci dirige la tête vers lui, plonge à l’intérieur de lui, le pénètre avec ses yeux globuleux. J’ai vu le médecin, si mal à l’aise, se tourner vers l’un de ses confrères : « Vous savez bien quels ont été les résultats de ces ponctions… Des convulsions, puis souvent la mort… Notre collègue italien, Giovanni Battista Morgagni en a plusieurs fois fait la démonstration il y a quelques années… Point ne s’agit-il de quelques saignées ! » « N’est-ce pas sa destinée? Il convulse déjà si fréquemment que la mort sera délivrance. » « Nous substituerons-nous à Dieu ? » « Ne l’a-t-il point abandonné ? » « Ne serait-il pas tout de même envisageable de faire des trous pour faire baisser la pression ? » « La mort ! Vous dis-je. » « Cependant peut-être installer un trocart, selon les expériences menées par Claude-Nicolas Le Cat pour la ponction de l’hydrocéphale ? Installé à demeure, nous pourrions ainsi vidanger le prince Ferdinand aux instants qui se révéleraient nécessaires. »
Vous eussiez vu tous les efforts déployés par Ferdinand pendant presque toute une année entière. Je les entendais jour après jour, inlassablement, invariablement. Son précepteur répétait sans se lasser, sans discontinuer, monocorde : « Sire, levez la jambe droite. Oui, celle-là, montez le pied et avancez-le. Bien… Reposez-le… Non, non ne vous arrêtez pas. Appuyez dessus et montez la jambe gauche… » Que de fois n’ai-je entendu Ferdinand choir ! Se relever en grognant… sans toutefois se plaindre. Il est enfin parvenu au bout de plusieurs mois à monter seul ou presque les marches des escaliers. Son apprentissage des rudiments d’une existence simple a tellement été laborieux, il aura fallu tant de patience ! Pourtant, François Steffaneo-Carnea se révèle si faible, incapable à donner à l’archiduc l’enseignement dont il a besoin et qui eut, est-ce là mon avis, nécessité un peu d’autorité. Oh, bien évidemment, l’Impératrice en a bien conscience même si elle ne se résout à le démettre. Elle ne se prive de le moquer, dans son salon entouré de ses dames de compagnies, de ses relations de cour, l’appelant à maintes occasions « la vieille femme ». Les repas sont des moments interminables, pénibles à l’extrême pour le jeune archiduc. La table est dressée pour l’occasion, les couverts personnels en or de l’empereur François ont été sortis de leur écrin de cuir, disposés avec minutie devant lui ; cuillère, couteau, fourchette, cuillère à moelle, coquetier, boîte à épices. Ceux des autres membres de la famille impériale, uniformes, ont été extraits d’une ménagère de douze couverts, nombre choisi en référence à celui des apôtres. Devant chacun des convives, de la vaisselle en porcelaine de la manufacture de Vienne. François se souvient que toute la haute aristocratie avait dû se séparer de celle en argent et en or au moment des guerres napoléoniennes pour fondre monnaie. J’ai vu en cette période la Cour puis la famille impériale, elle-même, ne pas se dérober à ce devoir national. L’Empereur a fait disposer les assiettes, dites panorama, d’un service dont la commande a nécessité cinq ans de travail : 120 pièces dont 60 assiettes à dessert et 24 à soupe, toutes illustrées d’une vue de la Suisse, d’une d’Italie et enfin d’une autre évoquant les plus belles réalisations architecturales de Vienne. Ferdinand sent tout son corps se tétaniser, ses courts bras deviennent aussi raides que des barreaux de chaise. Il hésite, avance sa main, se saisit de l’anse de la carafe. Ses gros doigts se serrent autour et il la soulève mais il la lâche comme si elle pesait plusieurs kilos au moment de se verser un verre d’eau. Plusieurs jours de suite, plusieurs semaines d’affilée la scène se répète. Les domestiques se précipitent essuyer, enlever promptement les morceaux éparpillés du verre de Murano, les débris de l’assiette de porcelaine. Diantre, est-il heureux qu’en cette époque, la vaisselle en argent commence à faire son retour au palais impérial ! Car, la maladresse maladive dont souffre Ferdinand eut tôt fait de venir à bout de tous les services de porcelaine de Vienne. A chaque fois, autour de la table, ses frères éclatent de rire ! A chaque fois, Ferdinand rentre dans une colère incontrôlée, il tape de petits coups répétés de plus en plus fort contre le surtout en bronze recouvrant la table. A chaque fois, son précepteur avec douceur le calme puis l’entraîne hors de la salle à manger de la famille impériale. Ferdinand demeure cet enfant en retard pour ne point dire attardé, un peu maladroit pour ne point dire infirme, un peu sot pour ne point dire débile ! C’est l’avis de beaucoup.
[...]
Les passions se déchaînent contre les grands banquiers israélites accusés de piller les finances publiques, soutenus par les plus puissants du gouvernement. Situation d’autant plus inacceptable alors que dans le même temps, les juifs de condition modeste, pauvres, sont traqués et molestés, pour le moins. Que n’y a-t-il différence de traitement selon la fortune ! Que la colère est grande par ailleurs contre la corruption qui règne ! N’y a-t-il pas dans l’empire d’Autriche, selon la population en révolte, trente-cinq mille grands fonctionnaires et quatre-vingt cinq mille fonctionnaires dits gradés, provenant tous de l’aristocratie !
Que la révolte prend une tournure dramatique, incontrôlable. On marche maintenant vers la Hofburg ! Déjà, des fenêtres du palais impérial, on aperçoit les premiers contestataires qui s’approchent ! Ferdinand est averti. Avec toute sa candeur, il demande ce qu’il se passe. Que Metternich semble interloqué par la question de l’Empereur ! « Une révolution, Sire ! » répond-il sans plus donner de détails. « Mais ? En ont-ils le droit ? » « Mais ? En ont-ils le droit ? » répète un peu abasourdi le prince de Metternich… La phrase est si naïve mais pourtant elle semble tellement juste tant elle est prononcée avec sincérité. Cette sincérité qui transpire de Ferdinand. Il regarde de ses grands yeux globuleux Metternich, il attend, il espère une réponse plus précise. Son premier ministre le regarde à son tour comme il l’a toujours fait depuis treize ans, avec un peu de compassion, avec beaucoup de mépris et énormément d’incompréhension ; il est un pion de son jeu. Dans la partie d’échecs que le prince de la diplomatie mène, Ferdinand est dans le même temps, le fou et le roi ! Il a souvent marché en diagonale, aujourd’hui il se doit de montrer qu’il est capable de marcher droit en monarque, en souverain ! Que ceci se rapproche du domaine de l’impensable. Toujours, en écho, dans la tête pleine d’eau, les propos de son père… Surtout ne rien changer ! Ferdinand se souvient de ces recommandations ! Surtout ne rien changer ! Surtout ! Mais là, aujourd’hui? Oh, que j’ai vu Ferdinand se replier un peu plus sur lui, son visage, crispé, accentuant des rides profondes. Il ressemble à l’une de ces pommes flétries ! Face aux troubles, aux manifestations hostiles que doit-il faire ? Rester immobile ? Oh diantre, qu’il ne porte en son cœur Metternich, mais jusqu’à présent, il était là. Il pouvait se reposer sur l’avis de cet homme habile en négociations. Désormais, il n’y a plus personne. D’ailleurs, reste-t-il encore quelque chose à négocier? La véritable tête de l’empire, celle de Metternich lui-même, est prête à tomber. Il y a plusieurs jours que celui-ci reçoit des lettres anonymes qui le menacent. Tenant à montrer qu’il reste maître de lui, de la situation, il les traite avec dédain mais cependant elles ne manquent pas de produire leur effet, sa confiance est ébranlée. L’annonce incessante de sa chute prochaine lui ôte de sa superbe. Ambrosius Nessehauer se redresse dans son lit avec les forces qui lui restent, poursuivant à grand-peine à réunir les souvenirs de ces semaines noires. En ce jour du 13 mars, le choix s’impose pour le diplomate. Ses belles phrases ne peuvent plus le sauver. Les étudiants demandent le départ, plutôt la mort de Metternich en latin « Pereat Metternich ». Qu’il périsse ! En latin, la menace semble plus douce mais elle est réelle. Metternich ne s’y trompe pas. L’empereur Ferdinand a bien conscience que tous ces soubresauts violents qui secouent son pays, agitent toute l’Europe sont au-dessus de ses facultés, ils sont même peut-être pour lui enfin l’occasion de se défaire de cette charge si lourde dont il a hérité ! Par la faute de Metternich ! « Pereat Metternich » se surprend à prononcer l’Empereur vacillant en secouant la tête. Dès ce moment-là, j’ai compris que Ferdinand allait vivre ses derniers jours de monarque. J’ai vu. J’ai entendu, l’impératrice-mère, Caroline, la veuve de l’empereur François, lui parler de s’éloigner du pouvoir. J’ai vu. J’ai entendu, l’archiduchesse Sophie, tant lui soumettre l’idée d’une abdication avec insistance. J’ai vu. J’ai entendu, son épouse l’impératrice Marie-Anne le pousser, elle aussi, à se retirer, à prendre ses distances. Mais Dieu, que leurs intentions me semblent bien opposées. Il m’est difficile de me prononcer sur la sincérité de l’impératrice Caroline. Oh, certes est-elle la sœur de l’archiduchesse Sophie, mais cette femme pieuse, qui a tant œuvré pour les œuvres sociales de l’Empire, a fondé plusieurs hôpitaux et asiles pour les pauvres éprouve également de l’affection pour Ferdinand. Que sans doute, j’ose le croire, est-elle animée par les sentiments les meilleurs, presque ceux d’une mère quand elle conseille l’Empereur. Que Marie-Anne veuille épargner à son époux une fin de règne bien éprouvante m’apparaît bien concevable. Mais que l’archiduchesse Sophie fasse œuvre de compassion relève du domaine de l’improbable. Imaginer que son cœur dévoré par l’ambition se soit attendri m’est impossible. Son mari ne fut pas Empereur, son fils le sera. Ferdinand le débile, le Habsbourg caché.. A lire! |
|
James Sacre
Photo
Jeanne Roux
James SACRE
24/03/2016 |
Christian Saint-Paul présente son invité : James Sacré poète français, né le 17 mai 1939 à Cougou, village de Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée).
Biographie selon Wikipédia : « James Sacré passe son enfance dans la ferme de ses parents en Vendée. Il est d'abord instituteur puis instituteur itinérant agricole, il part, en 1965, vivre aux États-Unis où il poursuit des études de lettres. Il y enseigne à l'université de Smith College dans le Massachusetts. Il fait également de nombreux séjours en France et ailleurs en Europe : l’Italie, la Tunisie, le Maroc. En 2001, il rentre en France et réside depuis à Montpellier. James Sacré commence à écrire dans les années 1970, en plein littéralisme. Son premier livre s'intitule néanmoins Cœur élégie rouge. Les sentiments ne seront donc pas absents de cette écriture. L’auteur a par ailleurs consacré sa thèse de doctorat au Sang dans la poésie maniériste. C’est donc d’emblée une poésie charnelle qui s’écrit, associant étroitement le cœur qui aime et celui qui bat, le cœur qui saigne et celui qui nous fait vivre de sa régulière pulsation. James Sacré est très attaché au paysage, et à la géographie. De nombreux textes sont consacrés au terroir de l’enfance. Les motifs centraux en sont la maison, la ferme, le jardin et le village. La mémoire joue un rôle important : tout un travail de remémoration est à l’œuvre afin de rendre le passé aussi vivant que le présent et de les fondre l’un dans l’autre. La poésie de James Sacré n'est pas pour autant égocentrée, elle s’ouvre à l’autre, l’appelle et l’accueille. Les voyages sont l'occasion de repenser l'identité, l'altérité et la relation amicale ou amoureuse. La passion de l'auteur pour le Maghreb, donnant lieu à de nombreux voyages, donne aussi naissance à de nombreux livres. La poésie est alors animée par un désir d'ouverture et de chaleur, de coprésence heureuse avec l'autre. Elle cherche une manière heureuse d'être ensemble, qui laisse s'écouler le temps avec douceur. L'un de ses poèmes favoris est celui où il parle d'un mariage au Maghreb dans "Viens, dit quelqu'un".
Antoine EMAZ dans sa magnifique préface de « Figures qui bougent un peu » Poésie /Gallimard, écrit : « James Sacré peut varier la forme tant qu’il veut puisqu’il reste dans la même unité tonale de langue, la sienne : « des phrases comme une musique plutôt que du sens ». La langue est poussée dans ses retranchements, ses limites, sans devenir obscure ou illisible. En cela, Sacré pourrait être un exemple de poète expérimental clair. »
La bibliographie de James Sacré se trouve à la fin de ce compte-rendu.
Un entretien s’instaure avec Christian Saint-Paul : « J’ai publié mon premier livre en 1965. Depuis tous les ans ou tous les deux ans, se sont succédées de nouvelles parutions. Après mon long séjour aux USA j’ai choisi Montpellier comme lieu de retour car j’y comptais de bons amis et je me rapprochais aussi de l’Italie, de l’Espagne et du Maroc. » Saint-Paul l’interroge, voulant savoir si ce Vendéen qu’est James Sacré, homme de l’Ouest, recherchait un ancrage méditerranéen. Le poète répond qu’il se serait adapté et plu aussi ailleurs. Mais il est heureux de ce choix ; de plus son voisin Jean-Claude Forêt des éditions Jorn lui a appris à connaître la poésie occitane et les poètes occitans qui vivent dans la région ou un peu plus loin. Dans « Si peu de terre, tout » paru au dé bleu, il semble qu’il s’inscrive parmi les poètes du quotidien. Il manie l’humour et la trivialité : Et comment décider si c’est l’odeur d’une chaussette propre ou celle des sales qu’on préfère ? Il règne une poésie métaphysique incontestable mais dans une langue qui n’effraie pas. Depuis longtemps, développe James Sacré, les poètes parlent de choses très familières auxquelles ils s’intéressent. Mais ce n’est pas le quotidien qui m’interpelle, précise-t-il, c’est le vécu. Je sais très bien que l’on n’arrive pas à exprimer tout le vécu dans les mots car dans le transfert il y a des choses qui disparaissent, mais je persiste quand même dans ce parti-pris de parler à partir de l’expérience du vécu tout simplement. Et le vécu c’est le quotidien même quand il s’agit de choses au loin ou de choses racontées par les journaux etc. Le quotidien, c’est l’immanence du monde. Je suis un matérialiste et cette immanence du monde s’ouvre sur l’énigme du monde, sur l’obscurité du monde. Fatalement cela dérive sur les questions du vivre, des valeurs etc. La poésie nait toujours d’une expérience, ne serait-ce que celle de la langue et des mots employés. James Sacré lit des extraits de « Le poème n’y a vu que des mots » (le dé bleu éd.) qui ont trait à la photographie. James Sacré entretient une complicité avec les artistes plasticiens. Ceux-là lui ont appris beaucoup plus que les musiciens. J’aimerais qu’un poème puisse se construire un peu comme une peinture, poursuit-il, car dans une peinture vous mettez une tache de rouge là, une autre ici, des lignes qui s’entrecroisent, et dans le poème je pense que c’est la même chose. Au lieu d’utiliser des motifs de couleurs ou des motifs de dessins, j’utilise des motifs sonores, des motifs de sens ou des motifs grammaticaux. J’organise tout cela, je rythme chacune de ces choses à l’intérieur de ce que j’appelle un poème. Et j’aimerai bien qu’un poème, comme une peinture, puisse se lire par n’importe quel endroit. Lorsque j’ouvre un livre de poèmes, il m’arrive de commencer par les derniers textes. Les artistes peintres m’ont appris une sorte de matérialité du poème. Je préfère parler du poème plutôt que de la poésie. Je ne crois pas qu’il y ait un lien transcendant entre le poème et la peinture, mais une sorte de continuité. James Sacré fait aussi le lien entre les lieux, la Vendée, les USA, le Kenya avec l’hôpital de Turkana par exemple. Le poème va lier ce vécu dans des lieux aussi différents. Mais j’écris les poèmes dans la même langue, le français, précise-t-il, et d’autre part je rencontre des différences ; ce que l’on voit en Vendée n’est pas ce que l’on voit au Maroc, mais si je m’attarde un peu, je finis par y voir non plus des différences, mais des ressemblances. Je retrouve au Maroc toute mon enfance paysanne qui a disparu en Vendée et aux USA un arrière fond rural que je retrouve au Poitou ou en Languedoc. James Sacré écrit que la photographie est « un mécanisme de souricière ». Est-elle un piège ? Et l’écriture aussi ? Oui, c’est un peu un piège, car on ne sait pas très bien ce qu’on cherche avec un poème, avec une photo non plus, et souvent on trouve des choses qu’on n’avait pas cherchées. Le poème, en quelque sorte, nous piège. Les mots nous piègent. Vous en écrivez un et un autre arrive que vous n’avez pas prévu. Et le mot n’a pas la même image dans l’esprit des lecteurs. Si j’écris arbre, un Québécois verra un érable, un Vendéen un orme ou un chêne, un Marocain un eucalyptus ou un arganier. Chacun dans sa relation au mot transporte son propre vécu, sa propre expérience. Et les différences-ressemblances apparaissent car il y a les deux. C’est donc un piège agréable le plus souvent quand même. La poésie nous rend vivants. Celui qui écrit « le monde est tellement sans fin et compliqué tout autour » remarque Saint-Paul, n’est pas dénué d’humour. L’humour chez James Sacré est ténu mais vivant. L’humour sert à douter un peu des choses mais sans être provocateur. L’ironie, l’humour me permettent de me sentir cherchant quelque chose plutôt qu’affirmant quelque chose. Cet humour, renchérit Saint-Paul, est la marque d’une humilité et paradoxalement c’est cette humilité qui donne la force à l’œuvre. Le monde ne cesse de disparaître ; c’est souvent un peu triste parce qu’il y a beaucoup de choses que l’on a aimées qui disparaissent. Mais notre passé, notre vécu disparaissent de la même façon. Même les poèmes sont des machines à faire disparaître le passé ou ce que l’on a aimé. Au lieu de le donner, le poème réinvente les choses. C’est un peu comme la vie en général qui est forcément toujours liée à la mort. En même temps que l’on est vivant, on est en train de mourir. Le poème est-il une façon de figer ce qui va disparaître, interroge Saint-Paul. Dans « Donne-moi ton enfance », répond James Sacré, où j’essaie de restituer l’enfance, au lieu de parler de la vraie enfance, j’invente une enfance. Mais ce qui se fige, est capable de s’ouvrir à quelque chose d’autre, est capable de créer. Lecture d’extraits de « Le poème n’y a vu que des mots » Reprise de l’entretien : C’est à cause de cet effritement que j’évoque dans mes poèmes, que j’ai le goût des choses usées, dont on ne se sert plus mais qui ont pourtant la capacité de vous saisir à cause d’un détail de couleur ou d’un arrangement de couleurs. Ce côté du monde qui part en guenilles nous fait sentir ce paradoxe qui fait que ce qui s’effrite nous fait songer à ce qui se fait maintenant et qui est nouveau. C’est le sens des tableaux d’Alexandre Holan cher à James Sacré. C’est dans la même posture que s’inscrit le peintre toulousain Philippe Vercelotti, remarque Saint-Paul. Si j’ai pu écrire, poursuit James Sacré, que dans le poème apparaît « un manque de fraîcheur » (Si peu de terre, tout p 35) c’est peut-être à cause de son impossibilité à coïncider avec le vivant. Comme l’a si bien relevé Antoine Emaz, James Sacré écrit dans des « façons de langue parlée ». Il a connu le patois poitevin. Son père le parlait, sa mère résistait. Lecture de (Portrait du père à travers les arbres). et des textes suivants extraits de « Si peu de terre, tout ». éd. le dé bleu L’émission s’achève par la lecture d’extraits de « Une petite fille silencieuse - poèmes pour Katia » (sa fille) in « Figures qui bougent un peu et autres poèmes » préface d’Antoine Emaz, Poésie / Gallimard. *** A bien y penser c’est pas beaucoup d’espèces d’insectes qui nécessitaient un travail de destruction ou de trie fait directement à la main. Sur la grande table de la cuisine après qu’on avait soupé, c’étaient les bruches et les charançons dans les haricots. Autrement on tuait un insecte occasionnellement. Les barbots lents au bas des murs. Une araignée. Les mouches plates qui se glissaient dans les plis gras de la peau des vaches. Autant d’odeurs et de touchers au bout des doigts. Une familiarité méchante et joueuse avec ce qui était déclaré mauvais. Le dégoût qui finissait par faire plaisir. Ça fait longtemps que j’ai pas tué d’insectes. J’oublie quasiment leur forme et leurs couleurs. C’est plus que des mots, sans guère d’odeur. Sans grand danger pour mon poème : à les choisir on sait pas trop ce qu’on trie ; et puis comment est-ce qu’on écraserait un mot ? ANACOLUPTERES * Qu’est-ce qu’on peut faire Avec un mot donné comme A la clef d’un poème ? Et que justement ça mène à rien, matin Et pas pouvoir partir, c’est déjà grand jour comment Est-ce qu’on peut dormir si longtemps, Matin comme un midi, c’est toujours Un peu comme ça un poème : Un manque de fraîcheur.
Si peu de terre, tout * (Portrait du père à travers les arbres).
Un chêne tout rabougri tout comme presque un buisson misère à peine qu’on peut chier dessous l’herbe mal douce le temps ramasse encore des gestes d’autrefois.
Si peu de terre, tout * Est-ce qu’on a tellement l’air paysan Si on ressemble à du patois ? A cause d’une façon d’attraper les mots Qui fait bouger la tête comme ça Plutôt qu’autrement, sans doute... Pour le reste ça veut quoi dire parler comme un paysan ? A travers mon patois est-ce que j’entendais pas Toute la musique de vivre (lenteurs, moments brusques, tendresses...) Et déjà le silence ?
C’est jamais un vrai dictionnaire qu’on fait Pour décrire la façon Que les paysans causent. Un gros livre écrit tout entier Dans leur patois, personne pour l’entendre ; Pourtant les gens qui savent ces choses, comment on apprend une langue, Pourquoi c’est important, la langue anglaise par exemple D’avoir un dictionnaire tout en anglais C’est mieux qu’ils disent. Sans doute, Mais pour le patois ? [...] Monsieur l’abbé Grégoire et tant d’autres Ah, vive la France ! Comme ils ont eu sa peau, peu à peu ! Le patois, qu’ils disaient, cette espèce d’âne grotesque Avec ses yeux sales, ses bruits ! De temps en temps on le fait braire, pour en rire.
Si peu de terre, tout * Hospital - Turkana
Comme si j’étais déjà venu là. Une pièce dans un dispensaire, par exemple à Marrakech. On y est comme dans une petite gare de l’ancienne colonisation et tout s’est un peu dégradé. Le ciment rêche est dans les yeux, le métal râpé du butane aussi. Un jour de mon enfance en Vendée. Je viens d’aller chercher la nouvelle bouteille de gaz dans le garage, pour l’installer à la cuisine. Le docteur venait nous soigner à domicile. Ou si je suis dans une école de campagne assez défaite au Maroc, ailleurs ? Le monde est jamais si surprenant Qu’on voudrait croire. Mon premier logement d’instituteur à Saint- Pierre-à-Champs, dans les Deux-Sèvres. L’hôpital de Turkana, tout à côté, au Kenya.
Le poème n’y a vu que des mots * Le désir fait que mourir, même si dans la mesure. Ce qui emporte c’est la défaite.
Tout le paysage est un lent mouvement de couleurs et d’aveuglements qui se poussent Comme on voit dans les tracements géologiques.
On devine que le désir a toujours été du silence. Rien à mesurer. Mourir est le dernier mot qu’on a Pour croire à du solide. * D’où vient cette maison qui s’en va ? On a le cœur si étroit, la Mésopotamie C’est tellement loin dans le temps ; On distingue plus ce qu’a été le sens D’une écriture ancienne, ça disait peut-être déjà Tant de gestes fous A travers la peur et le mot dieu, la dilution A tous les estuaires du monde. La montagne s’écroule. Le cœur qu’on a eu Est une petite chose calcaire et mouillée Qu’on écrase. * Sauver la maison veut plus rien dire. Toute l’entreprise de parler simplement a été ratée. Toute l’entreprise de pas comprendre et de continuer, Même que ç’aurait été dans la violence ou le désaccord. Une complication de l’esprit s’acharne à justifier Les remembrements la reconstruction qu’on va faire Quand on aura tout détruit. Mais le projet ça sera comme avant Le même ratage à répétition. Pas comprendre ou comprendre sans doute qu’on saura jamais Ça qui continue.
Le poème n’y a vu que des mots * Parler d’un pays, ça pourrait Consister en l’établissement de listes. Evidemment ça n’aurait pas de fin : liste De toutes les tribus indiennes qui ont vécu Dans ce pays (le vent même les connaît plus) Ou tous les noms de rivières et de beaux endroits qui sont restés Comme un dictionnaire de leur ancienne présence ; Des listes de marchandises que voilà partout Boissons gazeuses dans leur meuble mécanique à sous Couleurs publicité Si ta vie s’en trouve changée ? Liste De tous les noms d’église comme Une litanie marchande... Et puis n’oublie pas, la liste des commissions. * Dans l’entrée du Plaza Hotel à Las Vegas, pas la ville de l’Arizona. Beaucoup de sons « a » dans ce vers, mais ça va bien Aux volumes de l’endroit, à la couleur vert foncé Des fines colonnes de métal dans la salle à manger La frise aussi, même couleur avec des guirlandes et des nœuds blancs. Oui, une sorte d’austérité un peu froide et qui se continue dehors Avec la façade en brique rouge et les boiseries vertes, deux tons de vert, entre les surfaces vitrées Puis le bosquet des arbres sur la place où paraît, comme une nymphe un peu nue, Le kiosque léger blanc et bleu. Un homme qui est un clochard Sort de l’hôtel après un café pris là et c’est Des paroles amicales un peu emphatiques avec le personnel en tenue, Quelque chose de méditerranéen quasi qui rappelle Qu’on est dans la région hispanique des Etats-Unis (Las Vegas au Nouveau-Mexique) D’où ce mélange, qu’on se dit, de retenue grave et d’exubérance qui rit vrai. * Parfois le voyage est un peu long On ne voit plus rien, ou mal tout. Le paysage se réduit à quelques noms, Motel bon marché ou machin grand luxe. Ça finit par être nulle part.
America solitudes * Un jour on entend sa voix au téléphone. C’est déjà la nuit et presque du silence qui est très loin dans L’exiguïté de la solitude entre un lit d’hôpital et une chaise vide, Pendant que la lumière est partout courant dans la ville, parmi Des maisons dans les suburbs comme des gros cœurs cossus Si quelqu’un pleure à l’intérieur d’une, à côté Du téléphone et du silence, tout continue pareil. Quelque chose Bat tout près jusqu’à très loin, ça s’entend pas beaucoup. * Pourquoi moi ? demandait la voix, encore. Ça a résonné jusqu’à on sait pas où dans le fond mal arrangé du monde.
On n’entendait plus rien. * Les joues mêmes de la petite fille Sont ni de la renouée ni des véroniques dans les coins pas encore arrangés du jardin. Pourtant l’air qui lui vient par la fenêtre C’est à ces endroits de mauvaise herbe et de fleurs agrestes Que ça lui fait penser la paupière et la narine, Tandis que sa jambe devient comme un outil léger qui va servir.
Une petite fille silencieuse (in Figures qui bougent un peu) *
Livres et plaquettes de James Sacré publiées :
Relation, Bordeaux: N.C.J., 1965. Repris, légèrement modifié, dans Relation, essai de deuxième ancrit (1962-63; 1996), La femme et le violoncelle, Lamérac: Jean-Claude Valin éditeur, 1966 (avec un dessin de Pierre Bugeant); Repris dans Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t’aime. "Graminées" in Poésie-Ecrire, collectif, Paris, Le Seuil, 1968. Repris dans Les mots longtemps. Qu’est-ce que le poème attend ? La transparence du pronom elle, Paris, Chambelland, 1970. Tirage de tête (avec des burins d’Yvon Vey) Repris dans Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t’aime. Coeur élégie rouge, Paris, Le Seuil, 1972; Marseille, André Dimanche, 2001. Comme un poème encore, Liège, Atelier de l'agneau, 1975 (avec des dessins d’Yvon Vey). Repris dans La poésie, comment dire? Paysage au fusil (coeur) une fontaine, Paris, Gallimard, Cahier de poésie 2, (collectif), 1976; Tours, La Cécilia, 1991. Repris dans Les mots longtemps. Qu’est-ce que le poème attend ? Un brabant double avec des voiles, Paris, Nane Stern, 1977. Repris (avec une autre disposition des textes) dans Les mots longtemps. Qu’est-ce que le poème attend ? Un sang maniériste. Etude structurale autour du mot sang dans la poésie lyrique française de la fin du seizième siècle, Neuchâtel, La Baconnière, 1977. Figures qui bougent un peu, Paris, Gallimard, 1978. “Exercice et plaisir en faveur de l’amour” in L'amour mine de rien,collectif, Paris, Encre/Recherches, 1980. Repris dans La poésie, comment dire? Quelque chose de mal raconté, Marseille, André Dimanche, 1981. Tirage de tête (avec une gravure d’Olivier Debré). Des pronoms mal transparents, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Le dé bleu, 1982. Repris dans Une petite fille silencieuse. Rougigogne, Paris, Obsidiane, 1983 . Tirage de tête (avec deux sérigraphies d’Yvon Vey). Ancrits, Losne, Thierry Bouchard, 1983. Tirage de tête (avec des eaux-fortes de Patrice Vermeille). Repris dans Affaires d’écriture (ancrits divers). Ecrire pour t'aimer; à S.B., Marseille, André Dimanche, 1984. Tirage de tête (avec deux empreintes de Claude Viallat). Bocaux, bonbonnes, carafes et bouteilles (comme), Paris, Le Castor astral et Le Noroît, 1986 (avec des photographies de Bernard Abadie). Repris dans Les mots longtemps. Qu’est-ce que le poème attend ? La petite herbe des mots, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Le dé bleu, 1986. Repris dans Si peu de terre, tout. La solitude au restaurant, St. Benoît-du-Sault, Tarabuste, 1987 Tirage de tête (avec des travaux de Thierry-Loïc Boussard). Repris dans Ecrire à côté. Une fin d'après-midi à Marrakech, Marseille, André Dimanche, 1988. Un oiseau dessiné, sans titre. Et des mots, St. Benoît-du-Sault, Tarabuste, 1988 (avec un dessin de Jillali Echarradi). Repris dans La nuit vient dans les yeux. Le taureau, la rose, un poème, Montpellier, Cadex, 1990 (avec des dessins de Denise Guilbert). Repris dans Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t’aime. Je ne prévois jamais ce que je fais quand je dessine, Paris, Les petits classique du grand pirate, 1990 (avec des dessins de Jillali Echarradi). Repris dans La nuit vient dans les yeux. Comme en disant c'est rien, c'est rien, Saint- Benoît-du-Sault, Tarabuste, 1991 (avec des dessins de Jillali Echarradi). Repris dans La nuit vient dans les yeux. On regarde un âne, Saint. Benoît-du-Sault, Tarabuste, 1992 (avec une photographie d’abderrazzak Benchaabane). Tirage de tête (avec une aquarelle d’Areski Aoun) .Repris dans Aneries pour mal braire,Tarabuste, 2006. Ecritures courtes, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Le dé bleu, 1992. Repris dans Si peu de terre, tout. La poésie, comment dire?, Marseille, André Dimanche, 1993. Des animaux plus ou moins familiers?, Marseille, André Dimanche, 1993. Le renard est un mot qui ruse, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 1994 (avec un dessin de Jillali Echarradi). Repris dans La nuit vient dans les yeux. Ma guenille, Sens, Obsidiane, 1995. Viens, dit quelqu'un, Marseille, André Dimanche, 1996. Essais de courts poèmes, Toulouse, Cahiers de l’Atelier, 1996 (avec des dessins de François Mezzapelle). La nuit vient dans les Yeux, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 1997 (avec des dessins de Jillali Echarradi). La peinture du poème s’en va, Sain- Benoît-du-Sault, Tarabuste, 1998. Anacoluptères, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 1998 (avec des illustrations de Pierre-Yves Gervais). Relation, essai de deuxième ancrit (1962-63; 1996), Saint-Denis- d’Oléron, Océanes, 1999. Labrego coma (cinco veces), Saint-Jacques- de-Compostelle, Noitarenga, 1999 (avec des photographies d’Emilio Arauxo). Si peu de terre, tout, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Le dé bleu, 2000. Repris dans Affaires d’écriture (ancrits divers). L’Amérique un peu, Montréal, Trait-d’union, 2000. Repris dans America solitudes. Ecrire à côté, Saint-Benoît-du-Sault, Editions Tarabuste, 2000. Une petite fille silencieuse, Marseille, André Dimanche, 2001. Monsieur l’évêque avec ou sans mitre, Chaillé-sous-les-ormeaux, Le dé bleu, 2002 (avec des illustrations de Edwin Apps). Mouvementé de mots et de couleurs, Cognac, Le temps qu’il fait, 2003 (avec des photographies de Lorand Gaspar). Tirage de tête (avec une photographie originale de Lorand Gaspar). Les mots longtemps, qu’est-ce que le poème attend?, Saint-Benoît-du-Sault: Tarabuste, 2004. Repris dans Affaires d’écriture (ancrits divers). Sans doute qu’un titre est dans le poème, Rennes, Wigwam, 2004 (avec des reproductions de peintures de Mariène Gâtineau). Repris dans Le poème n’y a vu que des mots. Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t’aime, Devois-du-Château, Cadex éditions, 2006 (avec une vignette de couverture d’Yvon Vey). Broussaille de prose et de vers où se trouve pris le mot paysage, Sens, Obsidiane, 2006 (avec des reproductions de dessins peints de Khalil El Ghrib). Aneries pour mal braire, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2006. Khalil El Ghrib, éditions Virgile, « Carnets d’ateliers », 2007 (avec cinq reproductions de dessins de Khalil El Ghrib). Tirage de tête (sous étui avec un dessin original de Khalil El Ghrib). Le poème n’y a vu que des mots, Chaillé-sous-les-Ormeaux, L’Idée bleue, 2007. Un paradis de poussières, Marseille, André Dimanche éditeur, 2007. Se os felos atravesan polos nosos poemas ?, Santiago- de-Compostela, Amastra-N-Gallar, 2008 (avec des photos d’Emilio Araúxo). Comme pour être un jardin, Tunis, Tawbad, 2008 (bilingue, texte traduit en arabe par Saleh Diab ; couverture d’Anne Slacik). Une idée de jardin à Beyrouth, Soligny-la-Trappe, Ficelle n° 84, 2008. Tirage de tête (sous coffret, avec une gravure originale de Vincent Rougier). Coudre ton enfance à demain, Montluçon, Contre-allées, « Poètes au potager », 2008. D’autres vanités d’écriture, Tarabuste éditeur, Saint-Benoît-du-Sault, 2008. 31 poèmes de l’Amérique un peu, Contre-Pied, Martigues, 2008. Repris dans America solitudes. Bernard Pagès, Elancées de fêtes, mais tenant / Au socle du monde, Paris, La pionnière / Pérégrines, 2009 (avec des photographies de sculptures de Bernard Pagès). Portrait du père en travers du temps, Nancy, La Dragonne, 2009. Tirage de tête (avec une lithographie originale de Djamel Meskache). Le désir échappe à mon poème, Paris, Al Manar, 2009 (avec cinq reproductions de dessins de Mohamed Kacimi). Tirage de tête (sur vélin d’Arches). A port de temps, collectif, « De n’importe où à nulle part dans le mot septembre », Gigondas, Atelier des Grames, 2009/2010. Retour en des cafés de là-bas, Laon, La porte, 2010. Tissus mis par terre et dans le vent, Paris, Le Castor Astral, 2010 (avec des reproductions de photographies de Bernard Abadie). En tirant sur les mots, La Fermeté, éditions Potentille, 2010 (avec une photographie en couverture d’Emilio Araúxo). Peliqueiro levantando os brazos, Saint-Jacques-de-Compostelle, Amastra-N-Gallar (un fragment de lettre traduit en galicien par Emilio Araúxo, et une photo d’un peliqueiro). America solitudes, Marseille, André Dimanche éditeur, 2010. Où vas-tu dans la forêt, Odile Fix, 2010 (avec 3 photographies de Magali Ballet). Mobile de camions couleurs pour le noir et blanc de plusieurs photographies de Michel Butor, Besançon, Editions Virgile, 2010 (avec 9 photographies de Michel Butor). Durance, version dite « de papier », Atelier des Grames, leporello de 12 pages tiré à 111 exemplaires, 2011. Si les felos traversent par nos poèmes ?, éditions Jacques Brémond, 2012 (avec 7 photographies de Emilio Arauxo et une de James Sacré), 64 pages. Xestos para continuar, Amastra-N-Gallar, (avec 2 photographies d’Emilio Araúxo et sa traduction du poème en gallicien), 12 pages, editión non venal. Le paysage est sans légende, Al Manar, éditions Alain Gorius, 2012 (avec des reproductions de dessins de Guy Calamusa) 48 pages. Affaires d’écriture (ancrits divers), éditions Tarabuste, collection « Reprises », 2012, 234 pages. À Bazoches, Du poil aux genoux, 2013 (en supplément à la revue, n° 36 du 6 janvier 2013) (4 pages). « Affaires de formes », Catalogue Claude Viallat, Bernard Ceysson éditeur, 2013 (vingt poèmes avec des reproductions d’œuvres de Claude Viallat et une présentation de Pierre Manuel). Ah ! V’la un papillon, éditions Tarabuste (avec six planches de reproductions d’œuvres de Daniel Dezeuze), 2013. Parler avec le poème, La Baconnière, collection Langages, 2013. Donne-moi ton enfance, éditions Tarabuste, 2014. Ne sont-elles qu’images muettes et regards qu’on ne comprend pas ? Aencrages & Co, 2014. On cherche, on se demande, La Porte, 2014. Ecrire un poème, La Main qui écrit et Les Venterniers, 2015 (avec des encres de Chine et une suite de poèmes de Florence Saint-Roch et un entretien avec Florence Emptaz), 63 pages. Dans l’œil de l’oubli suivi de Rougigogne, Aux éditions Obsidiane, 2015, 94 pages. Un désir d’arbres dans les mots, Paris, Fario, 2015 (avec des dessins de Alexandre Hollan) James Sacré, par Alexis Pelletier (avec une étude d’Alexis Pelletier, un entretien et une anthologie de textes), éditions des Vanneaux, « Présence de la poésie », 2015. Figures qui bougent un peu et autres poèmes, Gallimard, « Poésie/Gallimard », 2016 (avec une présentation par Antoine Emaz).
Livres à tirage limité et livres d’artistes:
La transparence du pronom elle, Chambelland, 1970 (avec des burins d’Yvon Vey). Rrepris dans Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t’aime. Une bonbonne, Paris, Collectif Génération, 1978. Repris dans Bocaux, bonbonnes, carafes et bouteilles (comme). Puis repris dans Les mots longtemps, qu’est-ce que le poème attend ?. Fire, Paris, Collectif Génération, 1981 (avec des photographies de Ian Baxter). Repris dans La poésie comment dire?. Déplier replier le poème; l'abandonner, le ranger, Saint-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste,1988 (avec des travaux de Thierry-Loïc Boussard). Repris dans La nuit vient dans les yeux. Paysan comme (quatre fois), Paris, Collectif Génération, 1989 (avec des peintures de Jane Hammond, Sonia Guerin, et Ronald King). Repris dans Si peu de terre, tout. Comme un geste d'écriture, Paris, Bernard-Gabriel Lafabrie, 1991 (avec des lithographies de Lafabrie). Repris dans Viens dit quelqu’un. Noces: moments que le bonheur te prendrait par la main; ou par les mots,. Nice, La Mètis, 1992 (avec un dessin de Philippe Favier). Repris dans Viens dit quelqu’un. Passage par sept poèmes d'un autre livre, La Madeleine, ed. de, 1993. Repris dans Viens dit quelqu’un. Paroles de l'autre, Nice, Epiar-Cnap, 1993 (avec des sérigraphies de Laura Corti). Repris dans Viens dit quelqu’un. Une dimension de silence, Liancourt-Saint Pierre, Atelier de papier, 1993 (avec des gravures d'Isabelle Baeckeroot et de Didier Godart). Repris dans Une petite fille silencieuse. L'éternité c'est juste à côté, Saint-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste, 1994 (avec des travaux de Patrick Mellet). Repris dans La peinture du poème s’en va. Haïk de mots pour Essaouira, Saint-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste, 1994 (marqué été 1995) (avec six lithographies peintes de Mohamed Kacimi et trois planches de texte). Repris dans La peinture du poème s’en va. Si on voit tout sans rien voir?, Nice, Epiar-Cnap, 1995 (avec des travaux de Sonia Guerin). Repris dans Ecrire à côté. Petite note sur le désir d'écrire, Paris, Collectif Génération, 1996 (avec des interventions de Françoise Quardon). Repris dans Le désir échappe à mon poème. Voyages au centre de la chair, Paris, La Voix du Regard, 1996 (collectif peintres et poètes). Repris dans Le désir échappe à mon poème. Le corps qui maintient, Paris, Editions Maeght, 2001 (avec deux gravures de Jean-luc Parant). Repris avec des modifications dans Un paradis de poussières. On a traversé des territoires indiens, Montpellier et Saint-Hilaire du Rosier, Editions de livres objets “Le Galet”, 2001 (sept poèmes manuscrits avec sept pastels de Thierry Lambert). Repris dans L’Amérique un peu. Comme un brouillon continué, L’Ile Rousse/ Montpellier, Baltazar, 2002 (poèmes manuscrits avec des peintures de Julius Baltazar). Repris dans Un paradis de poussières. Si le corps dit, vraiment?, L’Ile Rousse/ Montpellier, Baltazar, 2002 (poèmes manuscrits avec des peintures de Julius Baltazar). Repris avec des modifications dans Un paradis de poussières. Comme un repli du temps dans le jardin diminué, L’Ile Rousse/ Montpellier, Baltazar, 2002 (poème manuscrit avec des peintures de Julius Baltazar). Repris dans Un paradis de poussières. Caresse d’écriture à des couleurs, Nice/ Montpellier, Gérard Serée, 2002 (poèmes manuscrits avec une gouache, un travail peint et des gravures de Gérard Serée qui a fabriqué le livre). Repris dans Le poème n’y a vu que des mots. Comme pour être un jardin, Paris, Robert et Lydie Dutrou éditeurs, “En Puisaye” n° 10, 2002 (avec Cinq lithographies de Jean-Paul Agosti et une gravure originale pour les exemplaires de l’édition de luxe). Un reste de fruit qu’on a mangé, Gallargues-le-Montueux, À travers, 2003 (poèmes pour accompagner une photographie de Jacques Clauzel). Repris dans Le poème n’y a vu que des mots. La mémoire de personne, Lyon, C. D’hervé éditeur, 2004 (avec une eau-forte de Richard Texier). Repris dans Donne-moi ton enfance. Un p’tit garçon, je sais plus, Paris, Bernard-Gabriel Lafabrie, 2004 (avec six linogravures de Joan Hernandez Pijuan). Repris dans Donne-moi ton enfance. Ecriture aux objets d’encre, Octon, Verdigris, 2005 (avec quatre gravures en manière noire de Judith Rothchild; exemplaires de tête avec une mezzatinte supplémentaire de Judith Rothchild; typographie, étuis et coffrets de Mark Lintott) ; repris dans Le poème n’y a vu que des mots. Du sensible et du parfum d’ange, Sain-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste, 2005 (avec des travaux de Khalil El Ghrib). Repris dans Khalil El Ghrib. Un, deux... seize, Paris/Pompignan, Anne Slacik éditrice, 2005 (texte disséminé dans seize livres peints par Anne Slacik). Petit volucraire patoisé, La Touche, “Collection privée”, 2006 (livre fabriqué, illustré et calligraphié par Guerryam). Une galbule, Gallargues-le-Montueux, éditions À Travers, 2006 (avec une photographie de Jacques Clauzel). Repris dans Le poème n’y a vu que des mots. (ou la rivière) une rivière, Soussans, Ateliers Barraud-Parage, (extraits de Cœur élégie rouge et d’Une petite fille silencieuse avec des dessins de Claude Barraud). On s’imagine, Pierrerue, Youl, 2007 (livre fabriqué et illustré par Youl). Serge Fauchier, “Entre peinture et poème, l’éclairage vient peut-être de l’écart”, Méridianes, Montpellier, 2007 (avec un texte de Christian Limousin). Un seul mot, Nice, Atelier gestes et traces, 2008 (livre manuscrit avec 5 gravures de Gérard Serée qui a fabriqué le livre). Trois ou quatre petits livres et quelques plus grands formats de papier, Montpellier/Vitry, Les éditions de Rivière, 2009 (quatre poèmes avec une peinture de Julius Baltazar). Paroles du corps à travers ton pays, Anger, Atelier de Villemorge, 2009, (cinq poèmes avec deux gravures sur bois de Jacky Essirard). Repris dans America solitudes. Mon poème empêché, Saint-Christol-lez-Alès, Les éditions de Rivière, 2010 (trois poèmes imprimés par François Huin, typographe à L’Hay-les-Roses, et les 22 pages peintes par Julius Baltazar), 30 exemplaires sur vergé Van Gelder peint au préalable avec rehauts à l’encre de Chine et crayon arlequin. Un désir de paysage, Montpellier, Maison de la Gravure Méditerranée, 2010 (cinq gravures de Mustapha Belkouch, et des encres, six poèmes de James Sacré et collaboration de Vincent Dezeuze pour l’impression, livre cousu et dos collé dans une reliure coffret de métal. Durance, Gigondas, Atelier des Grames, 2011 (textes gravés par Anik Vinay sur trois galets reliés par un fer). Camions transportés d’écriture, Saint-Laurent-du-Pont, Le Verbe et l’Empreinte, 2011 (exemplaires sur vélin d’Arches, avec une gravure en relief rehaussée d’argent de Marc Pessin, La gravure et une double page contenant les poèmes mis dans une chemise de vélin d’arche). Un serpent de vert, Paris, Joël Leick, 2011 (deux exemplaires manuscrits avec des photos et couleurs de Joël Leick). Couleurs qui te regardent, Montpellier, Maison de la Gravure Méditerranée, 2011(avec neuf gravures et quatre reproductions d’encres de Mostafa Belkouch, et un gaufrage en couverture). Femmes dans l’ombre d’autres femmes, Paris, Peauésie de l’Adour, 2010 (avec des dessins originaux de Colette Deblé). Bâches, bernes et d’autres toiles parlées, Montpellier, éditions Méridianes, 2012 (dans Ji, feuille de papier coréen Han-Ji pliée en huit avec, au verso, une estampe de Claude Viallat. Le paysage est sans légende, Paris, Éditions Alain Gorius, 2012,( leporello de huit pages, avec un dessin peint de Guy Calamusa au recto et le texte des poèmes au verso). Paysage au rouge, Paris, Joël Leick, « Books and Things », 2012, (deux exemplaires manuscrits avec des photos et couleurs de Joël Leick). Une touche de vert, Paris, Joël Leick, « Books and Things », 2012, (deux exemplaires manuscrits avec des photos et couleurs de Joël Leick). Des mots traversés par le temps, Saint-Christol-lez-Alès, Les éditions de Rivières, 2012 (avec trois dessins d’Yvon Vey pour chacun des douze exemplaires). Si le monde est en couleur ? Tours/Montpellier/Caen, Le livre pauvre, « Conflit », 2012 (avec des interventions de Philippe Boutibonnes). Quatre fois son portrait dans les Etats-Unis d’Amérique, éditions Wequetequock Cove-Stonington, 2012 (avec quatre gravures sur cuivre de Julius Baltazar, pressées par l’Atelier Alain Piroir à Montréal sur japon sekishu préalablement peint à l’unité par le peintre, et un original en frontispice de la page de titre. La traduction des quatre poèmes en américain est de Joshua Watsky). Artine mal étoilée, Tour/Montpellier/Caen, Le livre pauvre, série « Artine », 2013 (avec des interventions de Philippe Boutibonnes). Maison natale demain, Montpellier, éditions Méridianes, 2013 (avec des peintures de Jean-Paul Héraud) A peine une réponse, Joël Leik, « Paisatges »,,2013, un livret unique. Landscape en bleu, Joël Leik, 2013, un livret unique. Neuf vers pour une question, Joël Leik, « Landschaft », 2013, un livret unique. Ne sont-elles qu’images muettes et regards qu’on ne comprend pas ? Aencrages & Co, 2014.(avec une peinture originale pliée en quatre de Colette Deblé encartée dans le livre). Un jour on est là, Editions de La Margeride,, 2014 (50 exemplaires, sur Olin 250 g, avec une couverture aquarellée et une aquarelle sur double page de Robert Lobet ; conception, impression et peintures de Robert Lobet). Edition dite de tête, (12 exemplaires, avec couverture et quatre peintures intérieures sur double page, bâton d’encre de chine et encres diluées de Robert Lobet) Affaires de formes, éditions La Canopée, 2014, avec deux suites de peintures de Claude Viallat, sous emboîtage par l’Atelier Jeanne Frère à Nantes, et deux empègues (pochoir) d’Yves Martin réalisés à partir de deux dessins de Claude Viallat) (21 exemplaires). Quatre fois sur le motif, au Languedoc, collection « Mémoire », 2014 (avec des peintures de Georges Badin ; trois exemplaires). Solitude et silence dans le geste des titres, Editions Mains-Soleil, décembre 2014 (avec des peintures de Fabrice Rebeyrolle) (12 exemplaires : trois pages intérieures d’un dépliant). Quel geste a fait ton père que tu ne comprends plus ? Les Cahiers du Museur, collection « A côté », 2014 (deux poèmes : « Ma guenille : des carnets mal écrits sans forme » ; « Le paysage traversé ce matin », avec des interventions de Guy Calamusa) tirage de 21 exemplaires. Poesia alla pugliese, Nice, Atelier Gestes et Traces, 2014 (texte manuscrit, avec huit peintures de Gérard Serée ; trois exemplaires). Personne, Editions Rencontres, chaque exemplaire contient deux peintures de Jacques Clauzel ; coffret réalisé par les ateliers Dermont-Duval. 9 exemplaires. Personne, Editions Rencontres, chaque exemplaire contient deux collages de Jacques Clauzel ; étui réalisé par les ateliers Dermont-Duval. 3O exemplaires. Une chèvre en Méditerranée, Ateliers Barraud-Parage, mars-avril 2015 (cinq feuillets de papier Ingres MBM Arches, 35 exemplaires numérotés et 3 exemplaires HC). Ombres et lumières du chai, Ateliers Barraud-Parage, avril 2015 (30 exemplaires numérotés et 3 exemplaires HC . Extraits de Bocaux, bonbonnes, carafes et bouteilles (comme), dessins de Claude Barraud dont un original). Comme un bâti de fil, Book Leick, 2014 (écrit en juillet 2015 ; deux exemplaires uniques). Tenir ensemble, Book Leick, 2014 (écrit en juillet 2015 ; deux exemplaires uniques). Marrakech écriture , Robin dort , Maguelonne , Au musée Fabre , Quel esprit montré ? , Face à Face, 2015, livrets réalisés par Jean-Pierre Thomas à Samoreau (chaque livret en deux exemplaires) Poesía alla Pugliese, Atelier Gestes et Traces, 2015, orné de 7 peintures originales , plus une pour la couverture par Gérard Serée. Si légers fragments du monde, Association Méridianes, 2015 , « Collection Liber », avec des collages de Khalil El Ghrib (25 exemplaires, deux œuvres originales de Khalil par livre).
Cassette/CD: L'obscurité qui nous prend par la main. Paris: Artalect, 1994. Repris en CD chez Artalect, 2006.
*** |
|
Simone Alié-Daram
17/03/2016 |
Christian Saint-Paul reçoit Simone Alié-Daram accompagnée pour l’occasion du poète plasticien Claude BARRERE qui connaît bien l’œuvre poétique de son amie. Celle-ci est née en 1939 à Toulouse. Cette pupille de la Nation, médecin, a connu une longue carrière dans la Recherche médicale et la sauvegarde d'enfants atteints d'anémie immunologique (RH disease). Une carrière distinguée de nombreux honneurs officiels, qui ne lui ont pas tourné la tête. Simone ALIE-DARAM écrit depuis l’enfance, mais n’a franchi le pas décisif de la publication qu’en 2007 avec « Ecritures » Société des Ecrivains éditeur. Elle poursuit ensuite avec « Emoti’icones » en 2009 (CopyMedia), « Effluves » en 2010 (Copy Media), « Des Ephélides plein les poches » en 2011 (Copy Media), « Ellipsoïdes » en 2012 (Copy Media) et « Paradis ébouriffés » en 2012 (Copy Media). Chaque volume 12 € est à commander par courriel à : daramalie@free.fr
Elle fût élue maître-es-jeux à la prestigieuse Académie des Jeux Floraux de Toulouse en 2011, l’Académie la plus ancienne d’Europe. A ce titre, elle fit en 2012 l’éloge de Clémence ISAURE, exercice particulièrement difficile devant l’auguste assemblée, et réussie. Sa poésie est resserrée dans des textes assez courts, bâtis souvent comme de véritables croquis impressionnistes. Elle saisit des scènes de vie, fige leur fulgurance dans la gangue des mots. C’est souvent aussi une poésie contemplative. Ses qualités éprouvées d’observation font merveille dans le saisissement de la vie qui l’entoure, des agissements des autres. Elle est en éveil perpétuel, et écrit comme on photographie. Il en résulte un charme permanent où transparaît une inébranlable passion de vivre, sans leurre, avec la lucidité de l’expérience. En 2013 elle publie « Passions effleurées » poésie toujours édité chez COPYMEDIA 12 € que l’on peut aussi commander à www.copy-media-net
On pénètre dans ce livre dans la poésie de l’intime. Or, le mot a un double sens, intime c’est à la fois s’adresser à soi-même mais aussi partager quelque chose dans la confidentialité. Le terme vise la solitude intérieure et son contraire, le partage. Dans ses poèmes, Simone Alié-Daram en s’adressant à elle-même par d’incessants soliloques sur ce qui capte son regard et son âme, fait partager son émotion au lecteur fatalement intime. « Les langues sont la faune et la flore de notre intériorité » disait G. Steiner. A propos des poèmes « flashes » de l’auteure, il est aisé de vérifier la formule de Georges PERROS : « Poète celui qui habite totalement son être ». C’est le quotidien, dans ce qu’il a de plus révélateur de nous-mêmes et des autres et partant de l’époque, qui est la toile de fond des poèmes de Simone ALIE-DARAM. La peinture des circonstances permanentes de notre vie oblige à un regard attentif, pour voir ce que l’on ne voyait plus. Il y a de l’enchantement dans ces moments de contemplation qui donnent naissance au poème. L’inaltérable optimisme de l’auteure, malgré toutes les tempêtes essuyées, lui permet d’écrire : « Le bonheur marche à côté de moi / Certains matins il me prend par la main ». Elle croit comme Christian BOBIN « que quelque chose vient à tout instant nous secourir ». Poésie de contemplation, et poésie de célébration, de l’instantané (les flashes). Mais toujours avec lucidité : « Je ne parle de rien, je sais que tout va bien / Et j’attends de partir ». Un voile de scepticisme passe, mais vite dispersé : « Le monde a-t-il encore une âme ? ». Le rire n’est jamais loin et finit par gagner. Il est salutaire avec la musique qui rend la vie plus légère à traverser. L’auteure est douée d’humour et s’amuse parfois avec les lettres « M …Mains d’amour emmêlées / Même si, malgré moi ». L’érotisme comme le titre du livre n’est qu’effleuré, comme les passions qui l’animent et qu’elle tient à distance sans les effacer, et l’amour est partout présent dans ce regard généreux sans ostentation sur le monde et l’autre. Et l’on devine que les passions les plus fortes ne sont pas toujours les plus bruyantes : « Amour fusion dans lequel tremble / L’indicible que tu sais ».
Une poésie passée au tamis des sentiments violents qui emporteraient les passions dans les marécages de la conscience humaine, mais une poésie vivante, terriblement vivifiante et claire. Plus tard elle fait paraître « Paradis ébouriffés » ; ces poèmes se lisent d’un trait comme un roman. On pénètre dans l’univers intime du poète avec une facilité jubilatoire. Impression de tout comprendre immédiatement et d’être en permanente empathie avec ce regard porté sur la vie qui passe, qui est passée, sur les choses bonnes à prendre ou à contempler pour demeurer blessé certainement, mais jamais anéanti. Une profonde humanité se dégage de ces textes où l’abandon est contenu par une pudeur qui en font des œuvres d’art. Des hommes et des femmes rêvent d’une fleur Et ne sauront jamais la vérité sur leur enfance ; Est-ce que les jeunes gens meurent toujours dans les plaines Comme des plantes épuisées ? Pour ceux-là qui rêvent ou qui ne sont plus là Ecrire un vers soufflé comme une bulle Ou sec comme un bâton de réglisse Ensuite aller voir Bruges, Les deux pieds enfoncés dans le mythe de l’eau, Où maintenant est déjà passé.
Et sur le canal du Midi :
Je vais bader le canal vert Entre les vieux arbres qui Amoureusement penchent Leurs feuilles pour le caresser, Le vent s’amuse dans mes mèches, Un canard hiératique Danse. Egrenant sur son cou Des reflets mordorés. L’ombre fanée doucement lèche Les piles du pont envasées. Penche la tête oh ! Ma colombe, Toute de gris emperlée Que de ma bouche à ton long cou Le vent y dépose un baiser.
Ce soir elle vient présenter son dernier recueil « SYLLABES » qui constitue le n° 450 de la revue ENCRES VIVES, 6,10 € le numéro, abonnement un an 34 €, à adresser par chèque à Michel COSEM 2 allée des Allobroges, 31770 Colomiers.
Christian Saint-Paul qui signe la quatrième de couverture du recueil écrit :
... « Je ne parle de rien, je sais que tout va bien / Et j’attends de partir », écrivait-elle, comme une conclusion d’une vie saturée d’expérience, dans son dernier livre. Pourtant, avec ce nouveau recueil « Syllabes » d’une écriture épurée, d’une grande densité, elle poursuit le chemin, lucide sur l’impossibilité de revenir en arrière, mais sans rien oublier de ce qu’elle a traversé. La mélancolie, après un si long parcours d’une puissante vitalité : « Où es-tu ma rebelle », se réfracte dans le regard et elle atteint, sans l’avoir choisi, le plus troublant de sa parole poétique : « J’ai accouché de la tendresse » ; « Je veux mourir dans le vent / Grignotée d’amour par des vapeurs d’êtres ». La terrible expérience de la vie, des deuils, le temps qui s’effiloche, obscurcissent les jours à venir et elle se voit « sans devenir / Comme un mollusque handicapé ». Mais l’amour sauve du naufrage, un autre amour, non celui, charnel, qui lui a été enlevé : « Je suis vide de toi / Où es-tu passé / Une pluie de peines glacées / Me labourent le crane / Sans cesse », mais celui, impalpable, incommensurable qui lui permet de se « voir par transparence » et aller « sur un possible infini ». Elle sait qu’elle a atteint le discernement et qu’elle veut l’exprimer, comme toujours, avec pudeur : « Dans les mots que tu dis / Il y a plein de sens / Cachés ». Ce discernement qui, pour percer, fait le vide : « Quand tous les arbres qui cachent les forêts seront morts / On verra peut-être par-delà les futaies ». Et l’Espérance se dessine à l’horizon de la nostalgie et de la tendresse : « Demain / […] / Je deviendrai le souffle ».
Simone ALIE-DARAM, membre également de l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres, construit à l’évidence, pas à pas, une œuvre poétique. Elle saisit ces monuments d’instants par le langage. La poésie, c’est avant tout le souffle, disait Breton. « Je deviendrai le souffle ». Il y a une foi dans ce possible qui se dessine et dans lequel elle va devenir ce souffle. Nous sommes coincés, explique-telle, en tant qu’êtres humains entre plusieurs infinis, celui cosmique, celui des toutes petites choses, celui de nos pensées, et plus tard, nous deviendrons effectivement un souffle efficace pour tout ce qui reste, ce que nous avons aimé, les choses, les êtres. C’est monstrueusement vivant le souffle. Pour Luc Decaunes « La fonction même du poème est de nommer, de préserver, de sauver tout ce qui mérite de l’être face à la misérable activité des larves. Seul, il peut donner un sens, un avenir au contenu de l’existence que le temps dégrade, que la bêtise avilit ». Pour Simone Alié-Daram, on ramasse les instants comme avec une épuisette. Le rapport au temps est primordial. Or, le temps n’existe pas ! Le temps de dire cela, et le temps est déjà passé. Il faut fixer les choses au moment où nous les avons sous les yeux. Nous avons une existence tricotée de passé et d’avenir.
Pour Sylvia Pbath : « Le poème est un
moment d’éternité ». Ce flash de l’instant, commente S. Alié-Daram,
c’est le caillou dans la mare, avec toutes les ondes qui se répercutent
en nous et ailleurs, et dans ce que nous faisons et ce que nous sommes.
Mais le poète, en dehors de ses moments de dépression, est un émerveillé
de la vie. Il peut l’être par le moindre détail, la moindre lumière.
C’est une façon de dire la beauté du monde. Et pour dire la beauté du
monde, il faut l’aimer. Dans mon métier, insiste-telle, j’ai vu des
choses terribles, des enfants qui sont morts dans mes bras et on est
bien obligé de passer par-dessus ces malheurs, car malgré cela, le monde
est beau. Il n’y a pas d’angélisme béat dans cette imposture qui exige
simplement de passer par des acceptations, la première étant celle de
soi-même, puis de certaines règles. Car la révolte permanente ne mène à
rien. Ce qui ne veut pas dire que le poème n’ait pas pour objet cette
révolte qui est parfois salutaire, qui fait du bien. Claude Barrère
évoque la dimension humoristique de Simone ALIE-DARAM. Humour d’abord
par rapport à soi-même. Si sa lucidité apparaît à l’évidence, la
sensation est toujours très présente. Il s’échappe souvent des
sentiments mélancoliques, au sens où la mélancolie est un sentiment
profond. Elle est vivace dans son dernier recueil. Mais cette
mélancolie, dans ce recueil, débouche sur l’Espérance, la plupart du
temps dans les poèmes de Simone ALIE-DARAM, elle débouche sur une note
optimiste ou sur l’humour. Lecture par Simone ALIE-DARAM de mélancolie, puis d’une scène sur le Pont Neuf. Mélancolie douce, mélancolie ratée, Mélancolie mort-née Morte saison sournoise Impliquée de non vu De non être Planète ébréchée Qui tourne Pathétique Sans même de pourquoi. * J’ai laissé mon amour sur le quai Embruni de feuilles dorées Le vent et l’eau jouent dans les clochetons
Sous la pile du pont Les filles emmanchées sur leurs très longues cuisses Promènent leur pâleur Leurs cheveux raidis Flottent dans l’air douceâtre Cavernicole et étoilé. * Certains poèmes sont de véritables tableautins, constate Claude Barrère. Un poème vient d’une phrase dite par un autre et qui résonne en moi, poursuit Simone, ou parfois d’une anomalie ou de quelque chose de bizarre, comme celui-ci : Dans les jardins déserts L’avenir s’écrit en questions
Et quand tu mets la tête en arrière Tu survoles un troupeau de brebis ombrées Qui chahutent sur fond bleuté.
Cela, c’est regarder les nuages dans le ciel en mettant la tête en arrière, c’est tout ! « J’ai laissé mon amour sur le quai ». « L’amour n’est pas qu’échange, il est sacrificiel », disait Georges Lambrichs, affirmation partagée par Simone ALIE-DARAM. Les voix auxquelles elle parle sont ses amours sacrificielles. Elles sont devenues des souffles, précise-t-elle. Mais ces voix, ces ombres, sont à la fois rassurantes, mais c’est quand même un huit-clos. Il faut en sortir.
La fonction de la poésie peut être
une catharsis. L’écriture, comme toute forme d’art, est une forme de
sauvetage. Ce que Simone ALIE-DARAM nomme « les signes réprimés »,
au-delà de la pudeur de dire, c’est une façon, juge Claude Barrère, de
ne pas se prendre trop au sérieux. Il n’y a pas l’ombre d’un
nombrilisme, d’un narcissisme, dans la langue de Simone ALIE-DARAM. Dans
l’écriture, elle se regarde avec distance, donc avec discernement,
quelquefois avec dérision. Mais au-delà de cette lucidité qui peut
sembler cruelle, son regard enveloppe le cosmos. Sa poésie est cosmique.
Le cosmos la laisse sans voix. L’écrasement de l’immensité conduit à la
dérision de soi, mais aussi à une certaine joie d’en faire partie. Dans d’autres recueils, le corps est important chez Simone ALIE-DARAM, remarque Claude Barrère. Le toucher est important, renchérit Simone ALIE-DARAM. La poésie ne fait pas dans l’écart. Il faut noter les correspondances. « Nous sommes sous le même orage », m’a dit un jour un ami au téléphone quand grondait le tonnerre. C’est ça, une correspondance.
Lecture d’extraits de « SYLLABES »
Mots incompréhensibles Ennui incompatible Folle foule indocile Anéantissement éthéré Mort programmée Plus vivante que la vie. Happée par des algues brutales Au fond d’un goulet sournois Elle est sans devenir Comme un mollusque handicapé Elle glisse et dérape Sur des concepts branlants Le corps gluant désintégré.
Tout oublier sur l’oreiller Pensées ancrées dans le duvet Rétablir la connexion délabrée Quand tu verras le calamar aux reflets de lune Les vierges des coins de rues Souriront dans leurs cages grillagées.
Est-ce l’orage, est-ce le vent Est-ce les nuages sur les montagnes velours Est-ce un vieil olifant soufflé par des âmes perdues Je me noie dans la pluie couronnée d’un arc vert À mille lieux de tout Juste au centre de moi.
Transparente à la lumière de l’eau Douce et laxe Pseudopodes moelleux De notre monde copie de l’autre Dans toute cette nuit Je peine à garder les yeux ouverts Au bout de plusieurs mois J’ai accouché de la tendresse. * Ce recueil dit une fringale d’amour, constate Christian Saint-Paul. Nous avons besoin de beauté et d’amour, affirme Simone ALIE-DARAM et Claude Barrère croit que dans le désir de langue, il y a en premier le désir d’amour. Il faut parler du désir aussi. Henri Heurtebise disait que si la poésie n’avait pas pour vocation, par tous les détours possibles, de louer la vie, les êtres, les animaux, les choses et la beauté du monde, il faudrait l’arrêter. Elle serait scandaleuse. Le recueil de Simone ALIE-DARAM s’inscrit dans cette volonté. * Christian Saint-Paul avant de clore l’émission incite les auditeurs à lire : Jets de poèmes Dans le vif de Fukushima de Ryôichi WAGÔ éres éd. collection PO&PSY, 300 pages, 25 € Le poète japonais Ryôichi Wagô, ayant pris le parti de rester dans sa ville après la catastrophe de Fukushima, publie les tweets qu'il a écrits « à vif » pendant ces jours terribles, et nous fait les témoins de sa remontée des enfers grâce à l'écriture poétique. Après le 11 mars 2011, Wagô est l'un des premiers écrivains à transmettre l'ampleur de la catastrophe de manière palpable et concrète, dans des poèmes hantés par une tragédie vécue au quotidien, dont il décide de rendre compte sous forme de tweets réguliers. Ces poèmes, à la fois très simples et très inventifs, par leur moyen de transmission mais aussi par leur style elliptique et incantatoire, d'une grande force, auront un retentissement important à travers le Japon et même au-delà des frontières du pays. La mise en page et la typographie de ce recueil sont en totale adéquation avec ce work in progress où le lecteur assiste avec sidération à la création quasi ex-nihilo (l'annihilation catastrophique) du langage poétique et d'une réflexion forte sur le rapport du langage à la terre natale. * Le voyageur à son retour, de Jean-Michel Maulpoix Le Passeur éd. 160 pages, 15 €, livre numérique 6,90 € Un recueil poétique qui célèbre la joie infime des plaisirs partagés et les surprises liées au décentrement du voyage. Jean-Michel Maulpoix, agrégé de lettres modernes, enseigne la poésie moderne et contemporaine à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris III. Directeur de la revue Le Nouveau Recueil, il est l’auteur de nombreux ouvrages (poésie, critique littéraire, essais), parmi lesquels : Une histoire de bleu (1992), L’Instinct de ciel (2000), Chutes de pluie fine (2002), Pas sur la neige (2004). « Mais tu l’as bien compris : c’est pour cela que je m’en vais, que je m’envole, que j’en appelle au plus lointain. Ces étoiles au sol, ces feux roses de l’aube, ces forêts, ces rivages, ces toitures : la terre, la maison des hommes. Je ne connais pas de moment plus heureux que l’atterrissage. Ces départs, après tout, n’ont pour objet que le retour. » Jean-Michel Maulpoix saisit les émotions fugitives qui naissent de tous les sens. Chez lui, ce sont les voyages qui conduisent à l’éveil d’une sensibilité poétique tissée entre l’intime et le tangible. Après quelques années de silence, les mots du poète résonnent à nouveau dans ce recueil célébrant la joie infime des plaisirs partagés et les surprises liées au décentrement du voyage. En fin de volume, un carnet accueille l’écho qu’ils ont laissé dans l’oreille de quelques lecteurs. *** |
|
Philippe BERTHAUT
10/03/2016 |
|
|
Alem Surre-Garcia
03/03/2016 |
|
|
Jean-Pierre Lassalle
25/02/2016 |
En préambule Christian Saint-Paul invite les auditeurs à assister à la rencontre avec Gérard Macé écrivain-photographe & Georges Monti éditeur, au Centre Joë Bousquet et son Temps le Samedi 12 mars 2016 à 15h 30 au Centre Joë Bousquet et son Temps Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet 53, rue de Verdun – 11000 Carcassonne. Gérard Macé est né en 1946 à Paris. Aux éditions Gallimard (collection « Le Chemin », puis collection « Le Promeneur »), il a publié depuis 1974 des proses narratives et poétiques, comme Bois dormant, Le dernier des Égyptiens, la série intitulée Colportage, mais aussi des poèmes et, plus récemment, deux volumes de Pensées simples. À l’image poétique, il ajoute l’image photographique à partir de 1997, comme en témoignent La photographie sans appareil, Mirages et solitudes, Éthiopie, Le livre et l’ombrelle, La couleur est un trompe-l’œil ou Chefferies bamiléké, tous parus aux éditions Le temps qu’il fait. Écrivain, photographe, mais également très bon connaisseur de la photographie, il évoquera les relations qu’entretiennent la littérature et la photographie, depuis la naissance de celle-ci, et parlera de sa propre pratique à partir de la projection d’un choix de ses images. Georges Monti a créé les éditions Le temps qu’il fait en 1981. Rapidement, pour et grâce à Jean-Loup Trassard (autre écrivain pratiquant la photographie), il a publié des livres illustrés par la photo et a, pour ainsi dire, inventé un rayon de librairie intitulé « écrivains-photographes » (avec les ouvrages de Luc Dietrich, Jacques Laccarrière, Lorand Gaspar entre autres) avant d’ajouter à son catalogue un certain nombre de livres de purs photographes (Doisneau, Ronis, Dieuzaide, Erhmann, Brihat, etc.). Il défendra sa conception du livre de photographie et témoignera, dans un échange avec Gérard Macé, de la complicité qui a prévalu dans la production des ouvrages qu’ils ont faits ensemble.
C’est le nouveau recueil de Simone Alié-Daram, médecin, qui s’est illustrée dans les avancées de l’immunohématologie qui est cité ensuite pour mémoire, cette publication devant faire l’objet d’une émission à part entière. Membre d’académies scientifiques, l' est aussi Maître es-jeux de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Son humanité à fleur de peau s’est exprimée dans la parole poétique par la publication de recueils : « Ecritures », « Emoti’icones », « Effluves », « Des Ephélides plein les poches », « Ellipsoïdes », « Paradis ébouriffés » et « Passions effleurées ». avec ce nouveau recueil « Syllabes » d’une écriture épurée, d’une grande densité, elle poursuit le chemin, lucide sur l’impossibilité de revenir en arrière, mais sans rien oublier de ce qu’elle a traversé. La mélancolie, après un si long parcours d’une puissante vitalité : « Où es-tu ma rebelle », se réfracte dans le regard et elle atteint, sans l’avoir choisi, le plus troublant de sa parole poétique : « J’ai accouché de la tendresse ». A commander Encres Vives, 2, allée des Allobroges, 31770 Colomiers, 6,10 €, abonnement 34 €.
L’émission est ensuite consacréeà Jean-Pierre LASSALLE. Christophe DAUPHIN dans la revue « Les Hommes sans épaules » le présente ainsi : « Jean-Pierre Lassalle (né à Padirac le 9 août 1937), « qui sait caresser l’oiseau dans la pierre, capter le soleil ou la lune d’une monnaie », selon André Breton, a participé aux activités du mouvement surréaliste de 1959 à 1966, quand l’auteur de Nadja lui confia le soin d’inventorier la bibliothèque de son ami Benjamin Péret, qui venait de mourir. « La succession de Benjamin Péret avait traîné car son fils et seul héritier était brésilien, officier supérieur dans l’Aviation, et avait donné tout pouvoir à Breton. Péret était, on le sait, plutôt cigale que fourmi et vivait au jour le jour. Les Bédouin lui avaient procuré une chambre, rue Gramme, et il se plaignait d’être très mal logé. Il y avait entassé livres et documents, dont de nombreuses photographies d’identité de militants de la IVe Internationale, sans noms pour identification, obscurs témoins d’années de militantisme. Je procédai à ce travail exténuant d’inventaire, avec l’aide de Jean-Louis Bédouin. Je garde un bon souvenir de ces heures pourtant harassantes », témoigne Jean-Pierre Lassalle, qui, un an plus tard, publia (in revue Bief n°10/11, 1960) ses théories monétaires : «- macroscopique: mettre en circulation d’énormes billets de banque en béton précontraint avec figurant la République une vestale murée vive dans un bain de plexiglas... - microscopique: frapper une monnaie plus petite qu’un grain de sable, une monnaie que l'on perdra tout le temps; que l’on aura sous l’ongle, dans l’œil, dans une dent creuse... » Après la mort du Grand Indésirable en 1966, Lassalle se réinstalla en province et suivit une carrière universitaire, comme professeur de Linguistique et Littérature françaises, parallèlement à l’élaboration de son œuvre poétique et critique. Il a, entre autres, écrit sur François Maynard, Alfred de Vigny (dont il a donné une biographie de référence) ou Lautréamont. Il a publié des textes et des poèmes dans les revues Évohé, Préverbes, Non Lieu, Les Hommes sans Épaules et Supérieur Inconnu.
Jean-Pierre Lassalle propose des poèmes volontiers hermétiques, c’est-à-dire sous la haute figure d’Hermès, relevant du Trobar clus. Une œuvre poétique totalement atypique qui n’en rappelle aucune autre. À lire : Le Grand Patagon (éd. Salingardes, 1962), Retour de Rodez (éd. Riol, 1963), Rituel de Gueules (Morphèmes, 1967), Brusquement les oiseaux (Temps Mêlés, 1968), Diramant (éd. Riol, 1969), Clé d’amiante et clé d’or (Morphèmes, 1969), Enfin Lépante (éd. Riol, 1971), La Fuite Écarlate (éd. MCP, 1998), Poèmes Presques suivis de La Grande Climatérique (éd. MCP, 2000), L’Écart Issolud suivi d’Agalmata (éd. MCP, 2001), Les petites Seymour (Encres vives, 2007), Alfred de Vigny (Fayard, 2010). *
En 1983 Jean-Pierre LASSALLE a été élu Mainteneur de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse. C’est un poète historique de la poésie surréaliste. Il fait paraître son premier livre de poésie en 1958. Aujourd’hui il vient présenter sa dernière publication poétique : « Il convient » qui constitue le 448ème numéro de la revue Encres Vives. Le n° , 6,10 € à commander à Michel Cosem, 2, allée des Allobroges, 31770 Colomiers ; abonnement un an 34 €. Nous pouvons lire sur la 4ème de couverture : "La vie et l'œuvre de Jean-Pierre LASSALLE semblent se présenter comme les mansions du théâtre médiéval : mansion surréaliste ; mansion ésotérique ; mansion chevaleresque ; mansions des femmes aimées sous le double signe d'Eros et d'Agapè. Humour et créativité dans les thèmes et les images, mais aussi tonalité élégiaque caractérisent ce nouveau recueil. "Celui qui imagine sans érudition a des ailes mais n'a pas de pieds" écrivait Joubert dans ses "Carnets" ; le poète surréaliste Lassalle chausse les sandales ailées d'Hermès.
IL CONVIENT est la devise autographe d'Antoine LASSALLE (1386-1460) sur un manuscrit de Cassiodore en sa possession - même devise qu'il grava le 18 mai 1420 dans la grotte de la Sibylle."
Le père d’Antoine Lassalle explique l’invité, Bernard de Lassalle a été un chef de guerre au service des Anglais et avait son petit château, son repaire, dans le Lot à côté de Céret. Cette devise, Antoine Lassalle l’a calligraphiée sur un manuscrit avec un rébus, avant de la graver dans la grotte de la Sibylle. Il jouait sur les mots, sur son nom la salle, sur sel sal. Cela est emblématique de la fin du Moyen-âge et c’est très poétique. C’est pourquoi nous dit J.P. Lassalle, je me suis permis de prendre « Il convient » comme titre. Mais « Il convient » au sens étymologique du terme que l’on retrouve dans le couvent, dans le convent etc. Il y avait à cette époque une légèreté étonnante pour une époque (14ème et 15éme siècle) traversée par les guerres, les épidémies comme la peste, mais qui connaissait l’éclat de Cours très brillantes comme la Cour d’Orthez de Gaston Phébus, les Cours du Berry, de Bourgogne etc. et en même temps une activité littéraire. Antoine de Lassalle est considéré comme un des premiers romanciers ; il avait une belle plume. En 1323, il y avait déjà eu la création de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse. C’est une période de calamités avec de temps en temps des traits de lumière. Mais nous avons beaucoup de difficulté à concevoir comment les gens se représentaient le monde, il y a sept siècles. En tout cas, ils le transcrivaient comme j’essaie de la faire en plein 21ème siècle. Mais on ne lisait pas comme maintenant, on psalmodiait plutôt d’une certaine façon, mais il n’empêche que la poésie avait une certaine autonomie. Guillaume de Machaut est à la fois un grand compositeur, un grand poète et un rhétoricien. Et la rhétorique est au cœur du langage, donc de la poésie.
Jean-Pierre Lassalle est avant tout un poète surréaliste. Le surréalisme est toujours vivant. Il suffit pour s’en convaincre d’aller voir le site : « Surrealismo Internacional » pour connaître la richesse des publications surréalistes d’aujourd’hui. Il y a de jeunes poètes surréalistes. Il ne faut pas arrêter le surréalisme à la mort d’André Breton. Le groupe, tel qu’il fonctionnait avec Breton n’a pas survécu et a explosé en 1969. Mais les poètes surréalistes ont continué, soit à titre personnel, comme c’est mon cas, précise J.P. Lassalle, soit en formant de nouveaux groupes. Et la poésie surréaliste est toujours en marche. C’était d’ailleurs le vœu de Breton. La poésie d’aujourd’hui est la descendance du surréalisme suppose Saint-Paul. Jean-Pierre Lassalle a tendance à le penser aussi mais il ajoute qu’il y a des gens qui n’aiment pas être influencés ou à la séquence de quelque chose de grand. Mais le surréalisme lui-même était la séquence du romantisme. Et le romantisme a duré un siècle ! Le surréalisme a imprégné tout le 20ème siècle et continue toujours, ce qui est surprenant. Ce long mouvement est admirable et digne d’estime.
Le recueil « Il convient » a fait l’objet d’une recension en langue espagnole précisément sur ce site « Surrealismo internacional ». Saint-Paul en a fait la traduction qu’il lit à l’antenne : « Le titre de ce beau recueil de 16 poèmes, “Il Convient” est la devise autographe d’Antoine Lassalle, ancêtre du poète, qui la grava le 18 mai 1420 sur les murs de la grotte de la Sibylle, comme l’explique le poète dans son texte “Rêver de convenir”. C’est une allusion au récit d’Antoine Lassalle “Le Paradis de la reine Sibila”, récit de voyage initiatique avec une reine immortelle et supérieurement belle qui vit dans un jardin de délices, futur modèle du Venusberg de Tannhaüser. La souveraine de ce paradis païen connaîtra de nombreux avatars littéraires, le personnage de She de Rider Haggard étant un des plus fascinants. Antoine de Lassalle a découvert effectivement une grotte en Italie dans les montagnes de La Sibila situées dans la Marche Anconitana, mais il n’a pu explorer que l’entrée. Un autre des poèmes, “Matta n’est pas de ceux qui meurent” évoque la cérémonie sadienne surréaliste qui eut lieu au domicile de Joyce Mansour et à laquelle Lassalle assista. Le dernier poème, “Hanko Miastik”, extrait des “sargasses de la mémoire” les noms de nombreux amis surréalistes déjà disparus, tels André Breton, Marcel Duchamp, René Alleau, Roger Van Hecke, Jean Palou, Sarane Alexandrian, E.L.T. Mesens, Guy Rosey, Gérard Legrand, Gaston Puel, Adrien Dax...
Hanko Miastik
Tant d'arbres
givrés par le grand froid du temps * Jean-Pierre Lassalle poursuit l’explication assez détaillée des poèmes de « Il convient » : Matta était un homme étonnant, loué par Alain Jouffroy qui vient lui aussi de disparaître. Dans le poème où il est cité, il s’agissait de l’exécution symbolique du testament du marquis de Sade. Dans une soirée, avenue du Maréchal Monory, dans un très bel hôtel particulier, chez Joyce Mansour, Jean Benoit, poète canadien s’est dépouillé du costume symbolique qu’il avait confectionné pour l’occasion, en un effeuillage, et s’est appliqué sur le thorax un fer rouge avec les lettres SADE et a reposé le fer. Matta a voulu l’imiter, mais comme il n’était pas préparé (par l’alcool et autre), il s’est évanoui, brûlé au 3ème degré. Mais Breton, admiratif, a repris alors contact avec Matta avec lequel il était brouillé. J’ai voulu rendre compte de cela, poursuit J.P. Lassalle, parce que Matta est un très grand peintre dont la côte est de plus en plus haute. Je lui ai donc consacré un poème. J’ai voulu aussi reprendre la poésie encomiastique, née au 16ème siècle qui faisait l’éloge de la folie. C’est « l’éloge de la folie » d’Erasme. Mais j’ai écrit Hanko Miastik ; c’est un poème d’éloges. Saint-Paul se réjouit de recueillir cette explication car il était perplexe devant le titre du poème. Souvent nous avons besoin de clefs pour s’avancer dans le texte. Jean-Pierre Lassalle cite alors Mallarmé dans sa boutade à Degas qui se plaignait d’avoir plein d’idées mais était incapable d’en faire un poème : « Mais ce n’est pas avec des idées qu’on fait un poème, c’est avec des mots ! » Or, moi, insiste J.P. Lassalle, j’aime les mots ! les mots rares, les mots précieux, les mots techniques, les mots traditionnels. La poésie, c’est d’abord les mots. C’est ma vision des choses. Un de mes collègues, Mainteneur, disait de moi : « vous avez un vocabulaire coruscant. » Il ne faut pas avoir un vocabulaire plat comme une limande. C’est ce que je reproche à la poésie actuelle qui est tombée dans un prosaïsme que je condamne. Le poète lit des extraits de « Il convient » dont ce poème sur Alep en Syrie.
Alep
Le glacis d'Alep est muraille d'hipparion Gisant sous la pesée du sabot gigantesque Mon corps est laminé en ces jours d'indiction Ne demeure que vie de rampement d'exsangue Alep admirable ville du grand fardeau Je fuirai cependant vers l'Oronte sinople Filigrane d'argent de mon corps glorieux Mourir cétoine bleue sur le glacis d'Alep.
Le port d’Alep, je l’ai parcouru avec Alain Jouffroy. J’ai gardé la vision de cet espèce de mur oblique immense, et comme le sabot de cheval a une « muraille », ce plan oblique, j’ai fait l’analogie avec l’hipparion, l’ancêtre du cheval, le cheval à trois doigts. Dans « Hanko Miastik » J.P. Lassalle évoque Gaston Puel enterré à Veilhes (Tarn) dans un village qui ne possède pas un café. Et un village sans café est un village mort, et un village comme Veilhes sans Gaston Puel, alors là, je préfère ne pas dire ce que j’en pense s’exclame notre poète. « Tchilibim », c’est le nom d’un trio musical du Tarn. Mais c’est aussi Chibilim, un mot gitan. J’ai utilisé aussi la marque Dim ; les publicités de Dim sont très gracieuses et me fournissent une rime en im. Passim (ce qui est passé) est utilisé par les plus grands érudits.
Tchilibim
Tchilibim tchilibim Talmaï descend des anakim Tous les adeptes d'Elohim Célèbrent Thurim et Pourim A Taibeh mon Ephraïm J'irais pour toi jusqu'au Sikkim A Aubusson la tour Zizim Et puis gagner Sidi-Brahim De Camondo musée Nissim Ici ou là c'est du passim Jolies jambes gainées de Dim Tes bras sont nus sans tephillim Amie cello bimbo bobim Tes seins ambrés de Misraïm J'aime ton corps et le toutim Amours passées du temps d'olim Au surréel de Perahim Tchilibim tchilibim. * « Il est venu le temps des bômes », bôme, mot marin, qui permet de dresser une voile triangulaire et le mot varve est une allusion géologique en analogie avec la généalogie. Les varves révèlent les couches sédimentaires au fond des lacs. Et c’est un des rares mots suédois de la langue française qui veut dire rayé. Quelle image !
Au cœur des varves
Dans les varves de souvenance Sont les amis et les corps des femmes aimées Les instants bleutés du bonheur bref Les écailles du pangolin de nos désirs La vie triangulée s'accroche aux bômes de l'espoir Avec la hache pour abattre les trochures du cauchemar Et couper les sanglons du cheval pâle Dans les varves de l'affliction Sont les errances le long des pontuseaux Les glissements violets des échouages Le deuil royal des jonchées de morènes Sur les lacs bleus sans orpailleurs Le chatoiement des gemmes au cou des survenantes L'étirement des fauves laminaires Et le blottissement dernier en cocon d'ibérides Au cœur des varves. * L’humour est présent chez Jean-Pierre Lassalle, homme à la jovialité élégante. Je suis né à Padirac, s’amuse-t-il, et je dis par boutade que je n’ai pas besoin de psychanalyse puisque toute ma vie, je suis sorti du gouffre ! Très attaché à son pays l’Occitanie, il aime rappeler que la Cerdagne est aussi un pays qu’il affectionne et qui est présente dans un poème de « Il convient » ; de la même manière le recueil recèle des poèmes d’inspiration personnelle plus intime, comme l’allusion à l’Allemagne ou à une vallée de l’Himalaya.
Sanskar
La belle et longue louve du Sanskar A des midis illuminés Par le nef de Jean de Meung Dans la rosée d'aeply Tout le panier des ménagères La volupté des stabilos Une grande onde en crescendo Pour symphonie des doigts rosés Le long du beau corps nu Pour les midis incalminés De belle et grande louve du Sanskar. *
« Il convient » un
recueil de poèmes dans la veine surréaliste et hermétique au sens le
plus noble du terme, que Jean-Pierre Lassalle a bien voulu éclairer,
révélant leur genèse. Une poésie qui séduit par la richesse des mots et
ce juste langage soumis avant tout à la poésie, tant il est vrai que ce
que disait José Bergamin du langage liturgique : « tout langage
liturgique soumis à la Raison, et non à la poésie, se condamne à mort »
se vérifie d’autant plus dans le langage poétique. |
|
MARIE JEANNE VERNY
18/02/2016 |
Christian Saint-Paul remercie son invitée Marie-Jeanne VERNY d’avoir accepté de parler aux auditeurs de Radio Occitania de l’excellente étude qui a été publiée sous sa direction aux éditions Classiques Garnier (Etudes et textes occitans, 1), 423 pages, 49 €, broché :84 € : « Les Troubadours dans le texte occitan du XXe siècle ». Marie-Jeanne VERNY, très impliquée dans la défense des langues régionales et de la culture occitane en particulier, est agrégée de lettres modernes, professeur langue et littérature occitane à l’université Paul Valéry de Montpellier III et membre de l’équipe d’accueil Langues, littératures, arts et cultures des suds. Ses domaines de recherches sont : – Littérature contemporaine, recherches effectuées notamment sur les écrivains occitans du XXe siècle : Roland Pécout, Robert Allan, Max Rouquette… – Sociolinguistique : l’occitan à l’école – la langue et la culture occitane dans les manifestations artistiques contemporaines – Pédagogie et didactique de l’occitan : travail en collaboration avec le CDRP de Montpellier depuis 1985 Affectée en 1995 comme PRAG à l’Université Paul-Valéry, a soutenu en 2002 une thèse d’études occitanes, et une habilitation à diriger les recherches en 2007, l’année suivant son affectation comme maître de conférences.
Le livre « Les Troubadours dans le texte occitan du XXe siècle » s’inscrit dans le programme de recherches consacré à la réception des troubadours du XIIIème siècle à nos jours, associant les universités d’Aix-Marseille, Bordeaux Montaigne, de Gérone, Paul Valéry - Montpellier III, de Pau et des Pays de l’Adour et Toulouse - Jean Jaurès, coordonné par Jean-François Courouau et Daniel Lacroix de l’université Jean Jaurès de Toulouse. Le tout placé sous le patronage de l’Association internationale d’études occitanes (AIEO). Ce livre est issu essentiellement du colloque international organisé les 1er et 2 avril 2010 à Montpellier par la composante RedOc (recherches en domaine occitan de l’équipe de recherches LLACS - Langues, littératures, Arts et cultures du Sud) à la Médiathèque d’agglomération Emile Zola.
Dans la renaissance de la littérature occitane au XXème siècle, les troubadours sont souvent invoqués par les plus grands écrivains (René Nelli, Max Rouquette, Robert Lafont, Jean Boudou et bien d’autres), comme images d’un âge d’or où la langue et la littérature d’oc fournissaient des modèles à l’Europe. Cet ouvrage s’intéresse à la place de ces grands anciens dans l’imaginaire des créateurs (la chanson est également étudiée en fin de livre). Entre modèles idéalisés, figures recomposées sur un mode romanesque, imitation des formes et motifs, et aussi distance critique ou refus d’assumer un tel héritage, on trouvera ici une première ébauche synthétique de la réception contemporaine des troubadours. Cet ouvrage analyse la réception des troubadours dans la littérature occitane contemporaine, entre fascination pour un âge d’or où cette littérature – ainsi que la langue qui la portait – se constitua en modèle européen, imitation des formes et des motifs et distance critique.
Il s’agit d’un ensemble d’un colloque,
souligne bien Marie-Jeanne Verny qui explique les résultats de cette étude
au cours de l’entretien avec Christian Saint-Paul : « Comment les troubadours ont persisté dans la mémoire et la création après leur âge d’or qui était celui du 11ème et 12ème siècle. Que disait-on les siècles suivants ? Pour ma part, je me suis intéressée au XXème siècle et dans la lecture des poètes contemporains, je n’ai cessé de rencontrer les troubadours. Vingt auteurs ont apporté leur concours à l’entreprise, dont une italienne. Le colloque s’est tenu à Montpellier avec Pierre Bec. Puis le travail d’édition a suivi. Les troubadours sont connus dans le monde entier. Paradoxalement, c’est en France qu’ils sont le moins connus, réduits souvent à une image simpliste. Mais aujourd’hui, les romanciers écrivent sur la vie des troubadours. Michel COSEM, sur Peire Vidal, Francis PORNON sur Ramon de Miraval. » Il y a un rapprochement Catalogne-Occitanie. Marie-Jeanne Verny, auvergnate, est profondément occitane, et elle ne voudrait pas que soit exclue l’Auvergne de l’Occitanie, si le nom de notre future région se réduisait à « Occitanie ». Il faudrait ajouter, par exemple : centrale. « Max Rouquette, poursuit Marie-Jeanne Verny, après la Retirade, avait organisé à Montpellier une sorte de comité d’accueil des catalans intellectuels exilés et accueillait les Jeux Floraux de Catalogne. « Entre Barcelone, Toulouse et Montpellier, il n’ y avait pas de Pyrénées ».Quelle est la descendance des troubadours sur les poètes contemporains ? René Nelli a écrit « l’Erotique des Troubadours ». Comme lui, certains poètes ont écrit comme critique des troubadours et s’en sont inspirés. Max Rouquette connaissait les troubadours. Mais il y a souvent une confusion entre la civilisation occitane de la noblesse au Moyen-âge et le peuple en général. Les femmes du peuple subissaient le droit de cuissage des nobles comme dans le Nord. L’image de la femme était idéalisée dans l’aristocratie et c’est cette image là que l’on retient. Max Rouquette avait lu les « Vies » des troubadours des éditions savantes. C’est sa « Chronique légendaire des Troubadours », il crée une espèce de roman sur le roman. A partir de la connaissance précise qu’il a des textes et des vies des troubadours, comme il est avant tout écrivain, il va « broder » et en faire un sujet romanesque. Par exemple, il imagine que Bertran de Born et Bernard de Ventadour se rencontrent et qu’ils sont devenus moines pénitents qui n’ont donc plus le droit de se parler et qui, en compensation, se récitent des textes. C’est une très belle nouvelle, mais romancée par un littérateur du XXème siècle. C’est de la littérature, mais très juste. Le lecteur cultivé reconnaîtra le passage des citations des troubadours, l’autre les découvrira pour son plus grand bien. Il lira une belle histoire. Max Rouquette a écrit une dizaine de textes informatifs sur les troubadours. La langue d’Oc doit se trouver des raisons d’adopter cette « langue méprisée », expression utilisée au 16ème siècle par Pey de Garros et par Mistral dans « Mireille » en 1859. La langue méprisée, celle du peuple, a eu de grands modèles. L’écrivain occitan va toujours glisser une phrase dans laquelle il se croit obligé de se justifier sur l’emploi de sa langue. Pour Max Rouquette, il y avait deux justifications : 1) Mistral, son père récitait des strophes de « Mireille » qui, à 12 ans, l’ont ébloui au point de le décider à écrire dans cette langue. 2) les troubadours. Max Rouquette aurait aimé recevoir le prix Nobel de Littérature, comme Mistral, pour que son œuvre et sa langue soient reconnues. Si Robert Lafont ou Max Rouquette avaient écrit en français, ils auraient été nobélisables sans problème. Max Rouquette est né en 1908 et l’importance de Mistral était considérable. Toutes les Ecoles Normales d’Instituteurs étaient dotées des livres des Prix Nobel et donc, il y avait Mistral. L’œuvre de Mistral circulait. Sa graphie est la première graphie unifiée. Elle est plus calquée sur la graphie française que l’occitan unifié que nous employons aujourd’hui. Eric Fraj a écrit « Quel occitan pour demain ? » où il pose ce problème. Il faut pratiquer l’oralité de la langue, il faut que cette langue circule, dans les médias, dans le métro comme à Toulouse et cette langue vivra. Après, entre une uniformité sclérosée et le bazar complet, on a trouvé un moyen terme. Mais qu’est-ce que le trobar : c’est celui qui invite, celui qui trouve, cela vient de l’accusatif « trobadorem », le français « trouvère » venant du nominatif. Le troubadour créait le texte et la musique. Max Rouquette avait une très haute idée de la langue. Il avait une exigence de dignité pour la langue et pour la culture qu’elle porte. Il écrivait des pastiches d’écrivains et savait dans cet art, être d’une cruauté exceptionnelle. Pour les troubadours, le mot et le son sont indissociables. Max Rouquette disait qu’on avait trop négligé que les troubadours étaient créateurs de musique. Les mélodies se sont en partie perdues. Ils étaient interprètes en même temps qu’écrivains. Jean Boudou fait intervenir les troubadours dans «Le livre des Grands Jours » et ses poèmes « Alba ». A l’aube, les amants illégitimes doivent se séparer, parce que le mari jaloux arrive. Or, Jean Boudou a écrit plusieurs « Alba ». Cela m’avait beaucoup marqué. Ce fut un peu le déclencheur de cette recherche. Les poètes du XXème siècle ont été inspirés des troubadours. Quelle place avait les troubadours dans les œuvres de : Prosper Estieu 1860 - 1935 Paul-Louis Grenier 1879 - 1954 Denis Saurat 1890 - 1958 Sully-André Peyre 1890 - 1961 Clardeluno (Jeanne Barthès) 1898 - 1972 Jean Mouzat 1905 - 1986 René Nelli 1906 - 1982 Max Rouquette 1908 - 2005 Léon Cordes 1913 - 1987 Jean Boudou 1920 - 1975 Pierre Bec 1921 - 2014 Robert Lafont 1923 - 2009 Serge Bec 1933 Michel Minuissi 1956 - 1992
Ce qu’il y a de remarquable chez tous ces écrivains, c’est la diversité de l’intérêt pour les troubadours. Certains s’intéressent à la forme, la sextine, qui inspire Robert Lafont ou Pierre Bec. C’est un exercice de virtuosité. Pour Serge Bec, c’est la femme, l’idéal de la femme. Il n’a aimé qu’une femme de toute sa vie, Anne. C’est elle qu’il célèbre. Pour Max Rouquette, c’est une rêverie sur les paysages, sur les lieux où sont passés les troubadours et qui lui apparaissent comme encore habités par eux. Chaque écrivain est allé prendre chez les troubadours des choses différentes. Pour Jean Boudou, c’est la dérision. Il est vis-à-vis des troubadours entre distance et admiration. Il y a une variété totale d’inspiration. Pour Léon Cordes, il part de Minerve qui a tant souffert de la Croisade des Albigeois, et il reconstruit le passé dans « Minerve 1210 », il décrit ce qu’a été le siège de Minerve dans une pièce de théâtre qui a été jouée et mise en scène par son fils, Michel Cordes. Il y a eu 10.000 spectateurs qui se sont succédés à Minerve sur le lieu même où le drame s’était produit. Dans cette pièce, l’auteur mêle des textes des troubadours et des chants populaires. On voit bien que les poètes contemporains occitans s’inspirent, comme les poètes espagnols avec le romancero gitano de Lorca, des chants populaires, des légendes, des contes et de l’inspiration savante des troubadours. Sully- André Peyre fait partie des rares poètes occitans qui ne voulaient pas s’inspirer des troubadours. Dans « La grenade entr’ouverte » d’ Aubanel, chaque poème est ouvert par un texte des troubadours. Ceux du félibrige qui se référaient à Mistral, rendaient hommage aux troubadours, mais Sully-André Peyre, non ! Il a toujours été singulier, même pas proche du félibrige. Il écrit par exemple : « pour une culture provençale, les troubadours, pauvres et mornes, ne comptent guère ; il y a eu, de la Croisade contre les Albigeois (qui ne fit que donner le coup de grâce à une littérature moribonde), au miracle de Mirèio, six siècles d’éclipse. ...Mistral est le vrai commencement de la langue provençale. [ ...] Mais il aurait ensuite fallu que, par « droit de chef-d’œuvre », la langue de Mistral s’imposât à tous ceux qui, « de la Loire à la mer, des Alpes aux Pyrénées », choisissaient de ne pas écrire en français, et qui auraient alors disposé d’un moyen d’expression, et d’un public, couvrant à peu près la moitié de la France, révolution littéraire et culturelle qui n’est encore qu’un songe, à cause des patoisants et des dialectaux. La plupart des félibres ne valent guère mieux que les troubadours. »
Aujourd’hui, des groupes de musiciens très jeunes prolongent la culture des troubadours, comme les « Fabulous trobadors » de Claude Sicre à Toulouse, ou le groupe fondé à Marseille « Massilia Sound System » ou « Maoresque » à Montpellier. Chez eux, le fin’amor se mêle au reggae langoureux (Bob Marley chantait dans un patois jamaïcain), le sirventès à la tençon. Et il est heureux que le génie de ces groupes ait orienté, dans son élan de modernité audacieuse, la jeunesse vers la culture occitane et les troubadours. En conclusion, la diversité de réactions des influences des troubadours sur les poètes contemporains est énorme et ne peut être réduite à une seule posture, mais elle est indéniable et le livre « Les Troubadours dans le texte occitan du XXème siècle » réalisé sous la direction de Marie-Jeanne Verny apporte un éclairage précieux et assez exhaustif, que l’on ne possédait pas auparavant. Qu’elle, et tous les auteurs qui ont contribué à cette large étude, en soient remerciés ! ».
|
|
Alem Surre-Garcia
11/02/2016 |
|
|
Michel ECKHARD-ELIAL
04/02/2016
Diti RONEN
|
Christian Saint-Paul reçoit Michel ECKHARD-ELIAL venu parler des nouvelles publications des éditions LEVANT qu’il dirige à Montpellier. Michel Eckhard Elial est poète et traducteur de la littérature hébraïque (Yehuda Amichaï, Aaron Shabtaï, David Vogel, Ronny Someck, Hagit Grossman, Miron Izakson). Il dirige la Revue «Levant – Cahiers de l'Espace Méditerranéen » qu'il a fondée en 1988 à Tel-Aviv, aujourd'hui à Montpellier, dont la vocation est de promouvoir un dialogue pour la paix entre les trois rives de la Méditerranée. Parmi ses publications, signalons : L'instant le poème, Levant, 2009; Un l'Autre, Levant, 2008; Poèmes de Jérusalem, L'Eclat, 2008; Début, fin, début, L'Eclat, 2008; Les morts de mon père, L'Eclat/Levant, 2001; Beth, Levant, 1995; Histoires d'avant qu'il n'y ait plus d'après, Alfil/Levant, 1994 ; Au midi du retour, Euromedia, 1993 ; L’Ouverture de la bouche, Levant, 1992 ; Exercices de Lumière, Levant 2015. Ce dernier livre a fait l’objet d’une émission le 11 juin 2015 que vous pouvez écouter en cliquant sur : http://les-poetes.fr/son/son%20emision/2015/150611.wma Publié dans un tirage limité à 100 exemplaires poèmes,« Exercices de lumière », a paru dans une édition livre d'artiste, illustré par Robert LOBET.
Le souci de la qualité
matérielle de la présentation (fort réussie) de ce livre destiné
certainement à une réédition dans une anthologie, fut une volonté forte de
l’auteur. Et ce qui est vrai de toute l’œuvre poétique de ce poète, l’est, de façon démultipliée pour ce dernier livre « Exercices de lumière ». Ces poèmes, en effet, ont été écrits pour Matiah. Matiah Eckhard a quitté ce monde il y a peu, terrassé par la maladie, à l’âge de 19 ans. Matiah avait accompagné son père à Toulouse au musée Georges Labit quand ce dernier était venu présenter la revue LEVANT. Matiah, musicien hors pair, issu du Conservatoire National de Montpellier, composait de la musique, en particulier des rythmes de jazz. C’est ainsi qu’il avait joué, ce jour de présentation. Mais, en sus de cet indéniable talent, Matiah maniait aussi, avec une maturité incroyable, le verbe, et écrivait des poèmes, aujourd’hui publiés sous le titre : « Lointains chant sacrés d’où je suis né ». Un prix international de poésie Matiah Eckhard a été créé pour les jeunes poètes et attribué pour la première fois en juin 2015. Les mots de Michel Eckhard-Elial « Exercices de lumière » qu’il adresse à son fils Matiah et, dans l’universalité de cet acte d’amour, à toute l’humanité, ne pouvaient qu’être enfermés dans un écrin : le livre d’artiste. En exergue des vers de Matiah, de Paul Celan, une phrase de Hildegarde de Bingen : « J’ai entendu une voix émanant de la lumière vivante ». Michel Eckhard-Elial, dans cette époustouflante création, fait œuvre de veilleur prophétique. « Le silence prophétique apporte la plénitude » dit-il. Le poète doit se rapprocher de la lumière. Il cite Victor Hugo : « Le puits de la poésie va vers le ciel ». La poésie est verticale. Le sacré est cette dimension qui nous pousse à habiter l’être des choses. Il s’en suit que la poésie ne vient pas de la langue. Elle préexiste à la langue. Elle est la recherche de l’éblouissement originel. La symbolique du visage (chère à Emmanuel Levinas), et de la voix, éclaire « Exercices de lumières » : « En ta voix/ Je reviens au monde » ; « Je porte/ Le visage de/Ton nom ». Le poète révèle avoir puisé de la force dans le véritable réservoir de spiritualité qu’est l’œuvre de José Angel Valente, en particulier, les « Trois leçons de ténèbres ». « Ces textes, nous dit l’auteur, font partie de mon temps de deuil et d'espérance. Je n'ai pu tenir jusqu'à présent que par la pensée d'une présence, d'un visage, d'une lumière, émergeant de l'obscure absence. J'ai toujours eu en face des jours terribles, semblables à un séisme, la voix réparatrice de la poésie: Jose Angel Valente, Paul Celan quelques autres, ont été en quelque sorte les antennes de mon rassemblement, de ma rédemption quotidienne, parce qu'ils ont, particulièrement, touché le mystère et le naufrage de la parole, pour en faire surgir de la lumière, cette même lumière que le peintre Pierre Soulages fait surgir de la matière noire. Le fait que ces textes aient été rassemblés, au moment de Pâques est loin d'être un hasard (la poésie ignore le hasard, elle ne reconnait que l'évidence): exode et résurrection sont les fils de lumière qui rendent mon fils présent à ma pensée et à mon amour. » Cette fois-ci ce n’est pas de son œuvre personnelle dont s’entretient Michel ECKHARD-ELIAL mais de ses récentes réalisations éditoriales en sa qualité de directeur des éditions LEVANT. En préambule, il revient sur Hagit GROSSMAN. Son influence règne déjà sur la poésie en marche; elle incarne les valeurs de modernité littéraire, mais aussi les valeurs morales de cette génération toujours aussi attachée à cette patrie de providence, mais lucide sur les enjeux et les dangers de la confrontation de deux peuples aux désirs légitimes. C'est une poésie de la fraternité et de la paix que prône Hagit GROSSMAN. En 2013, elle était invitée au festival de Sète pour les Voix de la Méditerranée, puis à la Nuit de la Poésie en mars 2014. Son œuvre qui connaît un retentissement indéniable en Israël, peut s'articuler autour de trois grands thèmes : 1) celui de la continuité sociale d'Israël (celle du vindicatif Ben GOURION ou du seul homme du gouvernement que fut Golda MEIR) où l'ironie dissimule le malaise ; 2) celui de l'ars poetica propre à tout poète qui s'interroge sur le sens même de la poésie ; 3) celui de l'intime et de sa compréhension du monde, dans lequel elle se révèle un authentique poète de l'amour dans toutes ses déclinaisons, éros, agapè et charitas, atteignant ainsi d'emblée à l'universel. A ce jour, deux livres traduits en français (toujours par Michel ECKHARD-ELIAL) et publiés sont : Neuf poèmes pour Shmouel aux éditions de la Margeride animées avec ferveur par Robert LOBET,( Il s'agit d'un livre d'artiste réalisé à la perfection comme tous les ouvrages de cet éditeur.) et « Poèmes d’amour » aux éditions LEVANT. Ces « Poèmes d’amour » (voir émission de la semaine précédente et l’écouter en cliquant sur : http://les-poetes.fr/son/2016/160128.wma ), seront lus, indique Michel Eckhard-Elial au cours d’une soirée poétique « Lecture d’Amour » le mardi 16 février 2015 à 19 h à La Brasserie le Dôme, 2, avenue Georges Clémenceau à Montpellier, avec pour devise : « la poésie, pour rester humain, et l’amour, ouvert à l’autre. » En exergue sur l’invitation à cette soirée, une phrase de Mohamed Elmedlaoui : « Merci pour ces beaux morceaux de la poésie de haut lieu, seul bouclier possible en fin de compte contre bombes et couteaux, un bouclier sous forme de caresse. » Le livre d’Hagit Grossman, ce cri d’amour, a été très bien accueilli. Le Printemps des Poètes qui débutera en mars, s’arrime à cette volonté. C’est dans ce sillage de l’amour que s’insère le livre « Poèmes d’amour », pour s’opposer à cet instinct de mort (Thanatos) qui sévit aussi aujourd’hui. Il s’agit d’exprimer une volonté de paix dans ce coin de la Méditerranée où la violence apparaît très souvent. Car LEVANT depuis sa création n’a cessé de promouvoir l’éclosion d’un horizon de paix. Mais en cette période, un dialogue méditerranéen qui avait semblé possible dans les années quatre-vingt, semble impossible en raison de l’ouragan de violence qui s’est abattu sur la Méditerranée. Ce livre prolonge cette volonté et est un défi à la tempête. Malheureusement, on n’a jamais été aussi loin du dialogue, déplore Michel Eckhard-Elial. C’est paradoxal, poursuit-il, car les peuples sont las de cette violence, mais les « bulles » des discours, de ces forteresses vides du langage politique, empêchent toute avancée du dialogue. Nous sommes au point mort, constate Eckard-Elial. Mais face à cela, la petite voix du poème peut soulever des échos, et aller vers le cri de l’espoir. Saint-Paul rappelle alors que le poète toulousain Henri Heurtebise, disait, lors de l’hommage qui lui fut consacré en septembre 2015 à la Cave Poésie à Toulouse, que la poésie devait se situer dans cet élan d’amour, des êtres, des animaux, de la Nature, du monde. « Si je m’apercevais un jour que cela n’était plus le cas, je m’arrêterais aussitôt d’écrire » assurait-il. En effet la poésie, renchérit Eckhard-Elial, doit être le lieu des possibles. Michel Eckhard-Elial lit des textes de « Poèmes d’amour ».
Poésie
Tendre la main pour la paix quand ma force est attirée par le feu. Secrètement je persuaderai la lune de te donner la force du soleil.
Si je tends la main vers la paix je fais suivre le poème par un Cerbère. Dans la vallée de l’abondance le khamsin arrache le venin du serpent, il tranche sa queue et la vilaine morsure, à coups de hache.
Quand je tends la main pour la paix, la raison du poème est celle de la vie, son territoire est infini, où la poésie surgit le gardien de l’enfer s’endort * Hybris
Tomber dans tes eaux sans savoir que ce sont tes eaux. Tomber, avoir le mal de mer infiniment. Tu es le monde bleu où je ne cesserai pas de nager parce qu’il n’y a pas d’autre fin que nager en ces eaux. Je ne connais d’autre terre que ces eaux dont je garde l’empreinte turquoise sur les bras, le Léviathan nageant dans ma chair, j’étais la chair de ta chair et nous étions l’arbre portant le fruit sur les fleuves tumultueux de mon Amour. La lumière du shabbat est allumé et le feu brûle. Nous adorions le soleil de midi sur ta couche, j’étais submergée de soleil, et tu m’as dit : tu es submergée de soleil. Puis je fus pleine de toi, je devins grande et lointaine. Et le silence cessa, l’Océan fut. * Michel ECKHARD-ELIAL annonce ensuite qu’il présentera Diti RONEN poète israélienne à la Maison de la Poésie de Montpellier. Ensemble, ils proposent une lecture bilingue hébreu/français d’extraits des recueils de poèmes de Diti Ronen issus de La Maison fissurée de poèmes (Editions Gros Textes), et Quand la maison revient (Levant, à paraître, mars 2016). Le programme est en page d’accueil du site les-poetes.fr . Diti RONEN est une actrice importante de la vie littéraire israélienne. Les poètes sont des agitateurs de l’opinion publique ; ce sont souvent des acteurs du monde éducatif. Ce sont toujours des poètes agissants. Diti RONEN vit à Tel-Aviv ; elle est dans sa maturité littéraire. Elle a publié six livres de poésie et travaille avec des artistes, des musiciens, des plasticiens. Elle est au cœur des arts, une manière d’approcher la poésie aujourd’hui. En 2014 elle a publié chez Gros Textes, « Une maison fissurée de poèmes ». La notion de fissure est essentielle dans la démarche de Diti Ronen ; la ligne du poème est comparée à une fissure qui s’agrandit si on n’intervient pas. Alors le poète essaie d’arracher cette ligne là, au vide, à la destruction, pour en faire une ligne continue qui puisse fructifier grâce aux mots. « Le retour de la maison » a été publié à Tel-Aviv, il y a peu. Face aux sentiments d’incertitude et de menaces, cette maison est une espèce de capsule qui ressemble à l’Arche de Noë, qui essaie de faire singulièrement de la poésie, qui résiste à la tempête pour faire ressurgir la Terre, l’olivier, les attributs de la vie. Le but est le chemin. Le chemin est le complément de la maison. La maison suit son chemin pour construire avec l’Autre un avenir. Mais quel sens reste à la poésie ? Réponse : tout le sens reste à la poésie. « Je suis deux qui font un », conclut Diti Ronen. Ce postulat, remarque Saint-Paul, se rapproche de l’assertion de René DAILLIE qui affirme que « la poésie est plus que toute autre chose la cohérence entre l’Homme et l’Univers, la quête du Royaume, du réel absolu, du vrai pays et de la vraie vie ». Le chemin, poursuit Eckhard à propos de Diti RONEN, permet de rester vivant et de toucher à l’autre. Le chemin c’est la parole. Et le mouvement est la nécessité du chemin. La parole s’érige en « décideur », elle indique le chemin que doit prendre le monde. Saint-Paul rappelle que selon Ernst Jünger, « la seule paix féconde est celle qu’aura précédée le désarmement des passions. Telle est la considération qui doit présider à la punition des coupables. Car ceux qui se présenteront comme juges sont justement des hommes d’une volonté forte, mais de faible jugement. » Les poètes sont des guetteurs, des passeurs de paroles d’amour. Paul Celan a été une de ces voix qui ont témoigné, mais l’ont fait aussi dans la violence de l’arrachement de la langue ; il a mis en garde contre un certain usage de la parole, celui tout simplement de la perversion de la parole, de sa déroute lorsqu’elle est distraite de son rôle primordial de louer la beauté du monde, pour devenir une arme de destruction massive car la parole est la chose la plus répandue au monde. Mais Paul Celan n’a pas été compris de ses contemporains. Sa poésie est une poésie mémorielle du désastre, poursuit Eckhard-Elial, et au-delà de la mémoire qui est devant nous, dans le cœur même de la parole, du langage. Après Auschwitz la parole est possible, pour répondre à Adorno, si elle va au-delà du témoignage, si elle guette un horizon autre. Le poète a cette mission de porter cette vérité à l’extérieur ; il sent le frémissement de la vie qui est en dedans de nous. Vide et silence ne sont pas synonymes. Le silence pour le poète est un temps de méditation, de recueillement avant d’aller à la rencontre de l’autre, d’aller à la rencontre du monde. C’est dans ce sens que le vide est plein en poésie comme dans la vie spirituelle. Lecture de poèmes de Diti RONEN par Michel Eckhard-Elial.
D’où je viens les mots sont fils d’Elohim ils naissent nus créent des mondes exhalent d’une bouche un avenir d’humanité. Ce printemps à se taire à regarder les nuages sans écouter les nouvelles ni dire de paroles sacrées sans lire les journaux. Nous n’aurons ni raison ni reproche. Nous puiserons un regard profond à l’intérieur des pupilles. * Qu’est-ce qu’une maison ? une construction posée sur des fondations corps et alliance si un premier corps demande au second de l’abandonner les fissures ouvrent leur gueule elles font tomber les murs et la maison est détruite avec ses occupants.
Quand la maison vient vers moi elle me regarde dans les yeux et baisse le regard, je lui demande de tourner la page de croire qu’il est possible de réparer de se rappeler du figuier et l’arbre d’épines les arbres parlent dans la Fable de Yotam et passent leur chemin moi, je regarde la maison droit dans les yeux. * Le but est le chemin. Je compte à présent les passages d’hier à demain, je m’attarde sur les passerelles du temps. Le corps tendre et tendu a même mesure, échappé d’amours anciens, Indifférent à de nouveaux. Mes yeux sont rivés à l’eau de la rivière – Ils renoncent à comprendre, et mesurent la distance entre chaque goutte d’eau. * Le corps se souvient du mouvement La peau du toucher L’œil contient le visible L’oreille les sons la voix Le nez est imprégné d’odeurs Le goût du secret de la langue. Les mots s’égarent Voyelles et syllabes se fragmentent, moignons de membres pincés à la pointe de la langue. A présent la bouche se tait: tout ce qu’elle aurait pu dire est dit. Quel sens reste-il à la poésie ? * L’émission se termine par l’annonce heureuse de la parution des deux autres tomes de l’œuvre intégrale de Bruno DUROCHER aux éditions Caractères. Après le tome 1 consacré à la poésie, le tome 2 reprend toute l’œuvre en prose et le tome 3 le théâtre et les essais. Nicole GDALIA qui dirige ces éditions présentera ces ouvrages à la Maison de la Poésie de Montpellier en mars. Chaque volume, d’une conception superbe, 32 €. Une émission spéciale sera consacrée à ces ouvrages de Bruno DUROCHER. Michel Eckhard-Elial qui a connu cet auteur éditeur hors du commun dans tous les sens du terme, conclut l’émission par ces mots : « Bruno Durocher nous offrait sa maison pour construire la nôtre ». |
|
Hagit GROSSMAN
George CATHALO
28/01/2016 |
|
|
Gil PRESSNITZER
21/01/2016 |
|
|
14/01/2016 |
En préambule, Christian Saint-Paul invite les auditeurs à signer la pétition en faveur du poète palestinien Fayad Ashraf qui a été condamné à mort pour « apostasie » par des juges d’Arabie Saoudite. Il lui est reproché d’avoir publié en 2007 un livre de poèmes « Instructions internes » qui contient des poèmes athées. Il avait déjà été condamné à 4 ans de prison et à 800 coups de fouets. L’émission « les poètes » s’associe à la campagne de soutien pour sauver Fayad Ashraf. La revue de poésie vive « Nouveaux Délits » a fait paraître son n° 53. Cathy Garcia qui anime cette revue avec la pertinence qu’on lui connaît, y signe un éditorial sans fard, comme à son habitude, que Christian Saint-Paul juge bon de lire à l’antenne : « Même quand je travaillais dans le spectacle, je n’aimais déjà pas les répétitions. Je préférais le moment vrai et unique du spectacle lui-même, car dans le théâtre de rue, chaque représentation est toujours unique, remplie d’imprévus, d’inattendu. On n’y est pas à l’abri de la pluie, du vent, de toutes sortes d’obstacles et surprises et surtout pas séparé d’un public par une scène, ou pire encore, par une fosse. On est avec et dans le public, parmi les gens qui font et défont le spectacle, tout autant que nous-mêmes. L’idée même d’un public disparaît dans un échange interactif et vivant, une grande fête commune. C’est ça que j’aimais dans le théâtre de rue, le véritable théâtre de rue. Ce moment vrai qui nous mettait en danger. Et je continue à préférer le spontané, l’imprévu, le non-préconçu, et plus encore quand il s’agit de fêtes ou de belles déclarations. Faire un vœu, oui, pourquoi pas ! Parce qu’il nous vient à la bouche comme une source jaillissante ou parce que l’étoile filante… Si j‘avais un vœu à faire là maintenant, au moment précis où j’écris cet édito, ce serait : « délivrons-nous de nos certitudes ! ». On étouffe sous les certitudes, on en perd tout contact sensoriel avec la vie, toute capacité de penser de façon inédite et donc libre. Mes certitudes, vos certitudes, leurs certitudes. Les certitudes sont aussi nombreuses que les individus susceptibles de vous les asséner, même les certitudes d’un groupe sont en réalité un assemblage de certitudes uniques, chacune attachée à un seul individu. C’est comme les patates, les ensembles qu’on nous faisait faire à la maternelle. Alors oui, pour y voir plus clair, il y a des certitudes qu’on peut mettre dans une même patate, puis les patates empiètent sur d’autres patates, ce qui forme des espaces inter-patates, qui eux-mêmes empiètent les uns sur les autres, et au final on a de nouveau un grand bordel auquel on ne comprend rien du tout. Alors ouvrons toutes ces patates et délivrons-nous des certitudes ! Voilà, c’est mon vœu instantané et il a disparu aussi vite qu’il a été formulé. Les patates mathématiques ne sont rien d‘autres que des bulles qui nous éclatent au nez. Certaines sont très belles, tout dépend de comment elles prennent la lumière. Et voilà : tout dépend de comment on prend la lumière. » Au sommaire de ce numéro parfaitement illustré par Anna Minski : Lou Raoul, avec un extrait d’arrache moi fort la nuit Mokhtar El Amraoui (un grand salut à la Tunisie) Julien Boutreux Jean-Claude Goiri avec des Copeaux (contre la barbarie) Denis Wetterwald Sammy Sapin Tom Buron, avec entre autre des extraits d’un journal éthylo-poétique
|
|
Jacques ARLET
07/01/2016
31/12/2015 |
|



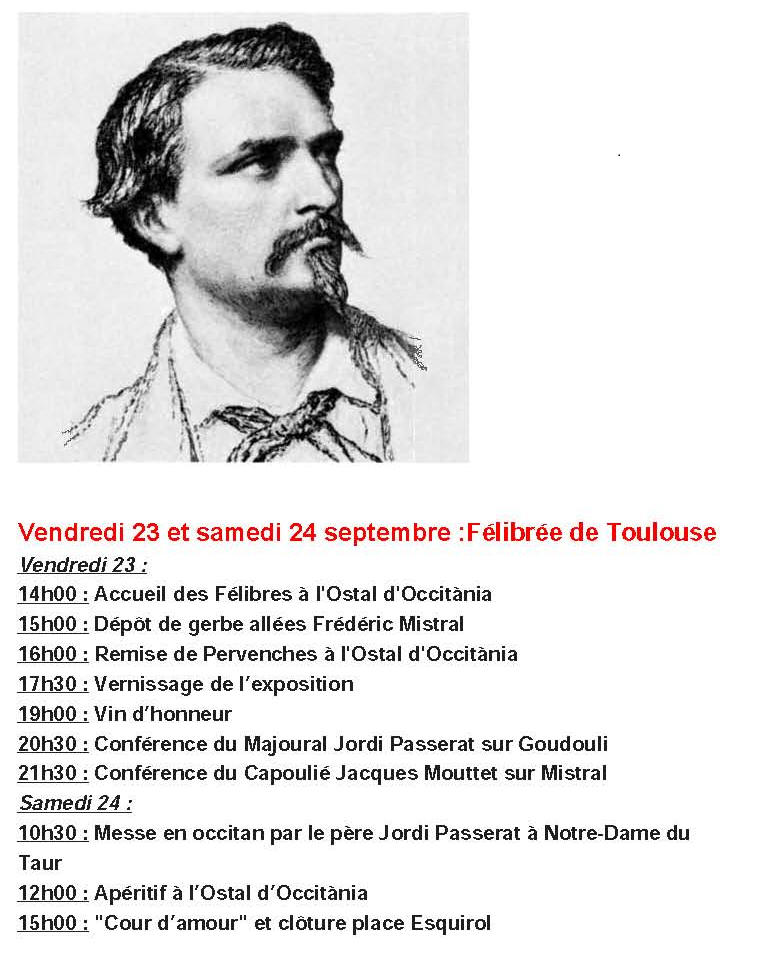










.jpg)