parutions ARCHIVES
parutions 2025 2024 2023
2022 2021
Retour
parutions
2026
Retour
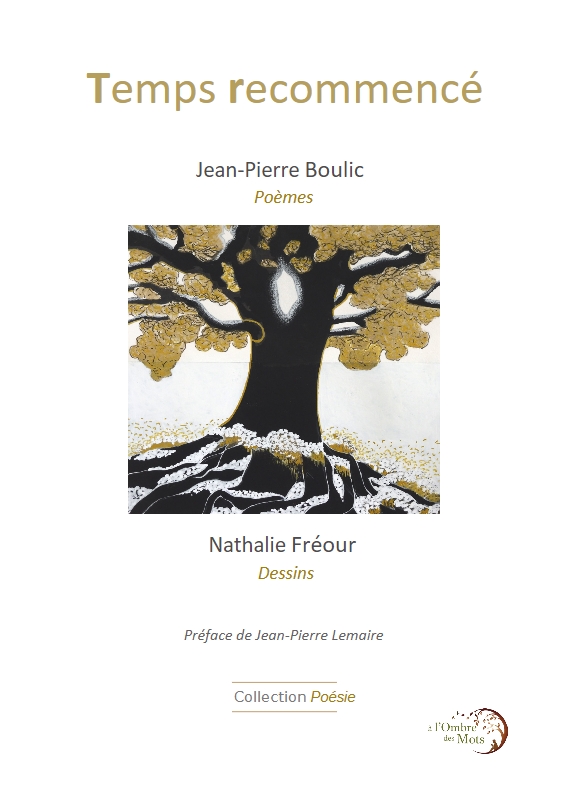
Bon de commande.pdf
Retour
S'opposer aux prédateurs
sans s'attaquer aux
autres utilisateurs des
parcours pastoraux…
toute une éducation !
|
|
|
|
|
LES CHIENS DE PROTECTION
Héritage vivant des
civilisations pastorales
|
|
|
Dès l’époque précédant les
Romains, les éleveurs
transhumants des montagnes
italiennes sélectionnaient un
chien apte à défendre leurs
troupeaux contre les loups, les
ours et les bandits, tous
nombreux dans ces contrées
rudes.
Sélectionner les meilleurs
chiens, les introduire dans un
troupeau, éduquer les chiots,
monter ou renouveler sa meute,
sont autant de bases techniques
portées par plus de deux
millénaires de savoir-faire
italiens.
Les races de chiens de
protection sont nombreuses. Si
chacune est adaptée au contexte
pastoral qui l’a façonnée,
toutes visent à remplir la même
mission : s’attacher au troupeau
et le défendre contre tout
intrus visant à agresser les
animaux. Mais il ne suffit pas
aux chiens de s’opposer aux
prédateurs. Encore faut-il
qu’ils acceptent le passage de
visiteurs. C’est pourquoi ces
savoirs venus du Molise et des
Abruzzes doivent inspirer le
travail, encore tâtonnant,
réalisé en France sur les chiens
de protection depuis le grand
retour des loups et des ours.
Pour faciliter ce travail
d’amélioration de la population
de chiens de protection en
France, un outil d’évaluation
(test) a été développé par Mario
Massucci et l’équipe de
scientifiques et de cynophiles
qu'il a su constituer autour de
lui dans le cadre de la Société
centrale canine. Ce test délivre
le Certificat de socialisation
et d’aptitude à la protection
des troupeaux.
Des chiens de protection
efficaces et tranquilles, c’est
un défi difficile mais pas
impossible à relever. L’enjeu
est considérable. La réussite
sera entièrement basée sur la
génétique des chiens, appuyée
sur une sélection séculaire face
aux prédateurs. Elle sera tout
autant basée sur l’éducation des
chiots visant à préparer leur
travail en meute.
Tel est l’héritage vivant des
civilisations pastorales qui
nous ont précédés, porté et
transmis par Mario Massucci.
Mario Massucci a rassemblé les
textes des meilleurs
spécialistes pour enrichir
l’ouvrage d’aperçus thématiques.
Paolo Breber, Sandro Allemand,
Andrea Mazzatenta, Ray Coppinger…
et même Columelle, du fond du 1er
siècle de notre ère, apportent
ainsi leurs expertises sur les
chiens de protection et la race
Abruzzes-Maremme. Le livre est
encadré par une préface et une
postface, signées par Laurent
Garde et Pascal Grosjean,
vice-présidents de l’Association
française de Pastoralisme.
|
|
|
Caractéristiques
Un livre
de 150 pages environ au format
16,5 x 24 à la française,
imprimé en couleur.Sortie en
avril 2026isbn 978-2-37649-049-4
prix public 26 €, en
souscription 20 € jusqu'au 31
mars 2026
Où
trouver l'ouvrage ?
Chez votre
libraire préféré (commande), ou
sur le
site de l'éditeur.
Télécharger le bon de
souscription
|
|
|
|
Bruno Msika
|
éditeur,
écologue
pastoraliste
|
|
|
|
10 avenue du pasteur
Rey84000 Avignon
|
|
|
|
|
Retour
http://cathygarcia.hautetfort.com/ht
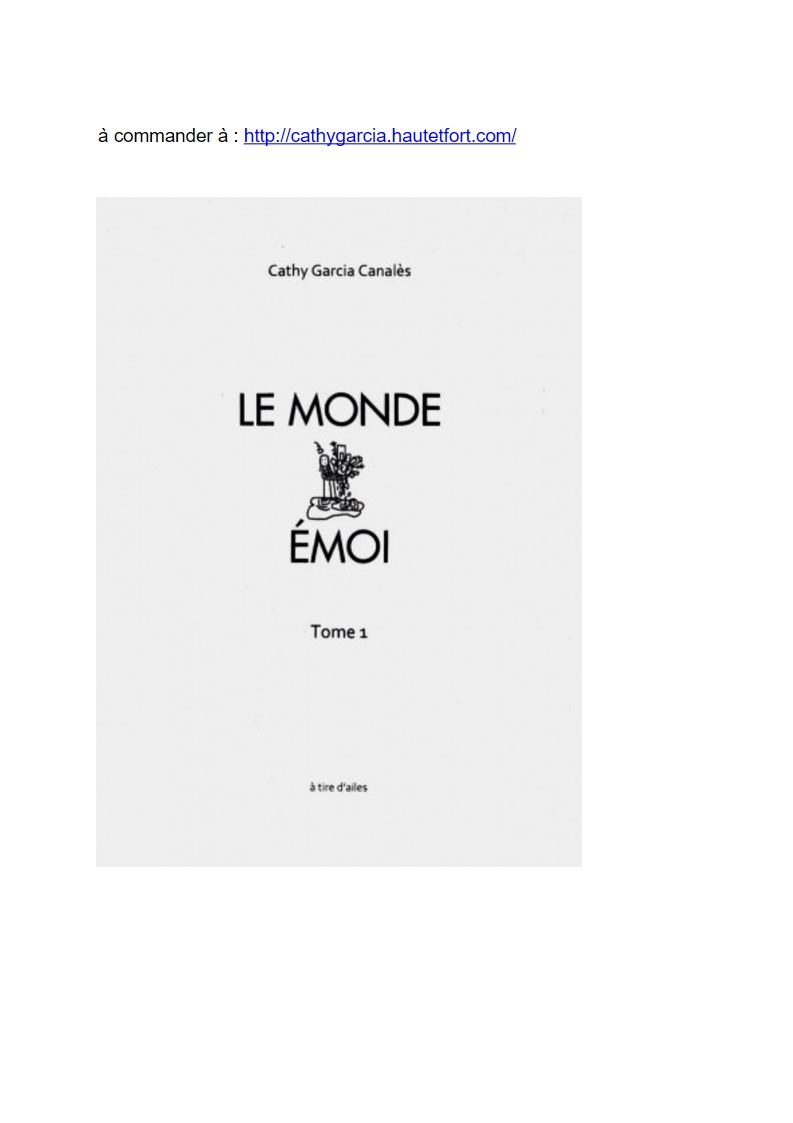
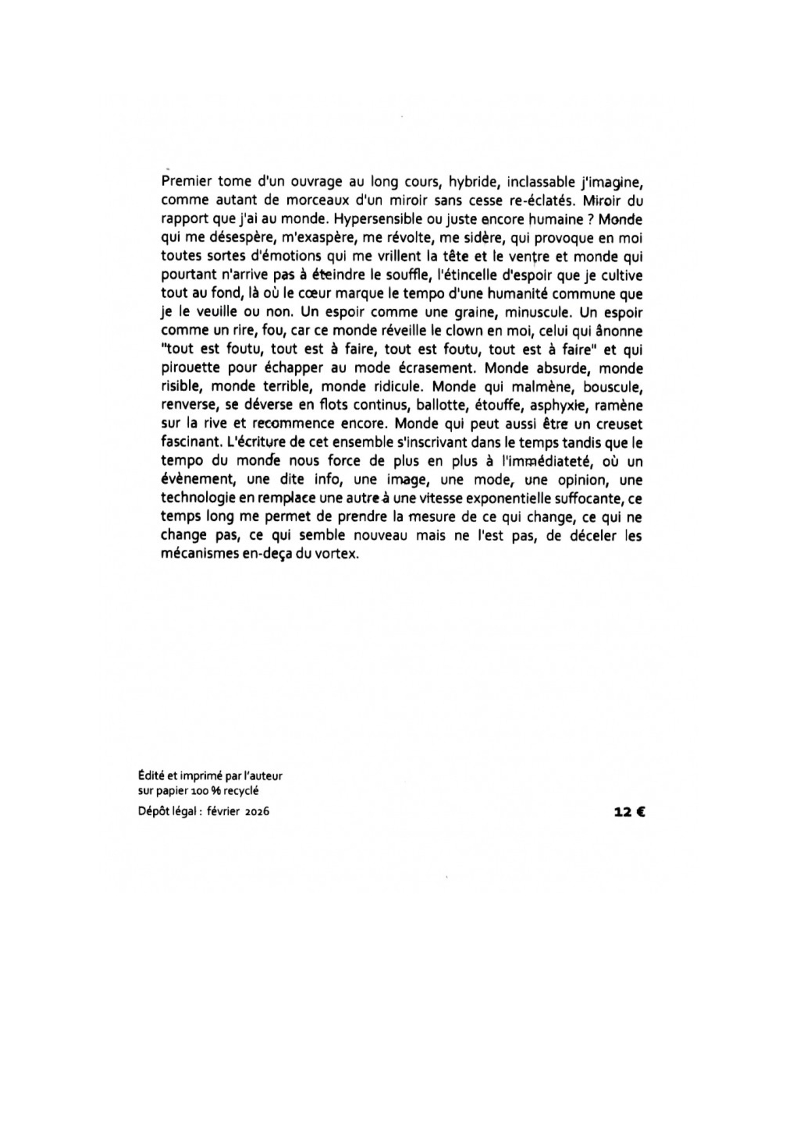
Retour
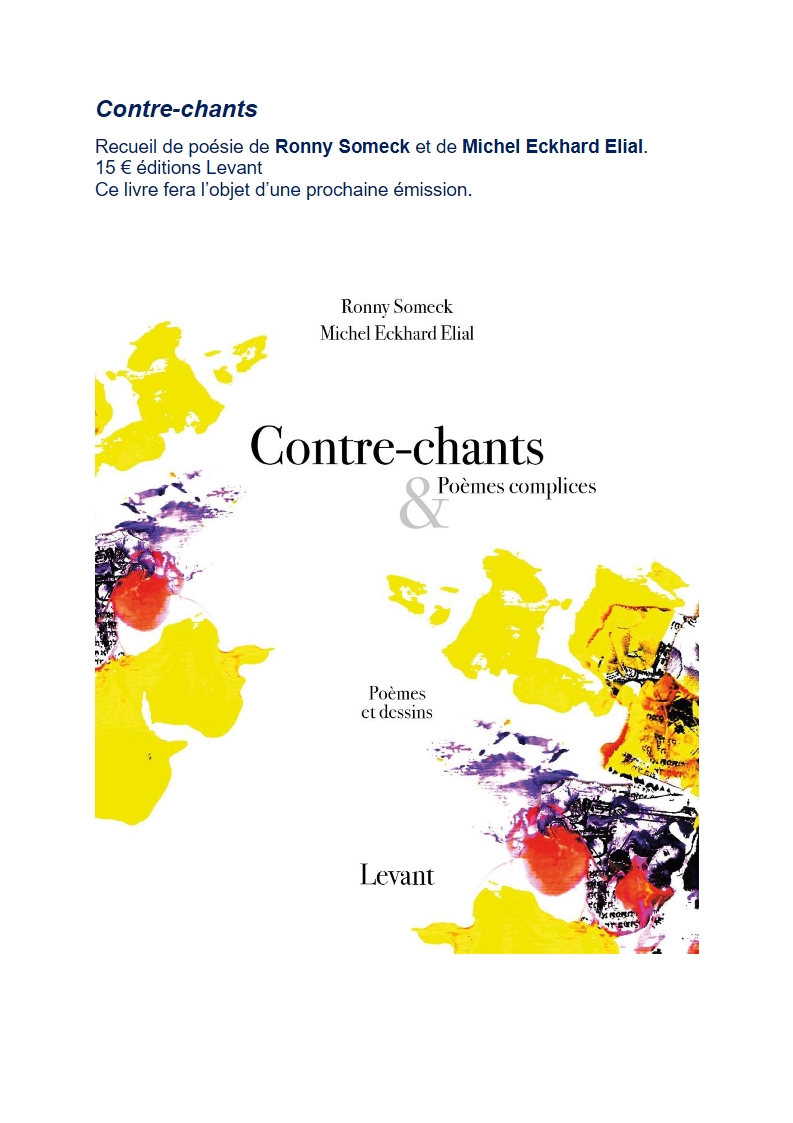
Retour
En ces temps où l’Europe,
agressée et meurtrie, se trouve
remise en cause dans ses moyens
de défense et ses perspectives
politiques, cinq écrivains sont
à l’honneur dans cette
Lettre du Lac Noir, dont
les destins sont tous, à leur
manière, représentatifs des
drames de la Mitteleuropa.
Le Polonais Edward
Stachura (1937-1979) est
né en France où son père était
venu chercher du travail. Il y a
vécu jusqu’à l’âge de 11 ans.
Ecrivain de l’errance et des
interrogations existentielles,
il s’est donné la mort à
Varsovie, laissant une œuvre
éblouissante, entre Kerouac et
Gombrowicz, dont paraît pour la
première fois en français une
œuvre majeure, La Marche du
scorpion.
Joseph Roth (1894-1939),
l’un des plus grands écrivains
allemands du XXe siècle, est né
près de Lviv, dans l’actuelle
Ukraine. Il s’est exilé en
France en janvier 1933, dès
l’accession au pouvoir d’Hitler.
Malgré l’aide d’amis fidèles
comme Stefan Zweig, il y a peu à
peu sombré dans le désespoir et
l’alcool. On l’a retrouvé un
jour sur un trottoir rue de
Tournon à Paris. Il est mort à
l’hôpital des indigents et
repose aujourd’hui au cimetière
parisien de Thiais.
Son ami Stefan
Zweig (1881-1942) est
né à Vienne d'une famile juive
originaire de Moravie. Comme
Roth, il a dû fuir les
persécutions antisémites et
s’exiler à Londres en 1934. Tous
ses biens ont été saisis. Ayant
à peine terminé Le Monde
d’hier, comme une sorte de
tombeau de la civilisation
européenne, il a quitté le vieux
continent pour le Brésil où il
s’est suicidé avec son épouse en
février 1942.
Krzysztof Kamil Baczynski
(1921-1944) est
né à Varsovie où il a fait ses
études et écrit, avec une
incroyable précocité, une œuvre
poétique intense et inclassable.
Il est mort à 23 ans les armes à
la main, le quatrième jour de
l'Insurrection de Varsovie, sous
les balles des forces allemandes
alors qu'il défendait un poste
insurgé.
Kalonymus Shapiro (1889-1943),
l’une des grandes figures du
hassidisme, était rabbin d'un
faubourg de Varsovie. Après
avoir perdu son fils et sa
belle-fille dans un
bombardement, il a tenu à
rester, malgré tous les dangers
et toutes les exhortations,
auprès de sa communauté, y
compris lorsqu’en novembre 1940,
elle a été regroupée dans le
Ghetto de Varsovie. Déporté dans
un camp près de Lublin en 1943,
il y a été assassiné.
Cinq destins tragiques et,
chacun à leur manière, lumineux.
Cinq œuvres qui nous éclairent
et nous donnent du courage quand
le chemin devient plus difficile
et incertain. Il faut citer ici
les fortes paroles prononcées
par Stefan Zweig quelques jours
après la mort de Joseph Roth en
mai 1939 en hommage à son ami
disparu dans ce qui pouvait
sembler la pire des déchéances
et le dernier abandon :
« C’était un miracle à
l’encontre de toute logique, de
toutes les lois médicales: ce
triomphe de l’esprit créateur en
lui sur un corps déjà
défaillant. Mais à la seconde où
Roth prenait le crayon pour
écrire, toute confusion cessait
; aussitôt, en cet homme si
indiscipliné, se mettait en
place cette discipline de fer
que seul pratique l’artiste
pleinement conscient de
lui-même, et il ne nous a laissé
aucune ligne dont la prose ne
soit marquée du sceau de la
maîtrise. Lisez ses derniers
articles, lisez ou écoutez les
pages de son dernier livre,
écrit à peine un mois avant sa
mort, et examinez cette prose
avec toute la méfiance et toute
la minutie d’une loupe de
joaillier : vous ne trouverez
pas la moindre imperfection dans
sa pureté de diamant, pas la
moindre opacité dans sa clarté.
Chaque page, chaque ligne est
martelée comme la strophe d’un
poème, avec la plus exacte
conscience du rythme et de la
mélodie. Affaibli dans son
pauvre corps fragile, ébranlé
dans son âme, il se maintint
droit dans son art – dans son
art à travers lequel il se
sentait responsable, non devant
ce monde qu’il méprisait, mais
devant la postérité : ce fut un
triomphe, un triomphe sans
pareil, celui de la conscience
sur la déchéance extérieure.
« Je l’ai souvent rencontré en
train d’écrire, assis à la table
de son café bien-aimé, et je
savais : le manuscrit était déjà
vendu, il avait besoin d’argent,
les éditeurs le pressaient.
Mais, sans pitié pour lui-même,
le plus sévère et le plus sage
des juges, il déchirait sous mes
yeux toutes les feuilles et
recommençait depuis le début,
simplement parce qu’un tout
petit mot n’avait pas encore le
poids juste, ou qu’une phrase ne
possédait pas encore la
plénitude de sa sonorité
musicale. Plus fidèle à son
génie qu’à lui-même, il sut
magnifiquement s’élever, par son
art, au-dessus de sa propre
chute.
Mesdames et Messieurs, combien
encore je brûle de vous dire sur
cet être unique, dont la force
pérenne ne nous est peut-être
pas encore pleinement
perceptible, même à nous, ses
amis, en cet instant. Mais ce
n’est pas le moment d’en venir à
des jugements définitifs, ni de
nous abandonner à notre propre
deuil. Non, ce n’est pas l’heure
des sentiments personnels, car
nous sommes en pleine guerre
spirituelle, et même à son
avant-poste le plus périlleux.
« Vous le savez tous : en temps
de guerre, à chaque défaite d’un
corps de troupe, un petit groupe
est détaché pour couvrir la
retraite et permettre aux forces
battues de se réorganiser. Ce
sont ces quelques bataillons
sacrifiés qui doivent alors
résister le plus longtemps
possible à toute la pression de
la supériorité ennemie ; ils se
tiennent sous le feu le plus
violent et subissent les pertes
les plus lourdes. Leur tâche
n’est pas de remporter la
bataille – ils sont trop peu
nombreux pour cela –, leur tâche
est uniquement de gagner du
temps, du temps pour les
colonnes plus fortes qui se
trouvent derrière eux, pour
livrer la prochaine, la
véritable bataille.
« Mes amis, ce poste avancé, ce
poste sacrifié, c’est
aujourd’hui à nous qu’il a été
confié, à nous, artistes,
écrivains de l’exil. Nous ne
savons pas encore, même en cette
heure, discerner clairement quel
est le sens profond de notre
tâche. Peut-être, en tenant ce
bastion, ne faisons-nous que
masquer aux yeux du monde le
fait que la littérature à
l’intérieur de l’Allemagne,
depuis Hitler, a subi la plus
lamentable défaite de son
histoire et est en train de
disparaître complètement du
champ de vision de l’Europe.
Peut-être aussi – et
puissions-nous l’espérer de
toute notre âme ! – n’avons-nous
à tenir cette position que
jusqu’à ce qu’une réorganisation
ait lieu derrière nous, jusqu’à
ce que le peuple allemand et sa
littérature soient à nouveau
libres et puissent de nouveau
servir l’esprit comme une entité
créatrice. Quoi qu’il en soit,
nous n’avons pas à nous
interroger sur le sens de notre
tâche, nous n’avons maintenant
qu’une seule chose à faire :
tenir le poste où nous avons été
placés.
« Nous ne devons pas perdre
courage si nos rangs
s’éclaircissent, nous ne devons
pas même, lorsque les meilleurs
de nos camarades tombent à notre
droite et à notre gauche, nous
abandonner à la mélancolie du
deuil ; car – je l’ai dit à
l’instant – nous sommes en
pleine guerre, et à ses
avant-postes les plus exposés.
Juste un regard, rien qu’un
regard, lorsque l’un des nôtres
tombe – un regard de gratitude,
de douleur et de fidèle souvenir
– et il nous faut revenir
aussitôt à la seule tranchée qui
nous protège : notre œuvre,
notre tâche – la nôtre propre et
celle que nous partageons tous
–, pour l’accomplir, droits et
fermes, jusqu’à la fin amère,
comme l’ont fait avant nous ces
deux camarades que nous avons
perdus : notre Ernst Toller,
avec sa perpétuelle fougue, et
notre inoubliable, à jamais
inoubliable Joseph Roth.»
Extrait de l’Hommage à Joseph
Roph traduit en préface à
PANOPTIKON, de Josph Roth.
Traduit par Louis Gehres. Cf
ci-dessous.
Extrait de l'Hommage à
Joseph Roth publié en
introduction à la première
traduction ifrançaise du
PANOPTIKON de Joseph Roth.
Traduit de l'allemand par Louis
Gehres.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES
DEUX NOUVEAUTÉS
DU
MOISEn
librairie le
jeudi 12 février
2026Distribution
Sodis –
Diffusion
Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edward Stachura
La Marche du
scorpion
Traduit du
polonais et
présenté
par Liliana
Orlowska et
Laurent Pinon
Collection
Le Rouge & le
Noir
ISBN
978-2-845-90403-3
– 256 pages –
18,5 €
|
|
|
|
La Marche du
scorpion est
le premier grand
livre de
Stachura traduit
en français. On
peut s’en
étonner
lorsqu’on sait
combien ses
écrits ont
marqué les
consciences en
Pologne et
combien son
destin tragique
a fait de lui
une légende.
Il est grand
temps de le
découvrir ici,
car c’est en
France qu’il est
né, à Charvieu
(Isère), où son
père était
travailleur
immigré. Il
avait 11 ans
déjà quand sa
famille est
rentrée en
Pologne.
Bilingue, il a
fait son mémoire
sur Henri
Michaux et
traduit Michel
Deguy.
Stachura a
toujours vécu
dans l’écart
entre le
polonais et le
français, entre
l’Europe et
l’Amérique,
entre lui et
lui-même. En
cela comparable
à Gombrowicz ou
Borges. Proche
par le style de
Kerouac et de la
Beat Generation,
Stachura est
avant tout un
écrivain
voyageur. Nous
le suivons d’une
ville à l’autre,
aux États-Unis,
au Mexique, en
Amérique latine, attentif
à toutes les
rencontres, à
tous les signes.
Toujours prêt à
sortir sa
guitare pour
chanter ou à
prendre le
premier train.
« On marchait
sur l’une des
innombrables
routes parmi des
dizaines parmi
des centaines
parmi des
milliers en
forme de boucle,
une des routes
de la Planète.
» Sur les
routes du
Mexique, des
États-Unis ou de
la Pologne,
Stachura,
guitare en
bandoulière, ne
vit que de
découvertes et
de rencontres.
Le mouvement
hippie bat son
plein, mais déjà
il en sent les
ambiguïtés et se
demande :
« Cela peut-il
se produire, une
aspiration
universelle vers
l’arrière ? Une
reculade
universelle ?
Oui, ça se peut.
» La même
année où
disparaissent
Kerouac et
Gombrowicz, en
1969, Stachura
publie son
premier roman.
La Marche du
scorpion a
paru en 1977
deux ans avant
la mort de
Stachura. Livre
d’errance et
d’anonymat à
travers
l’Amérique, son
titre polonais,
Się (« soi
» ou « on »),
est comme la
négation de tout
titre et tout
auteur. Pour
Stachura, il
désigne la
dimension
impersonnelle de
sa vision d’un
monde fait
d’instants et de
hasards. Ce
titre étant
intraduisible,
le choix a été
fait de prendre
pour titre celui
d’un des récits
les plus
marquants du
livre.
Liliana Orlowska
et Laurent Pinon
ont précédemment
traduit sous le
titre
Près d’Annopol
quatre récits
aux éditions
Alidades (2022).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joseph Roth
PANOPTIKUM
Personnages
et décors
précédé de
Hommage à Joseph
Roth, par
Stefan Zweig
Traduit de
l'allemand par
Louis GehresCollection Les
Vies imaginaires
ISBN
978-2-845-90404-0
– 208 pages –
18 €
|
|
|
|
Joseph Roth
(1894-1939) est
l’un des plus
grands écrivains
du XXe siècle
par la qualité
de son écriture,
l’ambition de
son œuvre mais
aussi par sa
personnalité
très attachante.
Stefan Zweig
proclamait que
Job,
l’un de ses
principaux
romans était
« la seule œuvre
destinée à
survivre à tout
ce que nous, ses
contemporains,
avons créé et
écrit ».
Roth s’est exilé
en France dès
1933. Il n’y a
survécu que
grâce à l’aide
d’amis comme
Zweig. Il est
mort à Paris en
1939 et y est
enterré. L’Hommage
à Roth ici
présenté a été
prononcé par
Zweig, quelques
jours après sa
mort de Roth.
Le
PANOPTIKUM de
Joseph Roth a
été publié à
Munich en 1930,
juste entre ses
deux grands
romans Job
(1930) et La
Marche de
Radetzky
(1932). La
présente édition
constitue la
première
traduction
intégrale de cet
ouvrage en
français. Une
première
traduction de
brefs extraits a
paru en 1959
dans les
Classiques
Hachette. Une
dizaine de
textes a paru
ensuite dans
différents
recueils et un
ensemble plus
large dans le
volume intitulé
Cabinet des
figures de cire
(Seuil, 2009).
Le terme
Panopticon a
été vulgarisé
par le
philosophe
anglais Jeremy
Bentham
(1748-1832) pour
désigner une
architecture
d’où tout peut
être observé
d’un point
central. Roth a
conçu son livre
comme un
dispositif
d’observation de
la société de
son temps. Il
reprend cette
image à
plusieurs
reprises au sens
d’un musée de
cire (autre sens
de
Panoptikum en
allemand), d’une
lanterne magique
donnant un
« panorama du
monde »
(Weltpanorama) ou
d’un
« musée des
horreurs
panoptique ».
Les 28 textes de
l’architecture
créée par Roth
se répartissent
ainsi en trois
ensembles très
identifiables :
Villes, L’Hôtel
et Voyages.
L’Hommage à
Joseph Roth
présenté en tête
du présent
volume a été
prononcé par
Stefan Zweig à
Paris. Nombre
des thèmes qu’il
aborde se
retrouvent dans
les textes du
PANOPTKUM
et les analyses
qu’en donne
celui qui n’a
pas publié
encore le fameux
Monde d’hier
(rédigé de 1934
à 1942) en
renforce l’effet
« panoptique »,
comme une autre
forme
d’auto-biographie
d’un monde en
éclats.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TROIS
LIVRESÀ
REDÉCOUVRIRDistribution
Sodis –
Diffusion
Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ainsi
parlait Stefan
Zweig
Dits et
maximes de vie
Traduit de
l'allemand et
présenté par
Gérard Pfister
ÉDITION BILINGUE
Collection Ainsi
parlait
ISBN
978-2-845-90342-5
– 192 pages –
14 €
|
|
|
|
L’œuvre de
Stefan Zweig
(1881-1942) est
un phénomène
d’édition. Ses
nouvelles et ses
biographies
historiques ne
cessent d’être
rééditées.
Pourtant Zweig
estimait ces
textes-là d’un
intérêt mineur.
À côté de la
poésie, seule
importait pour
lui le travail
de réflexion et
l’autorité
morale qu’il
pouvait avoir
sur son époque.
Cet
Ainsi parlait,
qui fait
largement appel
à ses journaux
et à ses lettres
fait apparaître
un homme intègre
et inquiet,
doutant de
lui-même mais ne
transigeant
jamais sur
l’essentiel : la
lutte contre les
nationalismes,
le rejet des
fanatismes
religieux, le
combat contre
tous les
dogmatismes.–
Toute sa vie il
a essayé de
penser
l’universel. Il
ne faut pas
s’étonner que
les trois
autorités
morales qui lui
ont servi de
modèles soient
des français :
Romain Rolland,
Castellion et
Montaigne.
Les éditions
Arfuyen ont fait
découvrir en
2021 ses textes
poétiques, qu’il
plaçait au
centre de son
œuvre. Or, de
même qu’on
oublie trop chez
Zweig le poète,
on oublie trop
chez lui le
penseur :
« Mon but,
écrit-il à
Rolland,
serait de
devenir non une
célébrité
littéraire, mais
une autorité
morale. »
Grâce à cet
Ainsi parlait,
c’est bien ainsi
que Zweig nous
apparaît au fil
de ses
nouvelles,
essais, pièces
et biographies
mais aussi de
ses journaux et
lettres. Un
homme intègre et
inquiet, doutant
de lui-même mais
ne transigeant
jamais sur
l’essentiel : la
lutte contre les
nationalismes,
le rejet des
fanatismes
religieux, le
combat contre
tous les
dogmatismes.
Aux côtés de
Romain Rolland
le combat qu’il
mène pendant le
Première Guerre
mondiale pour la
paix et la
réconciliation
européenne est
d’une admirable
clairvoyance.
Tout aussi
prophétique ce
qu’il annonce
pour les
lendemains du
conflit :
« Je suis
convaincu – dur
comme fer –
qu’après la
guerre
l’antisémitisme
sera le refuge
des partisans de
la “Grande
Autriche”. » Hitler,
on le sait,
était
autrichien…
Inlassablement
Zweig nous met
en garde contre
les périls du
sectarisme et de
la violence :
« Tuer un homme,
insiste-t-il
dans son
Castellion (1936),
ce n’est pas
défendre une
doctrine, c’est
tuer un homme.
On ne prouve pas
sa foi en
brûlant un homme
mais en se
faisant brûler
pour elle. » À
la fin de sa
vie, c’est chez
Montaigne, lui
aussi, qu’il
trouvera un
réconfort et un
modèle :
« Je vois en
lui, l’ancêtre,
le protecteur et
l’ami de chaque
homme libre. »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
K. K. BaczynskiTestament
de feu
Traduit du
polonais et
présenté
par Claude-Henry
du Bord et
Christtophe
Jezewski
EDITION BILINGUECollection
NeigeISBN
978-2-845-90084-4
– 204 pages –
19 €
|
|
|
|
|
|
|
Figure
légendaire de la
littérature
polonaise du XXe
siècle,
Krzysztof Kamil
Baczynski est né
en 1921. Il
appartient à la
première
génération née
dans une Pologne
libre, qui est
aussi celle de
Jean-Paul II. Il
est mort à 23
ans sur les
barricades de
l’Insurrection
de Varsovie, le
4 août 1944.
« Ces poètes
dépassèrent
l’enfer, écrit
Stanislaw Beres
dans sa préface
à l’anthologie
Poètes de
l’Apocalypse
(1991), mais ne
cessèrent de
chercher la
beauté du reflet
divin dans le
visage de
l’homme et cela
les amena à une
poétique
particulière,
unique peut-être
dans la
littérature
mondiale… »
Baczynski est un
poète
parfaitement
original. Les
poèmes
patriotiques,
les témoignages
sur ce qui fut
une des pires
nuits de
l’Histoire
voisinent avec
les poèmes
d’amour (parmi
les plus beaux
de la poésie
polonaise),
écrits pour sa
femme Barbara
(Basia), morte
enceinte trois
semaines après
lui, lors de
l’Insurrection.
Comment ne pas
évoquer les
bouleversants
poèmes d’amour
que Krzysztof
écrivit pour sa
mère et dont un
fragment est
gravé sur son
tombeau, au
cimetière de
Powazki à
Varsovie :
« Qu’importe si
je suis loin, /
si les ténèbres
nous ont
déchirés, et que
la douleur reste
plantée comme un
couteau. / Moi
en toi et toi en
moi, nous allons
en torrent, en
fleuve, / en
torrent d’or
frémissant, en
étoiles de roses
luisantes. »
Sa veine
satirique
déborde d’une
merveilleuse
ironie, mais ce
qui est le plus
caractéristique
de cette poésie,
c’est son
mysticisme :
Baczynski est le
poète d’une foi
en acte vouée à
un éternel
questionnement
et en proie au
doute.
Son
christianisme
toujours en
lutte contre
toutes formes de
pharisaïsme,
marqué par le
personnalisme
d’Emmanuel
Mounier (qui a
beaucoup
influencé les
milieux
chrétiens de la
Pologne des
années 30) se
résume en cette
phrase :
« combattre par
l’amour ».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Catherine
Chalier
Kalonymus
Shapiro,
rabbin du
Ghetto de
Varsovie
(1889-1943)
Présentation et
traduction de
l'hébreu de
textes inédits Collection
Les Carnets
spirituelsISBN
978-2-845-90164-3
– 160 pages –
12 €
|
|
Catherine
Chalier donne
ici en français
la première
présentation de
la personnalité
et l’œuvre de
Rabbi Kalonymus
Shapiro
(1889-1943),
cette haute
figure du
hassidisme et de
la résistance
spirituelle à la
Shoah. Kalonymus
Shapiro fut
rabbin au ghetto
de Varsovie et
l’on a retrouvé,
conservés dans
la terre, les
textes écrits
pour essayer de
trouver un sens
face à cette
inconcevable
épreuve. Les
éditions
originales des
textes de Rabbi
Kalonymus
Shapiro ont paru
en hébreu,
depuis Ech
Qodech (Le Feu
saint), en
1960, à Bnéi
Machavah Tova
(Enfants d’une
pensée bonne),
en 1989.
Plusieurs
traductions ont
paru en langue
anglaise. Le
livre se compose
d’un essai sur
la vie et la
pensée de
Kalonymus
Shapiro suivi
d’un choix de
textes extraits
de Derekh
Melekh (Le
chemin du Roi)
et de
Ech Qodech (Le
Feu saint)
et spécialement
traduits pour
cette édition
par Catherine
Chalier.
En 1941 le
Ghetto de
Varsovie
comptait 445 000
personnes et le
taux de
mortalité y
était
catastrophique,
suite au
dénuement
absolu, en
particulier au
manque de
vivres, de
vêtements et
d’espace, aux
maladies, tel le
typhus, et aux
exactions de
chaque instant
de la part des
nazis. La
situation des
enfants était
tout
particulièrement
dramatique.
« La mort
gouverne dans
toute sa
majesté, alors
que la vie ne
luit qu’à peine
sous une épaisse
couche de
cendres. Cette
imperceptible
lueur de vie est
faible,
misérable,
pauvre, sans le
souffle de la
liberté, sans la
moindre
étincelle de
spiritualité »,
écrit Abraham
Lewin dans son
Journal le
13 septembre
1941.
C’est pourtant
sur cette
étincelle de
spiritualité que
Kalonymus
Shapiro veillera
dans les
conditions
effroyables du
Ghetto, ne
cessant de
donner des
homélies chaque Chabbat
et jour de fête
afin de procurer
une aide
spirituelle à
ceux qui
l’entouraient et
encourager une
vie juive fidèle
dans la mesure
où l’atrocité
des conditions
d’existence le
permettait.
La résistance
spirituelle
dont, avec
d’autres,
témoigne
Kalonymus
Shapiro retient
généralement
moins
l’attention que
la résistance
armée de
l’insurrection
du Ghetto qui
éclata le 19
avril 1943 et
qui marque tant
la mémoire, pour
son courage
sublime et pour
sa dignité sans
espoir. Marek
Edelman, qui fut
l’un des leaders
du soulèvement
du Ghetto,
reconnaît
lui-même que
l’héroïsme n’est
pas l’apanage de
la lutte armée.
« En donnant des
leçons de Torah
dans ces
conditions
implacables et
infernales,
souligne
Catherine
Chalier,
R. Kalonymus
Shapiro ne
désarme pas. Sa
vigilance
spirituelle
maintenue grâce
à de grands
efforts et à une
patience qui ne
ressemble en
rien à la
passivité ou à
la démission
devant plus fort
que soi, ne
faiblit jamais,
même quand le
tourment enduré
semble en passe
de vaincre toute
foi.
« La résistance
spirituelle ne
mérite donc pas
d’être tenue
dans
l’insignifiance
comme cela
arrive encore
chez ceux qui,
méconnaissant sa
grandeur,
l’assimilent à
un manque de
courage pour
affronter la
lutte armée, la
seule censée
compter. Elle
aussi refuse
l’humiliation,
le mépris et
l’offense ; elle
aussi combat
pour sauver la
dignité humaine
et la force de
l’esprit malgré
la faiblesse
extrême infligée
aux corps et un
dénuement absolu
qu’aucun secours
venu de
l’extérieur
n’atténue. […]
La résistance
spirituelle
juive prend donc
également la
forme d’un
témoignage
destiné à faire
réfléchir au
sens de cette
humanité en
l’homme. Que ce
fût là, pour R.
Kalonymus
Shapiro, la
tâche éternelle
d’Israël ne fait
aucun doute.
L’éternité
d’Israël
souffrait alors
une violence
inouïe mais elle
ne pouvait
mentir. C’est là
l’ultime sens de
sa résistance
spirituelle. »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 février 2026
L’arrière-silence, de
Michèle Finck, lu par Marc
Wetzel (Poesibao)
4
février 2026
L’Éclatante Beauté de Sally,
d’Elizabeth von Arnim, par
Philippe Barthelet (Valeurs
actuelles)
3
février 2026
L’arrière-silence, de
Michèle Finck, lu par Guillaume
Curtit (Poesibao)
2
février 2026
Journal d’une planète minuscule,
d’Agnès Clerc, lu par Antoine
Jockey (Al Majalla)
7
janvier 2026
Ainsi parlait Platon,
d’Emmanuel Pasquier, par
Philippe Barthelet (Valeurs
actuelles)
6
janvier 2026
Un déjeuner en montagne, de
Gérard Pfister, lu par
Marie-France de Palacio (Recours
au poème)
6
janvier 2026
Le Rêve de Dostoievski, de
Cécile A. Holdban, lu par
Pierrick de Chermont (Recours au
poème)
|
|
|
|
|
Retour
Marc Tison Marc Bernard
Nouvelle vidéo
Extrait du
Ep "Jours pendant" en écoute ICI
|
|
La vidéo
"Antonomase sociologique"
Des spectres de fantômes
pilotent des machines dominantes,
clinquantes et ignorantes,
ridicules de victoires qui nous destinent à
conforter leurs complexions
La matrice initiale se grippe.
Le concept de révolution reste à
sa place à côté du rêve, extirpé du réel
|

|
|
|
|
Marc Bernard (ingénieur du son et
musicien) & Marc Tison (poète, ex
chanteur de rock) collaborent depuis
plusieurs décennies sur
différents projets.
Depuis quelques années, ils se
concentrent sur la réalisation
d'univers musicaux et sonores autour
de textes de poésie de Marc Tison
Voir ICI
|
|
|
|
|
BONUS
Visiter la page du
Collective Baudelaire
Baudelaire en vidéo visité par une quinzaine
d'interprètes en fusion électronique
|
Dernière sortie "Réversibilité"
|
|
|
|
|
|
|
Les plaintes d'un Icare par
Marc Tison et Le collective
Baudelaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 rue de la vieille forge, 81110,
Saint Amancet
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
Retour
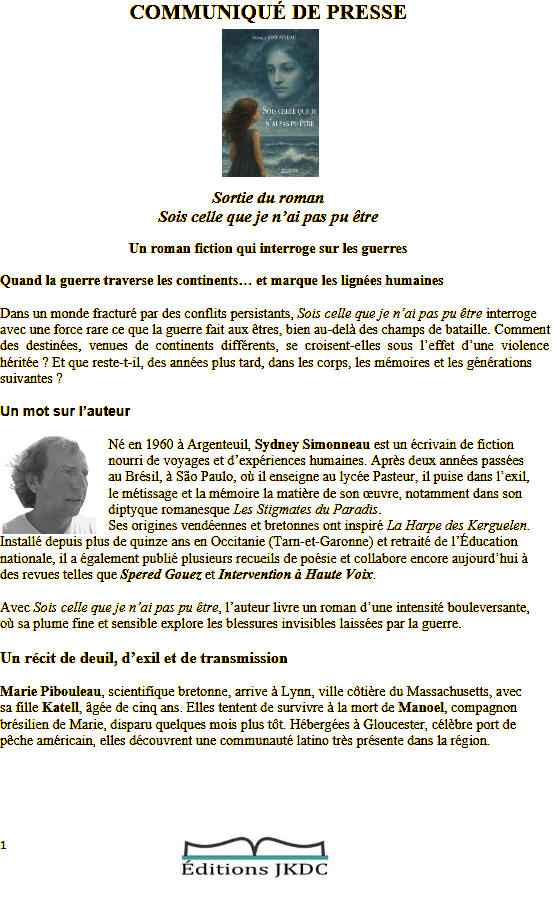
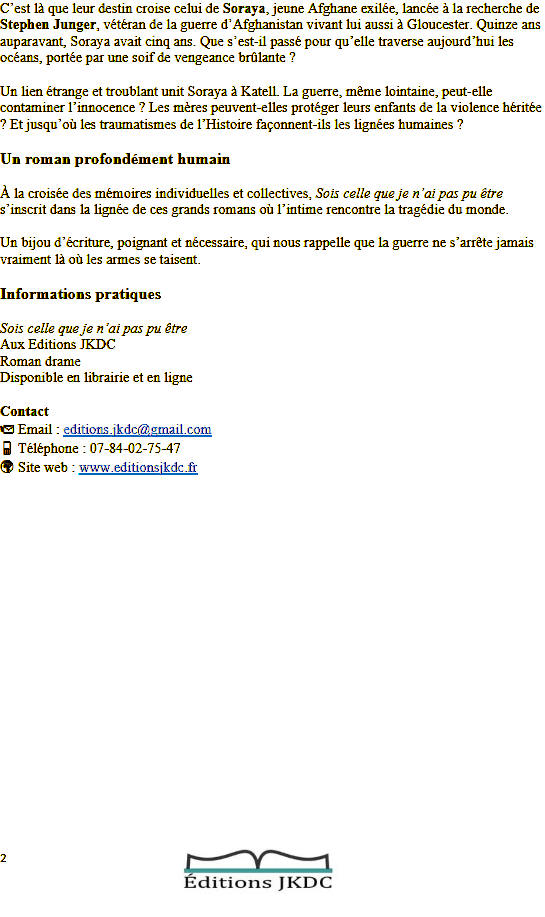
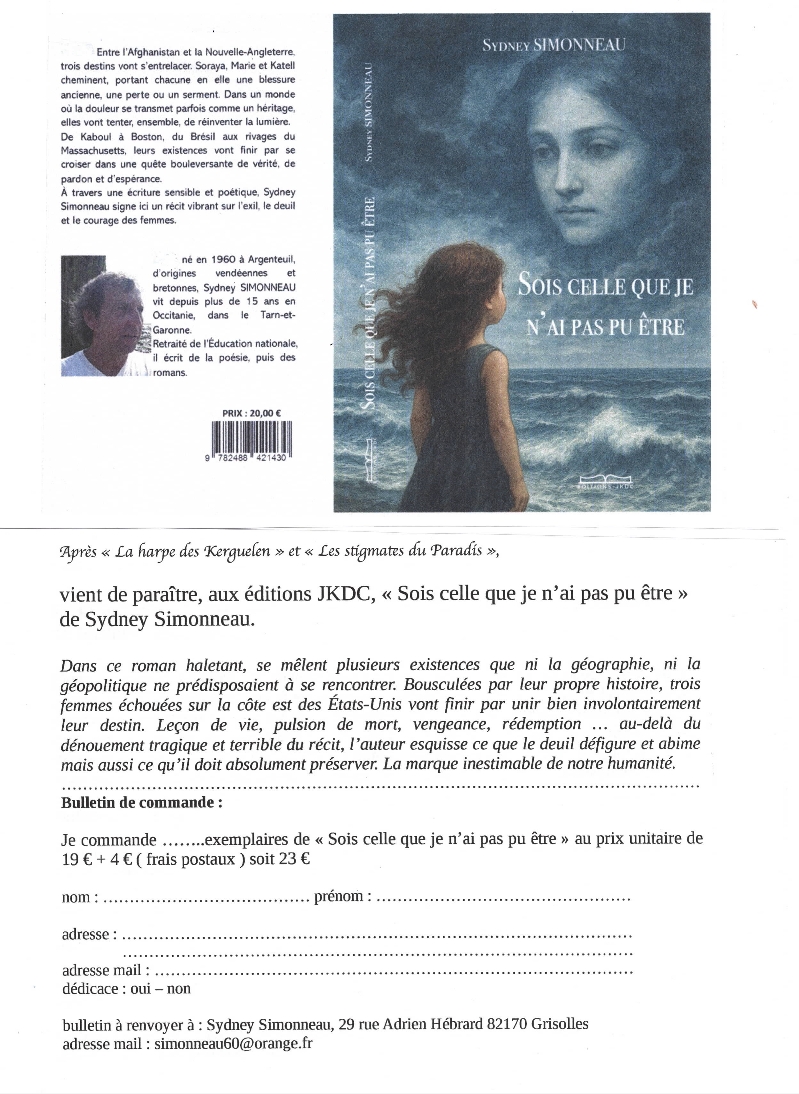
Retour
George Orwell
prophète de la
post-vérité
|
George
Orwell partage avec Franz Kafka
cette singularité d’être sans
doute davantage connu par
l’adjectif dérivé de son
patronyme que par son œuvre. […]
Parmi ceux qui utilisent à tout
propos « kafkaïen » ou
«orwellien », combien ont lu
Le Procès et La
Métamorphose, ou bien
1984 et La Ferme des
animaux ? Ne parlons même
pas d’Amerika pour le
premier ou du Quai de Wigan
pour le second. Orwell possède
de surcroît une autre
particularité, celle d’avoir
donné naissance à un autre terme
passé dans le langage courant :
newspeak ou « novlangue
» […]
Si les
formes multiples du
totalitarisme et la manipulation
du langage constituent bel et
bien deux axes essentiels de la
pensée politique d’Orwell, il
serait erroné de les y réduire.
Comme d’y réduire son œuvre
littéraire, au risque
d’appauvrir et de figer l’une et
l’autre. […] Sans doute
range-t-on trop hâtivement – et
à tort – 1984 dans le
genre dystopique, quand Orwell
parle explicitement d’une satire
qui, selon Tzvetan Todorov, fait
figure de « grammaire de la
peur politique ». Le terme
de satire à son importance chez
ce fin lecteur de Jonathan
Swift, pour qui Les Voyages
de Gulliver est un livre
inépuisable, qu’il ne cesse de
relire depuis ses huit ans. […]
Orwell
démontre la capacité qu’a la
langue de faire et défaire le
monde. Il partage avec Swift et
d’autres une forme
intransigeante de lucidité,
ainsi qu’il le dit : « Ce
qui fait que les gens de mon
espèce comprennent mieux la
situation que les prétendus
experts, ce n’est pas le talent
de prédire des événements
spécifiques, mais bien la
capacité de saisir dans quelle
sorte de monde nous vivons. »
Il dénonce, avec une verve
tantôt satirique tantôt
polémique, l’éviction et la
pétrification du langage qui,
inéluctablement, conduit à un
appauvrissement de notre
perception du réel. […]
Si Orwell
ne sépare jamais littérature et
morale, il redoute son
instrumentalisation au service
de l’idéologie. Car pour lui, la
littérature est l’espace même de
la pensée individuelle, ce qui
en fait l’une des cibles
privilégiées de toutes les
formes – ouvertes ou larvées,
politiques, religieuses,
idéologiques ou morales – de
totalitarisme. Dans son célèbre
essai The Prevention of
Literature (1946), il ne
dit pas autre chose : « Là
où règne une orthodoxie
politique rigide, une vraie
littérature ne peut exister. » […]
La guerre
d’Espagne, pour laquelle il
s’était porté volontaire avec sa
première épouse, Eileen, fut
pour lui à la fois une
révélation politique, une
épreuve physique et un choc
moral irréversible. Il y a vécu
ce que peu d’intellectuels de
son temps ont osé affronter : la
guerre, la révolution et la
trahison idéologique, les armes
à la main. […] En arrivant à
Barcelone, il découvre un monde
où la hiérarchie semble
suspendue, où les serveurs
refusent les pourboires, où les
soldats le tutoient, où les
uniformes sont supprimés. […]
Mais il
déchante très vite quand les
premiers combats opposant les
anarchistes et le POUM à la
garde civile contrôlée par les
communistes éclatent, ce qu’il
appelle la « sale guerre
dans la guerre ». Le Parti
communiste, soutenu par l’URSS,
commence à démonter
systématiquement les structures
révolutionnaires, à imposer une
discipline verticale, à désarmer
les milices ouvrières. Des
militants du POUM sont arrêtés,
torturés, accusés de trahison.
La propagande communiste les
présente comme des agents de
Franco. Orwell, visé lui-même
par un mandat d’arrêt, doit fuir
clandestinement l’Espagne avec
sa femme. […]
Désormais,
Orwell ne croira plus en aucune
forme de pouvoir centralisé. Il
se méfiera des partis, des
bureaucraties, des vérités
officielles. À son retour, il
n’aura de cesse de dénoncer la
manipulation idéologique :
La Ferme des animaux naît
de la trahison du rêve
révolutionnaire, et 1984
de l’expérience de la
falsification des faits. Car ce
qu’il a vu en Espagne, c’est que
le mensonge peut se déguiser en
vertu, que la vérité peut
devenir illégale et que le
langage est le premier champ de
bataille du pouvoir. […] Quand
il cherche à témoigner de ce
qu’il a vu, les portes se
referment. Il est en butte à la
conspiration du silence et à la
calomnie, « efficacement
organisée par les commissaires
du Komintern et tous leurs
auxiliaires bénévoles de la
gauche ». […]
Dans
Pourquoi j’écris (1946),
Orwell affirme : « Tout ce
que j’ai écrit depuis 1936 l’a
été, directement ou
indirectement, contre le
totalitarisme et pour le
socialisme démocratique tel que
je le conçois. » […] Le
socialisme d’Orwell n’est pas
dogmatique mais construit sur
une expérience vécue, qui est
celle de la pauvreté, de la
guerre et de l’injustice
sociale. De Dans la dèche à
Paris et à Londres à
Hommage à la Catalogne,
toute son œuvre est traversée
par la solidarité avec les
humiliés et par une haine active
de la domination, qu’elle soit
capitaliste, coloniale ou
bureaucratique. […]
Ce qu’il
constate également, c’est ce que
la machine fait à l’homme. Il
perçoit ce totalitarisme
technologique qui est en train
de se mettre en place. Dans un
essai paru dans Polemic
en mai 1946, il décrit cet autre
futur qui est en marche : «
Les nouvelles sociétés
managériales ne consisteront pas
en une mosaïque de petits états
indépendants, mais en grandes
superpuissances, groupées autour
des principaux centres
industriels en Europe, en Asie
et en Amérique. […]
Chaque société sera
hiérarchique, avec une
aristocratie fondée sur le
talent au sommet et une masse de
semi-esclaves à la base. »
[…]
Il déplore
que « l’horreur instinctive
que tous les gens dotés de
sensibilité éprouvent devant la
mécanisation progressive de la
vie » soit méprisée comme
« un simple archaïsme
sentimental ». Mais cela
participe de cette «haine du
passé qui est le trait
fondamental de toute la
psychologie progressiste ».
Orwell lui oppose la common
decency, une morale
élémentaire partagée par les
gens simples, qui n’est pas
écrite, ne repose sur aucune
idéologie, mais est profondément
ancrée dans le quotidien. […]
La common decency,
c’est ce qui subsiste en
l’absence de règles imposées :
un fond de bonté, ou du moins de
retenue, qui n’a pas besoin
d’être prescrit. […] Le
socialisme n’est pas, pour lui,
une théorie de l’histoire ou un
projet de société total, mais la
mise en œuvre politique de la
décence commune, autrement dit
une organisation sociale qui
permettrait aux valeurs
ordinaires de prospérer, au lieu
d’être écrasées par
l’exploitation ou le cynisme.
C’est la
raison pour laquelle il rejette
à la fois le capitalisme, qui
détruit la solidarité par
l’individualisme économique, et
le totalitarisme stalinien, qui
écrase la spontanéité morale au
nom d’une vérité d’État. Dans
les deux cas, c’est la même
chose qui est détruite : la part
humaine, irréductible, du
jugement moral personnel. «Ce refus
des catégories abstraites et des
masques idéologiques, cette
volonté de retrouver le visage
de notre commune humanité, même
dans ses incarnations les plus
singulières, les plus
déconcertantes ou les plus
odieuses, fondent l’humanisme
d’Orwell », écrit Simon
Leys.Thierry Gillybœuf
Ainsi parlait George Orwell
extraits de la préface, "La
vérité comme acte
révolutionnaire"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES
TROIS
NOUVEAUTÉS
DU
MOISEn
librairie le
jeudi 15 janvier
2026Distribution
Sodis –
Diffusion
Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bernard Shaw Les
Aventure
d'une jeune
fille noireTraduit
de l'anglais par
Antoine Lafarge Collection Le
Rouge & le NoirISBN
978-2-845-90401-9
– 128 pages –
14 €
|
|
|
|
Comme un roman
inédit de Conrad
avait inauguré
2025 pour la
collection
Le Rouge & le
Noir, 2026
s’ouvre par un
texte quasi
inconnu de
Bernard Shaw,
prix Nobel de
littérature
1925, aussi
génial et
provocateur que
son grand aîné
irlandais Oscar
Wilde.
Les
Aventures d’une
jeune fille
noire ont
paru à Londres
en 1932 Écrit
d’une traite
lors d’un séjour
de Shaw en
Afrique du Sud,
le livre est le
récit tendre et
ironique des
rencontres d’une
jeune fille
noire dans la
forêt africaine
: prophètes et
charlatans,
caravanes de
colons,
ermites., etc.
Cette drôlerie
n’est cependant
pas gratuite.
Shaw dénonce
toutes les
formes
d’obscurantisme
religieux, mais
livre aussi un
ardent plaidoyer
féministe et
antiraciste.
« Je
considère,
écrivait Shaw,
que la
morale actuelle
en matière de
relations
économiques et
sexuelles est
désastreusement
erronée, et je
considère avec
horreur
certaines
doctrines du
christianisme
tel qu’il
estaujourd’hui
compris. »Le
diagnostic reste
plus vrai que
jamais avec le
regain actuel
des
fondamentalismes.
L’ouvrage a
suscité un
véritable
scandale dans
les milieux
conservateurs et
religieux, et a
été même
interdit dans
l’État libre
d’Irlande. Ce
n’était
cependant pas la
première fois
que Shaw défiait
le conformisme
religieux et
moral du public.
Cette levée de
boucliers qu’ont
suscitée Les
Aventures de la
jeune fille
noire n’a
pas n’empêché
que ce grand
texte obtienne
un grand succès
tant en
Angleterre
qu’aux
États-Unis. Dès
1933, le livre
était traduit en
français par
Augustin et
Henriette Hamon,
traduction qui,
du fait de
l’antisémitisme
affiché du
traducteur, n’a
jamais été
rééditée. Ce
contretemps a
certainement
beaucoup nui à
la découverte en
France d’un
texte pourtant
particulièrement
représentatif de
l’esprit
généreux et
irrévérencieux
de Shaw.
La nouvelle a
été rééditée à
Londres en 1934
accompagnée d’un
court essai,
écrit à Ayot
St.Lawrence, le
village où Shaw
s’était retiré.
Nous présentons
ici la
traduction de ce
texte, révisé en
1946, convaincus
nous aussi,
quelques
décennies plus
tard, de «
l’importance
d’un tel message
dans la crise
mondiale
actuelle ».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
George OrwellAinsi
parlait George
OrwellDits
et maximes de
vie
Traduit de
l'anglais et
présenté par
Thierry
Gillybœuf
Bilingue
anglais-français
Collection
Ainsi parlaitISBN
978-2-845-90393-7
– 224 pages –
15 €
|
|
|
|
George Orwell
(1903-1950) est
certainement
l’un des
écrivains qui a
le mieux pensé
l’évolution des
sociétés
modernes. Ses
deux célèbres
romans
La Ferme des
animaux et
1984
dénoncent avec
une force
prophétique des
totalitarismes
nouveaux fondés
sur la
technologie et
la
désinformation.
Le succès
planétaire de
ces deux romans
fait trop
souvent oublier
qu’Orwell est
aussi l’auteur
de très nombreux
essais, articles
et lettres où
il a rendu
compte de ses
expériences
d’écrivain
engagé (enquêtes
sociales, guerre
d’Espagne)
développé une
profonde
réflexion sur
l’homme et sur
la société.
Au-delà de ces
deux célèbres
romans, Orwell a
mené à travers
de très nombreux
essais, articles
et lettres une
profonde
réflexion sur
l’homme et sur
la société.
« Le langage
politique,
écrit-il dans un
de ses essais
politiques,est
conçu pour
rendre les
mensonges
crédibles et le
meurtre
respectable.
»
Cet
Ainsi parlait
bilingue
anglais-français
permet d’avoir
une approche
d’ensemble d’une
œuvre lucide et
courageuse,
d’une extrême
actualité.
Thierry
Gillybœuf qui a
conçu et traduit
cet
Ainsi parlait
Orwell a
publié chez
Arfuyen
Ainsi parlait
Thoreau et
Ainsi parlait
Melville
et, dans le
domaine italien,
l’intégrale de
l’œuvre
d’Antonia Pozzi.
C’est Kellyanne
Conway,
conseillère de
Donald Trump,
qui a utilisé la
première
l’expression
« vérité
alternative ».
S’il y a
aujourd’hui un
écrivain à lire
pour lutter
contre cette
intoxication
répandue
aujourd’hui par
les politiques
et les médias,
c’est à coup sûr
Georges Orwell :
« Dire la vérité
dans un temps de
mensonge
universel,
écrivait-il,
est un acte
révolutionnaire.
» Orwell a
fait de la lutte
contre les
différentes
formes de
totalitarisme
une mission
primordiale.
La Ferme des
animaux et
1984 dénoncent
de manière
prophétique les
techniques de
manipulation et
l’écrasement de
l’individu de
nos
cyberdictatures.
Orwell considère
que la liberté
commence par la
fidélité aux
faits et la
clarté des mots.
Le concept de
« Novlangue »
qu’il introduit
dans
1984 montre
comment le
pouvoir peut
déformer la
réalité en
pervertissant
les mots : car
« si la pensée
corrompt le
langage, le
langage peut
aussi corrompre
la pensée. »
Par le courage
de ses
engagements et
par son
extraordinaire
lucidité, par
son indépendance
d’esprit et son
refus des
dogmes, Orwell
est un penseur
plus que jamais
nécessaire pour
apprendre à
penser librement
et à défendre
les fondements
de cette liberté
: «
Le véritable
ennemi, c’est
l’esprit réduit
à l’état de
gramophone. »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Michèle FinckL'arrière-silenceCollection Les
Cahiers
d'ArfuyenISBN
978-2-845-90402-6
– 224 pages –
18 €
|
|
|
|
|
|
|
Après
Balbuciendo
(2012),
La Troisième
main
(2015),
Connaissance par
les larmes
(2017),
Sur un piano de
paille
(2020) et
La Ballade des
hommes-nuages
(2022) et
La voie du
large (2024),
L’arrière-silence
est le septième
livre de Michèle
Finck que
publient les
Éditions
Arfuyen. Son
œuvre se
caractérise par
une rare
puissance et
intensité.
Rappelons que
La voie du large,
le sixième livre
de Michèle Finck
publié par les
éditions
Arfuyen, a
remporté en 2024
le prix
Apollinaire.
Leçons de
silence,
tel aurait pu
être le titre de
ce nouveau
livre. s’il
avait eu une
intention
démonstrative,
mais l’ambition
de Michèle Finck
est toute
différente. Il
ne s’agit ici
que de simples
témoignages
rapportés de
l’exploration de
ce tréfonds de
silence qui
veille en nous,
en-deçà de la
conscience et du
langage, « cette
rumeur
silencieuse
unique en chacun
de nous / qui
nous accompagne
toute une vie ».
Le terme« arrière-silence »
fait évidemment
penser à cet
« arrière-pays »
qui a donné son
titre au récit
autobiographique
publié par Y.
Bonnefoy en
1972. Mais le
pays qu’évoque
ici M. Finck est
une contrée
purement
intérieure :
«
arrière-silence
cette rumeur
silencieuse
unique en chacun
de nous / qui
nous accompagne
toute une vie en
s’accumulant
strates par
strates dans
l’arrière-crâne
/ c’est avec son
énigme que nous
passons notre
existence – et
peut-être notre
mort ».
Ce livre, comme
tous les
ouvrages de M.
Finck, est
soutenu par une
puissante
architecture en
sept mouvements
: « L’origine »
(prologue), «
Les muets », «
La femme », « A
cappella pour
les sans-voix »,
« Le chant des
choses », «
L’invention du
silence », « La
leçon de silence
», « Neige,
enfin «
Pianécrire »
(épilogue).
Professeur de
littérature
comparée à
l’université de
Strasbourg, M.
Finck est
l’autrice
d’ouvrages
essentiels sur
la poésie
contemporaine.
Pour Arfuyen,
elle a traduit
Trakl et son
père, Adrien
Finck.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TROIS
LIVRESÀ
REDÉCOUVRIRDistribution
Sodis –
Diffusion
Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joseph Conrad et
Ford Madox FordLes
Héritiers du
monde
Traduit de
l'anglais par
Paul
Decottignies
Collection
Le Rouge & le
NoirISBN
978-2-845-90304-3 –
168 pages –
16 €
|
|
|
|
Roman totalement
inédit en
français,
Les Héritiers du
monde (The
Inheritors) a
paru en
1901,juste après
deux des
chefs-d’œuvre de
Conrad,
Au cœur des
ténèbres
(1899) et
Lord Jim
(1900).
Ce récit
prophétique et
haletant dénonce
les techniques
de
désinformation
et de
manipulation
qui, d’un
populisme à
l’autre, ne
cessent de
menacer les
démocraties.
Avec une
étonnante
maestria, Conrad
et Ford tissent
une intrigue à
trois niveaux :
un financier
philanthrope et
mégalomane mène
une campagne
inter-nationale
pour exploiter
les ressources
du Groenland ;
un noyau
d’activistes
cherche à
compromettre le
gouver-nement
britannique pour
discréditer sa
«politique de la
raison » ;
par un subtil
jeu d’échecs,
une femme
fascinante et
cynique les
manœuvre tous à
ses propres
fins.
Qui sont ces
« Héritiers du
monde »,
dont elle se
revendique ?
« Nous sommes
l’Inévitable,
affirme-t-elle,
et vous ne
pouvez rien
contre nous. »
Le plus étonnant
dans ce roman,
c’est que cette
histoire qui
ressemble à La
Guerre des
mondes (H.
G. Wells était
un ami de
Conrad) ou à une
dystopie sur les
cyberdictatures,
se fonde sur la
situation du
Congo belge,
riche en or,
pétrole et
autres
ressources, tel
que Conrad l’a
découvert
lorsqu’il y a
été embauché
comme capitaine
de steamer en
1890.
Le personnage
central des
Héritiers du
monde, est
fortement
inspiré du roi
Leopold II,
sorte de
philanthrope
mégalomane qui
pillait sans
scrupule cette
terre devenue
son bien
personnel. Le
Groenland du
roman transpose
ces souvenirs du
Congo. Exploiter
les richesses du
Groenland en
jouant entre les
grandes
puissances,
est-ce un hasard
si c’est le
thème de la
quatrième saison
de la fameuse
série danoise Borgen ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Ainsi
parlait Georges
Bernanos Dits
et maximes de
vie
Textes choisis
et présentés par
Gérard BocholierCollection
Ainsi
parlaitISBN
978-2-845-90209-3
– 152 pages
– 14 €
|
|
|
|
|
|
|
Aussi laïque que
Bernanos était
chrétien, Camus
lui a rendu le
plus juste
hommage :
Bernanos,
écrit-il,
« mérite le
respect et la
gratitude de
tous les hommes
libres. » C’est
en cela, en
effet, que son
œuvre dépasse
les modes et les
étiquettes.
Bernanos est
aujourd’hui à la
mode. Longtemps
relégué parmi
les dinosaures,
le voici devenu
référence de nos
intellectuels,
comme Bloy ou
Péguy. Son style
brillant, sa
pensée
anticonformiste
nous le rendent
indispensable
face à un monde
de plus en plus
étouffant.
Bernanos est
inclassable dans
la littérature
française. Il
faudrait le
comparer
seulement à
George Orwell
(1903-1950) :
comme l’auteur
de
1984, celui
de
La France contre
les robots
est plus qu’un
écrivain : un
mélange de
journaliste et
de prophète, un
témoin de la
dignité de
l’homme face à
toutes les
tyrannies et
toutes les
lâchetés.
Gérard
Bocholier, poète
et essayiste,
nous fait
partager son
admiration pour
le meilleur
Bernanos. En
épigraphe de sa
préface, il cite
cette phrase
révélatrice de
Bernanos :
« Qu’importe ma
vie ! Je veux
seulement
qu’elle reste
jusqu’au bout
fidèle à
l’enfant que je
fus. »
D’instinct
Bernanos déteste
les postes, les
fonctions, les
honneurs. Tout
cela qui ne peut
que nous
tromper. Nous ne
sommes pas faits
pour ça. Vivre
est une
aventure, pas
une boutique.
Avant que
l’argent ne
prenne le
pouvoir en
toutes choses,
les hommes le
savaient bien :
« C’étaient des
gens qui
savaient vivre,
et s’ils
sentaient un peu
fort la pipe ou
la prise, ils ne
puaient pas la
boutique, ils
n’avaient pas
ces têtes de
boutiquiers, de
sacristains,
d’huissiers, des
têtes qui ont
l’air d’avoir
poussé dans les
caves. »
Bernanos n’a pas
de mots assez
durs pour ceux
qu’il nomme les
« réalistes »
ou les
« cyniques »,
tous ceux qui
apportent leur
consentement ou
leur soumission
au
«conformisme
universel,
anonyme ». Bernanos
dénonce les
ruses de ce type
nouveau d’homme
égoïste,
logicien,
hypocrite, ne
vivant que pour
le profit et la
jouissance. D’où
aussi, sur le
fond, sa rupture
avec Maurras,
dont l’esprit
lui paraît
« absolument
dépourvu,
dépouillé,
destitué de
toute charité ».
Polémiste,
Bernanos ?
Certes il
admirait Bloy et
sa plume était
vive. Mais il
détestait ce
terme. Bien
plutôt un
« combattant de
l’Esprit »,
n’écrivant que
pour se
justifier
« aux yeux de
l’enfant »
qu’il fut et qui
ne veut pas
mourir
« sans témoigner
», qui va
« jusqu’au bout
du vrai, quels
qu’en soient les
risques ».
|
|
|
|
|
|
|
Georg TraklLes
Chants de
l'Enténébré
Traduit de
l'allemand et
présenté par
Mchèle Finck
Bilingue
allemand-français
Collection
Neige
ISBN
978-2-845-90307-4
– 138 pages –
15 €
|
|
|
|
Comme l’Allemand
Novalis
(1772-1801),
comme l’Anglais
Keats
(1795-1821),
comme l’Italien
Leopardi
(1798-1837),
comme le
Français Rimbaud
(1854-1891),
l’Autrichien
Georg Trakl
(1887-1914) est
un des grands
météores de la
littérature
européenne. De
la génération
qui suit celle
de Hofmannsthal
(1874) et Rilke
(1875), Trakl
incarne une
révolte
viscérale face
aux valeurs de
la grande
bourgeoisie
autrichienne et
du classicisme
goethéen.
Durement marquée
par l’expérience
de la drogue, de
l’inceste, de la
démence et de la
guerre, son
œuvre annonce
toutes les
transgressions
et les
souffrances du
siècle à venir.
Son internement
psychiatrique au
lendemain de la
bataille de
Grodek et sa
mort mystérieuse
ajoutent à sa
légende pour en
faire une image
exemplaire du
poète moderne et
le précurseur du
grand poète
allemand d’après
la catastrophe,
Paul Celan.
Rimbaud cesse
d’écrire avant
trente ans,
Trakl meurt à
vingt-sept ans
en 1914 et sa
période dite de
« maturité »
n’aura également
duré que quatre
ans (1910-1914).
Comme celui de
Rimbaud, le
parcours
poétique de
Trakl est menacé
par la folie :
« Aucun des
sophismes de la
folie, – la
folie qu’on
enferme – n’a
été oublié par
moi »,
écrit Rimbaud.
C’est cette même
démence qui
« enténèbre »
l’œuvre de
Trakl. Mais
alors que
Rimbaud,
prophète solaire
et exalté,
travaille à
l’échelle de
« l’immensité de
l’univers »
et de tous les
hommes, Trakl,
l’ermite
nocturne, ne
conçoit qu’une
harmonie
transmissible à
quelques «
séparés »
L’hostilité de
Trakl envers le
classicisme
bourgeois de
Goethe contraste
avec son
admiration pour
Novalis, qui
apparaît comme
son double
bienheureux.
Mais, plus
encore que
Novalis,
l’interlocuteur
majeur de Trakl
est Hölderlin,
qui incarne la
figure du
« poète fou »,
devenu étranger
à une réalité
extérieure sans
emprise sur lui.
Rilke disait
avoir
« beaucoup
fréquenté, avec
la plus grande
émotion, la
poésie de Georg
Trakl. »
Mais il
s’interrogeait
aussi :
« Qui donc
pouvait-il être
? » C’est à
cette question
que Michèle
Finck s’efforce
de répondre en
traduisant ses
poèmes les plus
significatifs et
en méditant sur
cette
« œuvre-destin
». Trakl
appelait Rimbaud
son
« frère à la
plainte violente
» et
Hölderlin, son
« frère » au
« chant doux ». Dans
ces
Chants de
l’Enténébré,
le poète nous
donne à entendre
une matière
sonore
entièrement
nouvelle, voix
de notre
modernité en
détresse.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 janvier 2026
Ainsi parlait Platon,
d’Emmanuel Pasquier, par
Philippe Barthelet (Valeurs
actuelles)
6 janvier
2026
Le
Rêve de Dostoievski, de
Cécile A. Holdban, lu par
Pierrick de Chermont (Recours au
poème)
5 janvier 2026
Journal d’une planète minuscule,
d’Agnès Clerc, lu par Marie
Étienne (EaN – En attendant
Nadeau)
Janvier
2026
Ainsi parlait Barbey d’Aurevilly,
de Philippe Simon, lu par Thomas
Penguilly (Bulletin de la
Société Barbey d’Aurevilly)
Décembre 2025 – février 2026
Ainsi parlait Barbey d’Aurevilly,
de Philippe Simon, lu par Claude
Cornu (Études normandes)
23 décembre 2025
ARFUYEN, UN TRAVAIL D’ORFÈVRE,
par la rédaction d’En
attendant Nadeau
23
décembre 2025
Le 50e annversaire d’Arfuyen,
par Alain Roussel (EaN)
23
décembre 2025
Le Message réisophique, de
Laurent Albarracin, par
Jean-Marie Perret (EaN)
23
décembre 2025
La Voix de l’érable. Opus
incertum VII, de Roger
Munier, par Chistian Doumet (EaN)
23
décembre 2025
Un déjeuner en montagne, de
Gérard Pfister, par Alain
Roussel (EaN)
23
décembre 2025
Un fabuleux silence. Journal de
poésie 1933-1938, d’Antonia
Pozzi, lu par Hélène Fresnel (EaN)
23
décembre 2025
Ce qui écoute en nous et
Sur le seuil invisible,
d’Alain Suied, lu par Christian
Travaux (EaN)
23
décembre 2025
L’Œuvre poétique. I. Le code de
la nuit et II. Tout le soleil
durant, de Dylan Thomas, lu
par Mathieu Jung (EaN)
12
décembre 2025
La Parole, de Malcolm de
Chazal, lu par Marc Wetzel (La
Cause littéraire)
|
|
|
|
|
Retour
2025
Retour
|
Lettre de nouvelles : décembre 2025
|
|
|
|
Avec les éditions Jas sauvages,
cultivons la foi spirituelle ou
humaniste, dans tous ses
dialogues! |
| |
|
|
|
|
|
Si vous voulez prendre en relais
l'action des éditions Jas sauvages,
pensez à transférer cette lettre de
nouvelles à vos connaissances qui
pourraient être intéressées. Merci
d'avance!
|
|
|
|
OFFRIR DES LIVRES, OFFRIR L'ESPRIT, POUR
NOËL!
|
|
|
|
TOUS LES LIVRES DES ÉDITIONS JAS
SAUVAGES CONSTITUENT DE TRÈS BEAUX
CADEAUX DE NOËL!
|
|
|
|
DEUX ÉTUDES BIBLIQUES À
MARSEILLE SUD-EST, avec
Jacqueline Assaël |
|
SUR LE THÈME: La filiation dans
la Bible: 6 décembre 14h-17h,
l'épisode du sacrifice d'Isaac,
dans la Genèse. 10 janvier:
étude de l'épître à Philémon
dans le Nouveau Testament.
Ouvrage de référence: Nouaison,
suivi de Genèse et Nouaison,
paru dans la collection
"Prièmes".
|
|
|
|
|
|
EN JANVIER, UNE RENCONTRE POÉSIE
DE LA FOI À VENCE, avec Yves
Ughes |
|
Une rencontre de poésie
œcuménique dans le cadre de la
semaine pour l'Unité des
chrétiens |
|
|
|
|
|
EN FÉVRIER, JACQUELINE WOSINSKI
VIENDRA PRÉSENTER SON RECUEIL
"SOUS L'ARCHE D'EUCALYPTUS" À
MARSEILLE |
|
puis nous irons ultérieurement
en parler aussi à Gap. Un texte
très puissant sur le génocide
rwandais, le redressement d'un
peuple et les méthodes de soins
des traumatismes psychologiques
créés par de tels événements.
|
|
|
|
|
|
L'AGENDA DES ÉDITIONS JAS
SAUVAGES EST CHARGÉ! |
|
Venez nous retrouver! Vous
pouvez aussi nous inviter chez
vous pour un partage poétique ou
un partage de réflexion! |
|
|
|
|
|

Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
Vers un nouveau demi-siècle
Pour leur 50e
anniversaire, les éditions
Arfuyen ont publié cette année
un ensemble d’ouvrages
particulièrement riche et varié.
La nouvelle collection « Le
Rouge & le Noir », consacrée aux
romans et aux nouvelles, y a
pris une place importante, avec
six nouveautés.
À
compter du 1er
janvier 2026, le Comité
éditorial s’élargira à deux
nouveaux membres : Anne et
Gérard Pfister seront rejoints
par Cécile A. Holdban et Thierry
Gillybœuf, avec qui les Éditions
ont déjà établi depuis de
longues années une excellente
collaboration dans de nombreuses
collections. Dès le 1er
janvier 2027, ils assureront la
direction des deux collections
consacrées à la poésie française
(« Les Cahiers d’Arfuyen ») et à
la poésie étrangère bilingue («
Neige »). Ils reprendront de
même, dans le cours des années
suivantes, la responsabilité des
autres collections.
Nous nous réjouissons que, grâce
à eux, les Éditions
s’enrichissent de compétences et
de sensibilités nouvelles et
puissent entrer dans leur
deuxième demi-siècle avec des
atouts renforcés. Car, il ne
faut pas se le cacher, la
situation de l’édition
littéraire est de plus en plus
difficile tant du fait de
l’évolution du lectorat que de
la surproduction chronique de
nouveautés. Dans ce paysage, les
petites structures, moins
rigides et moins coûteuses,
disposent paradoxalement d’un
certain avantage concurrentiel,
pourvu qu’elles parviennent à
disposer d’un large catalogue
et d’une image de qualité.
La cause n’est donc pas perdue
et mérite de toutes façons qu’on
se batte pour la défendre. On ne
peut imaginer que les plus
grandes œuvres sur lesquelles se
sont construites notre culture
et notre sensibilité cessent
totalement d’être lues pour se
trouver reléguées au magasin des
antiquités, pour le seul usage
de l’Université. C’est pourtant
bien ce qui est en train de se
passer. Qui lit aujourd’hui
Platon, Shakespeare, Pascal ou
Goethe ? La collection « Ainsi
parlait » a été créée pour que
les plus grands écrivains et
penseurs de notre patrimoine
puissent continuer de nous
nourrir.
Car, si ces œuvres qui sont les
fondations mêmes de notre
littérature, ne sont plus lues,
il y a fort à craindre que, sans
que nous y prenions garde,
celle-ci ne soit rapidement
remplacée par la « fast
literature ». N’est-ce pas déjà
en vérité ce à quoi nous
assistons? D’un côté, une
industrie en quête de forts
tirages commercialise à grand
renfort de marketing des sortes
de « burgers » littéraires
riches en graisse et pauvres en
vitamines. De l’autre, des
auteurs en peine de
reconnaissance multiplient
jusqu’à l’absurde des genres de
« selfies » littéraires
dépourvus de toute véritable
écriture, oubliant qu’à 14 ans
Rimbaud le « voyant », le «
rebelle », était aussi capable
de remporter le premier prix de
vers latins au Concours
académique.
Nous consacrons cette dernière
lettre de l'année à présenter
les vingt nouveautés que nous
avons publiées en 2025. Les
fêtes de fin d'année sont
l'occasion d'offrir des livres,
et nous espérons que vous
trouverez dans cette liste – ou
plus largement sur notre site
editionsarfuyen.com – de
bonnes idées. Nos livres sont
distribués par Sodis-Gallimard
et peuvent donc être facilement
trouvés, ou commandés, en
librairie.
Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année et une
heureuse année nouvelle,
entourée d’excellents livres.
|
|
|
|
|
LES 20 LIVRES
PARUS EN 2025
Distribution
SODIS-Gallimard
|
|
|
|
|
|
|
LITTÉRATURES
« Le Rouge & le Noir »Romans
et nouvelles Joseph
CONRAD et Ford Madox FORD, Les
Héritiers du monde.
Trad. par Paul Decottignies.
Ilarie VORONCA,
Souvenirs de la planète
Terre.
Préface de Nicolas CavaillèsFumiko
HAYASHI,
Une femme célèbre.
Traduit du japonais par René de
Ceccatty
Jack LONDON,
L'Étrange Expérience d'un
misogyne.
Traduit de l'anglais par Antoine
Lafarge Agnès
CLERC,
Journal d'une planète
minuscule.
Préface de René de Ceccatty
Elizabeth von ARNIM,
L'Éclatante Beauté de Sally.
Traduit de l'anglais par Paul
Decottignies
«
Les Vies imaginaires »Textes
autobiographiques
Natalie
BAUER-LECHNER,
Conversations avec Gustav
Mahler.
Traduit de l'allemand par Gérard
Pfister. Préface de Mathieu
SchneiderAdrien
FINCK,
L'Homme sans langue, suivi
de Résistance par la langue.
Traduit de l'allemand et de
l'alsacien par Angèle et Michèle
Finck. PRIX NATHAN-KATZ DU
PATRIMOINE 2025 Malcolm
de CHAZAL,
La Parole. Textes
inédit présenté par Yves Moatty
POÉSIES
«
Les Cahiers
d'Arfuyen »
Poésie française Pierre
DHAINAUT, Et
pourtant suivi de Ajouter
du noir, ou non et de Ce
qui doit venir Roger
MUNIER, La
Voix de l'érable. Opus incertum
VII.
Mars 1995 – septembre 1997
Laurent
LALBARRACIN, Le
Message réisophique
Cécile A. HOLDBAN,
Le Rêve de Dostoïevski
Gérard PFISTER, Un
déjeuner en montagne, suivi
de Le pur plaisir d'exister «
Neige »Poésie
étrangère (bilingue) Dylan
THOMAS,
L'Œuvre poétique II. Tout le
soleil durant
Traduit de l’américain et
présenté par Hoa Hôï Vuong.
Bilingue. PRIX NELLY SACHS 2025
SCIENCES HUMAINES
« Ainsi parlait »Dits
et maximes de vieCOLETTE, Ainsi
parlait Colette. Lu
et présenté par Gérard Pfister
GOETHE, Ainsi
parlait Goethe. Traduit
de l'allemand et présenté par
Roland Krebs. Bilingue Jules
BARBEY D'AUREVILLY, Ainsi
parlait Barbey d'Aurevilly. Lu
et présenté par Yves LeclairPLATON, Ainsi
parlait Platon.
Traduit du grec et présenté par
Emmanuel Pasquier. Bilingue
SPIRITUALITÉS «
Ombre » Grands
textes de spiritualitéL'AMI
DE DIEU DE L'OBERLAND,
Lettres aux Amis de l'Île-Verte.
Traduit du moyen haut-allemand
par Jean Moncelon et Heidi
Schäfer
|
|
|
|
|
REVUE DE PRESSEpour
les articles de
revues
numériques,cliquer
sur les liens
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
12 décembre 2025
La Parole,
de Malcolm de
Chazal, lu par
Marc Wetzel (La
Cause
littéraire)
11 décembre
2025
Un déjeuner en
montagne,
de Gérard
Pfister, lu par
Veneranda
paladino (DNA-Dernières
Nouvelles
d’Alsace)
1er décembre
2025
L’Éclatante
Beauté de Sally,
d’Elizabeth von
Arnim, lu par
Marc Wetzel (Poesibao)
1er décembre
2025
Lettres aux amis
de l’Île-Verte,
de l’Ami de Dieu
de l’Oberland,
lu par Marc
Wetzel (Sitaudis)
Décembree 2025
La Voix de
l’érable. Opus
incertum VII,
de Roger Munier,
lu par Yves
Leclair (Études)
27 novembre
2025
L’Éclatante
Beauté de Sally,
d’Elizabeth von
Arnim, lu par
Françoise
Urban-Menninger
(e-litterature.net)
22 novembre
2025
L’Éclatante
Beauté de Sally,
d’Elizabeth von
Arnim, lu par
Patrick Corneau
(Le Lorgnon
mélancolique)
20 novembre
2025
Ainsi parlait
Platon,
d’Emmanuel
Pasquier, lu par
Marc Wetzel (La
Cause
littéraire)
17 novembre
2025
Un repas en
montagne,
de Gérard
Pfister, lu par
Pierre Tanguy
(Des sources et
des livres)
8 novembre 2025
La Parole,
de Malcolm de
Chazal, lu par
Antoine Jockey
(Al Majalla,
Londres)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retour
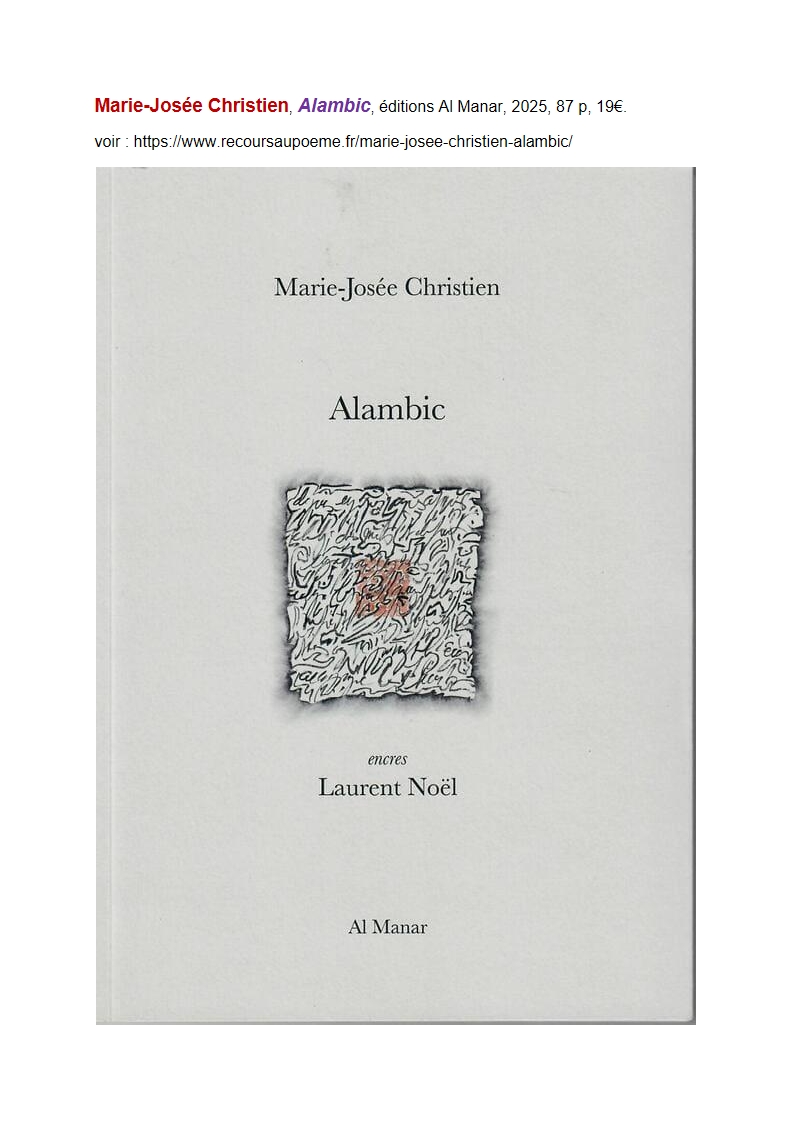
Retour

Retour
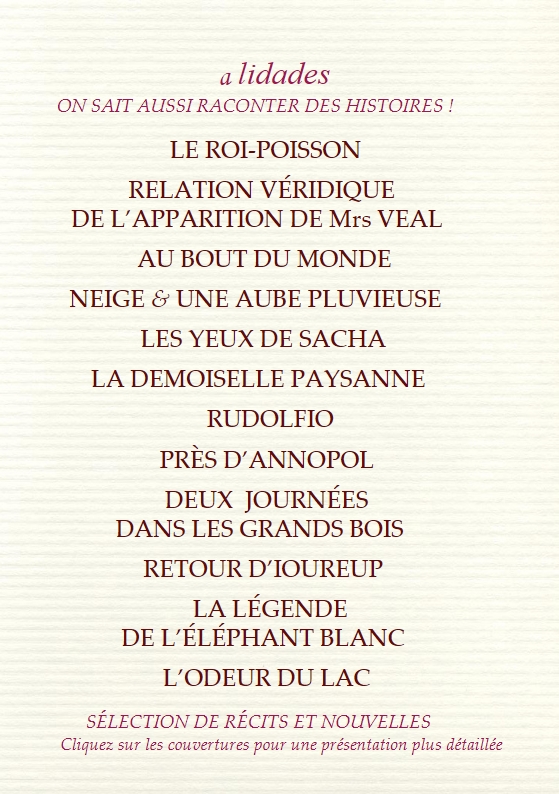

Retour
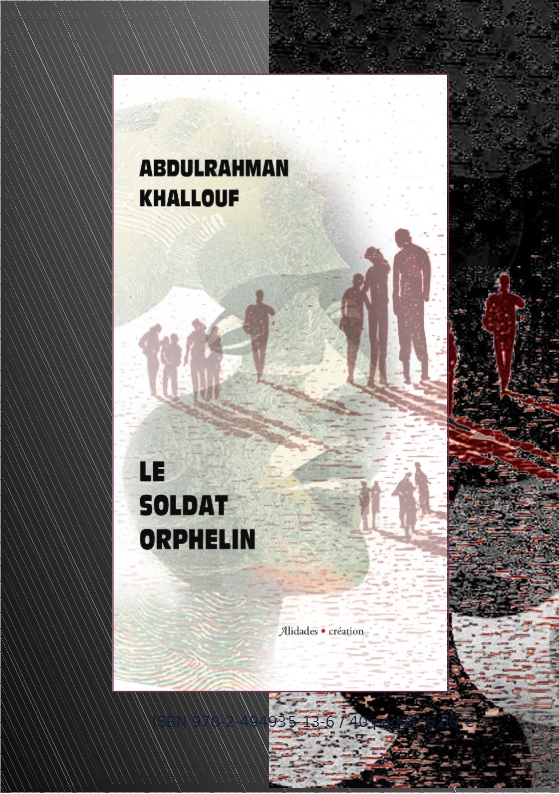

Retour
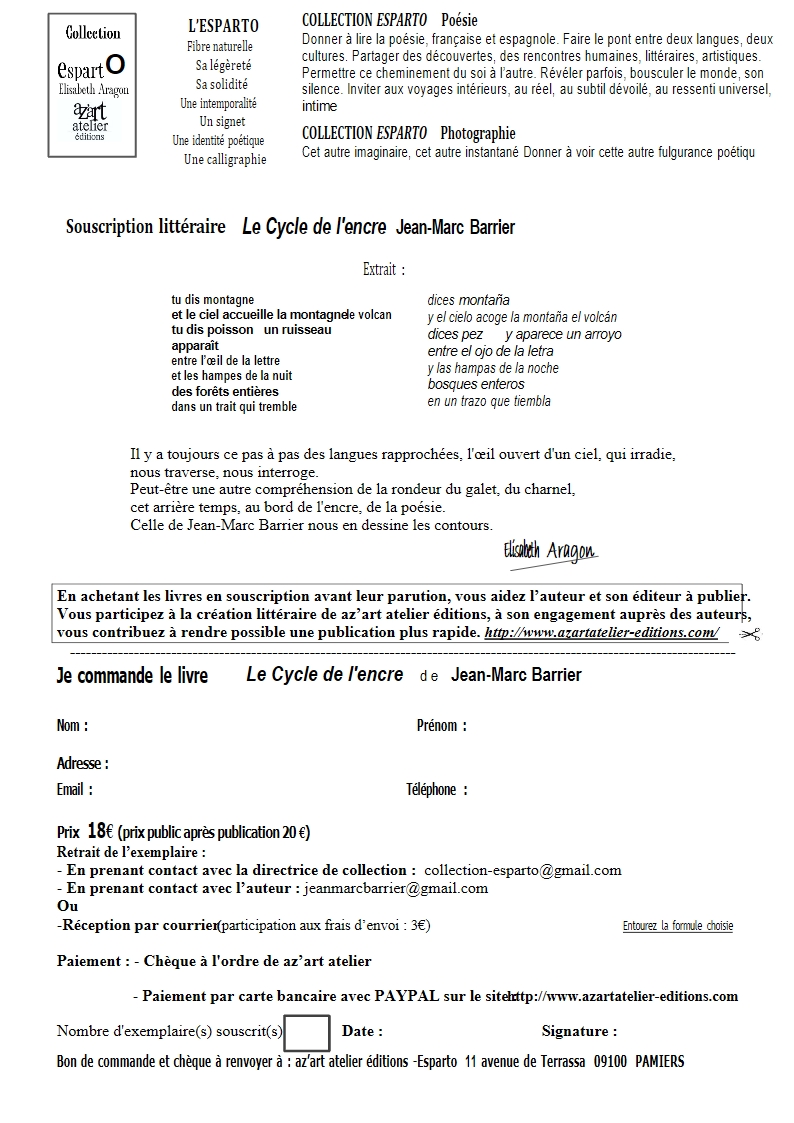
Retour
Le Prix Aliénor 2025
a été décerné
à Jacqueline
Saint-Jean
pour ce recueil
qui fera l'objet d'une prochaine émission
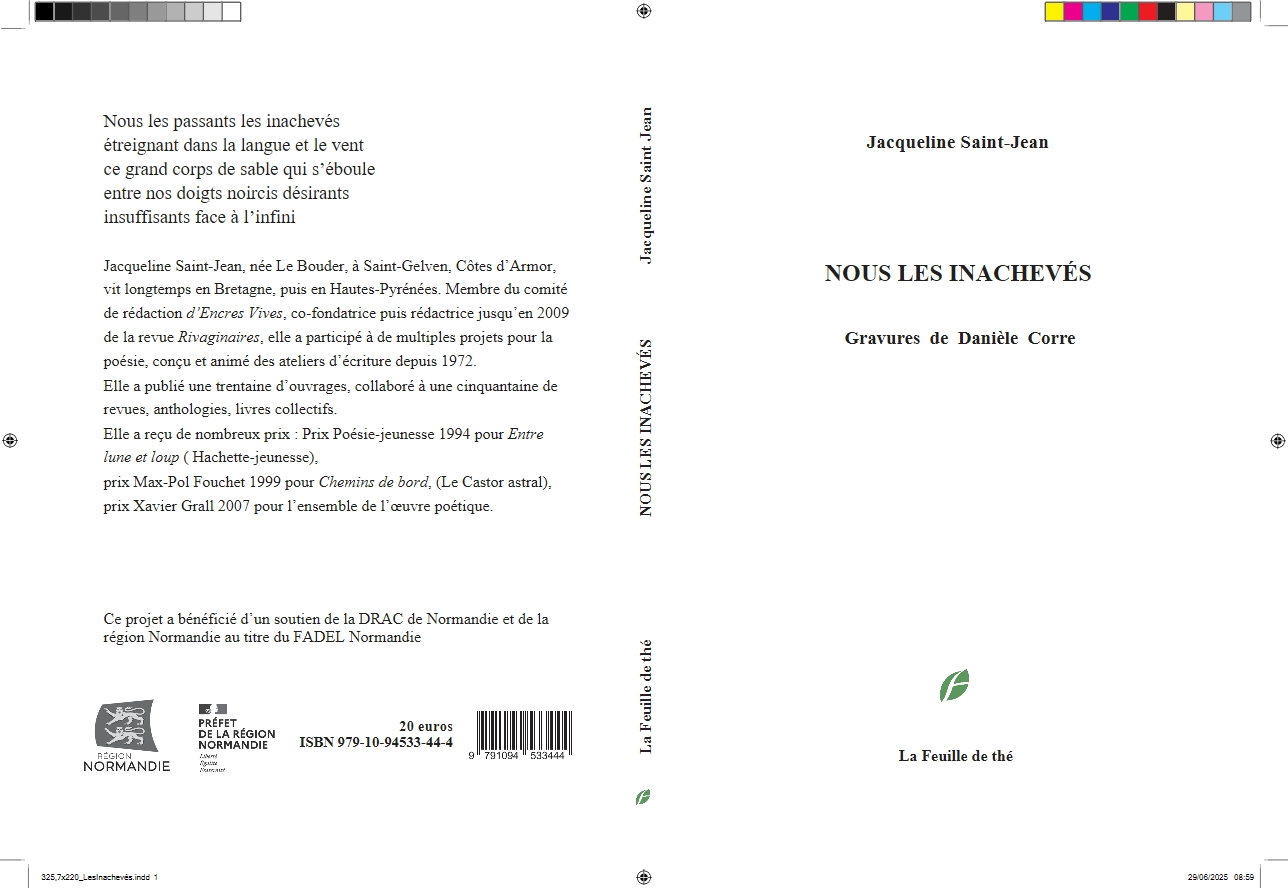
Retour
Les Clairières
souterraines
de Jean-Gilles Badaire,
Fata morgana éditeur, 2025
Merveilleux petits livres que ceux de Jean-Gilles Badaire.
Ils sont
véritablement des copeaux d'enfance,
menuisés de main de
maître. Voici le tout dernier,
Les clairières
souterraines,
paru comme de
coutume, chez fata morgana.
Admirable
couverture, accompagnée de dessins à l'intérieur.
Joël
Vernet
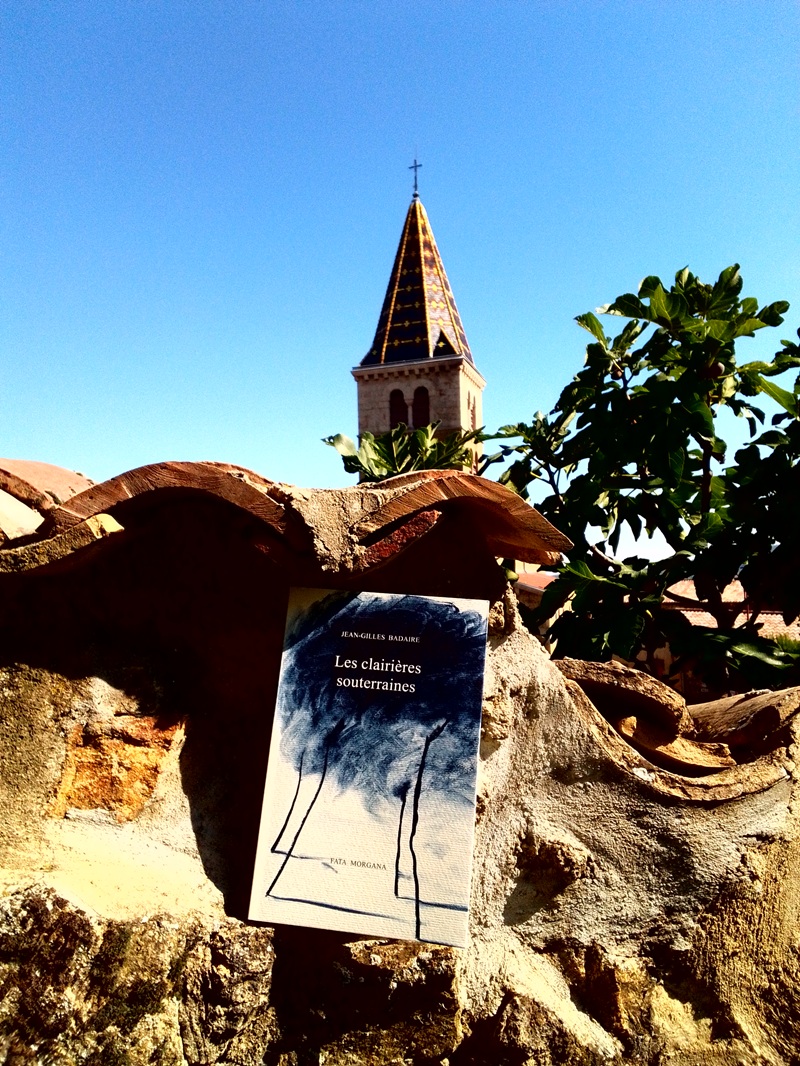
Retour

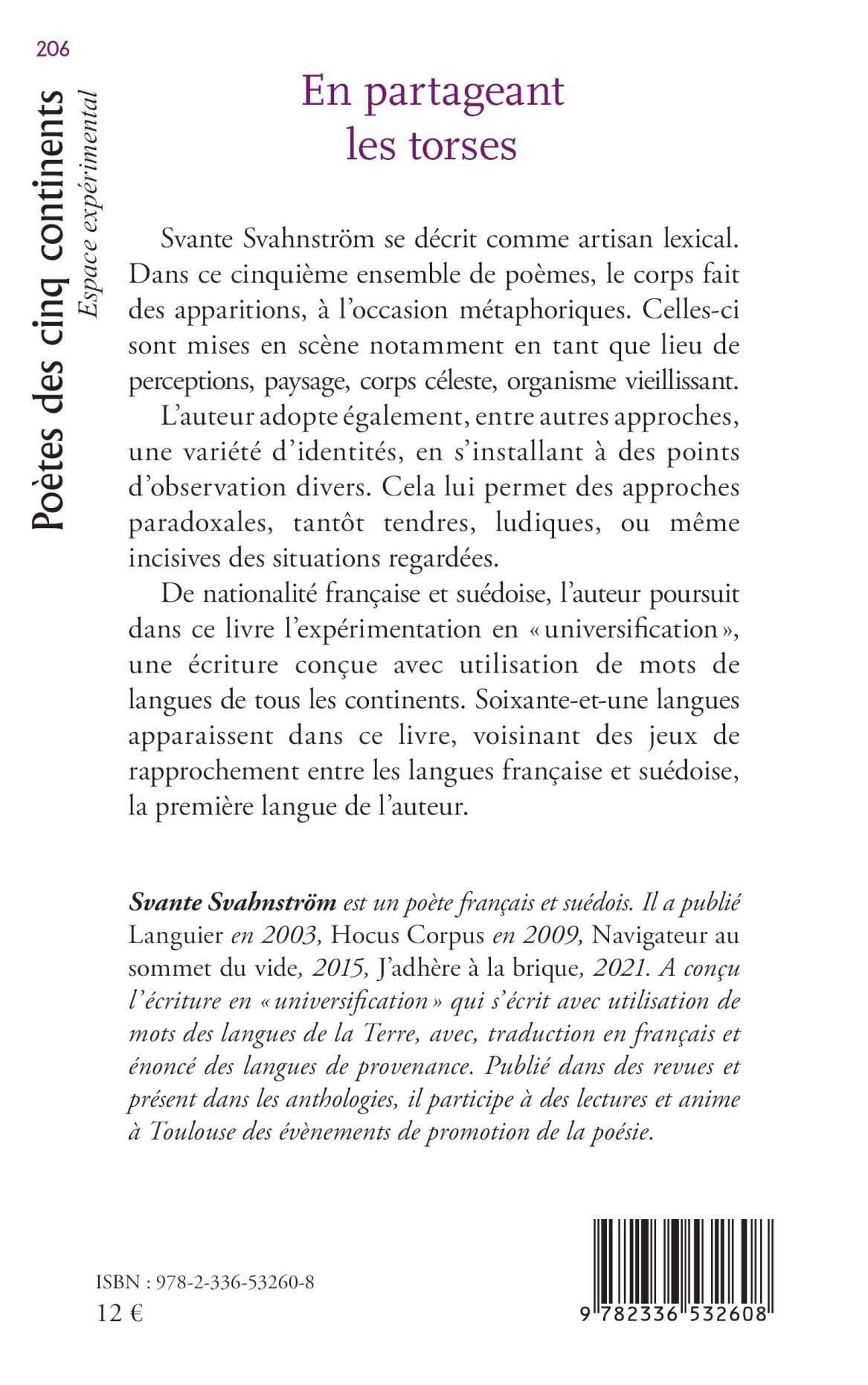
Retour
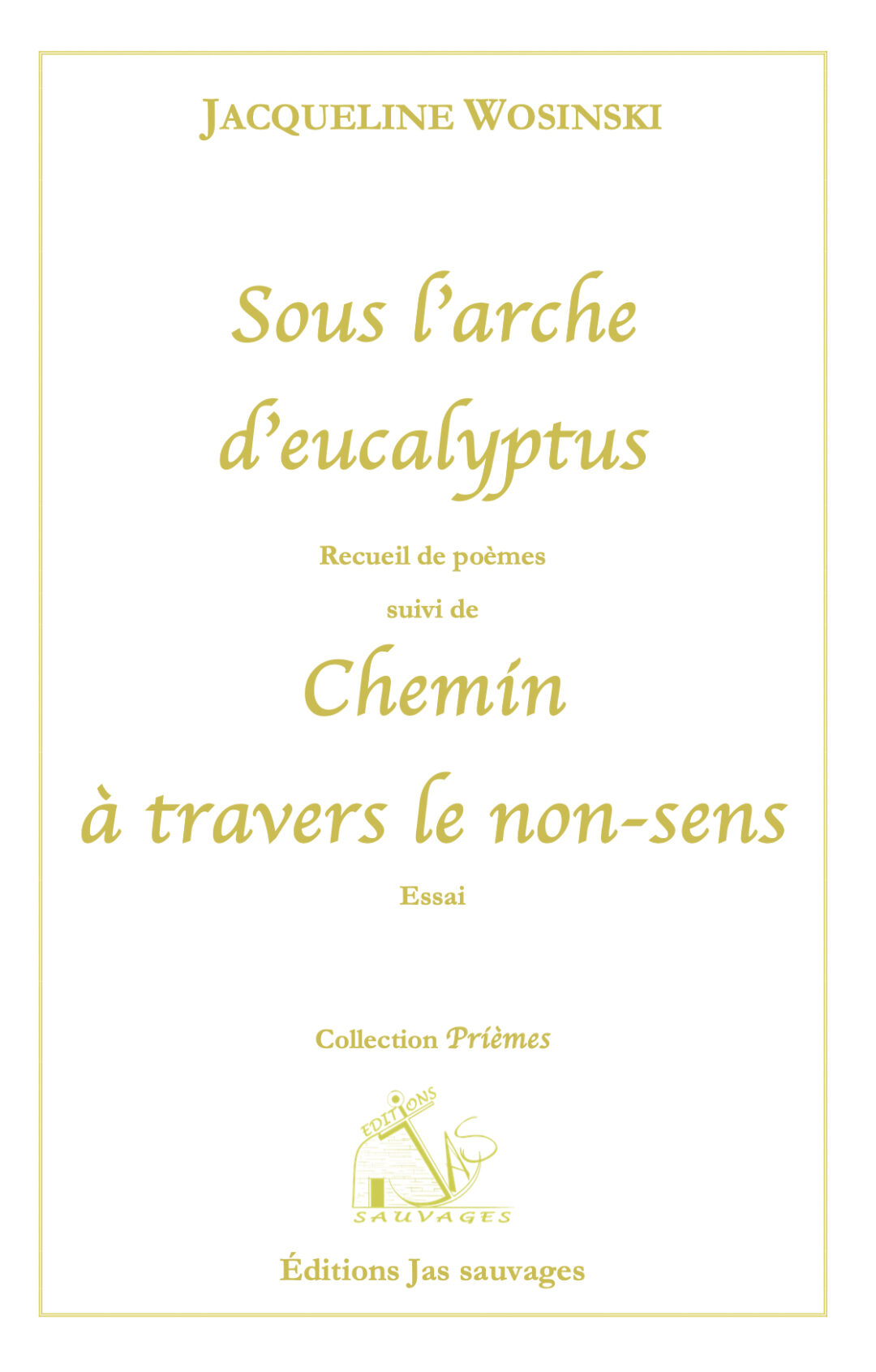
|
Un recueil de poésie et une réflexion, à la suite du
génocide rwandais |
|
« Nous venions de célébrer Pâques. Il me semblait que la
mort du Christ et celle des Tutsi participaient de la
même pulsion destructrice », écrit Jacqueline Wosinski.
Son recueil constitue à la fois un mémorial pour
entretenir le souvenir des êtres chers massacrés, une
réflexion sur les gouffres dans lesquels l’humanité
s’abîme, et une manière de « conjurer l’insensibilité,
prodrome de notre propre mort ». À la recherche de
pistes d’avenir, sa poésie dénonce, témoigne, avec une
force très maîtrisée, lucide, qui cherche à guérir.
|
|
|
|
|
Retour
revue Rumeurs
n°14-15
Juin 2025, Actualité des écritures, est consacrée
à 28 poétesses et poètes d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine,
de Croatie,
du Kosovo, de Macédoine du Nord, du Monténégro, de Serbie et de Slovénie.
Le poète
Joël VERNET
nous communique :
Je me permets de vous écrire au nom des Éditions de La
rumeur libre dont le dernier numéro de la revue Rumeurs
n°14-15 Juin 2025,
Actualité des écritures, dont j’ai assuré la coordination, est
consacrée à 28 poétesses et poètes d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine,
de Croatie, du Kosovo, de Macédoine du Nord, du Monténégro, de Serbie et
de Slovénie.
Ce numéro n’a pas la prétention d’être exhaustif, mais il est un pas
pour faire entendre de fortes voix contemporaines et poétiques, issues
de ces huit États. Ce numéro est riche de ces diversités, de ces
polyphonies.
Un accent est mis aussi sur les traductrices et traducteurs sans
lesquels ce numéro n’aurait pu voir le jour.
Il est aussi accompagné de photographies prises au fil du temps par
l’écrivain et éditeur Jean de Breyne qui a consacré sa vie à la
création, animant la belle édition de l’Ollave avec sa compagne Martina
Kramer, où ils ont créé le Domaine Croate/Poésie. Quelques photographies
apparaissant dans ce numéro ont été prises par moi-même au cours de
voyages au long cours.
Cette idée d’un N° spécial de la revue Rumeurs est née de rencontres, de
hasards et, nous le savons, beaucoup reste à faire pour tenter de
dresser un panorama poétique exemplaire.
Je m’adresse à vous, car d’une façon ou d’une autre, vous êtes
attentives et attentifs à la publication, à l’édition, à la poésie, à la
culture en général. Si vous pouvez nous aider à la diffusion de ce
numéro spécial, une étape nouvelle sera franchie.
Joël Vernet
Ici, le lien pour découvrir ce Numéro
spécial :
https://www.larumeurlibre.fr/catalogue/collections_la_rumeur_libre/revue_rumeurs/revue_rumeurs_n_14_15_juin_2025_rumeurs_revue_actualite_des_ecritures
Retour
|
Le photographe Olivier
Roller, collaborateur de longue date du Matricule des
Anges, entre autres, a constitué au fil des années
une vaste collection de portraits d’écrivains. Il en a
tiré une série de diptyques, obtenus en rapprochant deux
portraits du même auteur photographié à environ vingt
ans d’intervalle – parfois beaucoup plus. Secousse
leur a demandé de réagir à ces deux images d’eux-mêmes –
au passage du temps – au moyen d’un texte de nature
(réflexion, souvenirs, fiction, poème, imprécation) et
de format libres. |
Double
portraits par Olivier Roller et textes de :Frédéric
Beigbeder, Pierre Bergounioux, Arno Bertina, Stéphane
Bouquet,Gérard Cartier,
Marcel Cohen,
Pascal Commère, Marie Darrieussecq,Camille de Peretti,
Christian Doumet, Jean-Michel Espitallier, Marie
Étienne,Dominique Fabre, Philippe Forest, Sylvie Germain,
Victor Hugo,Régis Jauffret, Hédi Kaddour,
Cécile
Ladjali, Marie-Hélène Lafon,Mathieu Larnaudie, Pierre Michon,
Richard Morgièvre, Gilles Ortlieb,Benoît Peeters, Mazarine
Pingeot, Christian Prigent, Fabienne Raphoz,Catherine
Robbe-Grillet, Olivier Roller, Valérie Rouzeau, Martin
Rueff,Hélène Sanguinetti, Michel Zink.
Retour
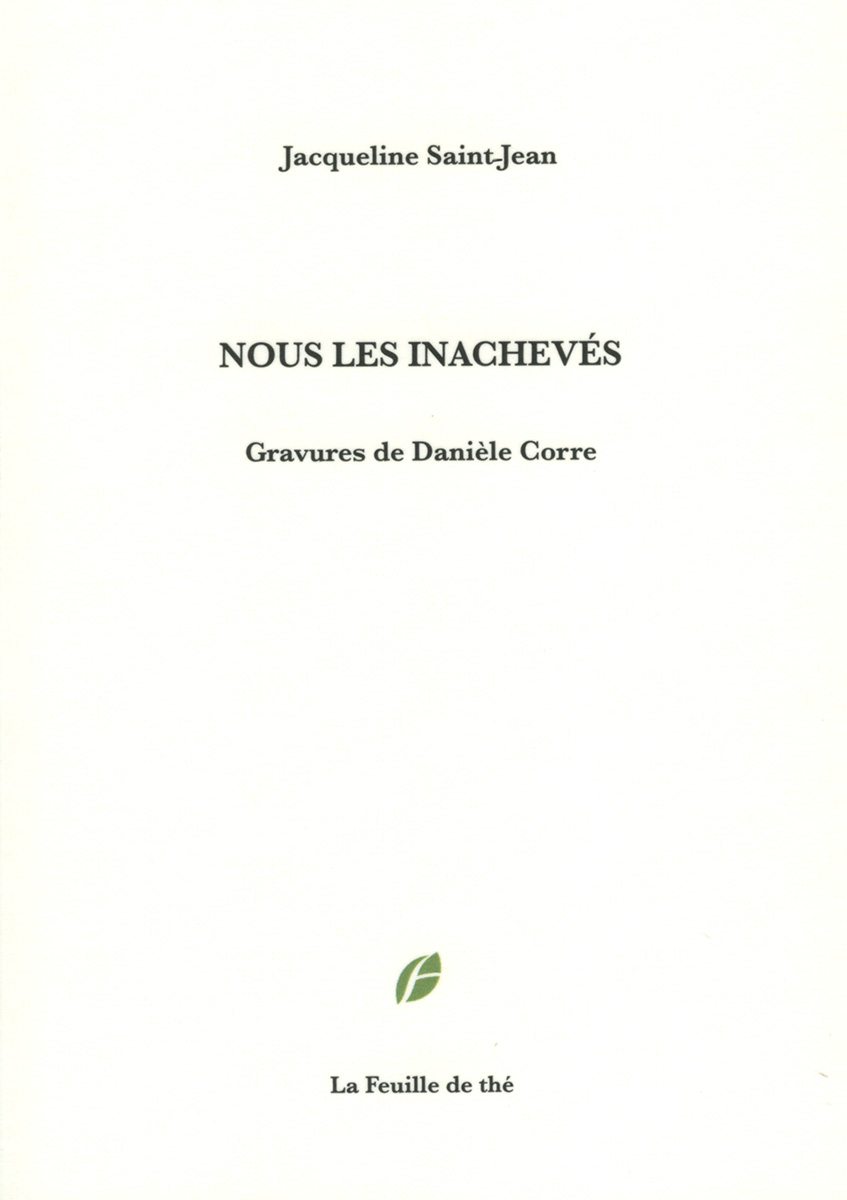
Retour
La douzième livraison de la revue
Des PAYS HABITABLES
est disponible en librairie.
Elle abrite notamment des textes et dessins inédits de Pierre Minet
(1909-1945),
à propos de qui on trouvera
ici des renseignements bio-bibliographiques.
Après la parution de La
Défaite, en 1947, André Breton dira :
« Celui qui sait parler de la liberté comme il en parle
est moins vaincu que quiconque ».
Dans cette nouvelle livraison donnent également tous les signes de
vivre
Nicolas BOLDYCH, Sylvia MAJERSKA,
Simon MARTIN, Georges-Henri MORIN,
Eric GODICHAUD, Rosalia DOMENECH
MARGUI
(par ordre
d'apparition) !
Douterions-nous qu'il en aille autrement dans les cas de
Henry BATES (1825-1892),
Lady GREGORY
(1852-1932), Vincent HUIDOBRO
(1893-1948)
et
Gonzalo ARANGO
(1931-1976), qui complètent le numéro.
Des PAYS
HABITABLES N° 12,
octobre 2025.
ISBN 978-2-912753-70-0 Prix 14,00 €
Retour
Le
prix de poésie Léon-Paul Fargue 2025
décerné
par la Mairie du XV ème arrondissement et l'association Poésie et
Chanson Sorbonne
a été
remis le 3 juin à Francis Coffinet
pour son
recueil
NOS CAUCHEMARS SONT CALMES COMME DES OISEAUX ENDORMIS
publié
aux éditions alidades
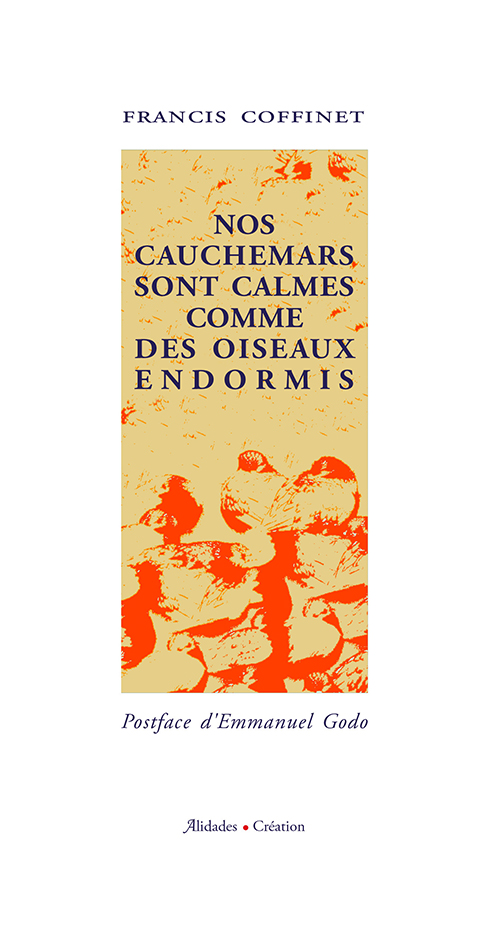
Retour
Ivan le Terrible, Pierre le
Grand, Alexandre III, Nicolas II...
Pendant près de quatre
siècles, les tsars ont construit la puissance et forgé le destin de l'immense
empire russe, avant d'être brusquement emportés, en 1917, par la tourmente
révolutionnaire.
Quand et comment la Russie
est-elle devenue un empire ? Quels liens unissaient le souverain et son peuple ?
Quelle marque les tsars ont-ils imprimée à leur pays ?
À ces questions et à beaucoup
d'autres, ce livre
« La Russie des Tsars » de Marie-Pierre Rey,
Mainteneur de l’Académie des jeux floraux de Toulouse, vous permettra de
répondre. (éditions Cerf, 14 €)
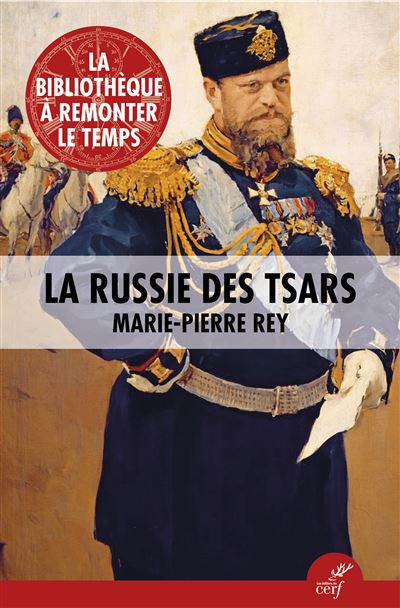
Retour
Bernard Noël Le roman
de la fluidité Ed
Fata Morgana 2002
André Du Bouchet Aveuglément
peinture Ed
Philippe Szwarc 2009
Michel Butor Rivieres
Ed Rivières 2007
P.A. Benoit Quand
Ed Fata Morgana 2004
Je remercie Bastien
Fery pour la rédaction
des notices des livres
|
|
|
|
|
|
Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
|
|
|
Vient de paraître
mars 2025
|
|
|
|
Les territoires
humanistes et
universalistes de Joseph
Pacini exposés dans son
ultime recueil...
|
|
|
|
« Je marche dans le gravier
et je sens dans le sable des
blocs calcaires affleurer. Mon
regard n’avait encore jamais
tenté de qualifier les choses
essentielles et les banalités
offertes à chaque passage. »À travers les frémissements
de la Terre ou des terres —
tantôt unique, tantôt plurielles
par la diversité quis’offre à nous —, Joseph
Pacini livre le secret et le
sacré d’une nature dans laquelle
l’homme doit trouversa juste place. (Marie
Cayol, préface)Ce recueil posthume de
Joseph Pacini est complété par
une rétrospective de son œuvre
(1973-2024) rédigée par
l'éditeur.
|
|
|
Caractéristiques
Un livre
de 90 pages au format 14 x 21 à
la française, imprimé en noir
sur papier bouffant blanc.Sortie en mars 2025isbn 978-2-37649-046-3 prix
public 15 €
Où
trouver l'ouvrage ?
Chez votre
libraire préféré (commande), ou
sur le
site de l'éditeur.
|
|
|
Sortie mars 2024
Désarroi et grande
solitude sur un lit
d'hôpital...
|
|
|
Sortie juin 2025
Nous sommes les
saumons de la rivièrequi lèvent l’onde
|
|
|
|
|
Bruno Msika
|
éditeur,
écologue
pastoraliste
|
|
|
|
10 avenue du pasteur Rey84000 Avignon
|
|
|
|
|
Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
Bruno Msika est un éditeur et un poète
qui publie aussi les poètes.
Nous le suivons dans sa passion d'une
écologie poétique.
|
|
|
Vient de paraître
septembre 2025
|
|
|
|
Une enquête qui
éclaircit la zone
trouble où se mélangent
belle et bonne vache,
entre passion et
production animale
|
|
|
|
|
BEAUTÉ DES VACHES
Élever des Montbéliardes, entre passion et production
animale
|
|
|
Les « beautés des vaches » sont
des listes pointant les
différentes parties du corps des
vaches (mamelle, aplombs…)
auxquelles il faut porter
attention pour en développer les
performances et la santé.
Conçues au début du XXe siècle
par des vétérinaires, elles sont
aujourd’hui toujours bien
vivantes.
Avec le décryptage de l’ADN, au
début des années 2010, la
sélection des animaux
domestiques a radicalement été
modifiée. Afin de saisir la
diffusion de cette innovation,
une vaste enquête est menée en
2014 sur la conduite de la race
Montbéliarde dans son aire
d’origine, le massif jurassien.
Alors que les entretiens
devaient prioritairement porter
sur la sélection assistée par
marqueurs, des regards
complémentaires ou antagonistes
se sont glissés dans les
interstices des conversations
chercheurs-éleveurs. La quête
de la belle vache s’est
ainsi imposée avec obstination.
À travers la succession des
notations chiffrées dont elle
est l’objet, elle laisse
échapper comme par effraction un
rapport sensible au vivant.
Pour rendre compte des beautés
des vaches, cet essai se compose
de quatorze observations dans
lesquelles le sujet se
renouvelle en permanence à
travers un assemblage de
perspectives chaque fois
recouvertes par la suivante. Ces
observations sont comme des
fragments hétérogènes qui
évoquent un métier, des
histoires individuelles et
collectives toujours en train de
se faire. Aux côtés des
réussites
technico-scientifiques, des
avancées du libéralisme et des
défis qui font la une de
l’actualité dans les mondes de
l’élevage, la recherche de
belles vaches témoigne de
relations inscrites dans la
connivence et la durée. Une
quête qui ne peut être résumée
sur un mode unique ni épurée des
ambivalences qu’elle est
susceptible d’embarquer. Ses
détails insistants attestent des
multiples manières dont les
vivants composent entre eux et
deviennent ensemble.
|
|
|
Caractéristiques
Un livre
de 252 pages au format 14 x 21 à
la française, imprimé en couleur
sur papier bouffant blanc.Sortie en septembre 2025isbn 978-2-37649-048-7 prix
public 18 €
Où
trouver l'ouvrage ?
Chez votre
libraire préféré (commande), ou
sur le
site de l'éditeur.
|
|
|
|
Bruno Msika
|
éditeur,
écologue
pastoraliste
|
|
|
|
10 avenue du pasteur Rey84000 Avignon
|
|
|
|
|
Retour
Les dernières publications de
Joël Vernet
sont éditées à
La Rumeur Libre
Retour
à paraître le 15 octobre 2025
et fera l'objet d'une émission
%20(1).gif)
Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
|
|
1975-2025
50 ans d'édition
|
|
|
|
|
La « vision retournée »
de Malcolm de Chazal
|
«
Voyant de génie, détenteur de gnose
», selon Raymond Abellio,
Malcom de Chazal (1902-1981), bien
que considéré comme l’un des plus
grands écrivains du xxe siècle, est
singulièrement méconnu.
Il
est né le 12 septembre 1902 à Vacoas,
dans une famille fixée à l’île
Maurice depuis deux siècles. L’un de
ses aïeux, François de Chazal de la
Genesté, fut l’ami et le secrétaire
du mystérieux comte de Saint-Germain
qui lui aurait confié ses secrets
avant de disparaître. C’est cet
ancêtre qui décida en 1763 de
quitter son Auvergne natale pour
s’installer à l’Isle de France. […]
Après des études d’ingénieur à
l’Université de Bâton-Rouge aux
U.S.A., il revient s’installer dans
son pays natal en 1925 […] Entre
1934 et 1936, il publie plusieurs
articles de presse critiquant la
gestion désastreuse par les grandes
familles blanches propriétaires de
l’industrie sucrière. […] En 1938,
il trouve un poste d’inspecteur au
Electricity & Telephone Department :
« Je n’avais rien à faire.
J’étais affreusement mal payé. Je
fis voir mon incapacité. On me
laissa en paix. »
Un
jour, en se promenant à Curepipe, il
reçoit la grâce d’une illumination
extraordinaire, une véritable
métanoïa. […] Il reviendra à
plusieurs reprises sur cette
expérience fondatrice de sa vision
du monde : « Je suis un être
revenu aux origines… La clé exacte
de la vision retournée, je l’eus un
jour, dans le jardin botanique de
Curepipe… J’avançais dans la lumière
de l’après-midi vers une touffe de
fleurs d’azalées, et je vis une des
fleurs qui me regardait. La fleur
devenait subitement un être. »
[…]
C’est
ainsi que naît l’œuvre qui le fera
connaître, Sens Plastique.
[…] En 1947, Jean Paulhan découvre
en lui « un occultiste sans
tradition ». Pressentant
l’importance de sa découverte, il
écrit dans Le Figaro littéraire
du 11 octobre : « Ça n’arrive
pas tous les jours de rencontrer un
écrivain de génie que personne ne
connaît. En voici un. » Il
convainc Gallimard de publier
Sens Plastique et, deux ans
plus tard, La Vie Filtrée. André
Breton dit de même : « Je
n’hésite pas à voir le plus grand
événement de nos jours dans la
publication de l’œuvre de Malcolm de
Chazal. » […] Francis Ponge le
félicite en ces termes : « Quel
merveilleux pouvoir est le vôtre de
fracturer ainsi les portes du
concret… Tous ceux à qui je montre
votre livre le considèrent comme un
événement sensationnel dans notre
littérature, où il vient de tomber à
la façon un peu d’un aérolithe. »
[…]
Quelques mois plus tard, à Souillac,
Malcolm a l’inspiration de son roman
Petrusmok. Il consacre son
temps libre en pérégrinations dans
un état d’identification avec la
montagne : « Petrusmok est une
révélation immédiate de la pierre…
J’ai rêvé au sein de la pierre, mais
ce qui jaillissait était l’essence
mythique du mont. » Dans
Petrusmok, Malcolm invente avec
une débauche de couleurs et de
visions la mythologie fondatrice de
son île. Selon lui, l’île Maurice
est le dernier vestige de la
Lémurie, vaste continent qui
s’étendait en forme de croissant de
Ceylan à la Patagonie avant d’être
englouti comme l’Atlantide. […] La
synthèse de son œuvre, L’Homme
et la Connaissance, préfacée
par Raymond Abellio, paraît en 1974.
Il meurt quelques années plus tard,
le 1er octobre 1981. […]
À
l’étroit dans une petite île dont il
disait lui-même : « Ce pays
cultive la canne à sucre et les
préjugés », Malcolm de Chazal
s’est voulu le chantre de
l’universalité, de l’Un caché
derrière les apparences de la
multiplicité. […] En cela, il est
proche de la métaphysique orientale
: « La poésie métaphysique est
semblable aux Upanishads en tant
qu’essence d’approche de l’absolu,
mais elle veut ici expliquer les
védas de l’être et de la vie, hors
de toute Révélation, par la voie
médiate vers Dieu qu’est le monde
visible qu’elle transsubtancie pour
s’en servir comme hostie
intermédiaire vers Dieu. » La
fonction du poète est de lever le
voile des apparences afin de révéler
les mystères à ceux qui en sont
dignes : « … les Upanishads, à
quoi mon œuvre est comparée, et qui
est la métaphysique même, n’ont
d’autre but que nous faire voir
derrière le rideau au-delà du voile
des apparences. » […]
L’Inde est la véritable patrie du
poète : « Je reste occidental,
par mes hérédités, par ma langue,
par ma manière de manger et de
m’exprimer. Mais mon âme est sur le
Gange et à Bénarès. Je respire
l’Inde. » L’Inde est la
véritable patrie de la métaphysique.
L’Inde est le pays de la Vie : «
Il n’est un mystère pour personne à
Maurice que je prône l’hindouisme.
Et la raison en est que l’Inde
cherche Dieu dans la vie, parmi les
fleurs, les prés, dans les eaux et
le feu, sur l’aile de l’oiseau,
autant que dans le regard d’un
enfant, dans la voix de la femme et
la communion humaine. »[…]
Nombre de ses ouvrages, publiés à
compte d’auteur n’ont jamais été
réédités. Ainsi La Parole,
imprimé en 1955 à 50 exemplaires,
hors commerce. […] Il nous a semblé
indispensable de rééditer ce trésor
inestimable afin d’éviter qu’il ne
retombe dans les oubliettes de la
littérature. C’est pourtant le
chef-d’œuvre, voire le Grand Œuvre
de Malcolm, puisque cet immense
poème métaphysique nous abreuve à la
source même de l’inspiration
chazalienne. Poète de
l’inexprimable, Malcolm de Chazal se
fait le porte-parole du Verbe divin.
La Parole retrace le cycle
cosmique de la chute de l’homme
ici-bas, de l’initiation de l’être
souffrant dans ses chaînes et de sa
remontée vers la lumière.
La
Parole est annonce du Royaume. «
La Parole est ce par quoi la vie est
une, et qui fait de l’homme le fils
aîné de la Nature. La Nature est la
Parole, dont l’homme s’est échappé…
On a inventé un Ciel à atteindre,
alors qu’il est là devant nos yeux…
Il ne saurait y avoir d’autre sens à
la vie que de passer de la condition
de jour-et-nuit au Jour Absolu, du
monde où la porte s’ouvre et se
ferme au monde de l’Ouverture à
jamais. »
Extraits de la préface d'Yves Moatty
à La Parole, de Malcolm de
Chazal.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES DEUX
NOUVEAUTÉS
DU MOISEn librairie
le jeudi 11
septembre 2025Distribution
Sodis – Diffusion
Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Malcolm de ChazalLa Parole
Texte inédit
présenté par Yves
Moatty
Collection Les
Vies imaginairesISBN
978-2-845-90399-9–
96 pages – 14 €
|
|
|
|
« Je n’hésite pas à
voir le plus grand
événement de nos
jours dans la
publication de
l’œuvre de Malcolm
de Chazal »,
écrit André Breton,
qui admire son «
système génial de
perception et
d’interprétation »
et ajoute : « On
n’avait rien entendu
de si fort depuis
Lautréamont…
l’attitude de Chazal
n’admet aucun
antécédent dans
l’histoire de la
pensée humaine. »
Et Jean Paulhan, lui
si prudent, n’hésite
pas à écrire : «
Ça n’arrive pas tous
les jours de
rencontrer un
écrivain de génie
que personne ne
connaît. En voici
un. »
Chazal a plusieurs
fois évoqué
l’expérience
fondatrice qui a
nourri sa pensée :
« Je suis un
être revenu aux
origines… La clé
exacte de la vision
retournée, je l’eus
un jour, dans le
jardin botanique de
Curepipe…J’avançais
dans la lumière de
l’après-midi vers
une touffe de fleurs
d’azalées, et je vis
une des fleurs qui
me regardait. »
Épisode qui rappelle
l’instant fondateur
de Jakob Boehme, le
reflet du soleil sur
une cruche d’étain.
L’Homme et la
Connaissance, où
Chazal synthétise sa
pensée, sera
préfacé par Raymond
Abellio : « Nous
sommes, écrit-il, en
présence d’un voyant
de génie. »
Nombre des ouvrages
de Chazal, publiés à
compte d’auteur,
n’ont pourtant
jamais été réédités.
Ainsi La Parole,
qui fut imprimé en
1955 à seulement 50
exemplaires hors
commerce et est
depuis longtemps
introuvable. Or il
s’agit d’un texte
central dans la
réflexion de Chazal
: « L’homme seul
ne danse pas en
marchant. L’homme
seul est hors du
Grand Jeu. Le
mouvement de Nature
est un jeu. L’homme,
lui, se déplace […]
La Parole est ce par
quoi la vie est une,
et qui fait de
l’homme le fils aîné
de la Nature. La
Nature est la
Parole, dont l’homme
s’est échappé. »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gérard Pfister
Un déjeuner en
montagne
suivi de
Le pur plaisir
d'existerCollection Les
Cahiers d'Arfuyen
ISBN
978-2-845-90396-8 –
128 pages – 15 €
|
|
|
|
Publié en 2023, le
précédent ouvrage de
Gérard Pfister (Le
Livre suivi de
L’expérience des
mots) abordait,
à travers une suite
de 500 poèmes suivie
d'un essai, une
méditation tout
aussi philosophique
et spirituelle sur
notre rapport à la
lecture et aux mots
dans un Occident
fondé sur les trois
religions du Livre.
Le récit en prose
ici publié est
centré sur le thème
du banquet, thème
central des
traditions
philosophiques et
spirituelles, mais
aussi lieu par
excellence de
l’amitié et de la
poésie.
D’inspiration
indissociablement
philosophique,
spirituelle et
poétique, il unit
ainsi les
différentes
tonalités qui font
l’originalité
d’Arfuyen et
s’inscrit en droite
ligne dans la
filiation de Roger
Munier qui donna une
préface à son livre
Naissance de
l’invisible en
1997 et dont il
assume, avec son
fils, Jacques
Munier, la
publication de
l'œuvre maîtresse,
l'Opus incertum
(plus de 3000
pages).
Dans son testament,
Épicure demande que
soit organisé chaque
année, le jour
anniversaire de sa
naissance, un
banquet, qui n’est
en fait qu’un grand
repas amical, à la
fois sobre et
joyeux, en souvenir
de lui. De la même
façon, nombreuses
sont les
philosophies et les
religions où un
banquet est au
centre du culte que
les disciples vouent
à leur fondateur,
qu’il soit associé à
un rite sacrificiel
ou réduit à une Cène
symbolique.
Le banquet est
célébration de
l’amitié et de la
parole, mais aussi
des dons de la
nature et du mystère
de la vie. Il est
aussi, par-delà la
mort, signe de
fidélité et de
gratitude envers le
maître disparu.
Malgré les misères
des temps et
l’angoisse du
lendemain, on y
affirme le plaisir
simple d’être là,
ensemble, grâce à
lui.
« Toujours nous
est doux le souvenir
d’un ami disparu. »
Cette citation
d’Épicure, extraite
des 242 fragments
inédits traduits et
présentés par Gérard
Pfister dans son
Ainsi parlait
Épicure (2022),
ouvre le présent
volume. En marche
vers la clairière où
se tient le banquet,
le marcheur – à la
fois philosophe,
spirituel et poète
–, s’interroge (et
ce sont les 3
parties de son
récit) sur le but de
son chemin,
le sens du
banquet et les
fondements de l’amitié.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TROIS
LIVRESÀ
REDÉCOUVRIRDistribution
Sodis – Diffusion
Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shankara
Les Mille
Enseignements
Traduit de l’édition
critique anglaise
par Anasuya
Préface de A. J.
Alston
Vie de Shankara
par T. M. P.
Mahadevan Collection OmbreISBN
978-2-845-90179-7 –
276 pages – 20 €
|
|
|
|
Malgré la brièveté
d’une vie qui prit
fin, semble-t-il,
dans sa 33e
année, Shankara
(788-vers 820),
ascète, philosophe,
inlassable
prédicateur, demeure
l’un des grands
maîtres spirituels
de l’Inde et l’un
des fondateurs de la
pensée non-duelle
(l’Advaïta
Vedanta).
Celui qui veut
accéder à cette
œuvre se trouvait
jusqu’à présent
confronté à de
volumineux
commentaires des
Upanishad et de
la Bhagavad Gîtâ
et à une foule de
textes dévotionnels
souvent en
contradiction avec
les commentaires.
Les études critiques
permettent
aujourd’hui de
penser que seuls
les Mille
Enseignements
(Upadesa Sahasri)
peuvent être
attribués avec
certitude à
Shankara. Dans une
approche très
pédagogique, le
maître y expose
lui-même sa vision
et donne ainsi une
introduction idéale
à l’œuvre tout
entière.
Au temps de
Shankara, le
désarroi régnait
dans toutes les
sphères de la
société. D’un côté,
les
fondamentalistes,
aveugles à leur
époque,
s’obstinaient à
suivre à la lettre
les écritures et en
manquaient l’esprit
; de l’autre, les
modernistes ne
cherchaient qu’à
détruire les valeurs
anciennes, aggravant
la perte de repères.
Shankara consacra sa
brève existence à
essayer de guérir
les blessures et à
indiquer la voie de
la santé physique et
spirituelle. Certes,
il eut à surmonter
des oppositions,
mais il le fit
toujours avec
bienveillance et par
la persuasion. Grâce
à sa profonde
expérience
spirituelle, il
s’efforça d’apaiser
les dissensions et
de redonner à chacun
sa véritable place :
« La réalité est
Une et indivisible »,
affirmait-il avec
les Veda, en
soulignant aussi :
« Ceux qui
savent la nomment de
différentes
manières. »
La doctrine de
Shankara vise avant
tout à dépasser la
peur et la violence
qui en découle :
« Le Soi, écrit-il,
n’est pas un objet.
En lui, il n’y a ni
changement ni
pluralité. Il ne
peut être ni obtenu
ni rejeté, par
lui-même ou par qui
que ce soit. Celui
qui sait qu’il est
le Soi au-dedans
comme au-dehors,
au-delà de la
naissance et de la
mort, au-delà du
délabrement et de la
vieillesse, pourquoi
devrait-il éprouver
la moindre peur ? »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
ÉpicureAinsi parlait
Épicure
Fragments inédits
extraits des Epicurea
d’Hermann Usener
choisis et traduits
du grec ancien et du
latin par Gérard
Pfister
ÉDITION BILINGUECollection Ainsi
parlaitISBN
978-2-845-90334-0 –
192 pages – 14 €
|
|
|
|
|
|
|
Le présent ouvrage
propose 242
fragments d’Épicure
inédits en volume,
qui s’ajoutent aux
108 aphorismes du
corpus habituel –
compte tenu des
recoupements entres
les Maximes
capitales et
les Sentences
vaticanes. Il est
dédié à Marcel
Conche, philosophe
majeur de notre
temps, admirable
traducteur et
commentateur
d’Épicure et
Lucrèce, décédé le
27 février 2022 en
sa 100e
année.
À travers les
siècles, la pensée
d’Épicure n’a cessé
d’apporter un
message
d’émancipation. Dans
la Rome antique,
face à l’omnipotence
impériale et au
fatalisme stoïcien,
comme dans l’Europe
de la Renaissance
face aux monarchies
absolues et au
dogmatisme chrétien.
Or cette pensée
essentielle, qui
s’inscrit comme
l’antidote à toutes
les tyrannies
religieuses ou
pseudo-religieuses,
n’a cessé d’être au
bord de s’éteindre.
Conscient des
puissances hostiles
dont il voyait
l’humanité entourée,
Épicure a publié
plus de 300 volumes,
plus qu’aucun auteur
de l’Antiquité. Dès
le 1er s.
de notre ère, il
n’en restait presque
plus rien. Pourtant
l’œuvre est peu à
peu ressurgie de ses
cendres.
En 1533, on
redécouvre dans les
Vies des
philosophes de
Diogène Laërce ses
40 Maximes
capitales ainsi
que ses trois
lettres à Hérodote,
Pythoclès et
Ménécée. En 1752, on
exhume à Herculanum
des fragments
presque illisibles
du traité Sur la
nature. En
1888, on retrouve au
Vatican les 81
Sentences dites
« vaticanes ».
Ce sont ces textes
qui constituent
l’œuvre d’Épicure
dans toutes les
éditions actuelles.
Or d’autres textes
tout aussi
essentiels se
trouvent dans
l’édition de
référence publiée en
grec et en latin par
Hermann Usener (Epicurea,
1887), mais ils
n’ont jamais été
traduits en français
et publiés en
volume. C'est dans
cet ouvrage capital
qu'ont été
sélectionnés les 242
fragments inédits
ici présentés, en
fonction de leur
originalité et de
leur fiabilité.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gérard Pfister
« La poésie, c'est autre
chose »
1001 définitions de la
poésie
Collection Les Cahiers
d'Arfuyen
ISBN 978-2-845-90121-6 –
240 pages – 17 €
|
Pierre Reverdy le
relevait avec humour
:
« Cette poésie, pour
le moins aussi
rebelle à la
définition que l’âme
à se laisser entamer
par la pointe du
bistouri, qu’est-ce
que c’est ? Oh ! ce
n’est pas que les
plus grands poètes
de ces derniers
temps soient restés
courts devant cette
question. Mais
l’abondance même des
brillantes réponses
qu’ils lui ont
données les rend
précisément
embarrassantes.
Elles fourniraient
toutefois l’opulente
matière d’une
merveilleuse
anthologie. »
Le but de cet
ouvrage n’est pas de
développer une
doctrine ni
d’exprimer une
sensibilité, même
si, bien sûr, il ne
saurait être aussi
objectif ni
exhaustif qu’on l’a
souhaité. Son propos
est avant tout de
faire comprendre et
aimer la poésie :
éclairer la
signification et
l’importance de
cette forme
littéraire
essentielle et
aujourd’hui si
méconnue qu’on
appelle poésie et
inciter ainsi à la
lire. Il s’agit,
modestement, de
faire partager une
passion.
Exercice difficile
s’il en est, mais
plus nécessaire que
jamais, parce que la
poésie, hélas,
intimide de plus en
plus de lecteurs et
qu’elle peut leur
offrir pourtant,
dans l’étouffement
des sociétés
contemporaines, un
espace où respirer.
« Autre chose »,
aurait dit
Guillevic. Car c’est
Guillevic qui nous
proposé la
définition qui sert
de titre au présent
ouvrage:
« La poésie, c’est
autre chose.
Évidemment, commentait-il
malicieusement,
c’est une définition
vague, mais juste……
Je la respecte. »
La poésie : lieu de
liberté, dans
l’ouverture à une
radicale altérité ;
et, en même temps,
exercice d’un
patient travail sur
la matière des mots
pour en faire
quelque chose. Et
quoi ? Un poème.
Le présent ouvrage
comporte quatre
strates : 1) Des
définitions inédites
ont été demandées
aux auteurs qui,
depuis 33 ans, ont
contribué au travail
des Éditions
Arfuyen. 2) Il leur
a été demandé
également
d’indiquer, chez
leurs écrivains
préférés, les
définitions de la
poésie qui avaient
leurs préférences.
3) D’autres
définitions ont été
encore ajoutées afin
que l’ensemble, sans
être exhaustif, soit
relativement
représentatif de la
richesse inépuisable
des territoires de
la poésie. 4) Un
travail de synthèse
a été mené pour
dégager les grandes
lignes de cohérence
de cet ensemble.
Huit grands thèmes
sont ainsi abordés,
découpant l’ordre
alphabétique en huit
séquences : A comme
Affirmation, C comme
Connaissance, E
comme Émotion, L
comme Licorne, M
comme Musique, O
comme Objet, R comme
Révélation, V comme
Vie.
Huit facettes
différentes et
complémentaires
d’une réalité qui
échappe toujours. Au
total près de 700
citations de quelque
250 auteurs,
d’époques, de
langues et de
sensibilités très
diverses. Et autour
de chaque citation,
un choix bien plus
large encore
d’analyses et
réflexions.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUR LES 50 ANS DES ÉDITIONS
ARFUYEN
LES 50 ANS DES ÉDITIONS ARFUYEN :
article de Veneranda Paladino (DNA)
LES 50 ANS DES ÉDITIONS ARFUYEN :
vidéo de Roméo Boetzlé (DNA)
MAIS AUSSI
Septembre 2025
Et
pourtant, de Pierre Dhainaut,
lu par Yves Namur (Le Journal des
poètes)
Septembre 2026
Lire
Alain Suied, par Antoine Jockey
(Kitab)
12
août 2025
Le
Message réisophique, de Laurent
Albarracin, par Pierre Vinclair (Les
temps qui restent)
23
juillet 2025
Le
Message réisophique, de Laurent
Albarracin, lu par Christian Travaux
(Sitaudis)
21
juillet 2025
Le
Rêve de Dostoïevski, de Cécile
Holdban, lu par Tristan Hordé
(Sitaudis)
12
juillet 2025
Une
femme célèbre, de Fumiko
Hayashi, par Frédérique Fanchette
(Libération)
9
juillet 2025
Ainsi parlait Barbey d’Aurevilly,
de Philippe Simon, lu par Marc
Wetzel (La Cause littéraire)
8
juillet 2025
Un
printemps à Hongo, d’Ishikawa
Takuboku, lu par Antoine Jockey (Al
Majalla, Londres)
Juillet-août 2025
Rabbi Nahman de Bratzlav, de
Catherine Chalier, lu par Ariane
Bendavid (Sens)
Juillet 2025
La
voie du large, de Michèle
Finck, par Mihaela Stanisor (Alkemie)
Juillet 2025
La
voie du large, de Michèle
Finck, lu par Judith Chavanne (Arpa)
30
juin 2025
L’Homme sans langue, d’Adrien
Finck, lu par Antoine Jockey (Al
Majalla, Londres)
26
juin 2025
Ainsi parlait Barbey d’Aurevilly,
de Philippe Simon, lu par Patrick
Corneau (Le Lorgnon mélancolique)
22
juin 2025
Le
Message réisophique, de Laurent
Albarracin, lu par Clément Alfonsi
(Anath & Nosfé)
14
juin 2025
Un
dédale de ciels, de Benoît
Reiss, lu par Jérôme Nalet
(Décharge)
11
juin 2025
Le
Message réisophique, de Laurent
Albarracin, lu par Marc Wetzel (La
Cause littéraire)
5
juin 2025
Une
femme célèbre, de Fumiko
Hayashi, lu par Florence Noiville
(Le Monde)
3
juin 2025
Souvenirs de la planète Terre,
d’Ilarie Voronca, lu par Jean-Pierre
Longre (jplongre.hautetfort.com)
1er
juin 2025
Et
pourtant, de Pierre Dhainaut,
lu par Jean-Louis Bernard (Concerto
pour marées et silence, n° 18)
1er
juin 2025
Et
pourtant, de Pierre Dhainaut,
lu par Sabine Dewulf (Diérèse n° 93)
1er
juin 2025
Cette allée qui s’efface, de
Gérard Bocholier, lu par Yves
Leclair (Diérése n° 93)
1er
juin 2025
Terminus, d’Edith Wharton, lu
par Nelly Carnet (Le Journal des
poètes)
1er
juin 2025
La
voie du large, de Michèle
Finck, lu par Patrick Née (Place de
la Sorbonne, n° 14)
28
mai 2025
Souvenirs de la planète Terre,
d’Ilarie Voronca, lu par Alain
Roussel (En attendant Nadeau)
|
|
|
|
|
Retour
Le
Belvedere
nouveau est arrivé !
A consommer sans modération !
Retour
|
En
librairie
UN
PEU D'ÊTRE, de Cédric Le Penven |
|
|
|
|
Cela fait dix ans que nous avons la joie
de publier et défendre l'œuvre de Cédric
Le Penven. La joie et la curiosité de la
suivre dans ses évolutions, dans son
voyage et ses réinventions, entre poèmes
et journal, traversant l'enfance passée
et celle qui croît sous nos yeux,
traversant les espaces du verger et
creusant les blessures intérieures.
Un peu d'être est un livre qui
nous semble précieux dans cette
trajectoire, un livre bref, sans détour,
qui cristallise à la fois le rapport au
langage et au silence de son auteur. Un
livre qui nous dit d'où vient cette voix
qui nous parle, et quelle est sa raison
d'être.
|
|
|
|
Un peu d'être
D’où vient le poème ? Et comment ?
Autour de ces deux questions aussi
simples que mystérieuses, Cédric Le
Penven articule une dérive plutôt qu’une
réflexion, remontant la source intime du
langage, où les mots agissent comme une
solution de clarté pour écarter les
ombres de l’enfance. Tout commence par
la « précision des coups » reçus, par un
corps d’enfant battu recroquevillé sur
lui-même pour encaisser les chocs,
impuissant. C’est autour de ce corps
ramassé en boule que tourne le poète,
tente d’y opposer une précision du
regard. Pas pour guérir, cela semble
vite impossible : c’est une histoire de
crue impossible à endiguer, c’est une
histoire de violence dont on ne peut se
défaire. « Où vivre alors ? » se demande
Le Penven, il s’agit, pour « s’ajuster à
l’existence », d’en entendre les appels,
la chaleur de l’amour, le sourire de son
fils, le bleu des fresques de Fra
Angelico, mais aussi, et c’est là
l’existence acceptée en un tout, la
disparition des proches, les choses qui
nous font baisser les yeux. Le
poème agit comme une présence contre la
solitude, en ce que nos propres
mots se mélangent à ceux des autres,
qu’il y a là une porosité qui est un
trait d’union, pour faire de la place
aux autres près de soi.
D’où vient le poème ? Il vient depuis
que le poète a « cessé d’écrire des
poèmes ». Il n’y a pas de
poèmes, simplement une réaction face à
la vie, à l’état d’être en vie, au
milieu d’un vide intérieur. Un
peu d’être est la cristallisation
d’une pratique de l’écriture. Pas une
confession, mais un rapport au langage,
à la mémoire, à la surprise des choses.
Tout vient de l’art de nommer pour
comprendre le monde, faute de pouvoir
nommer et en comprendre la brutalité.
Cela part de l’eau, celle qui submerge
et emporte tout, l’eau de la mémoire qui
noie, celle de l’Aveyron où la vie se
dessine, l’eau des larmes et la vase et
sa pesanteur insondable, le filet de
voix du poème qui cherche à épuiser la
soif. Plus qu’une poétique, ce texte est
un chemin, un parcours à travers les
jours dans lequel les mots sont le
viatique qui s’invente au fur et à
mesure de la route. Les mots
sont le désir d’une réponse aux
questions sans réponse. La
formulation de l’inquiétude en guise de
réponse à l’inquiétude. L’invention
d’une solitude contre la solitude.
Dans ce livre, aussi bref qu’important
dans la trajectoire d’un auteur qui a
fait de la quête de clarté l’obsession
de son œuvre, Cédric Le Penven
nous donne la main de son écriture
plutôt que sa clef. Clef qui
n’aurait de toute façon d’autre porte à
ouvrir que celle du regard, celui que
pose, tout au bord de soi, l’auteur sur
les choses aimées. Un regard intérieur,
une interrogation dont la réponse tourne
sans jamais se donner sur la langue, qui
est à la fois ce que nous avons en
partage et ce qui n’appartient qu’à soi. |
|
|
|
Cédric Le Penven
Cédric Le Penven est né en 1980. Il est
l’auteur d’une quinzaine de livres de
poèmes ou de journaux poétiques. Agrégé
de lettres modernes, spécialiste de
l’œuvre de Thierry Metz, auquel il a
consacré un ouvrage en 2017, il vit et
enseigne dans le Sud-Ouest de la
France. Son oeuvre développe la question
du biographique et
de l’environnement, entre réminiscences
et voyages, quotidien et introspection.
Son écriture cherche à cautériser les
plaies de l’enfance et leur écho dans le
temps présent, par une interrogation de
la place que chacun s’autorise à occuper
dans le monde, en quête constante de
clarté. Il a obtenu le prix Voronca en
2004 pour Elle, le givre (éditions Jacques
Brémond), et le prix Yvan Goll pour
son recueil Nuit de peu
(éditions Tarabuste) en 2016.
|
|
|
|
|
Cédric Le Penven aux Editions Unes |
|
|
|
|
AGENDA : LECTURE LE 17 SEPTEMBRE |
|
|
|
|
Ne manquez pas notre lecture de rentrée,
avec Bernard Chambaz pour Comment un
cœur peut-il, Marie Roumégas pour
Premiers espaces et Marine
Riguet pour Antigone sur la route
(à paraître le 12 septembre) le
mercredi 17 septembre à 19 h 30
à la librairie Tschann à Paris.
Librairie Tschann, 125 boulevard
du Montparnasse, 75006 ParisInformations
sur le site de la librairie |
|
|
|
| |
|
Nos ouvrages sont imprimés
en France par une imprimerie de
tradition familiale depuis 1839,
certifiée FSC et labellisée
Imprim’vert pour la réduction de
son empreinte environnementale
et la prévention des risques
sanitaires auprès de son
personnel. Nos papiers sont
issus de forêts gérées
durablement selon des critères
environnementaux et sociaux
certifiés PEFC, et bénéficient
de l’Écolabel européen. Après
fabrication, ces livres n'ont
parcouru que 150 kilomètres pour
arriver chez notre distributeur. |
| |
|
|
|
|
|
| |

|
Retour
Eric Chassefière
poète, directeur des éditions Encres
Vives nous communique :
Nous vous
informons,
Laurent Grison et moi-même, de la parution
prochaine de notre recueil
« Dans la nuit du jour », comportant 26
images en dialogue avec les poèmes, chez Rafael de Surtis.
Écrire dans la lumière, dans la fenêtre de la lumière.
La lumière éclaire un paysage, un champ, des lignes
d’arbres, une montagne lointaine.
C’est de la nuit d’enfance, du chant du vent dans les
arbres, de la rose noire sous les volets clos, que naît ce paysage
qui au matin saisit l’enfant dans sa lumière.
Cet instant de lumière, il est aujourd’hui, magnifié par la
mémoire, celui du poème, de l’éveil à la vie et à la beauté.
La fenêtre du paysage se double ici de celle de l’image
fournie par l’artiste, ouvrant des chemins neufs en de nouveaux
étés.
Dans la Nuit du Jour dit l’éblouissement d’être, le temps
perdu et retrouvé, la joie sans limite d’embrasser, prendre visage,
s’ouvrir au monde.
Bon de commande
Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
|
|
|
Vient de paraître
août 2025
|
|
|
|
Le référentiel des
milieux pastoraux du sud
de la FranceVoici le tome 2 :
Méditerranée
|
|
|
|
LA PASTOTHÈQUE
Tome 2. Méditerranée
Référentiel des milieux
pastoraux du sud de la France
un ouvrage collectif
|
|
|
De la mer aux sommets des
montagnes, les troupeaux des
éleveurs pastoraux se
nourrissent en parcourant des
pelouses sèches et humides, des
landes, garrigues et maquis, des
sous-bois feuillus et résineux.
Sur ces milieux non cultivables,
c’est par la seule pratique
pastorale que les éleveurs
auront à s’adapter aux accidents
climatiques plus fréquents et
plus intenses. C’est pourquoi il
est nécessaire de reconnaître
les milieux pastoraux les plus
sensibles et ceux les plus
résilients, susceptibles de
fournir des solutions au
pâturage.
C’est en effet l’atout majeur
des végétations pastorales que
de proposer une diversité de
structures et de compositions
floristiques avec laquelle il
faut savoir jongler de saison en
saison. Herbes grossières,
buissons comestibles et abri des
sous-bois fournissent une
palette de possibilités en
complément de l’herbe verte et
tendre.
La Pastothèque est éditée
en deux tomes, Montagne
et Méditerranée. Conçue
par la plupart des services
pastoraux avec l’appui de
chercheurs, elle propose une
typologie unifiée des milieux
pastoraux. Elle permet de les
caractériser, décrit les
fonctions d’alimentation
mobilisables sur chacun,
quantifie les ressources et
aborde leur fonctionnalité
climatique pour fournir aux
éleveurs, bergers et acteurs du
monde pastoral quelques clés
d’adaptation aux effets du
changement climatique.
|
|
|
Caractéristiques
Un livre
de 460 pages au format 16,5 x 24
à la française, imprimé en
couleur sur papier couché mat.Sortie en août 2025isbn 978-2-37649-039-5 prix
public 30 €
Où
trouver l'ouvrage ?
Chez votre
libraire préféré (commande), ou
sur le
site de l'éditeur.
|
|
|
|
Bruno Msika
|
éditeur,
écologue
pastoraliste
|
|
|
|
19 rue Agricol Perdiguier 84000 Avignon
|
|
|
|
|
Retour
*Ils sont à peine sortis de leur machine
Pour me rejoindre…
Et pour vous rejoindre ?

Redfoxpress
DUGORT - ACHILL ISLAND - COUNTY MAYO -
IRELAND - F28 RR66
info@redfoxpress.
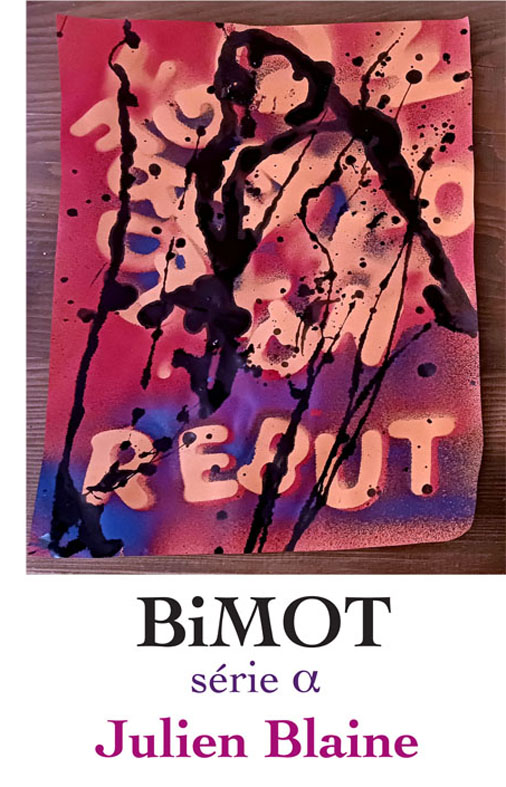
Retour
Vient de paraître dans
la collection DUO
(éditions Méridianes) le
livre de Jean-Marie Corbusier et
Yves Namur:
L'écrit se creuse.
Dans le sillage de Paul Celan, la poésie creuse ses possibilités
(et impossibilités) - ses silences :
"
L'écrit - disait-il- se
creuse"
et en parler
n'est rien d'autre
qu'une lame de
silence
posée
à même le sable
mouvant
là sur
l'éclat écarlate
éclaté
L'ouvrage sera sur le stand de la Maison de la Poésie Jean Joubert au
festival Voix Vives à Sète (jusqu'au 26 juillet) puis au festival Poésie
sauvage à La Salvetat (16 et 17 août).
ISBN: 978-2-493968-18-0
Retour
Lire de
Pierre Maubé
Saison lente
aux éditions Voix d'encre
voir :https://www.voix-dencre.net/titres/438-saison-lente.htm
Retour
Pierre Maubé
"Cette Rive"
éditions Illador, 87 p, 16 €
Dire l’amour rencontré,
dire l’amour perdu, dire l’amour fragile et fort, partagé, renié,
renaissant quelquefois le temps d’un souvenir, d’un regret, d’un
remords.
Dire certains de ces
instants d’une éphémère éternité. Dire ces paysages qui furent surtout
des paysages intérieurs. Dire l’intimité.
Ce livre
fera l'objet d'une prochaine émission.
Retour
Vladimir Jankélévitch à
Toulouse. 1940-1945.
Une parenthèse inoubliable. La guerre.
Voir :
Retour
Ce livre fera l'objet
d'une émission à l’automne 2025
Retour
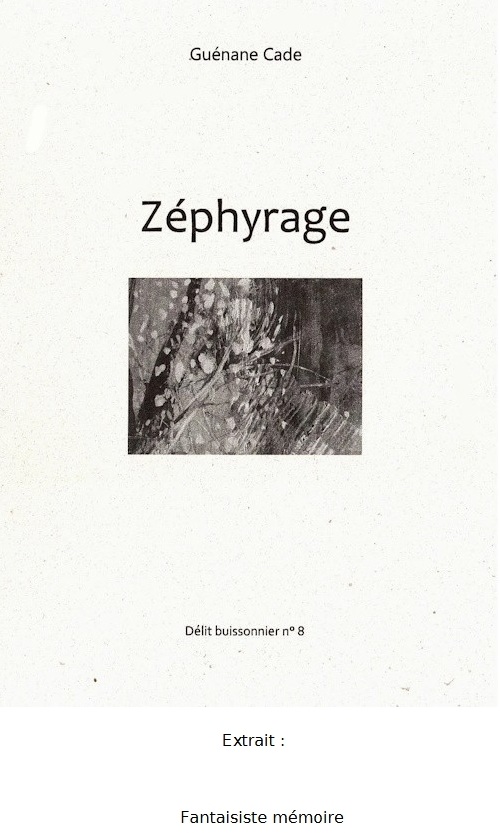
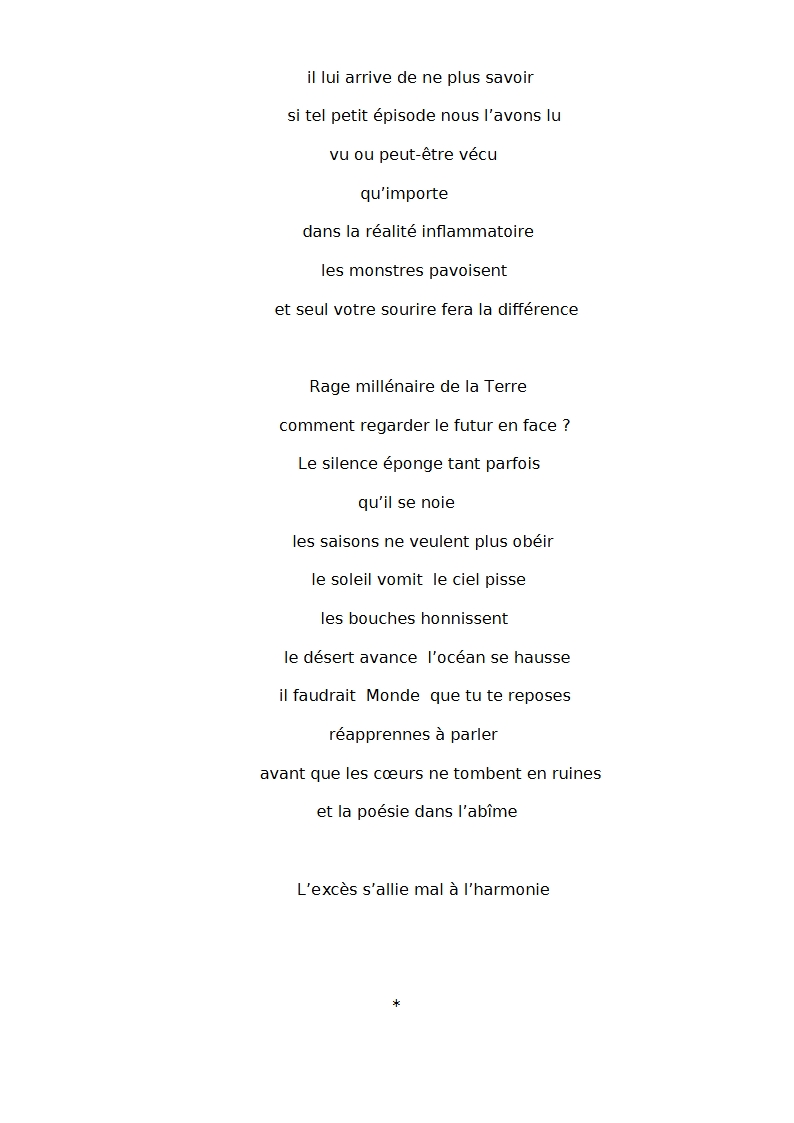
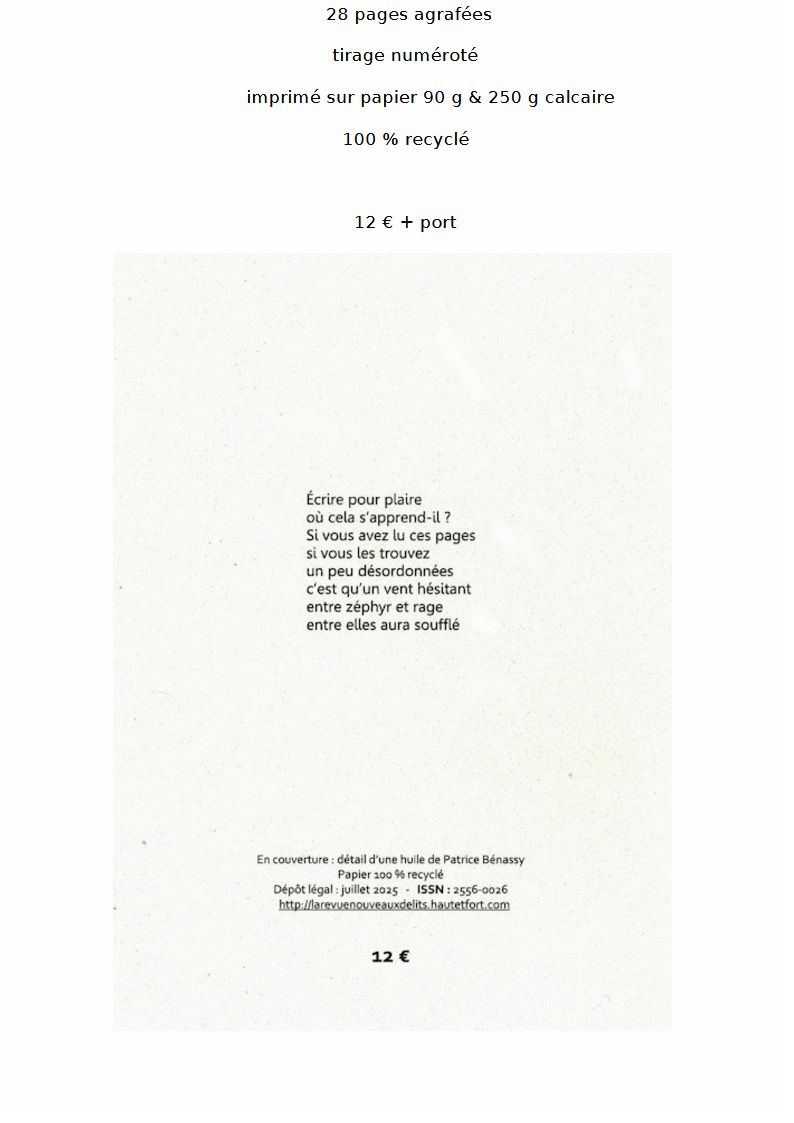
Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
|
|
|
Vient de paraître
juin 2025
|
|
|
|
Nous reposonscomme
de royales abeillesvenant
d’essaimer[…]Nous
sommes les saumons de la
rivière...
|
|
|
|
comme de royales
abeilles
poésie de Marie-Françoise
Ghesquier
dessins d'Anouk Rugueu
|
|
|
La seule voieétait
celle de la tige des plantes
la voie des salamandresen
spirale infinieet
leurs yeux clos de jade
la voie de l’amabieaux
écailles de poissonet
à bec d’oiseau
pour sortir de l’oubli
De schiste en schisteje
contournais
la poudre de l’ombre.
|
|
|
Caractéristiques
Un recueil
de 68 pages au format 14 x 21 à
la française, imprimé en
noir&blanc sur papier bouffant,
11 illustrations originales en
couleur d'Anouk RugueuSortie 24
juin 2025, dans la collection
Poésieisbn 978-2-37649-047-0
prix public 15 €
Où
trouver l'ouvrage ?
Chez votre
libraire préféré (commande), ou
sur le
site de l'éditeur.
|
|
|
© Marie-Françoise
Ghesquier
|
|
|
|
|
|
|
Bruno Msika
|
éditeur,
écologue
pastoraliste
|
|
|
|
19 rue Agricol
Perdiguier 84000 Avignon
|
|
|
|
|
Retour
Notre amie poète Marie-Josée
CHRISTIEN nous communique :
Je suis heureuse de vous annoncer la parution
de mon nouveau livre aux
éditions Al Manar:
Alambic,
accompagné des encres de Laurent Noël
Il est présenté sur le site de l'éditeur, où il peut être commandé
par les particuliers et les libraires :
https://editmanar.com/editions/livres/alambic/
Dates à retenir :
- Signature sur Marché de la poésie (Place St-Sulpice, Paris),
samedi 21 juin de 15 h à 16 h sur le stand d'Al Manar.
- Rencontre-lecture à Baie des Plumes (Place de l'Enfer, Douarnenez),
vendredi 8 août à 10 h 30, puis en signature
sur le stand d'Al Manar jusqu'au 10 août.
- Rencontre et signature à la librairie Ravy de Quimper,
samedi 4 octobre de 16 h à 18 h.
A bientôt,
Marie-Josée Christien
https://mariejoseechristien.fr
Retour
Les excellentes
éditions Pierre Mainard
nous communiquent :
Je vous invite à venir nous
saluer ici ou là et à découvrir
les nouveautés, les
nouvelles éditions, les rééditions... de la maison !
Et à vous rendre à l'hommage
consacré à l'étonnante Marcelle Delpastre.
Retour
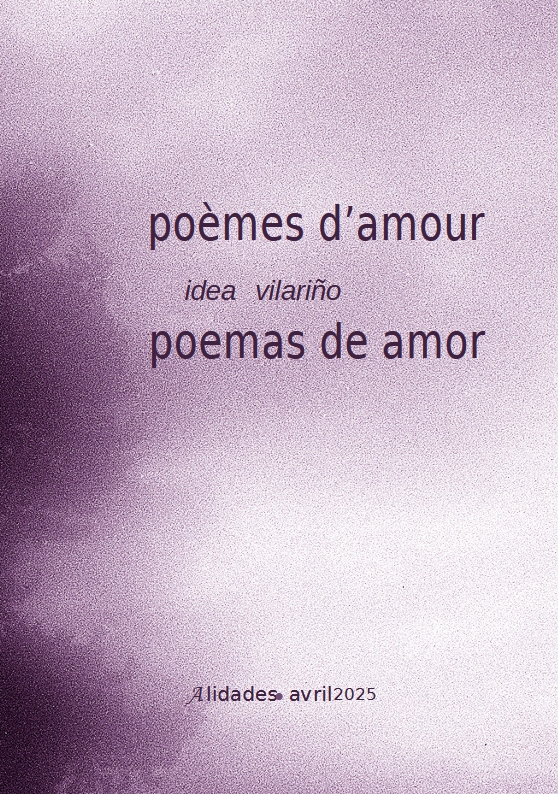

Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
|
|
|
Vient de paraître
mars 2025
|
|
|
|
La misère et la montée
du fascisme dans
l'Italie des années
1920-1930 les ont
assignés au voyage...
|
|
|
|
PARTAGE DES EAUX
L'épopée des bergers alpins à
saute-frontière
de Guillaume Lebaudy
dessins de Manuel Witt
|
|
|
Recueillies au tournant du XXIe
siècle, ces histoires de vies,
d’émigration, de travail et de
transhumance prennent
aujourd’hui la dimension
d’épopée dont les bergers alpins
de langue occitane ont été de
formidables conteurs. Et
puisqu’ils étaient à la fois des
« gens de moutons » et des
transhumants, c’est le rythme de
la marche – ce pas si singulier
des bergers qui règlent leur
allure sur celle des bêtes – que
nous entendons dans ces récits
chorals à forte teneur poétique.
Cette parole vive, souhaitons
qu’elle vous donne envie de la
dire à voix haute et, si
possible, en marchant, pour la
sentir vous traverser… comme une
rivière qui coule.
|
|
|
Caractéristiques
Un livre
de 184 pages au format 12,5 x 18
à la française, imprimé en
noir&blanc sur papier bouffant.Sortie en mars 2025, dans la
collection Hors-les-draillesisbn 978-2-37649-042-5 issn
2428-9248 prix public 15 €
Où
trouver l'ouvrage ?
Chez votre
libraire préféré (commande), ou
sur le
site de l'éditeur.
|
|
|
|
Bruno Msika
|
éditeur,
écologue
pastoraliste
|
|
|
|
19 rue Agricol Perdiguier 84000 Avignon
|
|
|
|
|
Retour
Viguier Jean-Louis, Tu,
poèmes, ed. Letras d’òc.Quelle belle surprise que la découverte d’un poète !
C’est en une édition bilingue par un éditeur local avec l’aide de la région
Occitanie qu’un public peut entendre les mots de Jean-Louis Viguier.
Ce poète occitan que les propres
enfants de l’auteur ont eux-mêmes découvert après sa mort, fut récemment donné à
la Cave poésie de Toulouse au cours d’une séance littéraire et musicale ou Eric
Fraj,
traducteur, chanteur en
occitan, catalan et français, fut accompagné d’un guitariste et d’un bassiste,
ainsi fidèle à l’origine de la poésie dite. Avec cette édition accompagnée d’un
disque,
il s’agit d’une déclinaison
d’adresses ou d’invocations à l’être aimé : Abans tu (avant toi), Per
tu (par toi) A tu (À toi) etc. durant dix-sept séries de morceaux
composés de lambeaux poétiques,
sortes de haikus ou plutôt
d’instantanés de cocktails émotifs ou clichés concentrés et explosifs. Difficile
de comprendre cette poésie comme l’est le surréalisme fait plutôt pour toucher à
l’inconscient où il tâche d’entrer et revenir.
On en est pourtant remué par cette
lecture qui distille une alchimie de la nature et du corps tirée bien-sûr de
l’esprit et du cœur qui la forgent.
En voici quelques bribes extraites
de Al luènh de tu (Au loin de toi) : « Absenta forma de memòria
(Absente forme de mémoire) / Uòo disparièr que giscla (Oeuf dissemblable
qui gicle)
Potz de remembres que miralhan
(Puits de souvenirs qui miroitent) / E mon còs ta cara carn de persèga
(Et mon corps ta chère chair de pêche) [...] »Ce qui parle de
l’absence de l’aimée,
ainsi déchiré et espérant, descend
tout droit des troubadours et leur amour de loin. Contrairement au bavardage
médiatique et même au discours scientifique,
en notre monde d’ores et déjà
condamné, souhaitons qu’il puisse être salutaire ce dit des profondeurs de
l’humain.
Francis Pornon
Retour

Retour


Retour

Retour
Les publications des éditions
Pierre
Mainard
souvent citées à l'émission "Les poètes" :
puis la collection de Littérature
occitane "Troubadours" et son
dernier titre
Cherche monde du troubadour Cercamon.
Distribution : Comptoir du
livre SPE - Paris :
détails
Retour
Ecouter l'émission de France Culture consacrée
à l'historienne
Marie Pierre Rey,
auteure de nombreux ouvrages,
Mainteneur de l'Académie des
Jeux floraux de Toulouse,
sur l’histoire de la Crimée
et la Mer Noire,
éclairant ainsi le
prolongement actuel des conflits d'aujourd'hui.
Retour

Lire la suite
Retour
Mhamed Hassani
nous communique :
Je vous informe avec plaisir
de la publication de mes dernières productions (un roman et un recueil de
poésie) sur Amazon.
N'ayant pas la possibilité de
me déplacer en France depuis 2019, pour vous présenter directement mes produits,
j'ai décidé de les rendre disponible sur Amazon.
J'espère que vous aurez la
curiosité de me lire.et de commenter.
Merci.
Mhamed Hassani poète
dramaturge romancier Kabylie Algérie.
-
Facebook
-
hassani-mhamed-aokas.overblog
https://amzn.eu/d/ch8LuUl
https://amzn.eu/d/gy70uCt
Retour

Retour

https://trobavoxeditions.com/discographie
Lire la suite
Retour
Pire est la mer que les déserts !Pierre Ech-Ardour
Avant-propos de Jean-Claude GayssotPréface de Jean-Pierre LacanAvec le concours d’Anthony Jean, photographe
voir doc« Ce recueil de poèmes nous aide à militer face à l’indifférence d’actes et de propos qui confortent la non-assistance criminelle au mépris de lois et des principes maritimes. » (Jean-Claude Gayssot.)
Pire est la mer que les déserts ! répond à une poétique du cri que déchaînent les circonstances dans l’âme du poète, pour donner lieu à des paroles bousculées tentant de dire l’indicible et l’incompréhensive catastrophe pour ces migrantes victimes,
dans un traumatisme insupportable pour le poète.
Parfois la révoltée parole, tant soit peu mesurée explose et déborde son auteur.
Dans le langage de l’utopie, le poète sait ô combien métaphores et images affichent son incapacité à être réalité. à valoir d’être dite, « cette image en lieu et place du monde », comme le dit Yves Bonnefoy, rend compte du tumulte intérieur qui habite le poète.
Pourtant il lui incombe de proférer la réalité du néant qui est sans mot et n’existe que dans chaque mot.
Conscient du piège du verbe poétique, le poète exhale l’inarticulable par son cri et son silence sans jamais trouver la forme du langage approprié.
Chaque poème charrie ainsi les limons de l’écriture conscients et viscéraux pour le poète et le lecteur.
Pierre Ech-Ardour réside à Sète.
Il a reçu le Premier prix de poésie 2018 décerné par les Gourmets de Lettres sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse.
Retour

Les commandes peuvent se faire auprès
des libraires ou auprès des éditions Méridianes -
editionsmeridianes@gmail.com ou 06 12 14 59 61
Bon de commande
Retour

Les commandes peuvent se faire auprès
des libraires ou auprès des éditions Méridianes -
editionsmeridianes@gmail.com ou 06 12 14 59 61
Bon de commande
Retour

Les commandes peuvent se faire auprès
des libraires ou auprès des éditions Méridianes -
editionsmeridianes@gmail.com ou 06 12 14 59 61
Bon de commande
Retour

Les commandes peuvent se faire auprès
des libraires ou auprès des éditions Méridianes -
editionsmeridianes@gmail.com ou 06 12 14 59 61
Bon de
commande
Retour

Les commandes peuvent se faire auprès
des libraires ou auprès des éditions Méridianes -
editionsmeridianes@gmail.com ou 06 12 14 59 61
Bon de commande
Retour

Les commandes peuvent se faire auprès
des libraires ou auprès des éditions Méridianes -
editionsmeridianes@gmail.com ou 06 12 14 59 61
Bon de commande
Retour


Les commandes peuvent se faire auprès
des libraires ou auprès des éditions Méridianes -
editionsmeridianes@gmail.com ou 06 12 14 59 61
Bon de commande
Retour
Revue Des PAYS
HABITABLES N° 11
Accompagné d'un numéro hors série, consacré aux poèmes de Kenneth
REXROTH sous le titre Les Constellations d'hiver, la onzième
livraison de notre revue est disponible.
En voici le sommaire :
Jacques Bibonne "Hommage
a Frida Khalo" / Éric Dussert Gabriel Gauny,
plantophile (1806-1889) Patrick Cloux Une
maison de campagne / Nicolas Boldych Souvenir
de Bourg d’Oisans // Florence Delporte
Histoire d’un ruisseau. Source de Bergheaud // Amélie B.
Amelie a tue-tête // Jacques Moulin En
lisant Pierre Peuchmaurd // Alfred Delvau La
Langue verte // Pascal Lenoir Le K //
La Rédaction Sur l’origine du « rêver vrai
» dans Peter Ibbetson // Maurice Joyeux
Andre Breton ou Le Chemin parallèle // Julien Starck
Le Manège de gravite. Note a propos de l’escalade //
Joël Gayraud La Falaise de Folégandros //
Anne-Marie Beeckman Devinette
En couverture, gravure de Louis Moreau (1883-1958) :
L’En dehors (ca. 1922). Exuberances intérieures de Gabrielle
Cornuault.
Des PAYS HABITABLES N°11, 86 pages, 14 € ISBN 978-2-912753-68-7
Kenneth REXROTH, Les Constellations d'hiver, poèmes traduits de
l'anglais (Etats-Unis) par Joël Cornuault, édition bilingue, 70 pages 14
€ ISBN 978-2-912753- 69-4
La revue est disponible en librairie. (à défaut, sur le site
Pierre Mainard édteur) Ou bien à notre adresse, où l'on peut
également s'abonner.
4, rue Sainte Barbe
03200 Vichy


REVUE SEMESTRIELLE
Naïveté Utopie Exubérance
Retour
Joël Vernet
Copeaux du dehors
Illustrations de Vincent
Bebert
éditions Fata Morgana (25 €)
Ce livre fera l’objet d’une prochaine émission
144 pages ‒
14 x 22 cm
Quelques larmes
sur les joues d’une vieille femme, la lumière argentée qui tinte dans les arbres
à cette seconde où un éclat m’apporte tout.
Je n’ai plus de
paroles à proférer. Je peux et sais enfin me taire. Je puise l’encre dans le
dernier silence. Désormais, le Dehors est un soleil écrivant tous les livres à
ma place.
Pendant l’errance
la contemplation agit comme un rabot. Des copeaux, fragments de l’esprit
enlevés au Dehors, se sont accumulés au fil de trois années de flânerie
dans les paysages hivernaux des Balkans.
Plein air et
vitesse : une écriture qui retient ce que les yeux voient. Des phrases de
lumière tirées de l’ombre de l’existence et de ses clameurs. Face à l’envol des
oiseaux, la musique de l’herbe ou les humeurs de la mer,
l’écrivain devient
chevreuil ou hirondelle, disparaît dans l’horizon qu’il toise. Taillés pour
n’être plus que l’essentiel, ces fragments célèbrent la symphonie de l’instant
où, dans une danse fugace, la vie se consume.
Chaque rencontre,
chaque regard, chaque remous est une réminiscence que le langage immobilise.
Joël Vernet est né
en Margeride dans un petit village aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère.
Dès les années 75, il entreprend plusieurs voyages qui le conduiront aux quatre
coins du monde.
Au fil des nombreux
ouvrages publiés, il développe un style singulier, entre la poésie et le journal
de voyage.
Il a vécu deux ans
à Alep en Syrie et vit depuis plus de vingt ans dans un tout petit village, non
pour s’éloigner du monde, mais pour en être plus proche.
En 2021, il
remporte le prix de poésie Heredia de l’Académie française pour L’oubli
est une tâche dans le ciel,
recueil en proses publié par nos soins.
Retour

Bon de commande Sacré. Dezeuze 20.1.25.pdf
Retour
Mars 2025 Hérault
Voir le
programme détaillé du festival de poésie de la foi à Montpellier :
Retour
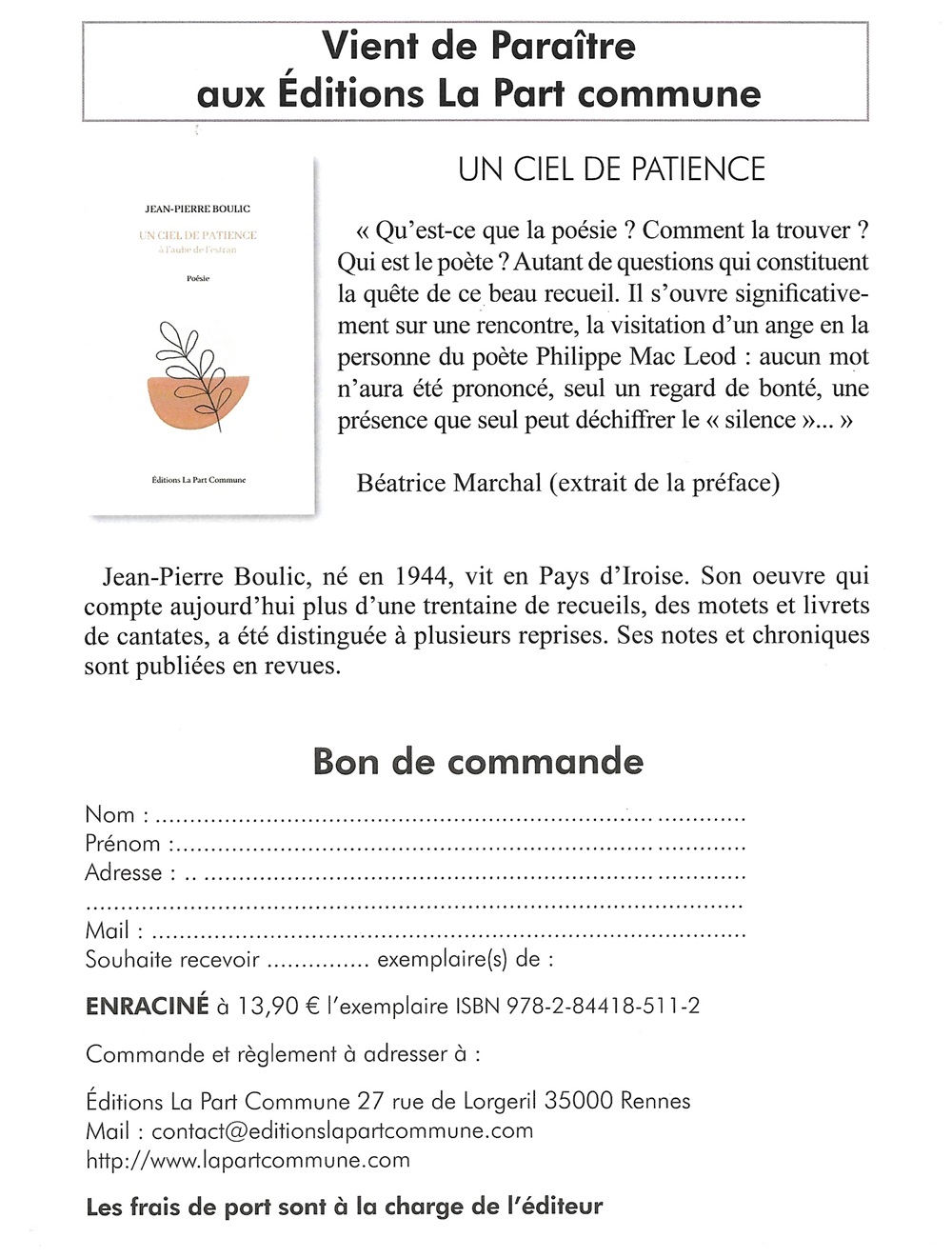
Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
|
|
1975-2025
50 ans d'édition
|
|
|
|
|
La « franchise rusée »
de Colette
|
Depuis sa naissance, sa mère ne
lui avait jamais coupé les
cheveux. Quand elle arriva à
Paris en 1893, sa natte était si
longue qu’elle frappait tous ses
interlocuteurs : Jules Renard
nous la représente après un
spectacle au théâtre de l’Œuvre,
au milieu de Rachilde,
Courteline, Maeterlinck et
Mallarmé, « traînant la corde
à puits de ses cheveux ».
Elle les aurait gardés ainsi
longtemps si son mari n’avait
décidé en 1892 qu’elle devait
ressembler à Polaire, l’actrice
qui portait les cheveux à la
garçonne et incarnait sur la
scène le rôle de Claudine. […]
Comment devenir soi-même quand,
à l’autorité sans partage d’une
mère, succède la férule d’un
mari ? Parée de l’innocence de
tous ses souvenirs d’enfance
campagnarde, Colette n’a pas
tardé cependant à trouver les
moyens de préserver contre tous
ce qu’elle avait de plus cher,
sa liberté. La popularité
inattendue de Claudine, le
personnage de ses premiers
romans, ne s’explique pas
autrement. La naïveté de la
jeune fille est sans cesse
démentie par ses attitudes
audacieuses et son indépendance
farouche. […]
Très vite, la provinciale est
devenue en fait une vraie
Parisienne, habituée de tous les
salons et salles de spectacle,
connue des gens du monde comme
des milieux artistiques. Dès ses
premières années à Paris, la
voici dans les cénacles de
Madeleine Lemaire et de Mme
Arman de Caillavet. Elle y
rencontre Proust, « jeune et
joli garçon de lettres » :
« De grandes orbites bistrées
et mélancoliques, note-t-elle,
un teint parfois rosé et parfois
pâle, l’œil anxieux, la bouche,
quand elle se taisait, resserrée
et close comme pour un baiser…
Des habits de cérémonie et une
mèche de cheveux désordonnée… »
Elle avoue cependant n’avoir
« guère de goût pour sa très
grande politesse » et ses
manières de « petit
complimenteur».
La
jeune provinciale a vite compris
les usages de la société
parisienne et, si elle ne s’y
est jamais sentie à l’aise,
n’ayant pas vraiment la culture
ni les manières pour y briller,
elle a promptement su comment y
jouer sa partie : «
L’instinct de dissimuler,
écrit-elle, ne s’est pas
taillé une part très large dans
mes différentes vies. Il
m’importait, comme à beaucoup de
femmes, d’échapper au jugement
de certains êtres, que je savais
sujets à l’erreur, enclins à une
certitude proclamée sur un ton
affecté d’indulgence. Un tel
traitement nous pousse, nous
femmes, à nous écarter de la
vérité simple comme d’une
mélodie plate et sans
modulations, à nous plaire au
sein du demi-mensonge, du
demi-silence et des
demi-évasions. » […]
« Nous femmes » : il
n’est pas si fréquent que
Colette se revendique de sa
féminité pour justifier son
comportement. Plus souvent elle
joue avec l’ambiguïté entre les
genres comme on le voit sur bien
des photos où elle se montre en
cheveux courts et pantalon. Mais
« demi-mensonge » veut
dire tout autant «
demi-vérité » : c’est une
autre manière de désigner cette
« franchise rusée » qui a
si bien réussi à Claudine et
fera la gloire de Colette. […]
Colette est consciente néanmoins
que sa culture d’autodidacte ne
va pas sans de graves lacunes en
bien des domaines. Aussi s’y
aventure-elle le moins possible.
«Il y a trois parures qui me
vont très mal : les chapeaux
empanachés, les idées générales
et les boucles d’oreilles. »
De même qu’on ne fait pas de
bonne littérature avec de bons
sentiments, elle a compris qu’on
écrit avec des mots et non avec
des idées. Elle en prend
volontiers son parti : « Un
esprit fatigué continue au fond
de moi sa recherche de gourmet,
veut un mot meilleur, et
meilleur que meilleur.
Heureusement, l’idée est moins
exigeante, et bonne fille pourvu
qu’on l’habille bien. » La
recherche forcenée du mot juste,
le souci de la phrase qui tombe
droit seront ses obsessions
permanentes. […]
Sans cesse, il faut retourner
aux choses, se situer au plus
près d’elles, pour ne pas se
laisser prendre au piège du
langage. Qu’un merle noir, «
oxydé de vert et de violet »,
se présente dans un cerisier, sa
mère Sido souffle aussitôt à
Colette : «Chut !…
Regarde !… » Se taire,
observer, Colette n’oubliera
jamais la leçon : « Nous ne
regardons, nous ne regarderons
jamais assez, jamais assez
juste, jamais assez
passionnément. » Les mots
viennent après, ils sont
toujours un peu à côté, en
porte-à-faux. Il faudrait que
les choses puissent parler
d’elles-mêmes, qu’elles soient
entièrement là dans ce qui est
dit : « Je me souviens,
écrit Colette à sa grande amie
Marguerite Moreno, qu’en
m’endormant un jour près d’une
petite rivière tumultueuse
(j’adorais dormir en plein air)
le langage de l’eau s’est
transformé, traduit en langue
humaine, quand j’ai passé de la
veille au rêve. Mais tout s’est
effacé au réveil, come il se
doit. » […]
Tout le monde était musicien
dans la famille de Colette et
elle-même voyait dans la musique
sa véritable vocation. Elle
jouait bien du piano et pouvait
à l’occasion accompagner une
chanteuse dans une mélodie de
Duparc. Critique musicale, elle
s’était rendue plusieurs fois à
Bayreuth. Par son mari, elle
avait connu Fauré et Debussy. À
la demande du directeur de
l’Opéra de Paris, elle avait
écrit le livret de L’Enfant
et les Sortilèges qui fut
mis en musique par Ravel et créé
à Monte-Carlo en 1925.
Elle qui n’avait pas eu pour
destin de composer, c’est en
musicienne qu’elle essayait
d’écrire, même si les mots ne
lui offraient qu’un matériau usé
: « Écrire, au lieu de
composer, c’est connaître la
même recherche, mais avec une
transe moins illuminée, et une
récompense plus petite. Si
j’avais composé au lieu
d’écrire, j’aurais pris en
dédain ce que je fais depuis
quarante ans. Car le mot est
rebattu, et l’arabesque de
musique éternellement vierge… »
[…]
Colette aime la métaphore du
jardinage, elle qui a eu tant de
jardins et y a investi tant de
temps et d’énergie : « Le
désordre dans les jardins que je
dirigeai fut toujours une
simulation. Un certain
échevèlement ne s’obtient
qu’avec la collaboration du
sécateur. » Il est agréable
que le jardin paraisse exubérant
de vie et de beauté sauvage et
dissimule autant que possible
l’intervention du jardinier. Pas
de plantes rares ni de tailles
savantes. Il est bon de faire
croire que tout s’est fait
spontanément. Demi-mensonge.
Il
est à cet égard chez Colette une
autre métaphore révélatrice :
celle du maquillage. On sait que
Colette a créé en 1932 une
marque de cosmétiques portant
son nom. Le premier institut de
beauté fut inauguré le 1er juin
à Paris au 6, rue de Mirosmesnil.
Une succursale ouvrit l’été
suivant sur le port de
Saint-Tropez. Colette y exerça
elle-même ses talents. Ce goût
pour les soins du visage n’était
pas nouveau chez elle. « Le
visage humain, écrit-elle, fut
toujours mon grand paysage. »
[…]
Nombreuses sont chez Colette les
métaphores de l’écriture. En
voici une autre : la pantomime.
Lorsqu’en 1905, la rupture avec
Willy est devenue fatale,
Colette a cherché un métier
nouveau qui puisse la
débarrasser de l’influence de
l’homme de lettres et assurer sa
subsistance. Elle décide
d’apprendre l’art du mime et
prend des cours auprès de
Georges Wague, héritier du
fameux Deburau que Jean-Louis
Barrault immortalisera dans Les
Enfants du Paradis, de Marcel
Carné. […] Au théâtre comme en
littérature, elle fait avec ce
qu’elle a : « On me reconnaît
une “mimique précise”, une
“diction nette” et une
“plastique impeccable”. C’est
très gentil. C’est même plus
qu’il n’en faut. » Comme sa
force en littérature est de
faire sentir le grain des
choses, son succès au théâtre
sera de s’en tenir à la partie
la plus physique du spectacle.
[…]
Le
journalisme pourrait être une
autre métaphore de sa manière
d’être écrivaine. Après le
théâtre, c’est la presse qui est
devenue vers 1910 son nouveau
gagne-pain. Elle y excelle. Au
fur et à mesure des années, elle
est accueillie par Le Matin,
Le Figaro, Vogue, Paris-Soir,
Marie-Claire… « Une
grande journaliste égarée dans
le roman », ira jusqu’à
écrire d’elle Jean Paulhan au
lendemain de sa mort. Qu’on ne
cherche pas cependant dans ses
articles des développements
intellectuels ni des exercices
littéraires : son style
particulier – et son apport au
journalisme – est de s’en tenir
aux faits. Tout son art se borne
à les faire ressortir par la
vivacité et la précision de
l’écriture.
Qu’elle assiste au procès de la
bande à Bonnot, elle essaie de
s’en tenir strictement à ce
qu’elle voit et dénonce chez les
accusés eux-mêmes le vertige de
mots dans lequel ils se sont
enfermés : « Le poison de la
littérature !… En lisant les
interrogatoires, en écoutant
parler les accusés, je ne puis
m’empêcher de voir en eux des
intoxiqués. Les moins atteints,
les plus incultes, cèdent au
besoin théâtral d’étonner le
jury et le public. »
Colette n’idéalise pas : elle
s’en est fait une règle en
toutes choses. Mais elle n’est
pas dupe non plus de ses
prétendues vérités : « Il
faut bien faire ce que l’on
peut, déclare-t-elle avec
malice, non pas pour mentir –
ce n’est pas pour le plaisir du
mensonge –, mais il faut bien
tromper un peu ses meilleurs
amis. »
Gérard Pfisterextraits
de la préface du livre Ainsi
parlait Colette
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES
TROIS NOUVEAUTÉS
DU
MOISEn
librairie le
jeudi 9 janvier
2025Distribution
Sodis –
Diffusion
Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joseph Conrad
et Ford Madox
Ford Les
Héritiers du
mondeROMANTraduit
de l'anglais par
Paul
DecottigniesCollection Le
Rouge & le NoirISBN
978-2-845-90380-7
– 288 pages –
18,5 €
|
|
|
|
Totalement
inédit en
français, Les
Héritiers du
monde (The
Inheritors) a
paru en 1901, juste
après deux des
chefs-d’œuvre de
Conrad, Au
cœur des
ténèbres
(1899) et
Lord Jim
(1900).
D'une frappante
actualité, ce
récit
prophétique et
haletant dénonce
les
techniques de
désinformation
et de
manipulation
qui, d’un
populisme à
l’autre, ne
cessent de
menacer les
démocraties.
Avec une
étonnante
maestria, Conrad
et Ford tissent
une intrigue à
trois niveaux :
un financier
philanthrope et
mégalomane mène
une campagne
inter-nationale
pour exploiter
les ressources
du
Groenland ; un
noyau
d’activistes
cherche à
compromettre le
gouvernement
britannique pour
discréditer sa
«politique de
la raison »
; par un subtil
jeu d’échecs,
une femme
fascinante et
cynique les
manœuvre tous à
ses propres
fins.
Qui sont ces
« Héritiers du
monde »,
dont elle se
revendique ?
« Nous sommes
l’Inévitable,
affirme-t-elle,
et vous ne
pouvez rien
contre nous. »
Le plus étonnant
dans ce roman,
c’est que cette
histoire qui
ressemble à
La Guerre des
mondes (H.
G. Wells était
un ami de
Conrad) ou à une
dystopie sur les
cyberdictatures,
se fonde sur la
situation du
Congo belge,
riche en or,
pétrole et
autres
ressources, tel
que Conrad l’a
découvert
lorsqu’il y a
été embauché
comme capitaine
de steamer en
1890.
Le personnage
central des
Héritiers du
monde, est
fortement
inspiré du roi
Leopold II,
« sorte de
philanthrope
mégalomane »
qui pillait sans
scrupule cette
terre devenue
son bien
personnel. Le
Groenland du
roman transpose
ces souvenirs du
Congo. Exploiter
les richesses du
Groenland en
jouant entre les
grandes
puissances,
est-ce un hasard
si c’est le
thème de la
quatrième saison
de la fameuse
série danoise Borgen ?
Voir la double
page de Mathieu
Lindon dans
Libération
des 4-5 janvier
: Conrad, le
futur est-il
pour demain ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ColetteAinsi
parlait ColetteDits
et maximes de
vie
Textes choisis
et présentés par
Gérard Pfister
Collection
Ainsi parlaitISBN
978-2-845-90379-1
– 192 pages –
14 €
|
|
|
|
La littérature
française compte
quatre
écrivaines
majeures :
Madame de
Sévigné, Madame
de Staël, George
Sand et Colette.
De ces
quatre-là,
Colette est la
seule dont
l’œuvre est très
largement lue
aujourd’hui
encore.
Écrivaine
populaire, et
qui le reste
avec les
Claudine et
les Chéri,
Colette est
devenue grâce à
sa liberté
d’esprit et la
puissance de son
écriture, une
sorte
d’équivalent
féminin de son
grand
contemporain
Marcel Proust.
Colette aimait
pourtant à dire
qu’elle n’était
devenue
écrivaine que
par hasard :
« Dans ma
jeunesse je n’ai
jamais, jamais
désiré écrire. »
Mais à l’âge de
20 ans, elle
épouse
Gauthier-Villars
(Willy) et
devient l’un de
ses multiples «
nègres ». Sa
vocation, nous
dit-elle, était
tout autre :
«Née d’une
famille sans
fortune, je
n’avais appris
aucun métier. Je
savais grimper,
siffler, courir,
mais personne
n’est venu me
proposer une
carrière
d’écureuil,
d’oiseau ou de
biche. »
Colette n’a pas
fréquenté, comme
les autres
grands écrivains
de sa
génération, les
grands lycées
parisiens. Sa
scolarité s’est
arrêtée
lorsqu’elle
avait 16 ans.
Elle a toujours
gardé l’accent
bourguignon :
cette « voix
de syrinx,
écrivait Aragon,
où perchait /
Avec toutes les
variations d’un
/ Beaune / Le
roulement des r
comme un vin
dans le chai ».
Sans cesse,
écrivait-elle,
il faut
retourner aux
choses: «
Nous ne
regardons, nous
ne regarderons
jamais assez,
jamais assez
juste, jamais
assez
passionnément. »
Ce qui rend
vivantes toutes
choses, c’est
une certaine
vibration qui
est en elles, un
rythme. Colette
jouait bien du
piano et a écrit
le livret de
L’Enfant et les
Sortilèges
de Ravel.
C’est chez sa
mère qu’elle a
trouvé la force
de cette liberté
indomptable.
« Marcel Schwob,
déclarait-elle,
m’appelait “la
béguine aux
scrupules”. Et
il est vrai que
je mets des
scrupules un peu
dans tout. Je
cache mes
scrupules sous
un peu de
cynisme. »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pierre DhainautEt
pourtantsuivi
de Ajouter du
noir, ou non
et de Ce qui
doit venirCollection Les
Cahiers d'ArfuyenISBN
978-2-845-90381-4
– 144 pages –
15 €
|
|
|
|
|
|
|
Forte de quelque
50 ouvrages
publiés depuis
plus de 50 ans,
l’œuvre de
Pierre Dhainaut,
inaugurée avec
Le poème
commencé (Mercure
de France, 1969)
apparaît
aujourd’hui
comme l’une des
œuvres majeures
de la poésie
française
contemporaine.
Après Prières
errantes
(1990),
Fragments et
louanges
(1993),
Introduction au
large
(2001),
Entrées en
échanges
(2005),
Levées
d’empreintes
(2008), Plus
loin dans
l’inachevé
(2010),
Rudiments de
lumière
(2013) et Et
même le versant
nord (2018)
et Ici (2021),
Et pourtant est
le dixième
recueil de
Pierre Dhainaut
que publient les
Éditions Arfuyen,
témoignage d’une
profonde
affinité et
d’une relation
privilégiée.
« L’air /
demande / une
aide, / les
poèmes / parfois
/ l’exaucent. »
Il n’est pas
de meilleure
image de la
poésie de
Dhainaut que
cette large et
généreuse
respiration que
donnent les
immenses plages
de la mer du
Nord. Mais que
faire quand
l’air lui-même
vient à manquer,
quand lui-même
appelle à l’aide
?
Pour éviter
l’étouffement,
le poète ne peut
compter alors
que sur les
mots. Mais ce
n’est que «
parfois » que
vient par eux «
l’exaucement ».
Le poète n’en
sait que trop
les limites:
« Aucun mot ne
nous a sauvés,
quelques-uns /
malgré tout
persistent,
palpitent. »
Le poète est
lucide, et
pourtant,
pourtant demeure
convaincu que
« seul un poème
/ rend
l’inquiétude
heureuse ».
Pourquoi ? C’est
ce que dit le
poème final du
présent recueil
: « Une voix
est en nous sans
être à nous : /
dans la
traversée des
poèmes ».
Cette voix-là
nous libère et
nous la libérons
: « nous la
dilapidons, nous
l’aidons à vivre
». Quelque
chose se passe
dans le poème
qui nous dépasse
et le dépasse,
et nous fait
comprendre cette
vérité : «
Rien ne
commence, rien,
ici ou ailleurs,
/ on reçoit un
écho, de qui,
pour qui ? »
Ce qui se
produit dans le
poème est la vie
elle-même : «
Rien / n’est
dit, / rien
encore, /
l’ignorance /
pour lumière».
Nous sommes
hôtes de ce
monde, comme les
mots sont hôtes
de cette voix
inconnue : «
Nous n’avons
droit qu’à
devenir des
hôtes, /bonjour
la boue qui luit
après la neige /
et bonjour la
poussière, la
chute / étant
une autre
incarnation du
vol. »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TROIS LIVRESÀ
REDÉCOUVRIRDistribution
Sodis – Diffusion Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marcel
ProustAinsi
parlait Marcel
ProustDits
et maximes de
vie
Textes choisis
et présentés par
Gérard PfisterCollection
Ainsi parlaitISBN
978-2-845-90305-0
– 192 pages –
14 €
|
|
|
|
Marcel Proust
(1871-1922) tend
à devenir
aujourd'hui la
figure par
excellence de
l’écrivain, à
travers une
œuvre totale qui
résumerait à
elle seule toute
la littérature.
Proust est à lui
seul, a-t-on
dit, toute la
littérature
comme Bach est à
lui seul toute
la musique. On
trouve en son
œuvre toute la
modernité, et
toute la
tradition
classique.
On sait le goût
qu’il avait des
moralistes comme
Pascal, La
Rochefoucauld ou
La Bruyère.
Bernard de
Fallois, l’un
des meilleurs
connaisseurs de
l’œuvre de
Proust, a publié
dans son
Introduction à
la Recherche du
temps perdu
un large choix
de maximes et de
pensées de
Proust, qui
atteste qu’il
est aussi, dans
la concision et
la lucidité, le
parfait
continuateur des
moralistes du
Grand Siècle.
Au reste
voulait-il
vraiment écrire
un roman ?
« J’ai trouvé
plus probe et
plus délicat
comme artiste,
écrit-il à
Jacques Rivière
en 1914, de
ne pas laisser
voir, de ne pas
annoncer, que
c’était
justement à la
recherche de la
Vérité que je
partais, ni en
quoi elle
consistait pour
moi […]
Ce n’est qu’à la
fin du livre, et
une fois les
leçons de vie
comprises, que
ma pensée se
dévoilera. »
A travers
l’imposante
masse de l’œuvre
de maturité, des
textes de
jeunesse et de
la
correspondance,
ce nouveau
volume de la
collection
Ainsi parlait
fait clairement
apparaître
l’essentiel de
ce que Proust
voulait
transmettre à
ses lecteurs :
des « leçons
de vie » et
plus largement
une
« pensée ».
« Au fond,
notait Proust en
1909, toute
ma philosophie
revient, comme
toute
philosophie
vraie, à
justifier, à
reconstruire ce
qui est.»
Quelle sont les
sources de cette
pensée ? On s’en
tient souvent à
son lien
familial avec
Bergson, c’est
oublier qu’il a
suivi lui-même
des études de
philosophie à la
Sorbonne et que,
admirateur de
Wagner, il s’est
également
passionné, comme
le montre la
préface du
présent volume,
pour la
philosophie
allemande, de
Schelling à
Schopenhauer.
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Elizabeth von
ArnimUn
été en montagneROMANTraduit
de l'anglais par
Paul
DecottigniesCollection
Le Rouge & le
NoirISBN
978-2-845-90366-1
– 240 pages
– 17 €
|
|
|
|
|
|
|
Cet ouvrage est
le premier d’une
collection
nouvelle : « Le
Rouge & le
Noir ». Le titre
fameux de
Stendhal en
suggère
l’orientation :
des textes de
fiction (romans,
nouvelles,
récits),
français et
étrangers,
modernes ou
contemporains.
Cousine de
Katherine
Mansfield,
Elizabeth von
Arnim
(1866-1941) fait
partie de ces
romancières
britanniques qui
ont imposé un
ton nouveau dans
la littérature
comme Virginia
Woolf, Vita
Sackville West,
Ivy
Compton-Burnett
ou Elizabeth
Bowen. Une large
partie de son
œuvre a été
traduite en
France, chez
Bartillat,
10/18, Plon,
Mercure et
Belles-Lettres.
Trois films ont
été tirés de ses
romans Avril
enchanté et
Mr.
Skeffington.
Totalement
inédit en
français, Un
été en montagne
(In the
Mountains) a
paru en 1920,
deux ans avant
son livre le
plus connu
Avril enchanté (Enchanted
April).
Arnim y est au
sommet de son
art, fait d’une
écriture
familière et
fluide,
artistement
improvisée, et
d’un ton plein
d’humour, de
finesse et de
nostalgie.
Pétillante comme
le champagne.
Juillet 1919 :
la narratrice
arrive à son
chalet de
montagne, dans
le Valais suisse
qu’elle n’a pas
revu depuis le
1er août 1914.
Fatiguée et
déprimée, elle
s’effondre dans
l’herbe avant
même de franchir
le seuil. «
C’est tellement
humiliant d’être
à ce point
bouleversée. Je
me sens aussi
ridicule que
malheureuse ;
comme si
quelqu’un avait
pris mon visage
et l’avait
frotté de
poussière. »
Mais tout de
suite, grâce à
la magie de
l’écriture
d’Elizabeth von
Arnim, le
paysage est là.
Naguère
bruissante de
gaieté, la
maison est à
présent
silencieuse.
Seuls avec la
narratrice, le
couple de
gardiens qui
voit d’un
mauvais œil
qu’on vienne
déranger ses
habitudes. Ils
parlent en
français dans le
texte, d’où de
savoureux
dialogues où
l’élégante
Londonienne se
retrouve
souvent, malgré
son humour et sa
bonne volonté,
en position
difficile.
Mais cette sorte
de tranquillité
ne durera pas :
une situation
des plus
étranges
s’instaure avec
l’arrivée de
deux femmes
venues de nulle
part et marquées
par un lourd
secret. Kitty,
terriblement
convenable et
polie, et Dolly,
sa cadette,
toujours
souriante et
silencieuse.
Au premier
étonnement,
succède
l’inquiétude et
une brûlante
curiosité. Le
huis clos
devient
confrontation et
se développe en
une enquête
quasi policière.
L’art
d’Elizabeth von
Arnim, d’une
fascinante
finesse
psychologique et
d’une
réjouissante
ironie, est de
nous entraîner
jour après jour
à sa suite.
Jusqu’à une fin
imprévisible et
merveilleusement
« british ».
|
|
|
|
|
|
|
Alain RousselLe
texte impossible
suivi de Le
vent effacera
mes tracesCollection
Les Vies
imaginairesISBN
978-2-845-90353-8
– 108 pages
– 13,5 €
|
|
|
|
La
collection
Les Vies
imaginaires
se consacre aux
textes
appartenant à la
vaste zone
intermédiaire
entre
autobiographie
et création.
Le texte
impossible,
d’Alain Roussel,
se situe
précisément à
cette jonction
de
l’autobiographie
et de la
création, l’une
et l’autre se
nourrissant
mutuellement
sans pouvoir
jamais
coïncider.
Et c’est cette
impossibilité
même de
coïncider jamais
avec le texte
qui fait écrire
encore et
toujours :
« Le texte
impossible, je
ne l’écris pas
réellement, je
vois bien que je
ne peux
l’écrire, qu’il
est condamné à
battre de l’aile
contre la vitre
de la vie
quotidienne sans
pouvoir la
briser. » On
croit pouvoir
rendre compte du
réel, en faire
un portrait
fidèle et exact.
On ne fait que
créer une autre
réalité
parallèle à la
première et qui
jamais ne la
rejoint.
Le texte
impossible
ne pouvait être
écrit que dans
la lumière
provençale.
L’auteur arrive
à Arles début
septembre 1974.
Il ne
connaissait pas
cette ville.
Qu’il guette de
sa fenêtre, dans
le lointain,
l’abbaye de
Montmajour et
les Alpilles,
qu’il arpente
les rues en
dédale ou longe
le Rhône, tout
l’appelle. Il
ressent comme un
irrésistible
besoin d’écrire.
Ce qui se passe
en lui, il ne le
sait pas
vraiment. Il y a
ce tumulte
intérieur, ce
tourbillon de
mots qui ne
demande qu’à
être canalisé
dans des
phrases.
Mais qui parle ?
Est-ce lui ou un
autre qu’il
porte en lui
depuis toujours
sans le savoir?
Est-ce la
pensée, dans sa
part inconnue,
qui cherche à
prendre ancrage
? Est-ce la
ville qui, à
travers lui,
cherche une voix
pour se dire ?
Et puis, en fil
d’Ariane, il y a
cette femme
mystérieuse dont
tout le livre
est la quête, la
femme avec
laquelle il vit
un amour
impossible – ce
grand mutisme
blanc qui est le
sien – et qu’il
cherche à
réinventer avec
les mots dans
les femmes qu’il
croise ? Mais
que peut la
parole quand
l’amour se meurt
?
Le texte
impossible a
d’abord été
écrit
directement sur
stencil, donc
sans possibilité
de correction,
dans une sorte
d’euphorie.
Imprimé sous
cette forme très
rudimentaire,
tiré à quelques
exemplaires, il
l’enverra à
quelques
personnes,
poètes et
écrivains, dont
il devra
chercher parfois
l’adresse dans
l’annuaire. À sa
grande surprise,
les réponses
affluèrent,
toutes
élogieuses :
Roland Barthes,
Adrien Dax, René
Nelli, Henri
Chopin (la
poésie sonore),
José Pierre,
Jacques Lepage,
Robert Lebel…
Gherasim Luca
lui enverra son
premier disque
artisanal, sur
support souple,
«Passionnément
», avec une
dédicace. Publié
en 1980 d’une
façon très
confidentielle
par «
inactualité de
l’orage », il
connaît un
accueil
similaire, avec
les réponses de
Joyce Mansour,
Vincent
Bounoure,
Jean-Michel
Goutier
notamment.
Cette nouvelle
édition du
Texte impossible
a été
entièrement
revue, sans
trahir le texte,
et en ajoutant
d’autres
textes-poèmes,
de nature
souvent
autobiographique,
qui viennent
apporter un
éclairage
supplémentaire,
indispensable.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retour
2024
Retour
Notre amie
Cathy Garcia Canalès qui
anime la revue de poésie vive
"Nouveaux Délits"
est très
heureuse de pouvoir vous annoncer une double parution :

Où il est question de codes, de
cases qui ne coïncident pas, ne collent pas ou collent trop
; asphyxie ; où il est question de contentions qui finissent
par provoquer de violentes fuites de poésie ; où il est
question d’accepter les turbulences pour ne jamais se
résigner à l’inacceptable, accepter des disjonctions parfois
brutales. Savoir que la plus grande force d’un
disjoncteur bipolaire est sa capacité à résister à des
courants pollués importants. Où il est question de ne
jamais renoncer à cultiver l’harmonie, la justesse et
l’équilibre.« L’ourse n’a jamais été bipolaire — polaire
parfois, égarée sur les banquises du monde — mais c’est une
ourse qui a toujours refusé le dressage pour le cirque et
les barreaux des zoos, une ourse triste qui piste la source
et une ourse de joie, oui, sauvage oui, et douce aussi comme
le miel. Les griffes et les crocs, c’est surtout contre
elle-même qu’elle les a usés. Aujourd’hui, c’est une vieille
ourse — plus sage peut être — qui vous regarde et elle a
enfin trouvé une tanière. »
*
56 pages, œuvre en couverture de l'auteur : Exorticare,
2024, 14 €
s
Au fond du tiroir d’un meuble
ancien, oublié dans le grenier d’une maison abandonnée, sont
des poèmes, oubliés eux aussi, qui sentent la naphtaline, la
vieille encre et le papier jauni. Des poèmes surannés qui
évoquent des temps qui n’existent plus. D’ailleurs, la poète
qui les a écrits, les a-t-elle vraiment vécus ces temps ou
simplement imaginés ? À lire dans le rai de lumière qui
traverse la toiture délabrée avant de les laisser retomber
en poussière. Au fond du tiroir, restera un vague parfum de
rose ou peut-être de violettes.
Il y a là-haut sur la colline
Une chatte qui met bas
Le
clocher a sonné douze fois
La
nuit s'enroule dans un drap
Au fond du tiroir a d’abord
été mon LivrArt n° 2, achevé à St Cirq-Lapopie, le 27
novembre 2012. J’ai rajouté ici un onzième poème aux dix qui
figurent dans le livre d’artiste originel. Il aura fallu 12
ans pour qu’il se retrouve entre de très bonnes mains et je
voulais attendre ce moment pour en faire le livre imprimé
que voici.
*
28 pages, 13 illustrations en couleur
tirées du livre d’artiste original, 12 €
Les deux livres
sont édités et imprimés par moi-même sur papier 100 %
recyclé, à réserver par mail ou par courrier (attention
mon adresse a changé : 415 Route de la Grèze 46300 SOUCIRAC).
Règlement par chèque ou virement. Port pour un : 3 €, pour
les deux : 5 €.
Merci de soutenir la
création et les circuits courts !
Belle fin d'année à toutes
et tous !
Cathy Garcia Canalès
Ces deux livres feront l'objet d'une émission "Les poètes".
Retour

Le dernier livre
d'Elisabeth Aragon
"Les pas ombrés"
sur le thème de l'exil
aux éditions Azart Atelier
est en souscription

SOUSCRIPTION les pas ombrés NOV 2024
Retour

-
Retour
https://lespoetes.site
Novembre ! C’est la première fois en 21 ans que Nouveaux
Délits paraît avec un mois de retard ! Ce qui est à retenir
aujourd’hui, c’est que la revue a changé d’adresse (voir le
bulletin de complicité, qui occupe comme à son habitude la
dernière page).
Le monde
s’enguerre et s’abêtit désespérément et les vies se compliquent,
basculent, explosent parfois très soudainement et j’ai la
sensation que c’est un phénomène qui touche ou a touché
énormément de personnes en cette déjà finissante année 2024 et
pas seulement sous les bombes. Ceci dit, si les dénommées
« infos » servent à quelque chose, ce pourrait être de nous
apprendre à relativiser justement nos problèmes et apprendre à
mieux apprécier ce qui EST ou tout au moins à mieux accepter ce
que nous ne pouvons changer tout en continuant à améliorer avec
ténacité tout ce qu’il nous est possible d’améliorer en nous et
autour de nous. La douleur est plus difficile à relativiser car
elle n’a rien à voir avec le mental, qu’elle soit physique,
psychologique, émotionnelle ou tout à la fois, chacun fait face
comme il peut. Perte, deuil, trauma. Trauma qui vient
d’une forme étendue de la racine indo-européenne terə,
qui signifie frotter, tourner, avec des dérivés qui font
référence à la torsion, la perforation, tout ce qui blesse mais
aussi au battage des céréales, au frottement qui leur fait
perdre leur enveloppe. L’analogie est très intéressante et
d’ailleurs anciennement cela se faisait à l’aide de fléaux…
Alors,
oui ! La vie peut nous frotter, nous tordre, nous perforer, nous
battre, nous faire mal à devenir foufolle et alors se pose la
question du sens. Je ne parlerai pas pour les autres, je vais
juste parler pour moi : chaque épreuve dans ma vie — et elles
ont commencé très tôt — m’a amenée peu à peu à creuser au-delà
de l’apparente et souvent réelle injustice, à fouiller au-delà
de la dégueulasse malchance, à chercher un sens bien au-delà des
limites de ce que je pouvais supporter ou pensais pouvoir
supporter. C’est à ce creusage, fouillage, à cette marche forcée
par les événements, par la collision des inconsciences, que je
donne le nom de spiritualité. Car c’est là que commence le
choix, notre choix : grandir ou pourrir.
Je n’ai
pas d’église, pas de religion, c’est avec les mains dans la
terre ou en marchant avec elle que je ne fais qu’un avec ma
spiritualité. L’essentiel est contenu dans la graine et dans
toutes ses transformations. Un cycle qui, à chaque nouvelle
germination, rend une plante plus forte, plus féconde, plus
résiliente mais pour cela la graine doit se défaire de son
enveloppe dans l’obscurité sans savoir si elle reverra la
lumière. Sans quoi, elle pourrit. Nous, humain-es, sommes aussi
des graines.
CGC
un vieux
jardinier m'offre des courges tardivesqui devinerait que le
vieillard oisiffait de sa vie une longue ivresse ?
Lu Yu
Pour voir
le sommaire et + c'est ici :
http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/archive/2024/10/30/nouveaux-delits-n-79-6520970.html
***
Les
Délits buissonniers
Une belle
collection hors des sentiers battus
à
découvrir absolument !
Feu de tout bois
de Murièle Modély, illust. Sophie Vissière
Instantanés de Myriam OH, illust. Silvère Oriat Petite
histoire essentielle de la futilité de Bruno Toméra, illust.
Jean-Louis Millet
Printemps captif
de Lionel Mazari, illust. Morgane Plumelle
Paraît que
d’Heptanes Fraxion, illust. Jimmy Fortier
La cloche a sonné
d’Aline Recoura, illust. Ludo Godot
Des ombres et des anges
de Josette Soulas Moyes, illust. Philippe Chevillard
Plus de
détails ici :
http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/delits-buissonniers/
à
commander aux éditions NOUVEAUX DÉLITS
415
Route de la Grèze – 46300 SOUCIRAC
10 € +
port 3 €
Règlement
par chèque ou virement
Retour


Retour
Jean-Claude Ettori au
Festival international de poésie
à TROIS RIVIÈRES
au Québec
(40 ème année)

Retour
La dernière publication
de Jean-Claude Ettori
Retour
Ce livre des
éditions Levant fera l’objet d’une prochaine émission.
Disponible en
librairie ou à commander sur https://editions-levant.net/
Anne Rothschild
Quel monde à venir ?
Poème
éditions Levant

A prendre sous
une forme interrogative ou exclamative, le titre du recueil d’Anne Rothschild
nous appelle à découvrir un monde qui brûle ou se perd. Nos racines happées par
l’oubli ou le déni garderaient - elles la nostalgie des ailes de l’oiseau ? Nous
est-il pas enjoint de témoigner de sa lumineuse présence, et de rester des
passeurs de rives et de rêves ? Tel est le monde à venir, telle la route
solitaire du poète, en premier ou ultime lieu, qui se dessine entre les lèvres,
pour ouvrir la porte du ciel, comme les oiseaux et les anges. Garder le sens de
l’énigme et la fidélité de l’amour, en dépit des remous et du chaos, pour
réparer le monde, et sauver sa beauté. Le poème redevient chant et prière pour
le poète, kaddish de deuil, mais éminemment de vie, pour ne pas oublier et
célébrer un espoir de réparation, et bâtir enfin, entre les nuages, une maison
de paix pour les vivants.
Michel
Eckhard Elial

Anne Rothschild
Une femme
interpelle l’être aimé, dont elle a été séparée, sur le pourquoi du chaos, des
guerres, de la violence et du déclin de la planète.
Quel sera le «
monde à venir » ? En hébreu, ce terme désigne tout autant le futur que les temps
messianiques. Survient une huppe, oiseau mythique à l’origine de la rencontre de
la reine de Saba et du roi Salomon. Le premier jour, l’oiseau frappe à la
fenêtre avec son bec. Le deuxième, il pénètre dans la pièce, « puis d’un envol
brusque ouvre une voie d’énigmes ». La femme est bouleversée. Elle interprète
cette irruption comme un présage. Et si l’amour retrouvé permettait de réparer
le monde… Biographie Anne Rothschild allie l’écriture à un travail de graveur
et sculptrice. Elle a publié de nombreux ouvrages de poésie et récemment un
essai : « Conversations avec mes arbres » au Passeur. Son travail est axé sur la
rencontre avec l’autre. Il invite à construire un espace de paix entre juifs,
chrétiens et musulmans.
****
Les Editions Levant :
“Du carrefour
multiséculaire étreint par les flux d’une Méditerranée intempérante ou
d’alliance, confluence de rives aux cultures attenantes, depuis l’imprévisible
Orient d’où fleurent sémitiques écriture nombre et parole, les Éditions Levant
lèguent les porteuses racines du sens d’un parcours plus que trentenaire. Les
Éditions Levant offrent ce dialogue des cultures et des écritures
méditerranéennes, gorgées de signes, de paroles et d’incendies. Attentives
écoutes en l’écrin d’une historique, culturelle, littéraire et artistique
réflexion, ses parutions n’ont toutes cessé de traduire les vivantes créations
d’une mosaïque dispersée en l’espace et le temps. Le catalogue des Éditions
Levant illustre à sa manière les chemins d’une poésie bercée au rythme des trois
rives de la Méditerranée, jardins d’inspirations.”
Dans la
Bibliothèque du Levant :
Revital Berger Shloman,
Femme
Hébraïque,
2022 Ronny Someck et Michel Eckhard Elial,
La poésie n’est pas une
métaphore,
2023 Pierre Ech-Ardour,
Vespérales élégies,
2024 Pierre Ech-Ardour,
Ramenez-les à la maison,
2024 Seuls
les oiseaux,
Laurent Delabesse, 2024
Retour
|
Avec les éditions Jas sauvages,
cultivons la foi, spirituelle ou
humaniste, dans tous ses dialogues
|
| |
| |
|
|
|
La saison commence très fort en
poésie de la foi à Nîmes et en
amitié poétique dans la Gardonnenque
|
|
Quelques comptes rendus avec les
articles suivants de Laure Gareil,
Jacqueline Assaël et Odile Godin
|
|
|
|
|
|
La paroisse de l'Église proteste
unie de Marseille sud est ouvre son
programme culturel |
|
par une conférence de Jean Alexandre
sur son livre "Dieu et son aide", le
24 novembre |
|
|
|
|
|
Dans la série: "De grands projets
sont en préparation". 1. |
|
Un sixième Festival de poésie de la
foi, du 20 au 23 mars 2025, pendant
le "Printemps des poètes", dans la
paroisse de l'Église protestante
unie de Jacou (ensemble de
Montpellier) et au Carrousel de
Montpellier, avec Jean Alexandre,
Jacqueline Assaël, Michel Block,
Éric Chassefière, Philippe François,
Joëlle Nicolas, Yves Ughes... Sur le
thème des jardins bibliques. Plus de
renseignements ultérieurement. |
| |
|
|
|
Dans la série: "De grands projets
sont en préparation". 2. |
|
Une deuxième "Rencontre
Théo-Lettres" dans la paroisse de
l'Église protestante unie de
Marseille sud est, sur le thème de
"l'Esprit dans la Bible", avec Jean
Alexandre, Jacqueline Assaël, Benoit
Benhamou, Christian Boudignon, Yves
Parrend, Céline Rohmer, Jonathan
Thiessen... Du 16 au 18 mai 2025.
Plus de renseignements
ultérieurement. |
| |
|
|
|
Et bien d'autres rencontres sont
prévues... |
|
N'hésitez pas à prendre contact pour
organiser une rencontre près de chez
vous! |
|
|
|
|
|
Retour


Voir émission du 17/10/2023
.jpg)
Retour
Belvedere 73
Juillet- Septembre 2024
est arrivé
voir
Retour


Retour
Jean-Luc Pouliquen
traduit en anglais :

Retour
Ce livre fera l'objet
d'une prochaine émission
Bon de commande
Retour

 Nouveauté
de fin d'été :NOS
CAUCHEMARS SONT CALMES COMME DES OISEAUX ENDORMISPoèmes
de Francis CoffinetAvec un
poème dédicace de Benoît Gréan.Postface d'Emmanuel GodoISBN 978-2-494935-08-2 –
40 pages, 6,00 €.
Nouveauté
de fin d'été :NOS
CAUCHEMARS SONT CALMES COMME DES OISEAUX ENDORMISPoèmes
de Francis CoffinetAvec un
poème dédicace de Benoît Gréan.Postface d'Emmanuel GodoISBN 978-2-494935-08-2 –
40 pages, 6,00 €.
"Des cauchemars calmes, des
ombres lumineuses, des envolées immobiles, des départs qui recentrent : les
poèmes de Francis Coffinet nous conduisent à un lieu profondément humain –
dans les parages immédiats de nos blessures, de nos désirs, de nos amours.
Car oui, «les êtres
que nous aimons sont des navires de haute mer». Il faut redire, en ces temps
persistants de disette langagière et spirituelle, ces paroles qui, elles
aussi, sont des navires de haute mer.
Et il faut le dire
avec des mots qui aient de la gueule. Pas avec de la fadeur barattée entre
le terne et le monotone mais avec de la flamboyance, du panache. Car être
homme, ce n’est pas rien.
La poésie de Francis
Coffinet a de l’audace, la belle audace mesurée, patientée, mûrie à la
confrontation des grands autres, à l’image de ce titre, admirable : « Nos
cauchemars sont calmes comme des oiseaux endormis »." (Emmanuel Godo).
Acteur, poète et plasticien, Francis
Coffinet a publié une vingtaine de livres à ce jour et a participé à de nombreux
livres d’artiste,
notamment avec les peintres et
graphistes Jean-Pierre Thomas, Thérèse Boucraut, Jérémy Chabaud, Frédéric
Benrath, Gérard Serée, Wanda Mihuléac, Giusto Pilan, Danielle Loisel.
Il collabore à de
nombreuses revues en France et hors de France. Ses poèmes ont été traduits en
coréen, en bulgare, en roumain, en turc, en hongrois, en wolof, en allemand, en
russe et en anglais.
On peut commander ce livre dans
toutes les librairiesou sur le site des
Éditions Alidades

Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOË BOUSQUET
UNE SINGULIÈRE PRÉSENCE
AU MONDE
Chez le poète et
romancier Joë Bousquet,
la maladie –l’état de
malade – coïncide avec
l’éclosion de ses dons
littéraires et le fait
aborder au rivage de ce
qu’il nomme « une autre
vie » où se manifeste la
capacité de traverser
des couches de
sensibilité et
d’affectivité nouvelles.
Bousquet mène cette vie
dans une distance plus
ou moins voulue envers
l’action.
De cette ascèse
particulière lui
viennent deux qualités
que Jean Paulhan a
soulignées : «
J’envie parfois votre
divination et cette
étrange rapidité qui
vous fait traverser d’un
coup ce qui me demeure
opaque » (lettre
non datée). De plus en
plus lié à Bousquet,
Paulhan complètera ses
propos en ajoutant par
exemple : « Il est
certain que tu disposes
d’une liberté, ou d’une
indifférence de pensée
extrême, presque
inhumaine, à laquelle la
composition de tes
œuvres ne donne que
l’apparence, non la
réalité de cette suite
et de cette chaîne
(tenant sans doute, qui
sait, à des habitudes
physiques, de démarche
peut-être, à un exercice
du corps) qui est notre
prison et notre lieu »
(lettre du 25 février
1942). […]
Écrire, pour Bousquet,
permet de tirer de soi
une singulière présence
au monde ; un monde qui
sera présent à lui
autrement, ni dans
l’illumination, ni dans
le délire, ni dans les
jeux imprévus du
langage, ce qui le
distancie de ses anciens
amis surréalistes. De
fortes attaches avec le
surréalisme subsistent
toutefois, comme le
prouve son amitié avec
Paul Éluard ou René
Char, mais l’écrivain
audois « coiffe » la
position surréaliste de
pensées issues de tous
horizons en la
réinscrivant dans la
logique implicite d’une
tradition de pensée
immémoriale, du
bouddhisme aux
présocratiques puis aux
platoniciens (Plotin
notamment) et à ceux
qu’ils ont inspirés.
Au fil des années,
l’œuvre de Bousquet
s’étoffe de romans
(La Tisane de sarments,
Le passeur s’est
endormi, Iris et Petite
Fumée, Le Médisant par
bonté…), de contes
(Le Roi du sel…),
de poèmes (La
Connaissance du soir)
ainsi que d’essais
(Les Capitales. De Duns
Scot à Jean Paulhan)
et d’une multitude
de fragments recopiés
sur des carnets et
cahiers dispersés après
sa mort. […]
Les notes critiques
qu’il a écrites font
justement partie de
cette présence. Les
écrire, être un lecteur
attentif, ce n’est pas
tout à fait le même
geste que celui d’autres
écrivains : c’est
alimenter un courant de
pensée de plus en plus
prégnant en lui, qui le
pousse à revenir
constamment sur les
sources de l’inspiration
littéraire. En
s’appuyant sur l’œuvre
de ceux qu’il juge
essentiels (Arthur
Rimbaud, André Breton,
Louis Aragon, Paul
Valéry, Pierre Jean
Jouve, et tant
d’autres), Bousquet
dégage non une poétique
théorique et abstraite,
mais une poétique «
engagée » si l’on peut
dire, « militante » en
faveur d’une conception
élargie de la création
qui puise aux sources
anciennes.
Ainsi n’y a-t-il pas de
dispersion dans les
notes de Bousquet. Il
faut considérer tous ces
textes dans un
cheminement vers plus de
clarté quant aux
ressorts de ce qu’on
nomme, d’un terme très
vague, l’inspiration. En
effet, ces notes
s’enchaînent selon une
nécessité forte et non
au hasard des parutions.
Bousquet fait des choix,
élit certaines œuvres
dont il approfondit le
sens. […]
Bousquet a une manière
bien à lui de rédiger
ces notes. Il cite peu
les textes ; semble un
temps s’en éloigner pour
mieux y revenir ; use
parfois d’un langage
caustique qui dit, en
vérité, son implication
totale en tant que
lecteur. Il ne faut pas
se tromper sur ses
intentions : les
meilleures notes, celles
qui sont pourvues d’un
certain développement,
sont nourries de
considérations
philosophiques et
métaphysiques qui
d’ailleurs évoluent
considérablement.
Bousquet a lu
attentivement Leibniz,
Hegel, Marx et cite ces
ouvrages, nourri
d’échanges avec quelques
amis choisis comme Jean
Cassou, René Daumal ou
Carlo Suarès. […]
Regroupées et classées
ici en tranches de cinq
années, les notes
rédigées par Bousquet au
fil des jours, loin
d’être livrées au hasard
des parutions,
constituent en réalité
un véritable journal de
lecture dont les
analyses très
substantielles sont
ouvertes à la plus
grande diversité
d’écritures comme de
genres.
La première moitié du
xxe siècle est certes
prodigue en ouvrages
originaux autant qu’en
manifestes, lettres
ouvertes et autres
écrits programmatiques,
mais seul l’écrivain de
Carcassonne sait, selon
nous, discerner derrière
cette diversité la
qualité du levain qui
fait lever la pâte, et
révéler les promesses
que tel ou tel livre
contient. Ainsi en
va-t-il pour La
Métamorphose ou
L’Amérique de Kafka
dont Bousquet perçoit
très tôt, et parmi les
premiers, la force
novatrice. De même,
tente-t-il de tirer
toutes les conséquences
du Très-Haut de
Maurice Blanchot, où la
voix narrative se fait
spectrale et neutre.
Comme un sismographe, ce
journal enregistre les
coups que viennent
porter au conservatisme
littéraire des œuvres
dans lesquelles
l’écriture ne se soumet
à aucune injonction
extérieure. Plutôt que
de publier en son
intégralité la masse des
notes de lecture de
Bousquet, on trouvera
rassemblées ici celles
dans lesquelles se
concentre le mieux sa
pensée et où ses propres
conceptions trouvent
leurs formulations les
plus saisissantes. […]
L’hommage ne prend
jamais le dessus sur le
dialogue qu’il ouvre
avec ces auteurs ;
dialogue certes souvent
difficile à suivre mais
toujours révélateur de
sa pensée foisonnante et
en constante ébullition.
Qu’il s’agisse du
dernier livre de Paul
Valéry ou d’un essai de
Roger Caillois, la
pensée de Bousquet est
toujours en éveil et se
nourrit des avancées
mais aussi des carences
ou des interrogations
que suscitent ces livres
: sur quelle conception
de l’homme repose en
réalité le cartésianisme
? À quels dangers
s’exposent les tenants
de l’écriture
automatique ?… […]
Partout le même souci de
faire passer de la nuit
au jour des motifs et
des images (l’ombre,
l’aube, la blancheur,
l’onde…) qui se sont
formés en lui bien avant
qu’il puisse élucider,
même partiellement, le
processus de leur
élaboration. Et c’est
sur ce processus que,
tout au long de ces
pages, Bousquet revient
inlassablement,
nourrissant une veine
qui devance bien souvent
– ou conteste par avance
– les travaux sur la
création littéraire que
la critique, notamment
dans seconde moitié du
xxe siècle, aura à cœur
de mieux cerner.
À la suite de Rimbaud
dans sa fameuse lettre à
Izambard sur la voyance,
l’écrivain n’a eu de
cesse finalement d’aller
vers sa propre étrangeté
et de la reconnaître
comme nécessaire.
Claude Le Manchec
extraits de la préface
du livre de Joë
Bousquet, Au seuil de
l'indicible. Journal de
lecture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES DEUX NOUVEAUTÉSDU
MOISEn
librairie le jeudi 12
septembre
2024Distribution Sodis –
Diffusion Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joë BousquetAu
seuil de l'indicibleJournal
de lectureCollection Les
Vies imaginaires ISBN
978-2-845-90377-7 – 320
pages – 22 €
|
|
|
|
Le 27 mai 1918, âgé de
21 ans, Joë Bousquet est
atteint à la colonne
vertébrale par une balle
allemande. Il perd
l'usage de toute la
partie inférieure de son
corps. Que faire de
cette vie ? Il songe
d’abord au suicide,
avant de comprendre que
sa tâche est de «
construire autour de lui
l’univers » et que cette
vie-là est « la plus
précieuse, la plus
profonde, la seule
probablement à être
réelle ».Alité pour
le reste de sa vie à
Carcassonne, dans une
chambre dont les volets
sont fermés en
permanence, il tisse une
autre forme de présence
au monde, plus vaste et
profonde d’une certaine
manière, à travers
l’écriture et la
lecture. Les amitiés
nouées à travers les
textes nourrissent de
nombreuses
correspondances
(notamment avec Simone
Weil dont il est très
proche) et attirent vers
sa chambre les visites
des plus grands
créateurs.« J’envie
parfois, lui écrit
Paulhan, votre
divination et cette
étrange rapidité qui
vous fait traverser d’un
coup ce qui me demeure
opaque. » Jusqu’à
sa mort en 1950,
Bousquet sera le témoin
le plus lucide de la
littérature de son
époque. Cette époque où
s’épanouissent les plus
grandes œuvres de
l’histoire littéraire,
il en perçoit mieux que
personne, grâce à sa
totale disponibilité et
à son extrême
sensibilité, les
secrètes lignes de
force.Retrouvées dans
leur profonde unité, ces
lectures que Bousquet
publiait en revue,
constituent tout à la
fois le véritable
journal de bord, année
par année, de cet homme
écorché vif et solitaire
et le passionnant
panorama d’une
littérature en train de
se faire – de Aragon à
Michaux, de Jouve à
Artaud, mais aussi de
Milosz à Kafka, de
Daumal à Char, de
Queneau à Simenon.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mihai EminescuAinsi
parlait Mihai EminescuDits
et maximes de vieTextes
traduits et présentés
par Nicolas CavaillèsCollection
Ainsi parlaitISBN
978-2-845-90376-0 –
176 pages – 14 €
|
|
|
Eminescu, c’est d’abord un merveilleux visage : un jeune Apollon à la longue chevelure et au regard doux que la Roumanie révère aujourd’hui encore comme une véritable pop star. Eminescu, c’est aussi, par exemple, ce poème à sa mère qui retentit dans les écoles et familles roumaines à chaque fête des Mères.Miracle de la culture roumaine, Eminescu a été le maître et la référence incontestés de tous les grands écrivains roumains qui lui ont succédé : Cioran, Ionesco, Eliade, et bien d’autres. Contemporain de la naissance de l’État roumain, il est, jusque dans sa personnalité déchirée, l’incarnation même de son écartèlement entre les puissances et les cultures qui y ont exercé leur emprise. Il est celui qui a lutté pour affirmer la singularité roumaine en faiusant connaître sa langue mais aussi son histoire depuis l’Antiquité.À sa mort, comme pour Vinci ou Leopardi, est resté un prodigieux ensemble de manuscrits pêle-mêle – ce qu’on appelle son «fragmentarium » –, véritable laboratoire où se mêlent ébauches, réflexions et travaux dans tous les domaines du savoir, de la philosophie à la biologie, l’histoire et la linguistique. Sont demeurés également de très nombreux articles de presse et de revue.L’ensemble de ces textes souvent géniaux, parfois délirants, ont été minutieusement édités en d’innombrables volumes. Une œuvre immense donc et difficile d’accès, qui explique pourquoi un tel génie reste quasi inconnu en France. Grâce à cet Ainsi parlait, c’est tout l’essentiel d’une œuvre exceptionnelle qui devient accessible au public français.
Cet Ainsi parlait bilingue roumain-français est l’œuvre de Nicolas Cavaillès, l’éditeur de Cioran en Pléiade.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TROIS LIVRES
À REDÉCOUVRIR
Distribution Sodis –
Diffusion Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
William Butler Yeats Ainsi
parlait YeatsDits
et maximes de vieTextes
traduits et présentés
par Marie-France de
PalacioCollection
Ainsi parlait ISBN
978-2-845-90309-8 –
176 pages – 14 €
|
|
|
Prix
Nobel de
littérature
en 1923,
William
Butler
Yeats
(1865-1939),
est l’un
des plus
grands
écrivains
irlandais.
Mais si
son nom
est
célèbre,
si son
œuvre
est
placée
très
haut, si
l’on a
pu lire
de lui
un jour
quelques
poèmes,
que
connaît-on
de son
itinéraire
et de sa
pensée ?
Les
œuvres
des plus
grands
écrivains
ont
toutes
quelque
chose de
précieux
à nous
dire :
« La
littérature,
écrit
Yeats,
est
toujours
personnelle,
elle est
toujours
la
vision
qu’a du
monde un
seul
homme,
l’expérience
d’un
seul
homme. »
Et,
dans
cette
parfaite
singularité,
elles
s’adressent
paradoxalement
au plus
grand
nombre :
« La
littérature
est, à
mon
sens, la
grande
puissance
enseignante
du
monde,
l’ultime
créatrice
de
toutes
les
valeurs.
»
C’est le
propos
même de
la
collection
Ainsi
parlait.
Yeats a
abordé
tous les
genres :
essais,
théâtre,
poésie,
mais
aussi
articles
et
correspondances.
Ses
thèmes
sont
marqués
à la
fois par
la
passion
de
comprendre
et
l’inquiétude
spirituelle
ainsi
que par
le goût
de la
scène et
l’amour
de
l’Irlande
pour
l’indépendance
de
laquelle
il n’a
cessé de
militer
Fasciné
par la
vie et
le
mystère
du
monde,
il
déteste
le
dogmatisme
et
l’intellectualisme.
Dans une
langue
simple,
sans
jargon
ni
abstractions,
il
bouscule
les
certitudes.
Ici,
comme le
théâtre
baroque,
masques
et
métamorphoses
sont
omniprésents.
Très
impliqué
dans le
mouvement
nationaliste,
Yeats
fut
profondément
bouleversé
par
l’Insurrection
de
Pâques
en 1916
et par
sa
sanglante
répression.
Les
Cygnes
sauvages
à Coole
(1919),
écrits à
la suite
de ce
traumatisme,
ouvrent
une
nouvelle
période
dans sa
création,
celle de
sa
maturité.
Marie-France
de
Palacio,
qui
présente
et
traduit
ces
textes,
a été
pour
Arfuyen
la
traductrice
de
L’Histoire
de mon
cœur,
de
Richard
Jefferies.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiki Dimoula
Mon dernier
corpsTraduit
du grec moderne et
présenté par Michel
Volkovitch Prix européen
de littérature
2009Collection NeigeISBN
978-2-845-90145-2 –
196 pages – 15 €
|
|
|
Les poèmes de Kiki
Dimoula (1931-2020)
sont écrits comme
des récits, avec une
grande simplicité
apparente. Mais ce
qu’ils racontent est
de l’ordre de
l’infime, du
trivial, de
l’insignifiant. Et
le récit semble à
chaque vers au bord
de basculer vers
autre chose, dans un
état de déséquilibre
permanent dans un
espace qui ne cesse
de s’élargir, se
creuser à mesure
qu’on avance. «
L’unique thème de
Dimoula, écrit
le critique Nìkos
Dìmou, c’est le
passage – progressif
ou soudain – de
l’être au non-être.
Ce passage qui
s’appelle temps,
usure ou mort. »
Il ne se passe rien,
mais l’enjeu est
immense, d’ordre
surhumain. Un ordre
souverain semble
s’exercer sur les
menus événements qui
sont là, comme si
les dieux de
l’antiquité
hellénique étaient
toujours à l’œuvre,
implacables jusque
dans le plus
dérisoire de nos
vies. Une femme
passe l’aspirateur,
et c’est une
tragédie grecque qui
se déroule sous nos
yeux. On a voulu
voir en Kiki Dimoula
une descendante des
poètes métaphysiques
anglais du XVII°
siècle ou d’Emily
Dickinson. Tout
aussi bien
pourrait-on y voir
l’étrange mariage du
prosaïsme le plus
absurde du monde
moderne et les
desseins mystérieux
du monde des dieux
et des héros
antiques.
Traduit avec un soin
tout particulier par
un traducteur
émérite, Michel
Volkovitch, Mon
dernier corps
est donné en édition
intégralement
bilingue avec une
préface du
traducteur et un
ensemble
d’informations qui
en font une édition
de référence pour la
découverte de cet
auteur. Dans le même
temps, paraît dans
la collection
Poésie-Gallimard un
autre recueil de
Kiki Dimoula, Le
peu du monde
(1971), également
traduit par Michel
Volkovitch.
À l’occasion de la
remise du Prix
Européen de
Littérature 2009,
Kiki Dimoula était
venue à Strasbourg
pour présenter ce
livre.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Henri MeschonnicL'obscur
travailleCollection
Les Cahiers d'ArfuyenISBN
978-2-845-90167-4 – 98
pages – 9 €
|
|
|
Henri Meschonnic est
l’auteur d’une œuvre
importante de
réflexion sur la
littérature, la
poésie et la
traduction.
Essayiste et
philosophe, il a
donné également des
textes passionnants
comme les cinq
volumes de Pour
la poétique
(1970-1978),
Modernité modernité
(1988) ou
Spinoza poème de la
pensée (2002).
Auteur de
Poétique du traduire
(1999), il a
lui-même donné
d’admirables
traductions des
principaux livres de
la Bible.
Inaugurée avec
Dédicaces proverbes
(Gallimard, 1972),
son œuvre poétique,
qui est au centre de
sa démarche
d’écriture, comporte
une quinzaine
d'ouvrages, dont une
grande partie a été
publiée aux Éditions
Arfuyen, de Puisque
je suis ce buisson
(2001), L’obscur
travaille
(2012).
En ouvrant le livre
ultime de Meschonnic,
comment ne pas
penser à L’Herbe
du songe,
d’Yvan Goll, écrit à
l’Hôpital Civil de
Strasbourg, durant
sa dernière maladie
: « Aux
hauts-fourneaux de
la douleur, / Quel
minerai met-on à
fondre / Nul ne le
sait / Ni les
esclaves du pus / Ni
les sœurs de la
fièvre » (trad.
Claude Vigée,
Arfuyen, 1988).
Tout autre est
cependant, face à
l’ultime,
l’expérience d’Henri
Meschonnic, tout
autre sa parole,
toujours davantage
ouverte au monde,
avec une sorte de
jubilation, alors
même qu’il sent de
toutes parts
s’échapper son être
: « les autres
me multiplient / je
ne me savais pas /
si différent de
moi-même / autant de
fois qu’ils passent
/ et repassent je ne
sais plus / si c’est
en moi devant moi /
et les arbres aussi
marchent / tout est
tellement en
mouvement / que je
ne sais plus si je /
suis là ou là et
l’arbre / qui était
parti revient / je
peux enfin les tenir
dans mes yeux / je
suis le bruit de ces
pas / sans parole je
ne peux pas me taire
/ et je parle tous
ces pas » (7-8
mai 2008). La menace
a beau être là,
toute proche, comme
une mise en demeure,
la conscience
d’Henri Meschonnic
ne tient pas en
place : toujours en
éveil, en partage,
et, autour d’elle,
tout est toujours en
mouvement, formes
fluides, tendres,
comme dans un
tableau de Chagall.
Le dernier poème du
recueil est daté du
26 février 2009, à
l’hôpital
Paul-Brousse : «
je n’ai rien que des
jours / à t’offrir
mais ensemble /
ensemble / ma bouche
ta bouche / dans tes
mains dans mes mains
/ ce sont elles qui
tournent / autour de
l’an pas l’an / qui
tourne / mais nous
ensemble / la ronde
de la vie ». La
ronde n’en finit pas
jusqu’au dernier
jour, avec cette
étrange allégresse
de qui se donne sans
rien retenir, sans
rien céder. Jusqu’au
dernier jour, c’est
l’amour, c’est la
vie qui s’étreignent
dans les mots, avec
un enthousiasme
intact.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2024 —
La voie du
large, de
Michèle Finck,
lu par Irène
Gayraud (Europe)
8 août 2024 —
Ainsi
parlait Jules
Renard,
d’Yves Leclair,
lu par Philippe
Barthelet
(Valeurs
actuelles)
13 juillet 2024
— La voie du
large, de
Michèle Finck,
lu par Veneranda
Paladino (DNA-Dernières
Nouvelles
d’Alsace)
5 juillet 2024 —
La Flûte de
la grue, de
Fumiko Hayashi,
lu par Nils C.
Ahl (Le Monde
des livres)
Juillet 2024
— Ainsi
parlait
Anatole
France,
de Guillaume
Métayer, lu
par R.
Pfefferkorn
(Raison
présente n°
230)
Juillet 2024
— Ainsi
parlait
James Joyce,
de Mathieu
Jung, lu par
Roland
Pfefferkorn
(Raison
présente n°
230)
Juillet-août
2024 — La
Flûte de la grue,
de Fumiko
Hayashi, lu par
Martine Sagaert
(Les Lettres
françaises)
16 juin 2024 —
Un été en
montagne,
d’Elizabeth von
Arnim, lu par
Florence
Noiville (Le
Monde des
livres)
Juin 2024 —
La voie du large,
de Michèle
Finck, lu par
Pierre Dhainaut
(Diérèse)
Juin 2024 —
L’Œuvre poétique
I. Le code de la
nuit, de
Dylan Thomas, lu
par Michel
Ménaché (Europe)
Juin 2024 —
La voie du large,
de Michèle
Finck, lu par
Gérard Bocholier
(Études)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Envoyé par

|
|
|
|
|
|
|
|
Retour
Vient
de paraître le
nouveau catalogue de la librairie A la
Demi-Lune :
100 livres d’artiste des Éditions
de Rivières
livres réalisés par Jean-Paul Martin, cousin
et héritier de Pierre André Benoit, entre
2002 et 2020.
|
|
|
|
|
|
La première partie du catalogue « Éditer PAB
» (lots 1 à 35) est entièrement consacrée à
l’écrivain Pierre André Benoit et à ses
textes inédits illustrés par lui-même, mais
aussi Pierre Alechinsky, Anne Slacik
(image 1), Lucien Clergue, Sylvère,
Julius Baltazar, Alain Clément, Daniel
Dezeuze, Jean Cortot (image 2),
Robert Lobet, Claude Clarbous, Didier Equer
ou encore Guillaume Moschini.
|
|
|
|
| |
|
|
La deuxième partie du catalogue « Jouer à la
rencontre » (lots 36 à 100) part à la
découverte du foisonnement des artistes et
écrivains de Rivières avec une sélection de
livres de Michel Butor, Fernando Arrabal,
René Pons, Christian Skimao, Gaston Puel,
Bernard Teulon-Nouailles, Salah Stétié,
Bernard Noel, Luis Mizon, Frédéric Jacques
Temple, Patricia Dupuy, Claude Minière,
Jacques Outin, Michaël Glück, Henri
Pousseur, Régine Detambel, illustrés par
Claude Viallat, Gérard Titus-Carmel (image
3), Anne Slacik, Robert Lobet, Lucien
Clergue, Daniel Dezeuze, Jean-Marc Scanreigh,
Sylvère, Claude Clarbous, Maxime Godard,
Patrice Pouperon, Marie Christine Schrijen,
Graziella Borghesi, Julius Baltazar, André
Cervera, Stéphane Quoniam.
|
|
|
|
| |
Retour
Avis de parution : L'Anti-mémère
|
|
Pour celles qui refusent de vieillir en robe-tablier…
SORTIE 29 AOÛT 2024
|
|
LIZZIE NAPOLI, pionnière des carnets de
voyage, est le modèle contagieux d’une jeune
centenaire habitée par la joie, le talent et le
désir de vivre (voir
ICI
son CV très personnel et
LÀ
un extrait audio).
L'anti-mémère, sur le thème du bien vieillir,
allie titre, texte et esquisses au service d'un art
de vivre qui l’a amenée elle-même à fêter ses 100
ans au printemps 2024. Écrit pour celles qui «
refusent de vieillir en robe-tablier »,
L’Anti-mémère est une véritable pépite prête à
l’emploi, pratique, philosophique et poétique.
Voici
sous ce lien
quelques morceaux choisis et ci-dessous les
références utiles (nombre de pages, format, isbn).
Un livre de 44 pages au format 14 x 21
Prix public 16 €
Sortie 29 août 2024
isbn 978-2-37649-045-6
Où commander le livre
Chez votre libraire préféré,
sur le site de l'éditeur
ou par courrier :
Cardère éditeur, 19 rue Agricol Perdiguier, 84000
Avignon
|
|
|
|
|
|
|
|
Lizzie, Claire et Marine ses filles, Marie-Laure
chargée de comm et la bonne maison Cardère vous
offrent un bon grand bol de jouvence…
|
|
Retour
Vient de paraître
Paroles du silence suivi de
Lumière dans l’obscurité,
la traduction par Bernard Grasset
du premier et du dernier recueil de
Jeanne Tsatsos (1902-2000)
sœur de Georges Séféris, prix Nobel de littérature
et épouse de Constantin Tsatsos, ancien Président de la République grecque.
Reconnue Juste parmi les Nations, figure marquante de la Résistance grecque,
Jeanne Tsatsos fait partie de cette rare lignée des poètes-témoins.
Comme le montre Paroles du silence suivi de Lumière dans
l’obscurité,
sa poésie est remplie d’humanité, de ferveur et de justesse.
Simple et profonde, elle touche notre esprit et notre cœur.
« Etoile, Toi qui viens / à ma rencontre, /
montre-moi la voie »,
tels sont, comme une invitation à l'accueil, les trois derniers vers de ce livre
publié en édition bilingue (grec moderne –
français) au Bois d’Orion et diffusé en librairie.

Retour
ce livre fera
l'objet
d'une
prochaine émission

Retour
Le poète Alain
Helissen nous communique :
Permettez-moi de vous présenter ci-dessous l'une de mes dernières
réalisations.
Alain Helissen
appARiTions
Surgies du noir, ce sont 8 apparitions qui constituent le corps de ce
livre d'artiste intitulé "appARiTions", un titre qui contient le mot
"ART". Car il s'agit bien d'art, plus précisément de 8
peintures-collages accompagnés d'autant de textes. Sans thème précis
cette incursion artistique se veut porteuse d'espoir ou d'une certaine
jubilation créative.
Format : 14,5 x 21 cm; 18 pages; papier noir
reliure: collé;
Le présent ouvrage, exemplaire unique fait main, est numéroté 1/1 et
signé par l'auteur. Il a été réalisé au mois de juillet 2024.
Il est proposé à la vente au prix de 40€, port inclus pour la
France. Pour l'étranger me contacter.
Réservation à: alain.helissen@live.fr
Obs. D'autres extraits peuvent vous être envoyés sur simple demande à l'adresse-mail
ci-dessus. L'ouvrage, ainsi que d'autres de mes réalisations, peuvent
être consultés à mon domicile de Metz (DLP), sur rendez-vous.
Retour
Académie des Jeux floraux : 700 ans de poésie
à Toulouse
Collectif - Cairn, 126 pages,19 €.
En
décembre 2022,
les Jeux floraux de Toulouse et leur fête des
Fleurs
entraient dans l'inventaire national du Patrimoine culturel immatériel.
Il y avait là une reconnaissance non seulement
de l'histoire d'une tradition continuée, depuis 1694, par l'Académie des Jeux
floraux, mais plus encore des actions menées par cette Compagnie pour que
demeure le goût de la poésie.
Des sept fondateurs de 1323-1324 au Collège de
Rhétorique, en passant par la Compagnie du Gai Savoir, les sept siècles, dont ce
livre retrace l'histoire, feront aussi mémoire de quelques noms qui les ont
marqués comme Guilhem Molinier, Simon de Laloubère, Ronsard, Voltaire, Victor
Hugo, René de Chateaubriand et Clémence Isaure.
Sous la direction de :
Philippe Dazet-Brun, Amandine de Pérignon,
Marie-Pierre Rey.

Retour
Pierre Manuel des éditions Méridianes nous
communique :Cet été, Jean
Hugo est exposé à Montpellier (au Musée Fabre) ; à Sète (au Musée Paul
Valéry) ; et à Lunel (au Musée Médard). Une riche actualité qu'accompagnent
les éditions Méridianes en publiant le livre de Fabienne Schwartz écrit à
partir du livre de Maurice Scève et de lavis de Jean Hugo : La
Saulsaye – souffrir non souffrir.
1547 : Maurice Scève publie Saulsay
‒
Églogue de la vie
solitaire : dialogue entre un amateur de la vie urbaine et un de la vie
solitaire, dans un paysage d’arbres et en particulier de saules.
1970 : Jean Hugo, lui-même retiré en son mas de Fourques, prépare
une réédition de cet ouvrage et se rend à La Saussaie, à la confluence du
Rhône et de la Saône. La zone est déjà fortement urbanisée, mais restent
quelques saules le long de la rivière dont il fait six lavis restés à ce
jour inédits. Il est probable que ce soit le peintre qui ait choisi ce livre
de Maurice Scève pour l’illustrer : Jean Hugo y retrouvait sans doute des
similitudes avec ses propres choix de vie.
2023 : Fabienne Schwartz relit et reprend le poème à sa guise et
avec la généreuse complicité de Léopoldine Hugo et de sa famille,
l’accompagne de ces lavis. Philerme, retiré dans sa saulaie, de sa
souffrance d’amant fait un «non souffrir», s’effaçant dans « son
paysage de bois, de roche et d’eau », laissant ainsi intacte « la lumière
qui enveloppe le vivant ».
Ce livre peut être commandé en librairie ou auprès des éditions Méridianes
par mail ou téléphone ou sur le site.
En août les éditions Méridianes seront
présentes à Saint-Antonin Noble-Val du 29 juillet au 11 août. Et au Festival
de poésie de La Salvetat, le 17 et 18 août. Venez les rejoindre. Y sont
présentées les publications récentes autour de Pierre Soulages, de Vincent
Bioulès, Christophe Hazemann, Paul Valéry avec des textes de Pierre Alfredo,
Serge Bourjea, Nathalie Reymond, Jean-Yves Tayac,
Bonnes lectures et bel été.
Pierre Manuel
editionsmeridianes@gmail.com / www.meridianes.fr
/
Bon de COMANDE
Retour
Hommage à Joël Cornuault
Nous ne sommes pas les seuls à dire beaucoup de bien du poète
Joël Cornuault,
les
excellentes
éditions Pierre Mainard nous
communiquent :
Nous remercions
les amis des éditions Le Temps qu’il fait
d’avoir ouvert leur bulletin
d’information,
Saisonnier (n° 14), à notre maison pour son 25ème
anniversaire ;
et tout particulièrement Jean-Pierre
Ferrini pour son propos,
« Il faut rêver… »,
consacré à Joël Cornuault qui gratifie,
depuis des années, nos deux maisons
amies de ses écrits.

Retour
2023 de Julien Blaine
à lire
:
https://www.sitaudis.fr/Parutions/2023-de-julien-blaine-1719805306.php
Retour
Eric Dubois
publie
Nul ne sait
l'ampleur
Poèmes
aux éditions
unicité
45 p, 12 €
Ce livre,
recommandé par "Les poètes",
fera l'objet
d'une prochaine émission

Retour

Retour
Bonjour à toutes et tous,
"Juin, bon garçon, détache l’hameçon. Mai n’avait
rien laissé paraître mais il ferrait les proies qu’avril
filait dans les trous d’eau. (...)"
Anne-Marie Beeckman "Les Heures"
Au plaisir de vous saluer !
Retour
RAPPEL : PO&PSY vous attend au
rendez-vous !
|
|
Rencontres avec les artistes
-
Lors du vernissage, le vendredi 31 mai à
18h30
-
Lors du finissage, le dimanche 14
juillet à 18h30
|
Rencontres avec les auteurs
Dimanche 9 juin de 16h30 à 19h30
présence exceptionnelle du poète iranien
Alizera ROSHAN qui lira "Jusqu'à toi combien de poèmes"
(po&psy princeps 2011)
Samedi 15 juin de 10h30 à 12h30 et de
16h30 à 19h30
Lecture bilingue suisse allemanique /
français de Foliesophie de Urs JAEGGI (po&psy in extenso
2019) par son traducteur Alain JADOT
Samedi 22 juin de 10h30 à 12h30 et de
16h30 à 19h30
Lecture bilingue occitan / français de Le
vent qui parle le paradis (po&psy
princeps 2023) par Joan-Peire TARDIU
|
|

Retour
|
Vient de paraître
Gérard Cartier
LE ROMAN DE MARA
(Tarabuste,
mai 2024) |
|
|
|
|
|
|
Ce livre est une manière de roman : celui
d'une enfant qui grandit, découvre le monde
et s'émancipe. C'est aussi le roman de celui
qui l'élève, à qui elle échappe peu à peu.
Deux vies mêlées (et même trois, car c'est
en creux le roman de l'absente), où
la fiction sert une autre vérité que celle
des événements. S'il s'agit d'un roman quant
au récit, c'est bien un livre de poésie,
affranchi de tout prosaïsme, multipliant les
formes et les rythmes... (Extrait de la
Présentation de l'éditeur). |
|
|
|
|
(Pompei)
Rien n’est plus délicieux échappant un soirau lacis des ruines comptoirs de
garumégouts noirs chambres de passe aux lits
plâtreuxcoït interrompu rien n’est plaisant
commeayant recraché le nuage de cendresde s’éprouver vivant une closeriesous les grenadiers résidence d’un peuplede guêpes soûles la cadence garderla cadence et sans se retourner sur
soini sonder sa fin louer l’instant Marade son éventail chasse le temps la peauà vif déchirée par les mûres ce sangqui coule vif et clair ne sera pas longà cailler et noircir verser en
attendantl’huile et répandre le sel bar au
fenouilchair sans fiel délectable et
combattreles fumées de l’esprit par le vin remèded’Hildegarde de Bingen qu’a sur l’ardoiseprescrit l’aubergiste malinconiaRoero Areis 2x |
|
|
|
Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAGABONDE ET REBELLE
FUMIKO HAYASHI
C’est en 1930 que
Fumiko Hayashi a
acquis une précoce
notoriété en
publiant, après
plusieurs poèmes et
brefs récits parus
en revues,
Hôrôki (Vagabonde),
son journal romancé,
où elle raconte son
parcours littéraire.
Fille de marchands
ambulants, elle
a vécu une vie de
bohème, exerçant
toutes sortes de
métiers dont ceux
d’ouvrière à la
chaîne, de vendeuse,
de serveuse,
d’entraîneuse et de
chanteuse de
cabaret, ayant
plusieurs liaisons
avec des peintres,
des acteurs et des
écrivains, avant de
voyager à l’étranger
(en France, en
Italie, en
Indonésie, en Chine,
en Russie) et de
devenir
correspondante de
guerre.
Ses nouvelles, comme
ses romans adaptés
au cinéma par Mikio
Narusé qui a
grandement contribué
au maintien de sa
renommée au Japon et
dans le reste du
monde, contiennent
une importante part
autobiographique
transfigurée, et
l’on retrouve le ton
qui caractérise son
journal, à la fois
désabusé, cru,
méditatif et rêveur,
par alternance
sarcastique et
lyrique. […]
Si les thèmes les
plus fréquents sont
l’amour et la
rupture entre deux
êtres à la dérive
(avec la menace de
la grossesse, le
risque de
l’adultère, le refus
d’un enfant et la
crainte d’un
avortement), il y
est beaucoup
question de la
guerre et des
pénuries qui l’ont
accompagnée et
suivie, l’incendie
et les bombardements
de la capitale ayant
contraint une grande
partie de ses
habitants à la fuir,
à chercher des
moyens incertains de
subsistance et à
découvrir en
province un autre
type de vie, souvent
au milieu
d’orphelins, de
veuves, de
vieillards, de
parents ayant perdu
ou abandonné leurs
enfants. […]
Le recours aux
poèmes et aux
fables, au cœur même
d’une narration
impressionniste et
fluide, est
récurrent chez
Fumiko Hayashi, qui
rejoint là une
tradition littéraire
japonaise qui a
donné lieu à de
grandes œuvres,
classiques et
modernes. […] La
forme du conte (que
l’on retrouvera dans
les trois nouvelles
pour la jeunesse,
évidemment) et la
tendance au
fantastique sont les
moyens d’aborder,
sans pesanteur et
sans didactisme, des
problèmes sociaux ou
psychologiques et de
témoigner, en
l’occurrence, de la
guerre, du front, de
l’exil, de la faim,
de la séparation, de
la précarité et
surtout de la
démobilisation et de
la défaite.
Si l’on a déjà
signalé, à propos de
Vagabonde
ou de Nuages
flottants, la
parenté de
l’écriture de Fumiko
Hayashi avec celle
de l’Anglaise
caribéenne Jean Rhys
(1890-1979) dont la
vie et le style ont
de nombreux points
communs avec les
siens, on trouvera
ici des analogies
avec le monde
imaginaire de Kenji
Miyazawa (1896-1933)
qui appartient à sa
génération […]
L’influence des
écrivains russes
était revendiquée
par Hayashi dans ses
textes réflexifs.
C’est ici Tchékhov
dont la marque est
la plus
reconnaissable dans
la nouvelle chorale
intitulée "Recherche
d’emploi".
La tentation de la
déchéance est
combattue par une
composante
empathique et
humaniste très
forte, sensible dans
plusieurs nouvelles
choisies ("Le gobie
de rivière",
"Consolation",
"Centre-ville"), où
l’amitié, la
maternité, la
solidarité dans
l’épreuve, la
générosité prennent
le relais de la
passion sans
lendemain. […]
La dernière
nouvelle,
"Centre-ville", qui
est parmi les plus
tardives et les plus
structurées, offre
de la vie d’un
couple, que le
hasard a formé et le
désir a soudé
éphémèrement, une
image moins cynique,
moins désespérée que
les précédentes […],
mais tout aussi
douloureuse.
Fumiko Hayashi donne
alors toute la
mesure de sa
lucidité et de son
originalité
poétique, usant
comme toujours d’un
style fragmentaire,
syncopé et concis,
par éclairs et
allusions, par
visions fugitives
dans lesquelles
paraissent
éclatantes sa
sensibilité aux
lieux et sa grande
capacité évocatrice
des errances
solitaires et
nocturnes, dans des
quartiers de
plaisirs ou dans des
zones désertes, au
bord de la mer, au
bord des fleuves,
sur des rivages
désolés, meurtris
par la guerre, dans
des milieux paysans,
minés par la
pauvreté, ravagés
par la violence, le
désir perverti et la
faiblesse des
hommes.
René de Ceccatty,
extraits de la
préface du livre La
Flûte de la grue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES TROIS NOUVEAUTÉSDU MOISEn librairie le
jeudi 2 mai 2024Distribution Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fumiko HayashiLa Flûte de la
grueNOUVELLESTraduit du japonais
et présenté par René
de Ceccatty Collection Le
Rouge & le Noir ISBN
978-2-845-90368-5 –
240 pages – 17 €
|
|
|
Cet ouvrage
est le
deuxième de
la nouvelle
collection
de fiction
des éditions
Arfuyen,
Le Rouge &
le Noir.
Après un
roman
traduit de
l’anglais et
d’un esprit
proche de
Katherine
Mansfield,
des
nouvelles
traduites du
japonais
dans une
ambiance qui
évoque
beaucoup les
films d’Ozu
et Ishikawa
Takuboku,
publié par
le Éditions
Arfuyen
depuis leurs
tout débuts
.
Fumiko
Hayashi est
une des
figures
majeures de
la
littérature
japonaise.
C’est en
1930 que
Fumiko
Hayashi a
acquis une
précoce
notoriété en
publiant
Vagabonde,
son journal
romancé.
Beaucoup de
ses nombreux
romans et
nouvelles
ont été
adaptés au
cinéma par
le grand
réalisateur
Mikio
Naruse, et
notamment le
chef d’œuvre
de ce
dernier
Nuages
flottants
(1955).
Les onze
nouvelles
inédites ici
présentées
datent des
années
1930-1948,
sa période
de maturité.
Elles ont
été
traduites et
préfacées
par l’un des
meilleurs
connaisseurs
français de
la
littérature
japonaise,
René de
Ceccatty,
par ailleurs
romancier,
essayiste et
traducteur
de
l’italien.
Un pays
dévasté, où
les journées
se passent à
chercher un
emploi, un
toit, de la
nourriture.
On entend
voler des
avions
américains.
Certains
hommes sont
partis se
battre dans
une guerre
que l’on ne
comprend
pas.
D’autres ont
tenté
l’aventure
en
Mandchourie.
Des enfants,
des épouses,
des amis ont
disparu.
Et pourtant,
dans cette
ambiance de
désolation,
une forme
étrange de
sérénité,
comme si les
destinées
individuelles
comptaient
moins qu’un
moment de
beauté ou
qu’un
sourire de
bonté sur un
visage.
Comme si
seul
importait ce
chant
mystérieux
de la flûte
pour éviter
de «
perdre
l’espoir,
quelle que
soit
l’adversité
».
L’écriture
vive et
rapide
d’Hayashi
s’ouvre aux
tonalités
les plus
diverses,
des récits
d’errances
dans la
grande
tradition
japonaise
jusqu’à des
visions
apocalyptiques
ou des
récits quasi
légendaires.
Sa tonalité
est très
proche de
celle
d’Ishikawa
Takuboku,
lui aussi
révolté par
une société
patriarcale
et
répressive,
qu’elle cite
fréquemment.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vincent La SoudièreBatelier de
l'inutile Texte établi et
annoté par Sylvia
MassiasPostface de Marc
Wetzel Collection Les
Vies imaginairesISBN
978-2-845-90369-2
– 160 pages – 16
€
|
|
|
Vincent La Soudière (1939-1993) n’a publié de son vivant qu’un seul tout petit livre, Chroniques antérieures (1978). Dix ans après la mort de l’écrivain, les éditions Arfuyen ont été les premières, en 2003, à lancer avec Brisants la publication de son œuvre.
De nombreuses éditions ont vu le jour depuis lors par les soins de Sylvia Massias : au Cerf les trois forts volumes des lettres à Didier (2010-2015, 1800 pages) et une biographie, Vincent La Soudière, la passion de l’abîme (2015) ; dans la revue Nunc un dossier La Soudière (2017) ; enfin aux éditions La Coopérative, un ensemble de fragments sous le titre Eschaton (2022).
« L’ayant rencontré plusieurs fois, je sais qu’il n’écrira jamais rien de gratuit, écrivait Henri Michaux. Ce qu’il fera connaître est important. » Cioran lui aussi s’enthousiasmait pour la « haute tenue littéraire » de ses écrits « dont il me semble, écrivait-il, difficile de ne pas admirer l’unité de ton et de vision ».
Écrits de 1988 à sa mort en 1993, les textes ici réunis constituent une sorte d’autobiographie et donc aussi de testament. Le titre Batelier de l’inutile a été choisi dans une liste de titres listés par l’auteur. La figure de Pessoa hante ces réflexions : « Le secret, écrit-il, c’est de laisser ta personnalité au vestiaire, et de laisser se défaire le fantôme de ton moi. »
C’est ainsi seulement qu’on peut espérer devenir celui que l’on a toujours été, « source jaillissante qui n’a jamais quitté la lumière éternelle ». C’est ainsi que peut advenir cette « autre naissance», pressentie dans la contemplation des « étoiles scintillantes » sous le regard maternel du firmament.
Pour la première fois, le philosophe et critique Marc Wetzel a accepté d’écrire ici le témoignage de ses rencontres avec Vincent La Soudière. « C’était un homme étonnamment lucide, se souvient-il, (auquel l’intelligence aiguë de ses faiblesses semblait coûter peu), qui savait que ses facilités travaillaient contre lui. […] Je crois que le drame vital de son génie était qu’il n’avait pas de force non-créatrice. Tout passait à “retenir quelque chose du Mystère”. »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Margherita GuidacciLe Retable d'Issenheimsuivi de L'Horloge
de Bologne Traduit de l'italien et
présenté par Gérard
Pfister Collection NeigeBILINGUEISBN 978-2-845-90370-8
– 120 pages – 14 € |
|
|
Née deux ans
avant Cristina
Campo et d’une
inspiration très proche,
Margherita
Guidacci
(1921-1992) a
été publiée par
les éditions
Arfuyen dès 1977.
Quatre autres
recueils ont
suivi, ainsi que
deux traductions
(Dickinson et
Powers).
La fluidité et
l’intensité de
son écriture ont
exercé une
profonde
influence sur
nos choix
éditoriaux.
Spécialiste de
la littérature
anglaise et
américaine,
Margherita
Guidacci a été
la première
traductrice de
l’œuvre d’Emily
Dickinson en
Italie.
Le Retable
d’Issenheim,
épuisé dans la
collection
Les Cahiers
d’Arfuyen,
est réédité ici
avec
L’Horloge de
Bologne
dans la
collection
bilingue
Neige,
donnant aux deux
recueils leur
pleine
dimension.
Margherita
Guidacci a
publié ses deux
grands cycles
poétiques,
Le Retable
d’Issenheim
(1980) et
L’Horloge de
Bologne
(1981), à un an
de distance.
Avec le recul du
temps les deux
font résonner la
même éternelle
plainte de
l’humanité
souffrante.
On sait que
Picasso de
passage en
Alsace en 1932
avait été très
frappé par le
Retable
d’Issenheim,
joyau du Musée
d’Unterlinden à
Colmar, dont on
retrouve
nettement
l’empreinte dans
le Guernica
de 1937.
Face au célèbre
Retable,
Guidacci médite
la présence du
mal et de la
violence dans
l’homme à
travers les
siècles. Car la
beauté
renversante du
grand cycle de
peintures de
Mathis Grünewald
fait apparaître
avec d’autant
plus de cruauté
le cortège de
souffrances et
de malheurs
dont, hier et
aujourd’hui,
l’homme est tout
à la fois la
victime et le
coupable.
«
Confrontons /
nos cauchemars,
Mathis :
lesquels
choisirons-nous
? »,
s’interroge
Margherita
Guidacci. D’un
côté, l’humanité
du XVIe siècle,
frappée par les
épidémies, les
guerres, les
famines.
Grünewald nous
montre les corps
mutilés et
pourrissants,
les visages
affolés, les
hurlements. De
l’autre, le
monde moderne,
où le mal prend
le visage de la
guerre et du
terrorisme.
Guidacci en
prend pour
symbole
l’attentat à la
gare de Bologne,
le 2 août 1980,
le plus
meurtrier en
Europe (85 morts
et 200 blessés)
jusqu’aux
attentats de
2015 à Paris
(130 morts et
352 blessés).
Sur le mur de la
gare, l’horloge
de Bologne reste
aujourd’hui
encore bloquée à
10 h 25, l’heure
de l’explosion.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TROIS LIVRES
À
REDÉCOUVRIR
|
|
|
|
|
|
|
|
Elisabeth von Arnim Un été en montagne ROMANTraduit de l'anglais
par Paul
DecottigniesCollection Le
Rouge & le Noir ISBN
978-2-845-90366-1 –
240 pages – 17 €
|
|
|
Cousine de
Katherine
Mansfield,
Elizabeth von
Arnim
(1866-1941) fait
partie de ces
romancières
britanniques qui
ont imposé un
ton nouveau dans
la littérature
comme Virginia
Woolf, Vita
Sackville West,
Ivy
Compton-Burnett
ou Elizabeth
Bowen. Une large
partie de son
œuvre a été
traduite en
France, chez
Bartillat,
10/18, Plon,
Mercure et
Belles-Lettres.
Trois films ont
été tirés de ses
romans Avril
enchanté et
Mr.
Skeffington.
Totalement
inédit en
français, Un
été en montagne
(In the
Mountains)
a paru en 1920,
deux ans avant
son livre le
plus connu
Avril enchanté
(Enchanted
April).
Arnim y est au
sommet de son
art, fait d’une
écriture
familière et
fluide,
artistement
improvisée, et
d’un ton plein
d’humour, de
finesse et de
nostalgie.
Pétillante comme
le champagne.
Juillet 1919 :
la narratrice
arrive à son
chalet de
montagne, dans
le Valais suisse
qu’elle n’a pas
revu depuis le
1er août 1914.
Fatiguée et
déprimée, elle
s’effondre dans
l’herbe avant
même de franchir
le seuil. «
C’est tellement
humiliant d’être
à ce point
bouleversée. Je
me sens aussi
ridicule que
malheureuse ;
comme si
quelqu’un avait
pris mon visage
et l’avait
frotté de
poussière. »
Mais tout de
suite, grâce à
la magie de
l’écriture
d’Elizabeth von
Arnim, le
paysage est là.
Naguère
bruissante de
gaieté, la
maison est à
présent
silencieuse.
Seuls avec la
narratrice, le
couple de
gardiens qui
voit d’un
mauvais œil
qu’on vienne
déranger ses
habitudes. Ils
parlent en
français dans le
texte, d’où de
savoureux
dialogues où
l’élégante
Londonienne se
retrouve
souvent, malgré
son humour et sa
bonne volonté,
en position
difficile.
Mais cette sorte
de tranquillité
ne durera pas :
une situation
des plus
étranges
s’instaure avec
l’arrivée de
deux femmes
venues de nulle
part et marquées
par un lourd
secret. Kitty,
terriblement
convenable et
polie, et Dolly,
sa cadette,
toujours
souriante et
silencieuse.
Au premier
étonnement,
succède
l’inquiétude et
une brûlante
curiosité. Le
huis clos
devient
confrontation et
se développe en
une enquête
quasi policière.
L’art
d’Elizabeth von
Arnim, d’une
fascinante
finesse
psychologique et
d’une
réjouissante
ironie, est de
nous entraîner
jour après jour
à sa suite.
Jusqu’à une fin
imprévisible et
merveilleusement
« british ».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ishikawa TakobokuUn
printemps à HongoJournal en
caractères latins Traduit du japonais
par Alain Gouvret Préface de Paul
DecottigniesCollection Les
Vies imaginairesISBN
978-2-845-90304-3
– 168 pages – 16
€
|
|
|
Les Éditions
Arfuyen ont
commencé de
publier Takuboku
dès 1979. Après
de nombreuses
rééditions,
trois volumes de
poésie bilingues
sont à leur
catalogue :
Ceux que l’on
oublie
difficilement
précédé de Fumées
(2017), Le
Jouet triste
(2016) et
L’Amour de moi
(2003).
Depuis longtemps
en projet,
voici, grâce à
Alain Gouvret et
William English,
la traduction
d’un texte en
prose essentiel
: le fameux «
Journal en
romaji » tenu
par Takuboku en
1909.
Poète de la
jeunesse et de
la révolte,
Takuboku a une
tonalité unique
dans la
littérature
japonaise, faite
de liberté, de
crudité et d’une
déconcertante
innocence. Mort
à 26 ans,
Takuboku est
considéré comme
le Rimbaud
japonais.
Véritable mythe
dans son pays,
il est le
personnage
principal d’un
célèbre manga de
Jiro Taniguchi.
De juin 1907 à
avril 1908,
Takuboku a vécu
dans les brumes
d’Hokkaïdo, la
grande île du
nord, les pires
moments de sa
vie. Malade et
sans le sou, il
décide cependant
d’aller
accomplir à
Tokyo son destin
littéraire. Ce
n’est qu’en mars
1909 qu’il
trouve enfin un
poste de
correcteur au
grand quotidien
Asahi.
Le 7 avril 1909,
il commence
l’écriture du «
Journal en
caractères
latins », texte
unique dans
l’histoire de la
littérature
japonaise.
Marqué par ses
échecs, le jeune
homme de 23 ans
joue son
va-tout. Pour
briser le vieux
moule de la
littérature
japonaise et se
permettre de
tout dire, il
tente une
expérience
singulière :
substituer aux
caractères
japonais les
caractères
latins. C’est
une totale
libération.
Ses besoins
sexuels, ses
sautes
d’humeurs, ses
lâchetés, ses
contradictions,
il les aborde en
entomologiste,
comme s’il
s’agissait d’un
autre : « Je
suis une
personne née
individualiste.
Le temps passé
avec d’autres me
semble toujours
vide, sauf quand
on le passe à se
battre »
(11 avril). Même
terrible
lucidité dans
son regard sur
la société :
« Le système
matrimonial
actuel – tous
les systèmes
sociaux – pleins
d’absurdités !
Pourquoi
devrais-je être
enchaîné à cause
de mes parents,
de ma femme, de
mon enfant ?
Pourquoi mes
parents, ma
femme, mon
enfant
devraient-ils
être sacrifiés
pour moi ? »
(15 avril).
La voix de ce
Journal est la
même que celle
de ses plus
beaux tankas,
immédiatement
reconnaissable
dans son immense
compassion et sa
profonde
autodérision. Ce
Journal si
étrange, si
difficile à
traduire, le
voici enfin
disponible au
public
francophone.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vincent La SoudièreBrisantsTexte établi par
Sylvia MassiasCollection Les
Cahiers d'ArfuyenISBN
978-2-845-90029-5 –
176 pages – 13 €
|
|
|
En 1988, dix ans
après ses
Chroniques
antérieures
et après une
égale période de
grandes
souffrances
intérieures,
Vincent La
Soudière
entreprend
d’écrire ce
qu’il appellera
lui-même un peu
plus tard des
« aphorismes
». Les
textes sont
rassemblés dans
trois cahiers
numérotés.
Fin 1989,
Vincent La
Soudière a déjà
choisi un titre
: Brisants.
Ce livre a donc
clairement été
voulu comme tel
par Vincent La
Soudière.
Plus encore que
Chroniques
antérieures,
Brisants
témoigne de la
quête
spirituelle qui
fut au centre de
la vie de La
Soudière :
«mystique
aspiration »,
chez un auteur
qui, à l’âge de
22 ans, fut
postulant dans
une abbaye
bénédictine. Il
la quitta pour
l’amour d’une
femme, mais ne
se remit jamais
de ce départ –
vécu comme une
exclusion –,
menant dès lors
une vie
d’errance et de
souffrance,
physique et
spirituelle :
« La vie,
écrit-il
dans
Brisants, n’est
que souffrances
et renoncements.
La poésie aussi.
Autant dire
qu’elles
s’abreuvent
secrètement à
une même source
; la source de
l’incomplétude,
de l’admirable
et brisante
incomplétude. »
Cette brisante
incomplétude,
c’est de n’être
pas encore né :
« Je suis
inconsolable de
n’être pas
encore né »,
« Ma seule
souffrance est
que je n’ai pas
encore été nommé
». Ce désir
de naître enfin,
de naître à
nouveau, est
incessante
recherche du
père, attente de
« la Grande
Rencontre »
: « Très
loin dans les
sables, tu n’es
pas sans
remarquer un
point fuyant :
c’est mon père
qui ne m’a pas
encore engendré.
»
Attente
désespérante,
mais pleine de
confiance et
d’amour :
«Nous sommes
faits pour Toi,
ô vertigineux
Amour. Appelle
tes brebis,
elles
reconnaîtront ta
voix. »
L’homme, nous
dit La Soudière,
n’a d’autre
dignité que
d’être «
sentinelle de sa
propre naissance
».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2024
Ainsi
parlait
Anatole
France,
de Guillaume
Métayer, lu
par Michel
Ménaché
(Europe)
Mai 2024
Villa
Florida,
de René
Schickele,
lu par
Freddy
Raphaël
(Europe)
29 avril
2024
29 avril
2024
27 avril
2024
24 avril
2024
19 avril
7 avril 2024
6 avril 2024
5 avril 2024
Un été
en montagne,
d’Elizabeth
von Arnim,
lu par
Philippe
Barthelet
(Valeurs
actuelles)
30 mars 2024
25 mars 2024
23 mars 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Envoyé par

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retour
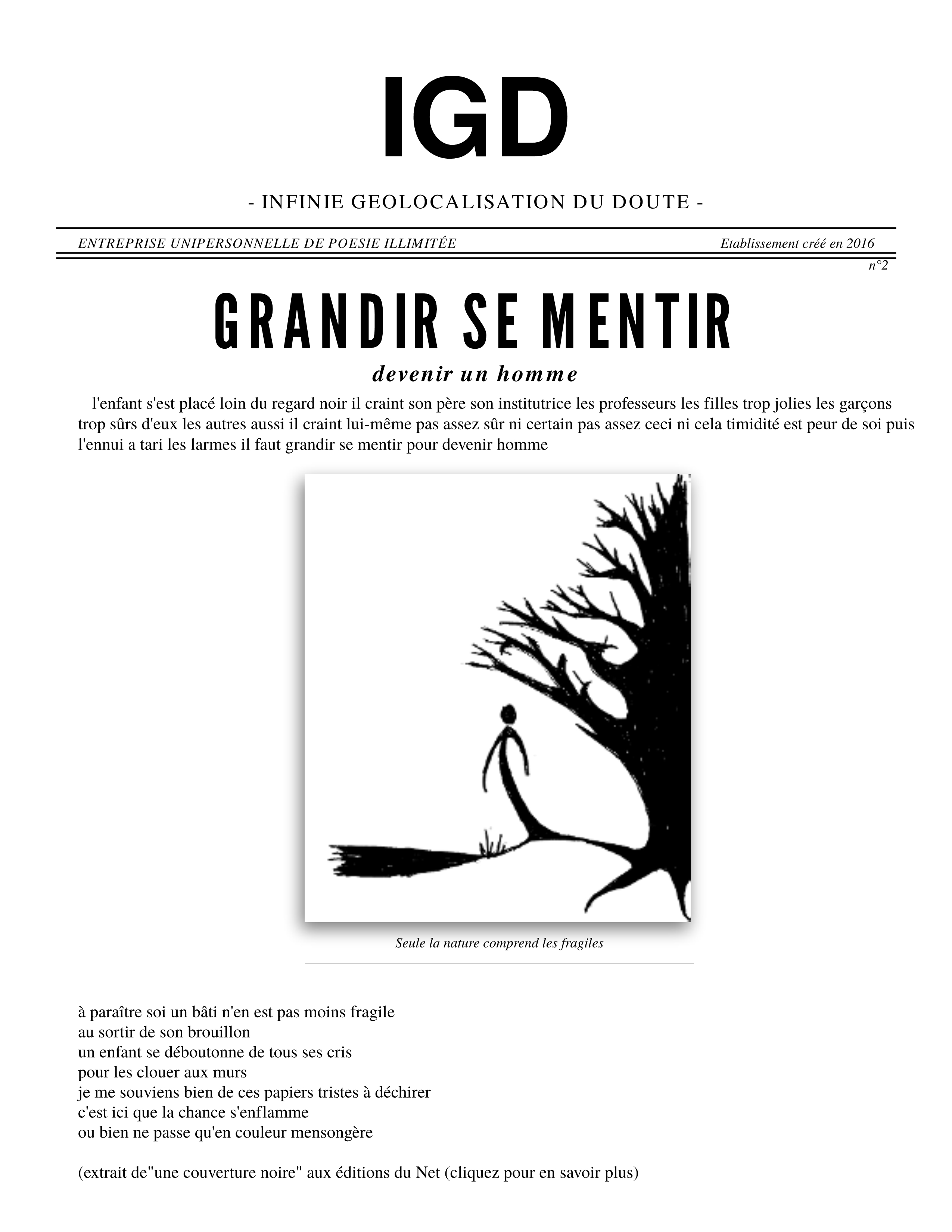
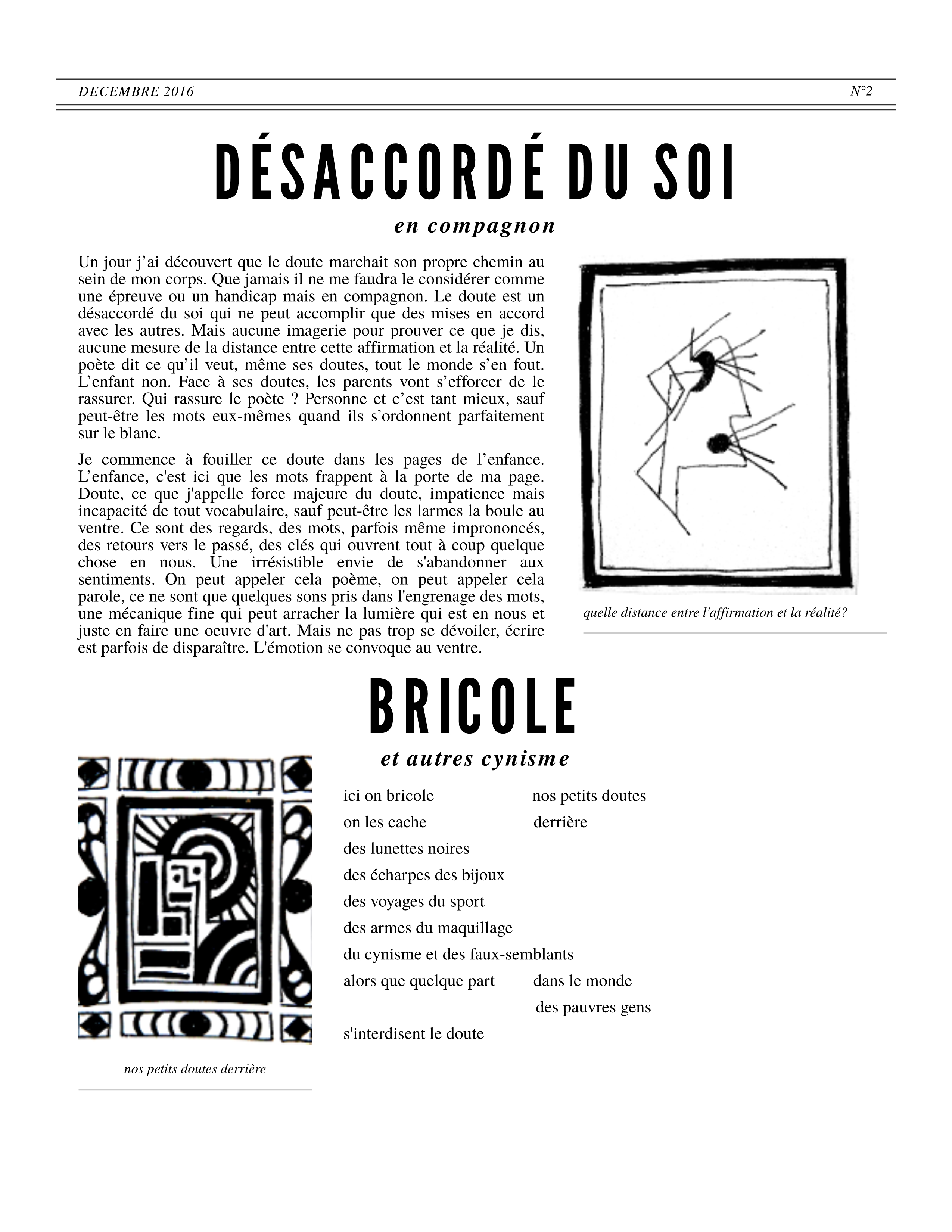
Retour
La dernière
traduction et publication
du poète Daniel
Giraud (1946 - 2023)
qui vivait à Oust dans la Haute Ariège

Retour
Bientôt le tome VI de mes albumanachs :
« 2023 »
En librairie fin
mai début juin !
Julien BLAINE
Retour




Retour
Ce livre a fait l'objet de
l'émission du mardi 7 mai 2024 et du
14 mai 2024
Retour
Elisabeth Aragon
fait paraître aux
éditions az'art atelier
Garde-moi de l'oubli
voir annonce de l'éditeur :
avec bon de commande.
Ce livre fera l'objet d'une prochaine émission.
Retour
Marc Tison - Marc Bernard
Nouveau clip poésie musique
-Les Varennes-
"Un texte et des images d'une
sorte de "post romantisme" des villes"
"L’amour en mémoire dans les
ruines"
La dernière sortie numérique du duo : Ep « Les
Varennes » + « Souvent » (en écoute ICI)
Retour
Philippe Berthaut
a fait
paraître
aux
éditions Jacques Brémond
LE MOTAGER DE POÈMES
ou comment jardiner le langage
pour faire pousser des poèmes
Voir:
Retour
Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIMONE WEIL
UNE MYSTIQUE DE
L'ACTION
Dans « L’importance
de Simone Weil », un
texte de 1960,
Czesław Miłosz
écrivait : « La
France fit un don
merveilleux au monde
moderne en la
personne de Simone
Weil. La venue au
XXe siècle de pareil
écrivain défiait
toute probabilité,
mais il arrive que
l’improbable se
produise. » Il
nourrit pour la
philosophe française
une admiration sans
réserve, sans pour
autant cacher les
aspérités de son
œuvre et de sa
pensée qui, selon
lui, sont de nature
à effrayer ou
rebuter le lecteur
timoré. […]
Disciple du Christ
jusqu’au mysticisme,
celle que ses
détracteurs
surnommaient la
« Vierge rouge »,
comme Louise Michel
avant elle, était
également proche de
Boris Souvarine, des
républicains
espagnols et des
combats
anticoloniaux.
Véritable activiste
du pacifisme, son
discours changea du
tout au tout au
moment de
l’armistice de 1940,
jusqu’à voir dans le
refus de se battre
une lâcheté et une
compromission. Très
tôt, son engagement
politique la
rapproche du
syndicalisme et du
communisme, mais
elle refuse de
souscrire au culte
du progrès, réfute
jusqu’à l’existence
même d’une doctrine
marxiste, et
s’oppose avec
véhémence à un
Trotski qui n’a pas
de mots assez durs à
son encontre. […]
Se considérant comme
un « esprit
médiocre »,
cette grande
lectrice de Platon
se voyait condamnée
à vivre dans
l’illusion et donc
dans le malheur,
comme en écho au
mythe de la caverne.
La vérité lui étant
ainsi refusée, elle
aimait « mieux
mourir que vivre
sans elle ».
Son obsession de la
vérité, à laquelle
elle n’a jamais rien
cédé dans ses
multiples
engagements jusqu’à
se retrouver seule
parce qu’incapable
du moindre
accommodement, cette
quête qui ne va
cesser de la
consumer durant les
vingt années
suivantes s’est
manifestée à l’issue
d’une sorte de crise
existentielle aux
alentours de ses
quatorze ans.
Trois ans plus tôt,
elle avait découvert
sa judéité, comme
elle le racontera à
la fin de sa vie à
un Jacques Maritain
auquel elle demande
de l’aider à rentrer
en France, alors
qu’elle vient
d’arriver à New York
avec ses parents :
« Je suis
d’origine israélite,
mais mes parents,
tout à fait
agnostiques, m’ont
laissé ignorer mon
origine jusqu’à
l’âge de onze ans et
m’ont élevée en
dehors de toute
religion. » Il
y a peut-être là une
forme de blessure
originelle
inconsciente qui,
parce qu’elle n’a
pas été nommée ni
guérie, ferait de
Simone Weil une
juive qui se refuse
à l’être. […]
Pour elle, le «
péché impardonnable
» des Hébreux est
d’avoir perçu Dieu
« sous
l’attribut de la
puissance et non pas
sous l’attribut de
Dieu ». Alors
qu’elle se
passionnera pour les
Upanishads ou la
Bhagâvad-Gîtâ,
elle est incapable
de se plonger dans
la lecture de
l’Ancien Testament
en s’en tenant au
« devoir de
probité
intellectuelle »
dont elle a
pourtant fait sa
méthode. Aux yeux de
Simone Weil,
l’Iliade a plus
d’importance et de
valeur que l’Ancien
Testament, et ce
sont les Grecs qui
préfigurent la venue
du Christ, et non
les Hébreux, jugeant
de surcroît la
notion de peuple élu
incompatible avec
l’idée qu’elle se
fait de Dieu. […]
Par ailleurs, son
opposition à
l’installation juive
en Palestine,
autrement dit à une
nation juive dans ce
protectorat anglais,
s’inscrit pleinement
dans la ligne
adoptée à l’époque
par les
organisations juives
de France, hostile
au parti pris
nationaliste adopté
par le Sionisme.
C’est précisément,
dans son
intervention sur le
sujet, le risque que
soulève Simone Weil,
celui de créer une
nationalité nouvelle
alors que « nous
souffrons déjà de
l’existence de
nations jeunes, nées
au dix-neuvième
siècle, et animées
d’un nationalisme
exaspéré ». […]
Peut-être cette
« haine de soi »
qui semble
caractériser Simone
Weil est-elle
d’ordre pascalien ?
À la phrase bien
connue de l’auteur
des Pensées,
« le moi est
haïssable »,
fait écho la rude
affirmation de la
philosophe de La
Pesanteur et la
Grâce, « le seul
chemin vers Dieu est
de ne pas exister
soi-même ». Or,
chez cette
intellectuelle
repentie, les mots
n’ont de réalité que
dans leur
réalisation : «
La foi, c’est
l’expérience que
l’intelligence est
éclairée par
l’amour. » Cet
effacement du soi,
elle n’a eu de cesse
de le pratiquer
comme les grandes
mystiques, dans une
forme de dolorisme
consenti, parce que
depuis toujours,
avant même sa «
crise » et les
questionnements qui
en ont découlé, elle
a vécu avec une
conception
chrétienne – et
platonicienne – du
monde. […]
Le choix de l’usine
répond à une «
nécessité intérieure
», à une
volonté de se mettre
à l’épreuve du réel.
Mais elle suit en
cela la leçon de son
ancien professeur,
Alain, qui
préconisait de
raisonner à partir
du concret et
n’avait que mépris
pour les
spéculations
industrielles
abstraites. «
J’ai l’impression
surtout de
m’échapper d’un
monde d’abstraction
et de me trouver
parmi les hommes
réels »,
écrit-elle à Simone
Gibert en 1932. Son
Journal d’usine,
tiré de son
expérience chez
Alsthom et chez
Renault, décrit
cette réalité d’«
établie » avant
l’heure, attentive
aux pénibles
conditions de
travail et aux
instants d’entraide
et de solidarité
dont le
désintéressement
renouait avec la
beauté.
C’est l’organisation
sociale, que Platon
appelle le «
Gros Animal »,
qui prive l’ouvrier
de l’accès à la
beauté du monde. Car
lui, le « Gros
Animal »,
décide la finalité
sur laquelle l’homme
doit se régler, son
action se trouvant
ainsi vidée de son
sens puisque l’homme
doit désormais obéir
à sa propre
création. […] C’est
ce qu’elle reproche
au marxisme, et à
ses tenants, qui est
«obsédé par la
production, et
surtout par le
progrès de la
production ».
Depuis la révolution
industrielle, toute
réflexion sur
l’organisation du
travail ne s’est
jamais intéressée
qu’à la production
et non à celui qui
produit.[…]
Restée proche d’une
certaine tradition
anarchiste, Simone
Weil n’a eu de cesse
de travailler sur
les formes de vie en
marge du droit.
Ainsi, rompant avec
la doxa marxiste, la
révolution ne peut
se traduire que par
une émancipation
complète et non par
l’avènement, comme
l’illustre l’exemple
soviétique, d’une
forme nouvelle
d’oppression
sociale. C’est
ce qui la
différencie des
marxistes, cette
conviction que toute
transformation
historique est
davantage sociale
que politique. Son
rejet de la
révolution
s’explique si on
l’appelle de ses
vœux en y pensant
« non comme à
une solution des
problèmes posés par
l’actualité, mais
comme à un miracle
dispensant de
résoudre les
problèmes ».
Simone Weil critique
le mythe d’une
conception
scientifique de
l’Histoire qui est
au cœur de la
réflexion développée
par Karl Marx.[…]
L’œuvre de Simone
Weil est d’une
complexité d’autant
plus fascinante
qu’elle est en
grande partie
posthume, mise en
ordre par deux
artisans, gardiens
ardents de sa pensée
: Gustave Thibon,
pour la partie
spirituelle, et
Albert Camus, pour
la partie
philosophique. […] Rendue
à sa forme première,
celle de fragments,
dans ce volume, la
pensée de Simone
Weil y retrouve sa
nature autant que
son essence faite de
fulgurances, d’élans
et de brisures,
pareils aux
mouvements
désordonnés des
électrons qui sont
pourtant une source
prodigieuse
d’énergie. Il n’est
pas possible de
l’épuiser. Cela
explique que son
influence et sa
présence, tour à
tour exaltantes,
déconcertantes et
irritantes, n’aient
jamais cessé de
croître.
Camus ne s’y était
pas trompé : au
moment de recevoir
le prix Nobel,
répondant à la
question d’un
journaliste lui
demandant quels
écrivains vivants
comptaient pour lui,
après avoir
mentionné les noms
de quelques auteurs
et amis français et
algériens, il avait
déclaré : « Et
Simone Weil – car il
y a des morts qui
sont plus proches de
nous que bien des
vivants. »
Cécile A. Holdban,
extraits de la
préface au livre Ainsi
parlait Simone Weil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES DEUX NOUVEAUTÉSDU MOISEn librairie le
jeudi 4 avril 2024Distribution Sofédis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Simone WeilAinsi parlait
Simone WeilDits et
maximes de vieChoisis et présentés
par Cécile A.
HoldbanCollection Ainsi
parlaitISBN
978-2-845-90364-7 –
192 pages – 14 €
|
|
|
Simone Weil
(1909-1942) est
morte à 34 ans
après une vie
aussi intense
qu’héroïque.
Bien qu’elle
n’ait presque
pas publié de
son vivant, elle
laisse une œuvre
immense et d’une
extrême
diversité.À Normale Sup,
Simone de
Beauvoir, d’un
an son aînée,
est frappée par
« sa réputation
d’intelligence »,
« son
accoutrement
bizarre »
mais plus encore
par son extrême
sensibilité aux
malheurs
d’autrui. Elle
n’a alors pas
même 20 ans.
« Tous les
hommes admettent
une morale
rigoureuse quand
il ne s’agit pas
de l’appliquer.
»
Lorsqu'elle
écrit ses
lignes, Simone
Weil commence sa
vie
professionnellle
comme
professeure de
philosophie au
lycée de Roanne.
Dès la fin de
l’année scolaire
1933-1934, elle
quitte
l’enseignement
devenir
ouvrière.
Marxiste, elle a
compris pourtant
que la
révolution ne
suffit pas à
résoudre le
problème social
: « Le mot
de révolution
est un mot pour
lequel on tue,
pour lequel on
meurt, pour
lequel on envoie
les masses
populaires à la
mort, mais qui
n’a aucun
contenu. »
Elle n’a pas
plus confiance
dans les
staliniens et
les trotskistes
que dans les
réformistes :
« Toutes les
absurdités qui
font ressembler
l’histoire à un
long délire ont
leur racine dans
une absurdité
essentielle, la
nature du
pouvoir. »C’est au contact
le plus proche
avec la réalité
que l’on peut
comprendre les
mécanismes de
l’oppression et
les moyens de
s’en affranchir.
De même,
pacifiste, il
lui faudra faire
la guerre
d’Espagne avec
les anarchistes
pour se donner
le droit de
parler de la
paix.Poussant au plus
loin cette
expérience de la
compréhension
des autres et de
la compassion,
la jeune
agnostique
révoltée en
vient à se
rapprocher du
christianisme.
« Nous
vivons une
époque privée
d’avenir,
observe-t-elle.
L’attente de
ce qui viendra
n’est plus
espérance, mais
angoisse. »
Après sa mort
paraîtront les
textes
incandescents de
La Pesanteur
et la Grâce
et L’Attente
de Dieuqui
révèleront en
cette
infatigable
militante l’une
des grandes
spirituelles de
son siècle.
Alors que ses
parents l'ont
entraînée aux
États-Unis pour
fuir les
persécutions
anti-sémites,
elle décidera de
retourner en
Europe pour
travailler à
Londres au
service de la
France Libre.
C'est là qu'elle
meurt de la
tuberculose et
repose
aujourd'hui
encore.
Cécile Holdban,
poète et
peintre, a déjà
donné en 2019 un
excellent Ainsi
parlait Virginia
Woolf. Chez ces
deux femmes, une
même volonté
indomptable et
la même
extraordinaire
créativité.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antonia PozziUn fabuleux
silenceJournal de poésie
1933-1938Traduit de l'italien
et présenté par
Thierry GillybœufBILINGUECollection NeigeISBN
978-2-845-90367-8
– 276 pages – 22
€
|
|
|
Les
Éditions
Arfuyen
ont
entrepris
de
publier
en
édition
bilingue
l’intégralité
du
Diario
de
poesia
(Journal
de
poésie),
qui
constitue
l’œuvre
unique
d’Antonia
Pozzi.
En
2016
a
paru
le
premier
volume
intitulé
La
vie
rêvée.
Journal
de
poésie
1929-1933,
qui
a
remporté
un
vif
succès. Ce
second
volume,
Un
fabuleux
silence.
Journal
de
poésie
1933-1938,
en
constitue
la
dernière
partie. Traduite
en
de
nombreuses
langues,
elle
est
révélée
pour
la
première
fois
en
français
grâce
à la
traduction
intégrale
de
Thierry
Gillybœuf,
traducteur
également
de
Quasimodo,
Svevo
ou
Sinisgalli.
Malgré
une
mort
prématurée
à
l'âge
de
26
ans,
Antonia
Pozzi
(1912-1938)
a
laissé
une
œuvre
considérable
dont
la
publication
posthume
a
révélé
la
force
et
l'originalité.
Vittorio
Sereni
a
reconnu
le
premier
ses
dons
exceptionnels.
Eugenio
Montale
admirait
chez
elle
la
«
pureté
du
son
»
et
la
«
limpidité
des
images
».
Et
le
grand
T.
S.
Eliot
lui-même
se
disait
frappé
par
«sa
pureté
et
sa
probité
d'esprit
».
Un
an
après
sa
mort,
les
éditions
Mondadori
ont
publié
sous
le
titre
Parole,
un
premier
ensemble
de
ses
poèmes
(1939).
L'année
suivante
a
paru
sa
thèse
:
Flaubert.
La
formazione
letteraria
(1940).
En
1948,
a
paru
enfin
la
totalité
du
Diario
di
poesia
1930-1938,
préfacé
par
Montale.
La
publication
de
ses
lettres
(notamment
à
Sereni)
a
révélé
une
personnalité
complexe
et
attachante.
Le
Diario
di
poesia
est
un
journal
entièrement
fait
de
poèmes:
le
miracle
est
que,
grâce
à la
vivacité
du
regard
et à
la
limpidité
du
style,
ce
journal
ne
tombe
jamais
dans
le
prosaïsme
ni
la
complaisance.
Comme
Emily
Dickinson,
Antonia
Pozzi
n’a
rien
publié
de
son
vivant.
Pour
elle
aussi,
la
poésie
constitue
une
sorte
de
journal
secret
où
la
vie
entière
est
reprise
et
métamorphosée.
Dans
sa
parfaite
immédiateté,
son
écriture
est
ainsi
frappante
de
profondeur
et
de
densité.
La
montagne
(les
Dolomites)
est
comme
le
symbole
de
son
écriture,
elle
qui
réconcilie
le
ciel
et
la
terre,
la
vie
et
la
mort.
C’est
là
qu’elle
trouve
le
refuge
spirituel
nécessaire
pour
s’affranchir
d’un
monde
où
l’épanouissement
normal
de
sa
vie
de
femme
lui
est
refusé
par
les
conventions
sociales
d’un
milieu
et
d’une
époque
marqués
par
le
patriarcat
mais
aussi
le
fascisme.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TROIS LIVRES
À
REDÉCOUVRIR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Virginia WoolfAinsi parlait
Virginia WoolfDits et maximes de
vieChoisis et traduits
de l'anglais par
Cécile A. HoldbanCollection Ainsi
parlaitISBN
978-2-845-90287-9
– 176 pages – 14
€
|
|
|
Qui a
peur de
Virginia
Woolf ?
Grâce à la
pièce
d’Edward
Albee et au
film
interprété
par
Elizabeth
Taylor, le
nom de
Virginia
Woolf est
entré dans
le langage
courant. La
lit-on pour
autant ? Ses
grands
romans –
dont Mrs
Dalloway,
qui a pris
au cinéma
les traits
de Vanessa
Redgrave –
ont
révolutionné
l’art
romanesque,
mais ne
constituent
qu’une
partie parmi
d’autres de
son œuvre,
qu’elle-même
considérait
comme
secondaire
par rapport
à
l’autobiographie.
Grâce à cet
Ainsi
parlait,
on peut
enfin
explorer
l’ensemble
du parcours
biographique
et
littéraire
de cette
femme hors
du commun :
profondément
libre et
rebelle à
toute
convention.
Auteur de
deux livres
chez
Arfuyen,
traductrice
fascinée par
les
écrivaines
anglo-saxonnes
comme
Katherine
Mansfield,
Virginia
Woolf ou
Sylvia
Plath,
Cécile A.
Holdban rend
hommage à
une de ses
modèles
d’artiste.
« Quelle
vie doit-on
mener ? La
vie que l’on
aime. J’aime
écrire,
j’aime le
changement,
j’aime
lancer mon
esprit dans
les hauteurs
et attendre
de voir où
il va
retomber. »
Virginia
Woolf écrit
ses lignes
dans le
monumental
Journal
qu’elle
a commencé
de rédiger
lorsqu’elle
avait 15 ans
et qu’elle
tiendra
jusqu’à sa
mort. Et
dans une
lettre à son
ami Hugh
Walpole ce
qu’elle
écrit
poursuit la
même
interrogation
: « Je
pense
parfois que
seule
l’autobiographie
relève de la
littérature
; les romans
sont les
pelures que
nous ôtons
pour arriver
enfin au
cœur qui est
vous ou moi,
rien
d’autre. »
C’est la vie
qui
intéresse
Virginia
Woolf, et
rien
d’autre. Qui
l’effraie
aussi :
« La vie,
pour les
deux sexes
est ardue,
difficile,
une lutte
perpétuelle.
Qui demande
un courage
et une force
gigantesques.
» Ces
lignes, elle
les écrit
dans un
recueil de
conférences
intitulé
Une chambre
à soi.
Dans ses
journaux,
lettres,
essais, il
n’est rien
dont
Virginia
Woolf ne
fasse
l’objet de
son
écriture.
Car écrire,
pour elle,
c’est avant
tout se
libérer :
« Le
premier
devoir de la
femme
écrivain,
c’est de
tuer l’Ange
du Foyer »
(Journal).
Il faut
avoir lu,
bien sûr,
les géniaux
romans de
Virginia
Woolf –
Mrs Dalloway,
Les Vagues,
etc. –, mais
elle ne s’y
trompait pas
: c’est dans
les écrits
autobiographiques
que nous
arrivons
avec elle
« au
cœur »
: ce «
cœur qui est
vous ou moi,
rien d’autre
».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antonia PozziLa vie
rêvéeJournal de poésie
1929-1933Traduit de l'italien
et présenté par
Thierry GillybœufBILINGUECollection NeigeISBN
978-2-845-90226-8
– 320 pages – 20
€
|
|
|
Le premier texte
de ce
Journal est
daté de
Sorrente, le 2
avril 1929 –
elle vient
d’avoir 17 ans.
Ce premier
volume s’achève
le 25 septembre
1933 : « Ô toi /
voile – de ma
jeunesse, / ma
robe légère, /
vérité évanouie
– / ô nœud /
luisant – de
toute une vie /
qui fut rêvée –
peut-être – //
oh ! pour
t’avoir rêvée, /
ma chère vie, /
je bénis les
jours qui
restent – / la
branche morte de
tous les jours
qui restent, /
qui servent / à
te pleurer. »
Tels sont les
derniers mots du
poème écrit ce
jour-là, «
La vita sognata
» (La vie rêvée),
qui donne son
titre à ce
volume.
Antonia
Pozzi est
née le 13
février 1912
à
Milan. Elle
est la fille
de l’avocat
du Duce,
Roberto
Pozzi, et de
la comtesse
Lina Cavagna
Sangiuliani
di Gualdana. Entrée
en 1922 au
lycée
Manzoni,
elle tombe
amoureuse en
1927 de son
professeur
de
latin-grec,
Antonio
Cervi, de
quatorze ans
son aîné. En
1929, elle
écrit ses
premiers
poèmes. Elle
entre en
1930 à la
Faculté de
Lettres et
de
Philosophie
de
l’Université
de Milan, où
elle se lie
au grand
poète
Vittorio
Sereni.
En 1931, son
père espère
l’éloigner
de Cervi en
l’envoyant
en
Angleterre.
La liaison
ne prendra
fin qu’en
1934. En
1935, elle
soutient sa
thèse sur la
formation
littéraire
de
Flaubert. Le
2 décembre
1938, elle
sera
retrouvée
inconsciente
dans un
fossé de la
banlieue de
Milan, un
poème de
Sereni dans
la main :
suicide par
barbituriques.
Elle meurt
le lendemain
et est
enterrée
dans le
petit
cimetière de
Pasturo.
Traduite en de
nombreuses
langues, elle
est révélée pour
la première fois
en français avec
la traduction
intégrale du
Diario di poesia,
« journal de
poésie »
d’une tonalité
très proche de
la grande
Katherine
Mansfield.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cécile A. HoldbanToucher terreCollection Les
Cahiers d'ArfuyenISBN
978-2-845-90327-2 –
176 pages – 14 €
|
|
|
Le premier
livre de
Cécile A.
Holdban
publié par
Arfuyen en
2016
imposait
d’emblée une
voix
poétique
nouvelle et
évidente,
que le prix
Yvan Goll a
immédiatement
reconnue.
D’origine
hongroise,
familière
des grandes
figures de
la
littérature
anglo-saxonne
comme
Katherine
Mansfield et
Virginia
Woolf,
Cécile A.
Holdban aime
à introduire
dans ses
recueils les
voix des
auteurs
qu’elle
traduit ou
qu’elle aime
(de János
Pilinszky à
Alejandra
Pizarnik).
Ce nouveau
recueil
impose avec
une sûreté
et une
délicatesse
infinie un
monde
troublant et
magnifique,
peuplé
d’obscures
menaces et
de grâces
envoûtantes.
Une voix
simple et
nue, venue
d’on ne sait
quel pays
proche et
lointain et
qu’on ne
peut
oublier.
Il est rare,
écrivions-nous
en 2016,
lorsque nous
avons publié
Poèmes
d’après
d’être saisi
par la
simple
évidence
d’une
écriture. Ce
nouveau
livre de
Cécile A.
Holdban
s’articule
en 4 parties
bien
distinctes
qui
déterminent
comme un
itinéraire :
« Labyrinthe
», « Demeure
», « Voix »
et « Toucher
terre ».
Lisons le
tout premier
poème de «
Labyrinthe »
: « Dans
les livres /
on dit qu’il
faut libérer
la parole /
mais si
j’ouvre ma
bouche /
n’en tombent
que les
corps /
d’oisillons
livides /
trop tôt
sortis du
nid ».
Voici celui
de « Demeure
» : «
Aimer ce qui
se délie /
jusque dans
sa chute »
et celui de
« Voix » :
«
Écoutez-nous
: quelle
étrange
poésie nous
habite,
créatures
d’os et de
cris ! /
Notre rivage
est planté
sur le
monde, une
tente de
veilleur /
sur le flux
et le reflux
du monde,
ventre
abritant le
désir. »
Tout un
monde
d’herbes et
d’oiseaux,
d’abeilles
et d’arbres.
Solennel et
familier à
la fois.
Jusqu’au
dernier et
admirable
poème de «
Toucher
terre » :
«
Toucher
terre
lentement, à
l’abri des
sous-bois, /
des
cyclamens
mauves, des
lianes de
ronces / les
flammes des
bruants
voletant /
entre
l’ombre des
haies /
simplement
toucher
terre, /
jusqu’à
suivre,
l’œil
délivré dans
les brins, /
la lumière,
le ruisseau
clair,
l’ambre, /
jusqu’à la
chute rousse
du soleil. »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 mars 2024
20 mars 2024
19 mars 2024
14 mars 2024
9 mars 2024
7 mars 2024
La voie du
large, de
Michèle Finck,
par Gérard
Bocholier (La
Vie)
7 mars 2024
7 mars 2024
Ainsi
parlait Anatole
France, lu
par Philippe
Barthelet
(Valeurs
actuelles)
Mars 2024
Ainsi
parlait Eugène
Delacroix,
par Nelly Carnet
(Le Journal des
Poètes)
Mars 2024
Villa
Florida, de
René Schickele,
lu par Isabelle
Baladine Howald
(Or Norme,
magazine de la
métropole
strasbourgeoise)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Envoyé par

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retour
Afficher dans le navigateur
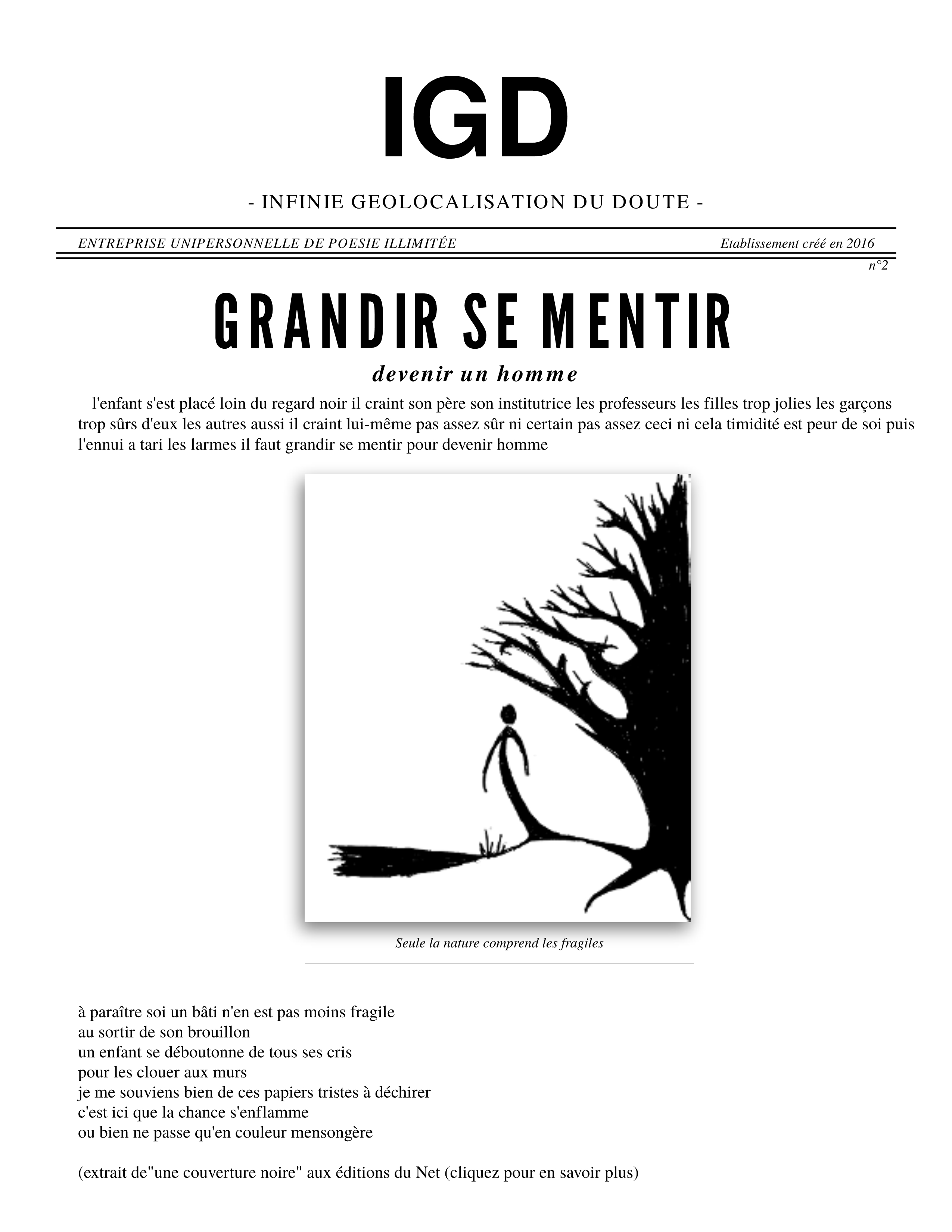
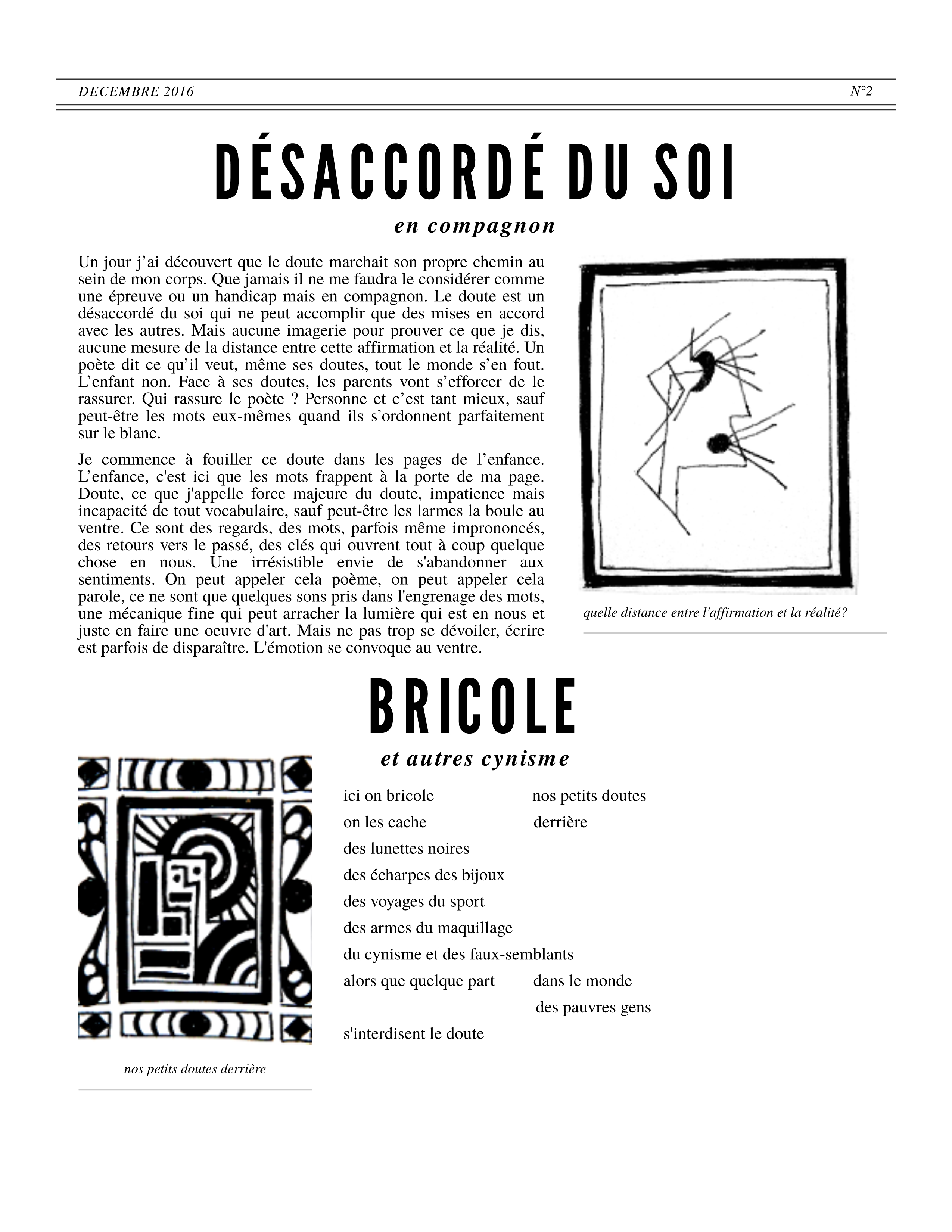

Retour
Michel
Eckhard-Elial
publie
aux éditions de la Margeride
"Dans l'éclat des mots"
Ce livre fera l'objet d'une prochaine émission.
Retour
Retour

Voir bulletin de complicité
Cet édito ne
m’est pas aisé car j’ai perdu les mots. Cela arrive et ce n’est pas
grave même si la cause en est un excès de maux qui dépasse la capacité —
même pour une poète bien noire comme je peux l’être — d’assimilation et
de transmutation, et ce n’est pas la démence épuisante des décideurs du
monde qui va me faire retrouver l’art des mots pirouettes.
J’ai perdu
les mots mais les silences font des trous dans le temps, plongent au
plus profond de sources insoupçonnées et ramènent dans leurs filets
tendus à vif, une poignée de sable : l’essence de soi et des vibrations
qui tournent autour des anciens mots, forment un tourbillon et les
décapent jusqu’à l’os. Le reste est à brûler, brûler pour renaître,
libre des mots radotés, des mots enkystés, des mots qui nous entravent,
nous enferment dans les cachots de nos histoires.
Et après le
labeur des silences, viendront les mots nouveaux, les mots graines.
CGC
Toute parole est là pour
séduire la mort.
Anne Jullien
Pour voir le sommaire, c'est ici :
http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/archive/2024/03/30/nouveaux-delits-n-78-6492008.html
Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent cette revue
fabriquée dans le Lot depuis plus de 20 ans !
Retour


Retour




Retour


Retour


Retour

Retour
Retrouvez tous les titres des éditions
Troba Vox
sur le site :
Retour

BON DE COMMENDE
Retour
Lire le poème du dimanche
choisi par Tahar Bekri :
"Elena"
du poète uruguayen
exilé au Mexique
Retour


Retour
 Soscripcion
pel libre-CD
Soscripcion
pel libre-CD
“Cante per un poble”
Eric Fraj canta
Robèrt Lafont
Amiga, amic,
ai cabussat dins l’univèrs poetic d’En Robèrt Lafont e ne torni amb 16
cançons (Morgan Astruc: guitarra, Tim Tchang: percussions, Sarah e Eric Fraj:
cant). Son l’anma d’un libre-CD editat per Tròba Vox1,
ont cabon paraulas e traduccions, de tèxtes de Danièla Julien, Joan-Ives
Casanova, vòstre servent, las òbras del plastician Daidièr Mir e qualques
suspresas. Lo podètz crompar per avança, per ajudar vos tanben, e decisivament,
a son espelison (a la fin d’abril venent). De tot còr, mercés!
E. Fraj (15/02/24)
Per soscriure: siá comandar lo libre-CD sol pel prètz de 15€ (e lo
recebretz tre sa sortida); siá comandar per 49 € lo libre-CD + unaestampa
numerotada signada Mir (Retrach de Robèrt Lafont, 15 x 20 cm, la
cobertura, o una autra gravadura de causir amb l’artista: didiermir@gmail.com)
D’enviar a: E. Fraj 4 rue Sant Laurenç –
31390 - Carbonne.
ericfraj@hotmail.fr
/ 06 12 94 12 01
Nom :
……………………………………..............................................
Prenom :
...…………………………………...........................................
Adreça :…………………………………………………………...………………………………………………………………………...
Tel.:
..................................................................................................................
Mail:………………………......................@...............................................
•Comandi: ………... exemplar(s) de “Parle a un pòble” al prètz de 15€ l’un
(contra 20€ en comerç) 15€ x ...... .........(pòrt comprés)
•Comandi……...exemplar(s)
de “Parle a un poble” + una estampa de Mir 49 € x ...... = ......... (pòrt
comprés)
Junhi un chèc
de : …………………….. a l’òrdre d’Eric Fraj.
A ………………………..
lo ............................. Signi :
S’estimatz mai pagar
per virament bancari, mandatz-me un corric ! Mercés !1https://trobavoxeditions.com/ Amb l’ajuda de la
MARPÒC, de la Region Occitania, del CIRDÒC, de l’IEO-PACA, de l’IEO del
Vilafrancat, de l’IEO d’Aude, etc. (totas las contribucions seràn indicadas dins
lo libre-CD).
Retour
Ce livre fera l'objet d'une prochaine
émission
Retour
Le Chant du balancier
Gilles Baudry
éditions Ad Solem, 110 pages, 17€.
En
librairie ou sur : https://www.editionsadsolem.fr
Le
temps est une ombre. Tout passe. Nous passons aussi comme fleurs des champs,
mais en Celui qui ne passe pas, en « Dieu jeune ensemble qu’éternel » (Péguy).
Déjà ici-bas, la lumière fait son miel de tout ce qu’elle touche. Prière et
poésie se pollinisent . S’instaure au cœur de l’écriture le temps intérieur.
Temps sans temps où affleure l’éternel, comme soustrait à l’écoulement des
heures. Pour avoir offert l’hospitalité à l’invisible, l’évènement est quotidien
et le mystère semble presque naturel. Des petites épiphanies du réel le poète
fait une métaphore voilée de la Présence. Humble artisanat, ses mots silencieux
suggèrent, en filigrane et en aparté, qu’on ne devrait pas évaluer notre vie en
termes de pesanteur mais en mesure de grâce.
Gilles Baudry Gilles Baudry est poète et moine à l’abbaye bénédictine
Saint-Guénolé de Landévennec en Bretagne. Il a publié en 2013 chez Ad Solem,
Demeure le veilleur.

Retour
Le romancier et poète
Andrea
Genovese
a fait paraître en français, italien
et anglais :
Belvedere
n.70
octobre-décembre 2023
Retour

FRANÇOIS MAURIAC
L’INGUÉRISSABLE JEUNESSE
par Philippe
Dazet-Brun
éditions
Memoring de Bordeaux
collection :Figures
de Nouvelle-Aquitaine 2024
Romancier, poète, essayiste et dramaturge, François Mauriac – couronné par le
prix Nobel de littérature en 1952 – est l’un des grands écrivains du XXe siècle.
Journaliste, il fut également un acteur de la vie intellectuelle et politique au
moment où le monde connut deux conflits généralisés, l’instauration des
totalitarismes et la décolonisation, au moment aussi où la France traversa
quatre régimes, l’Occupation et les bouleversements liés à l’établissement de la
société de consommation. Catholique, il prit part aux débats de l’Église tout en
cherchant le dialogue avec ceux qui ne partageaient pas sa foi. Homme de
convictions, souvent à rebours de son milieu, Mauriac fut donc une figure
marquante du siècle dernier, une voix qui conserve encore une portée dans le
nôtre.
Cette
biographie, enrichie par un apport iconographique souvent inédit, revient sur ce
destin que l’on peut aisément placer sous le signe de l’inguérissable jeunesse.
14,00€
Retour
Argumentaire Antigone Casimir Prat
Ce livre a fait
l'objet de l'émission du
Retour
La revue et éditions "Nouveaux
Délits" font paraître :

L’auteur :Josette Soulas Moyes est née le 25 décembre 1942, dans une
banlieue proche de Paris, Issy-les-Moulineaux, mais le changement de vie de
sa mère l’amena en Normandie, à l’âge de quatre ans. Elle n’a jamais été
publiée, mais a toujours gardé un contact avec l’écriture, « petits papiers
», porteurs de poèmes et d’histoires courtes, perdus, déchirés, retrouvés…
Elle a suivi plusieurs ateliers d’écriture et depuis sa retraite, elle a
consacré plus de temps et de travail à l’écriture. Elle a formulé, d’une
façon qui l’a surprise elle-même, l’enjeu que représente ce chemin : « se
réconcilier avec sa vie ». Sa vie, elle la partage entre l’Alsace
(Strasbourg) et la Provence (Vaucluse-Ventoux).L’illustrateur, Philippe
Chevillard« Auteur de BD amateur et illustrateur amateur, je consacre une
partie de mon temps à la création de courtes bandes dessinées et
l'illustration de textes d'auteurs pour des revues, recueils de poésie, ou
affiches. Mes dessins ont été publiés aux éditions Jacques Flament, éditions
des embruns, éditions Lamiroy, dans les distributeurs BDs de Short édition,
ainsi que dans divers fanzines, recueils, et revues littéraires tels que :
Traction Brabant, Le Soc, Le coquelicot, Poétisthme, Soleil Hirsute, La
piscine, L’imagineur, L’utopie, Présences d’esprits, Lichen, Hélas,
Opuscule, L’Ampoule, Caractère … »https://philippechevillard.f28
pages agraféestirage numéroté imprimé sur papier 90 g & 250 g calcaire100 %
recyclé
10 € + 3 € de port

*
Délits buissonniers
est une
collection de tirés à part
de la revue
Nouveaux Délits
Vous pouvez
lire Josette Soulas Moyes
dans le
numéro 46 (octobre 2023)
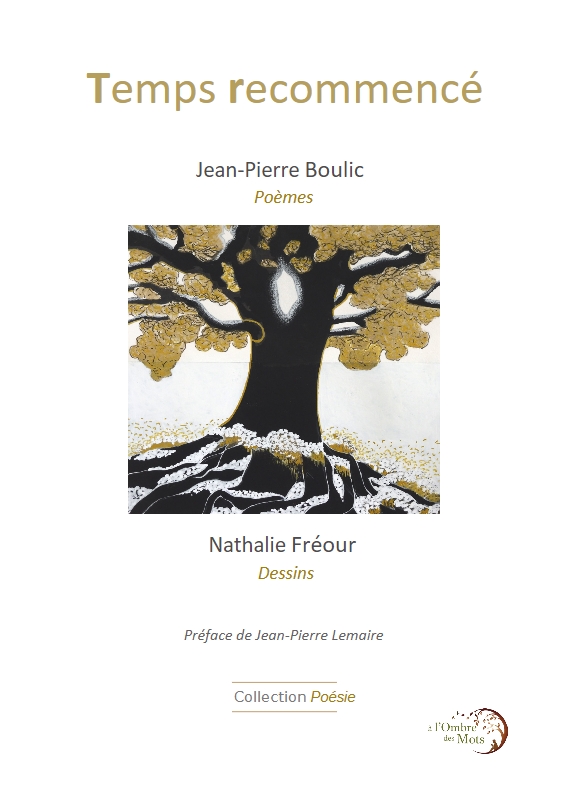
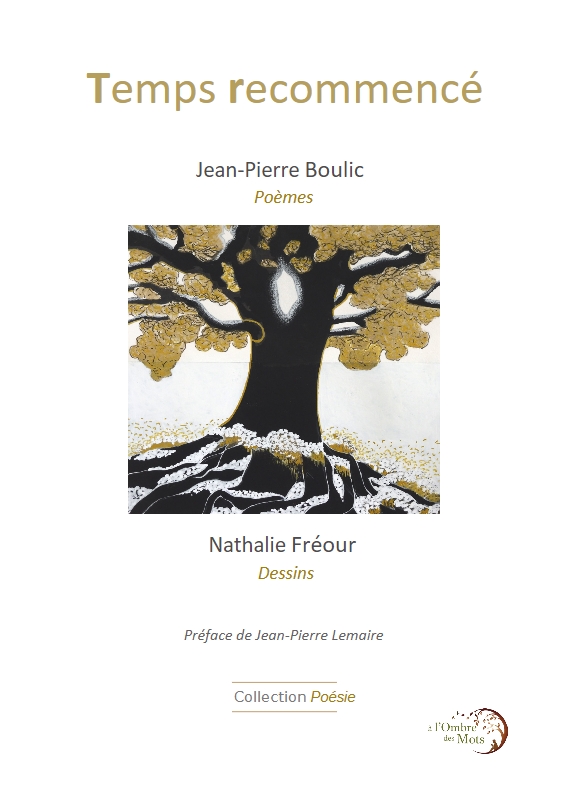
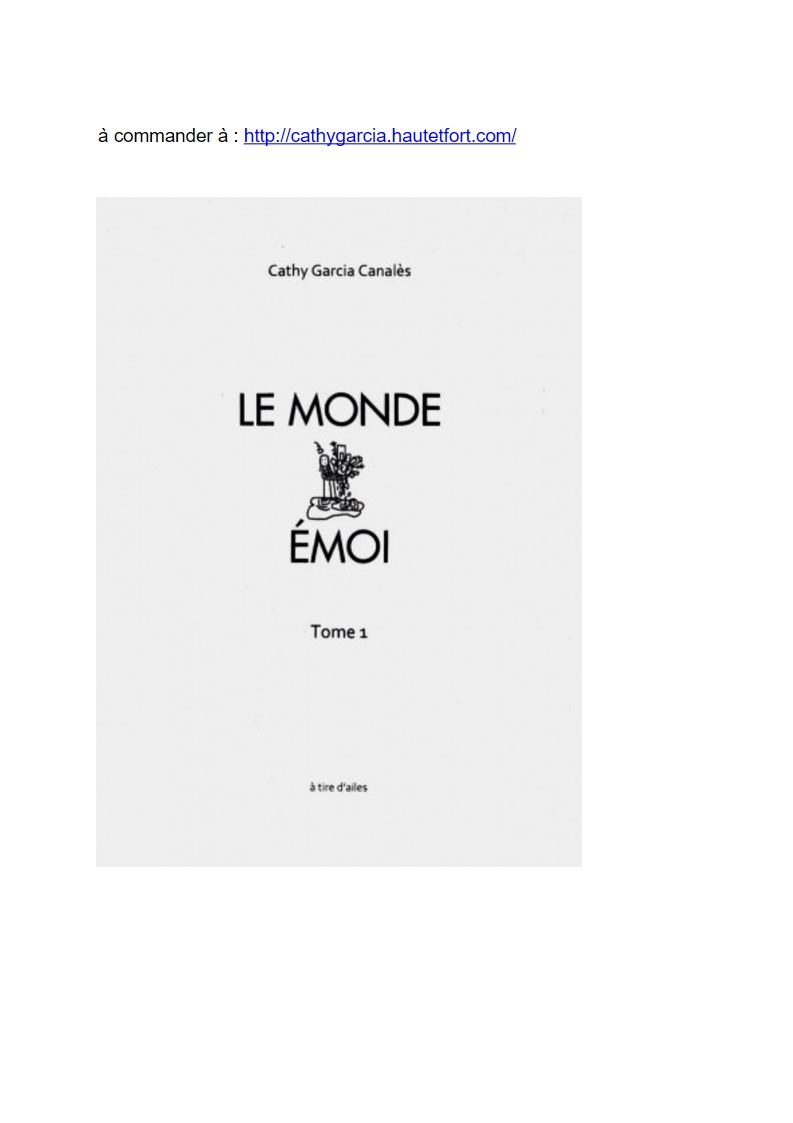
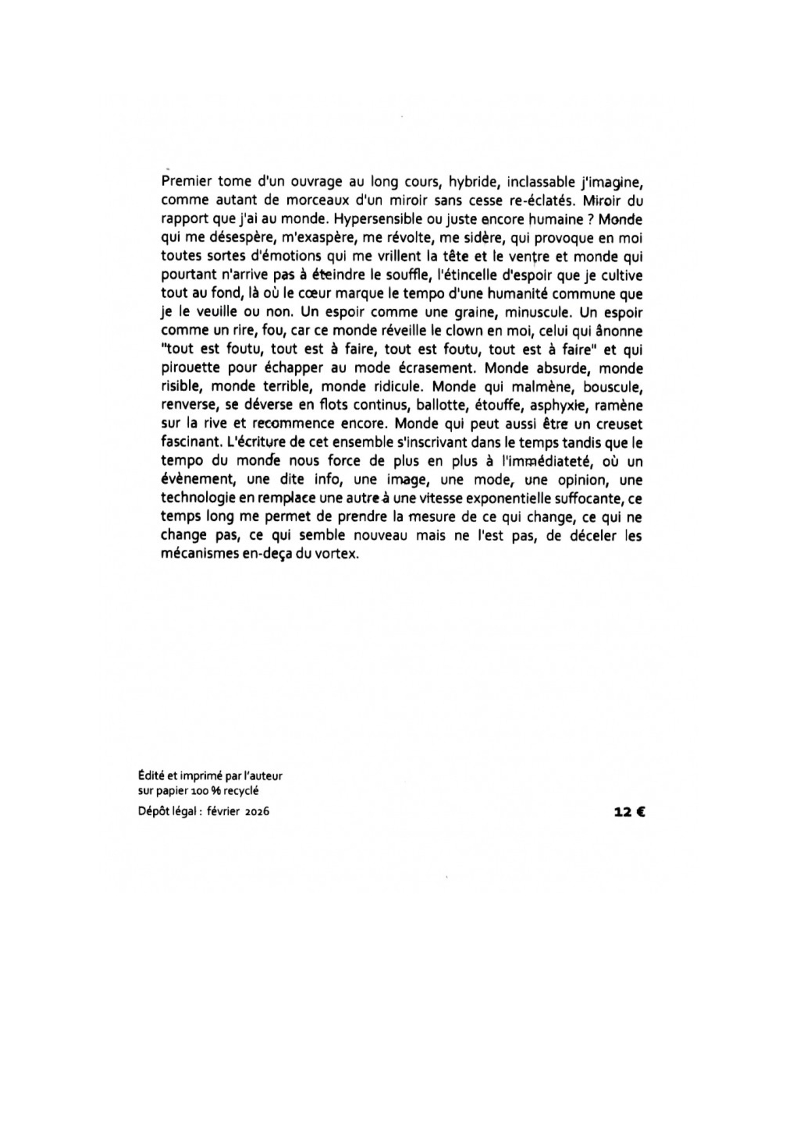
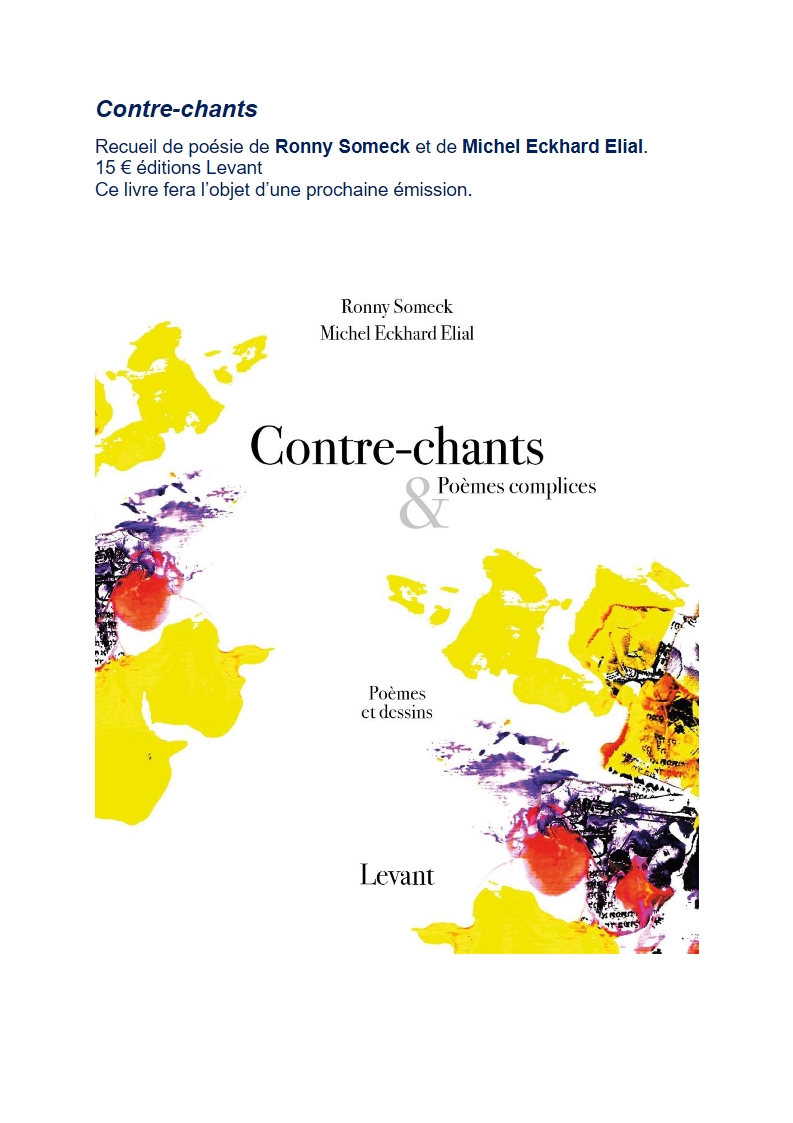
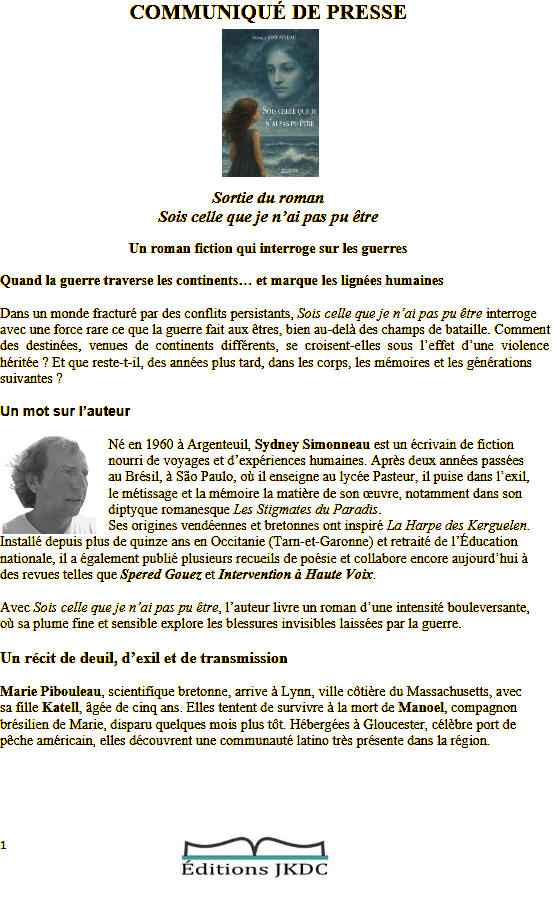
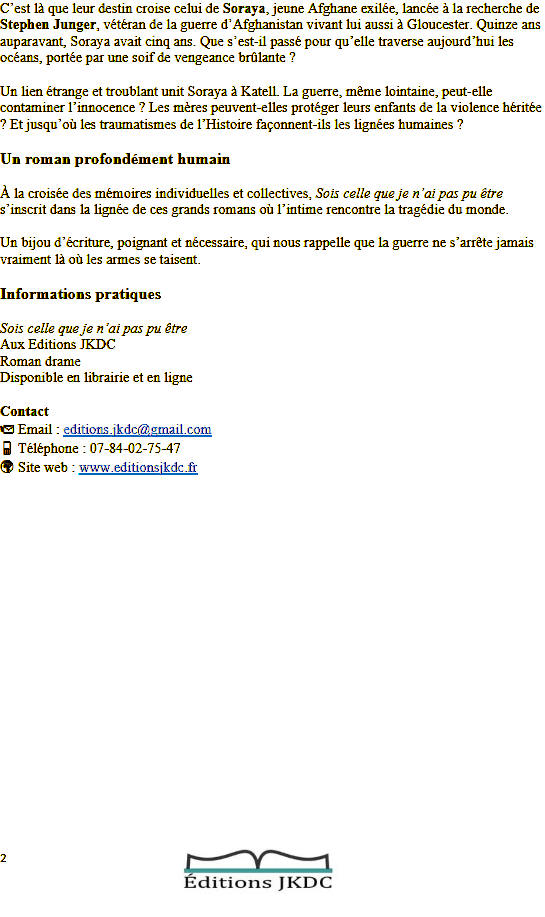
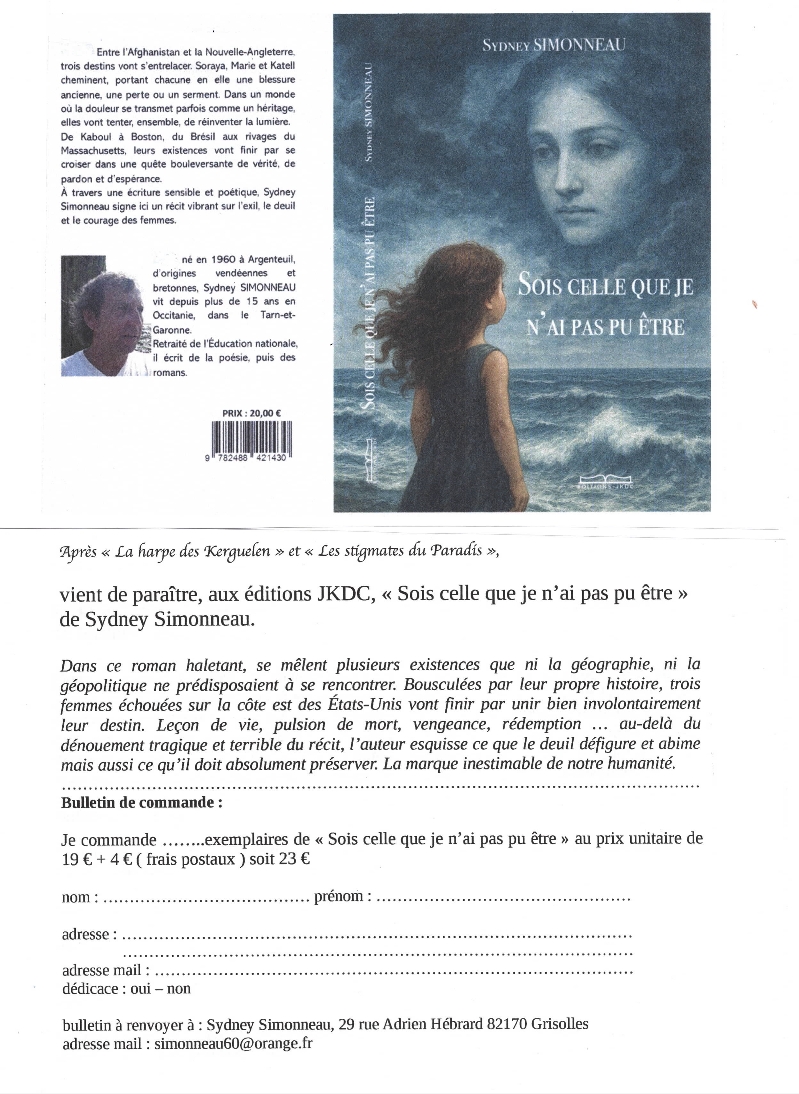
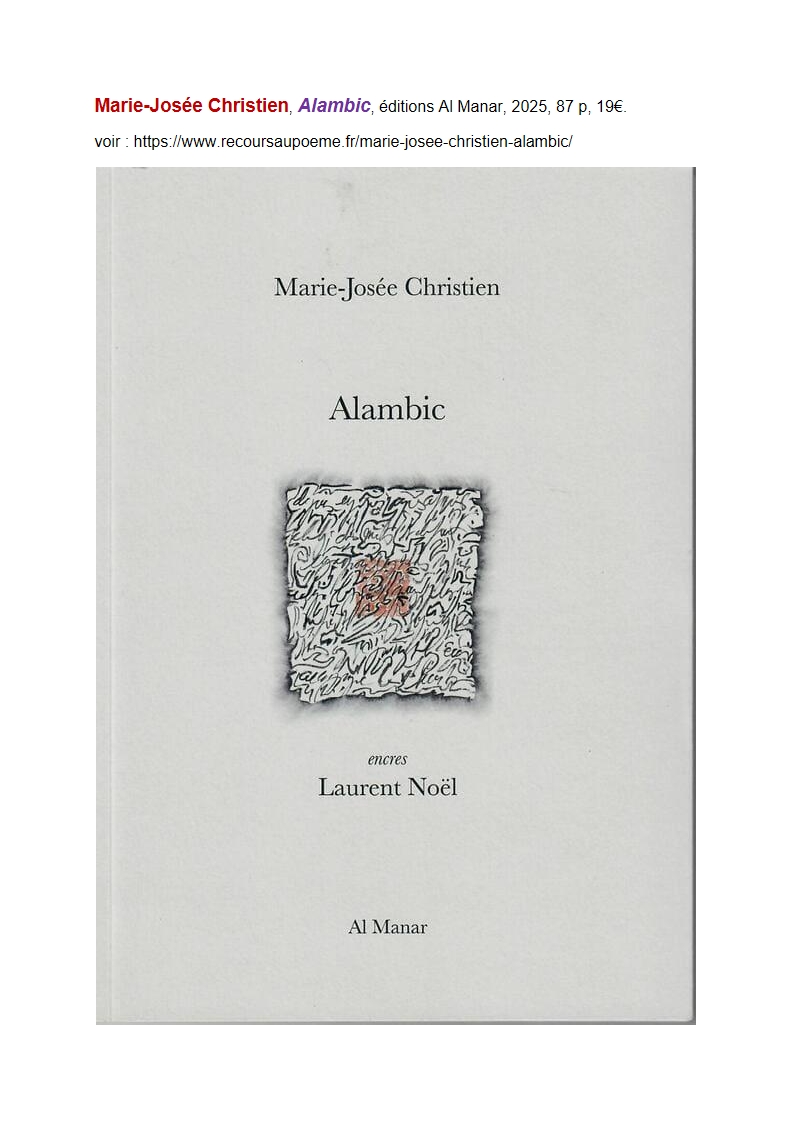

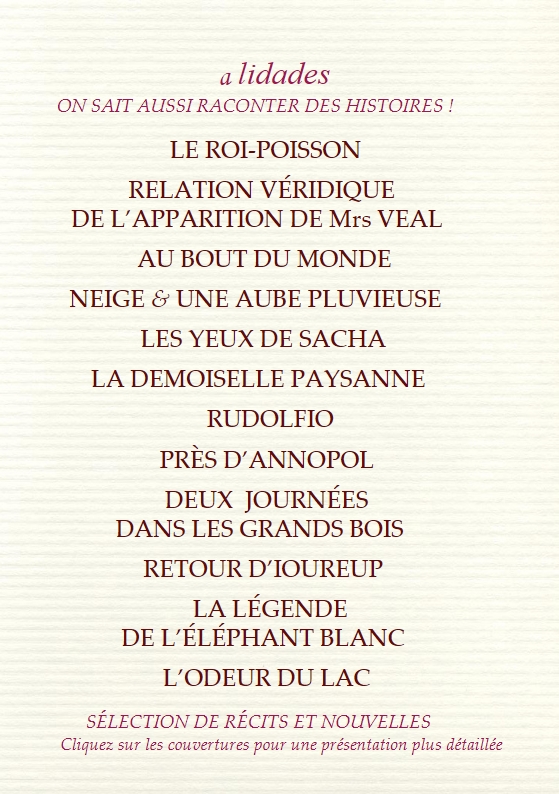
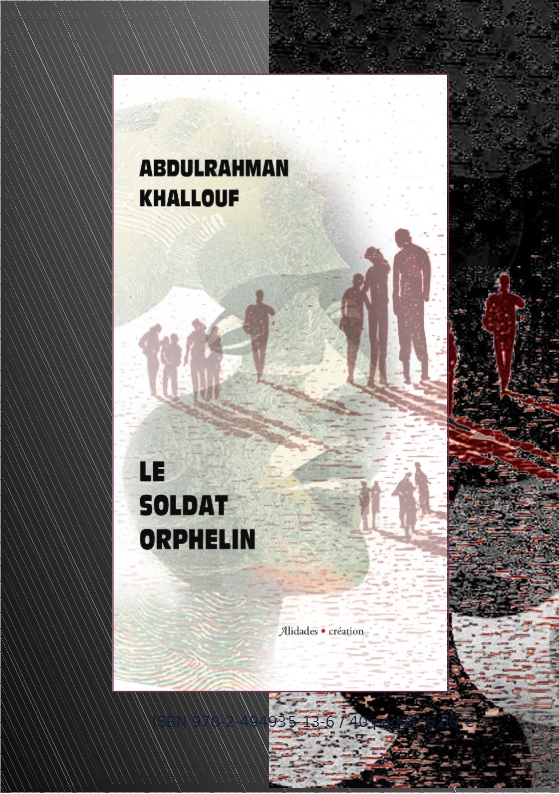
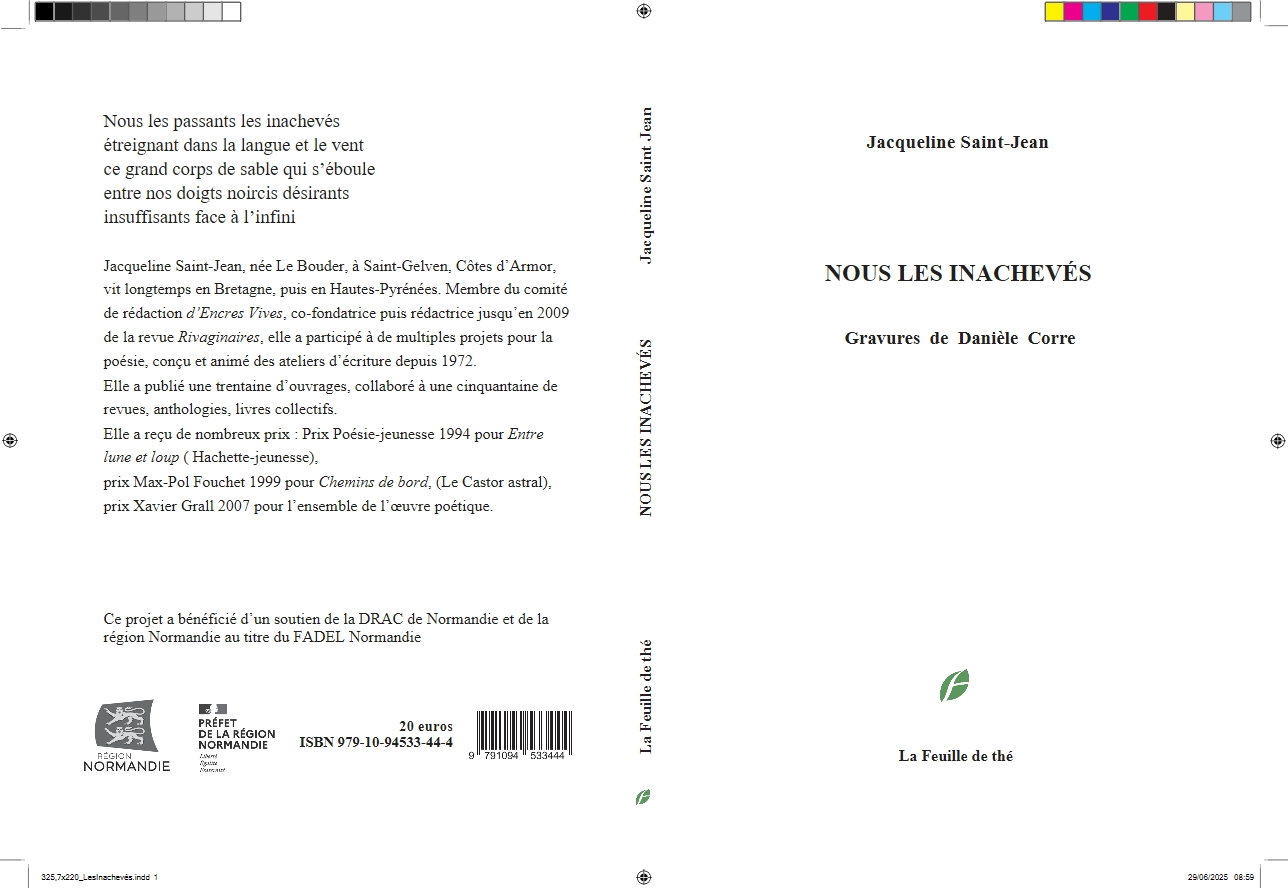
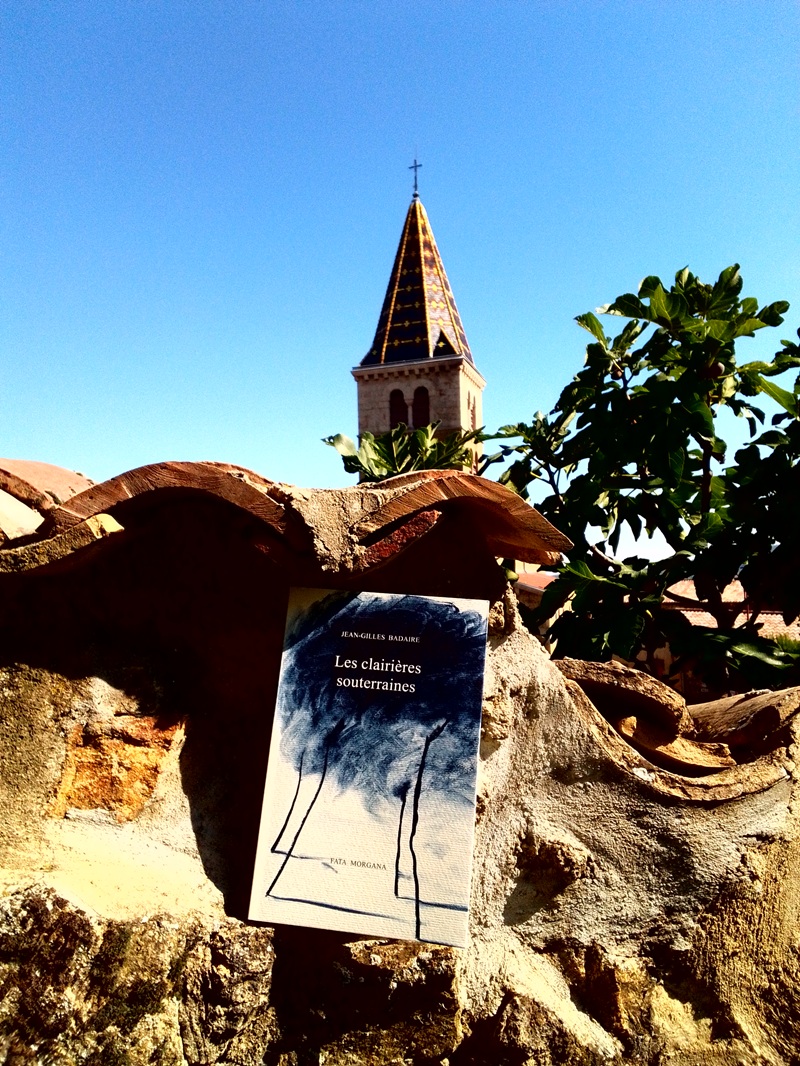

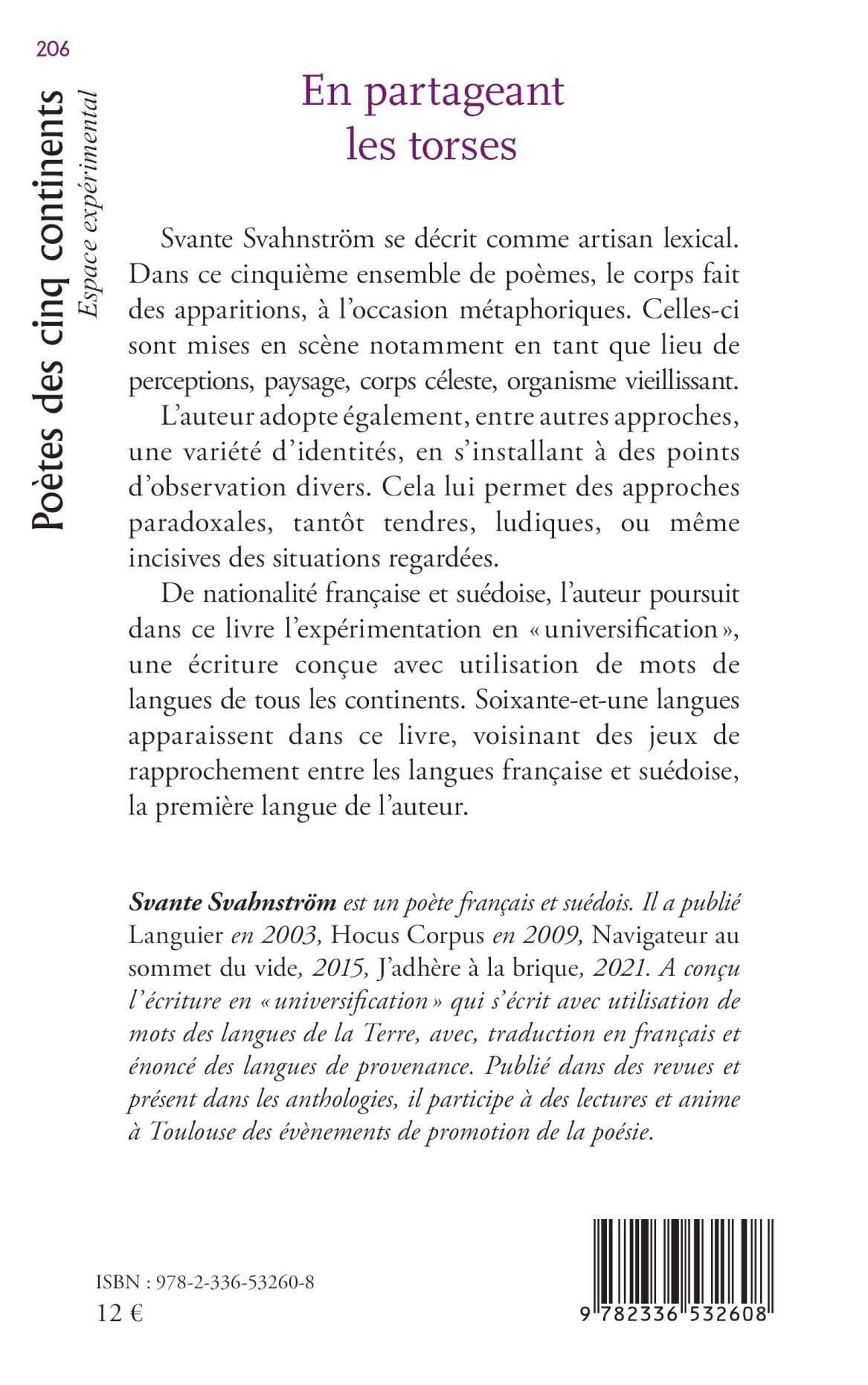
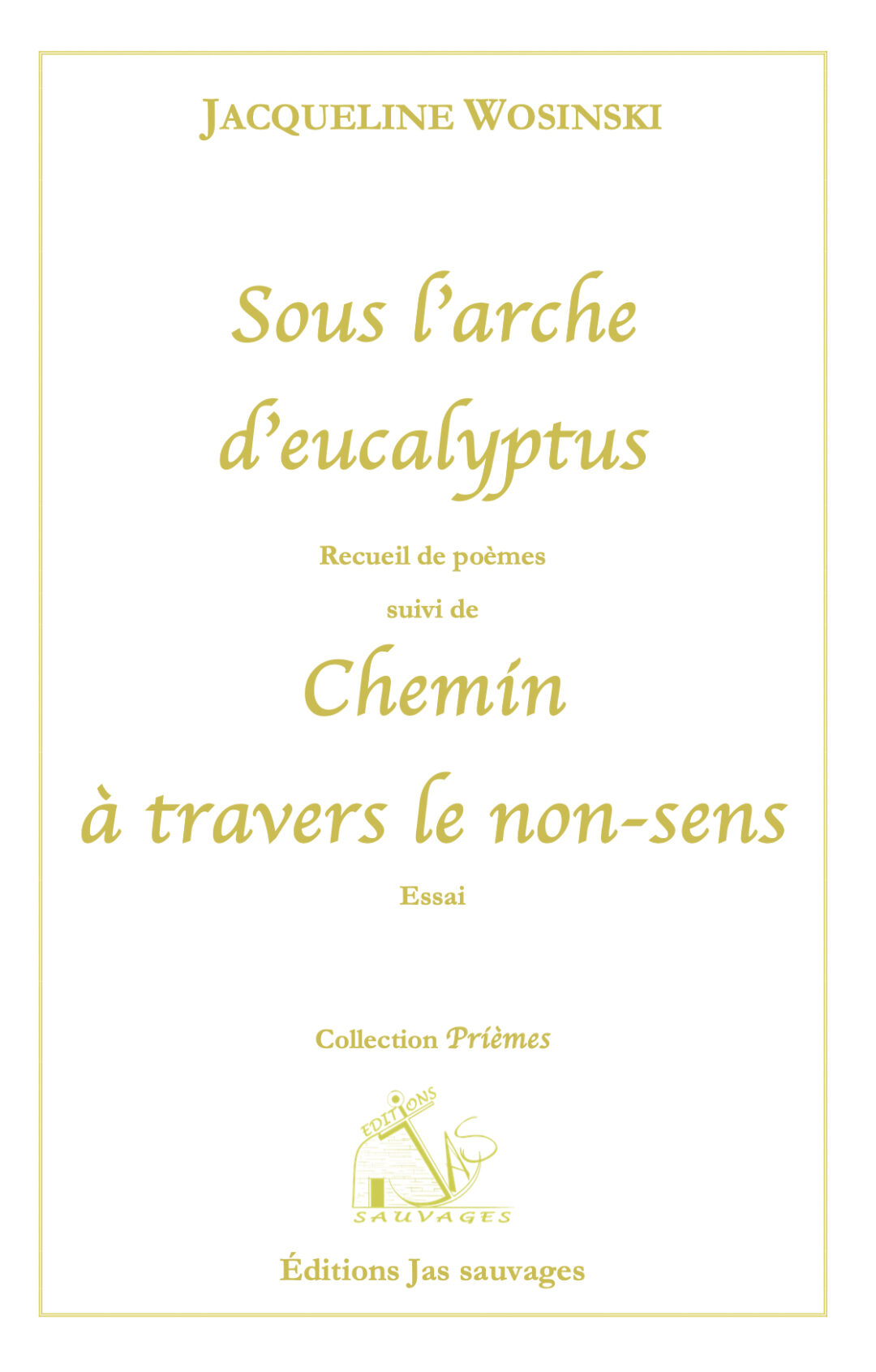
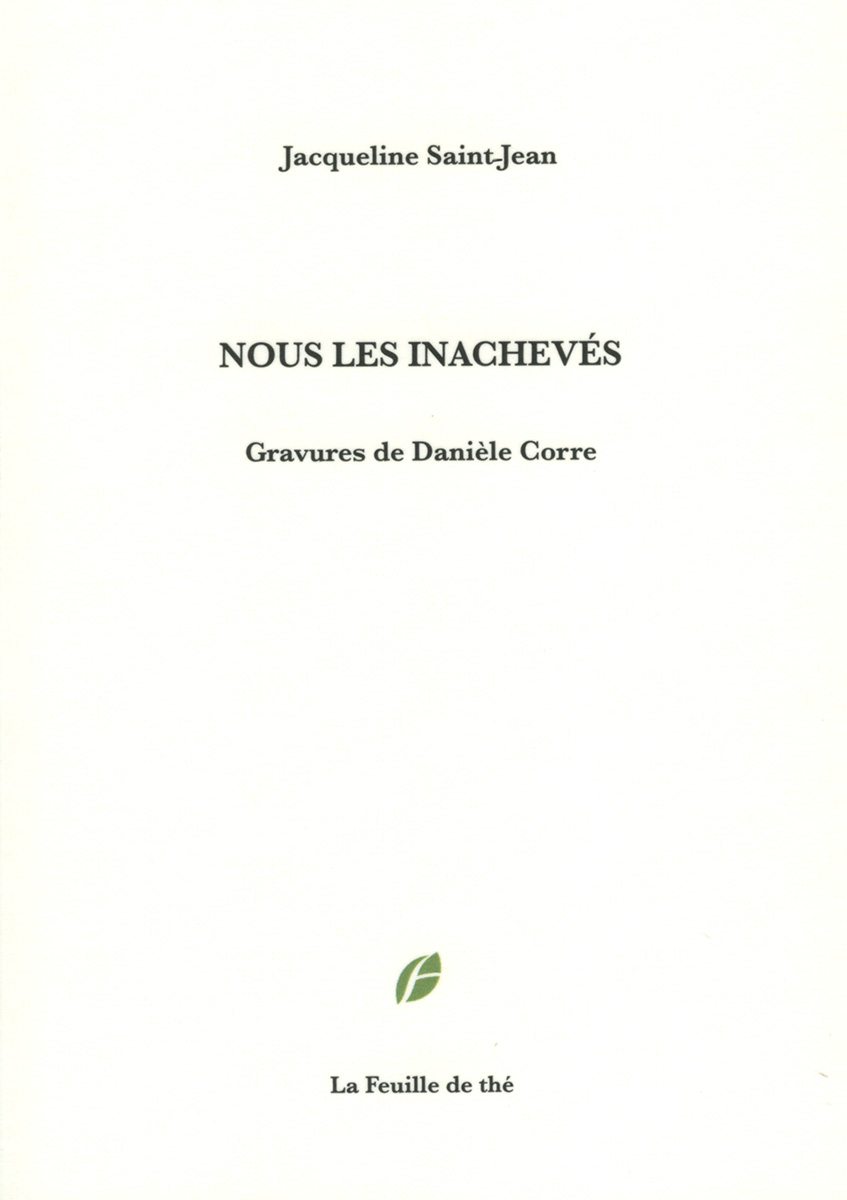

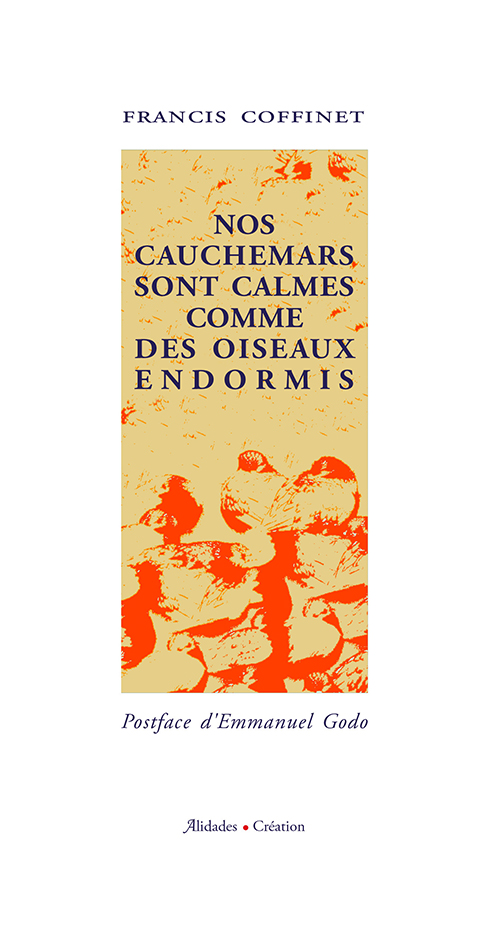
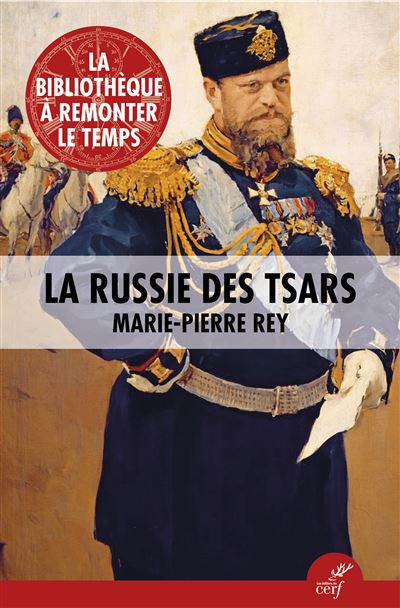
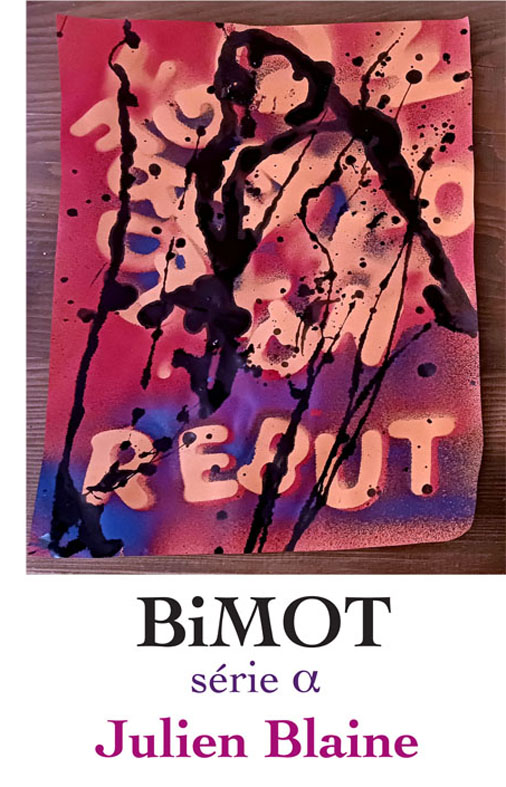
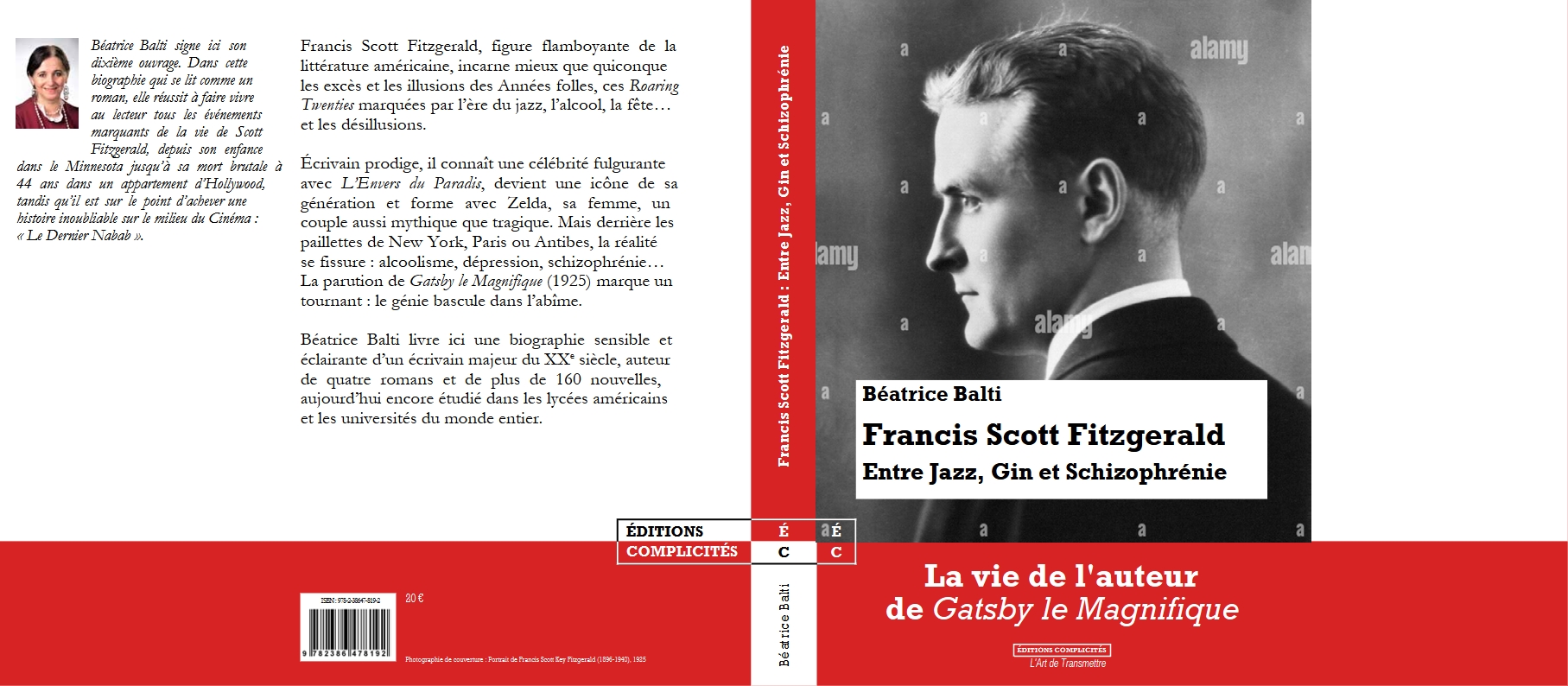
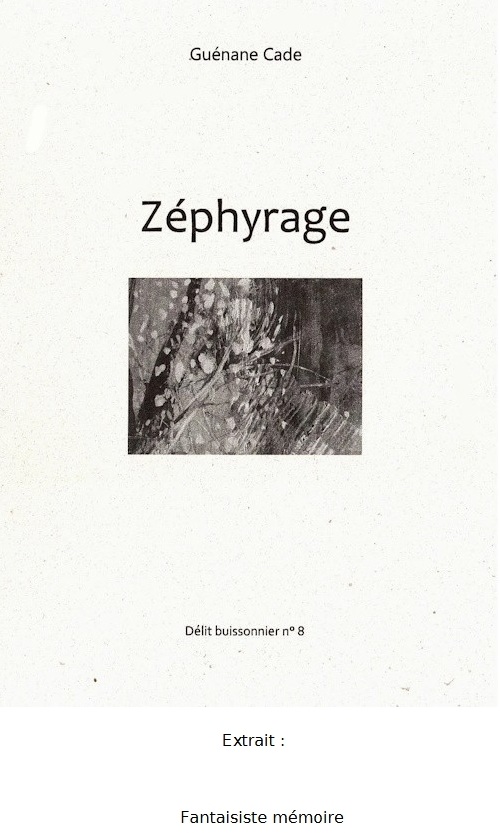
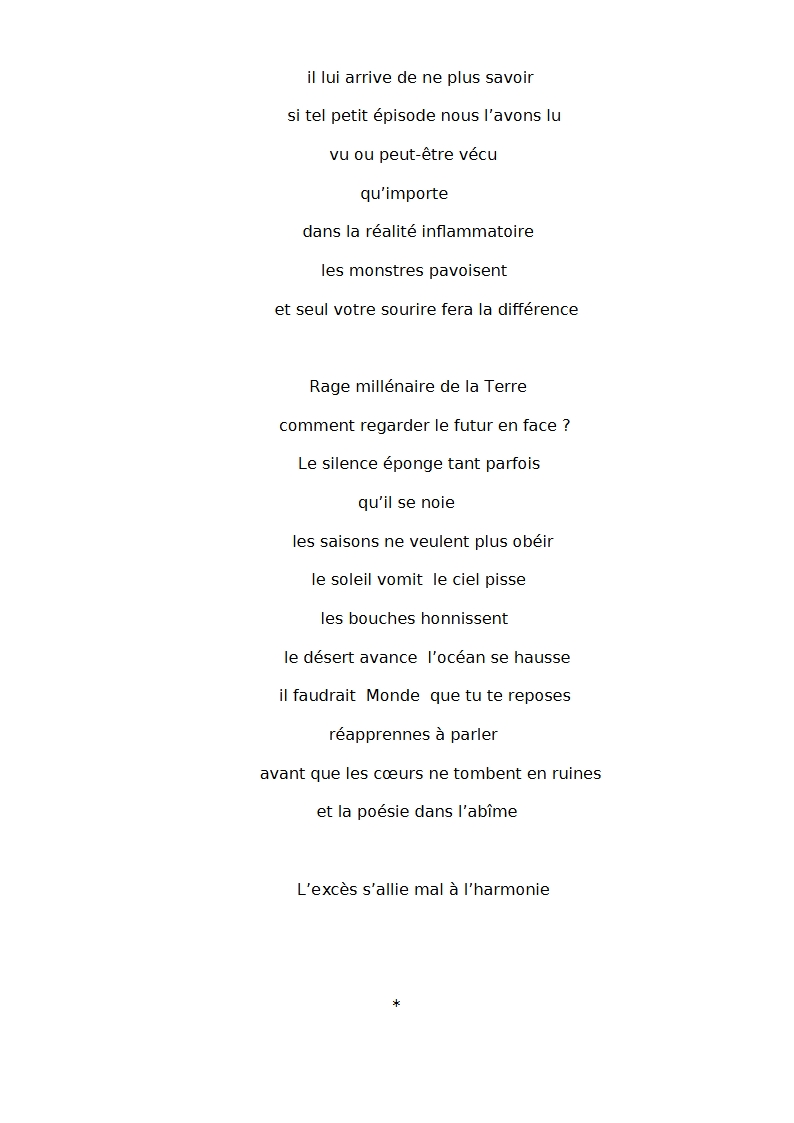
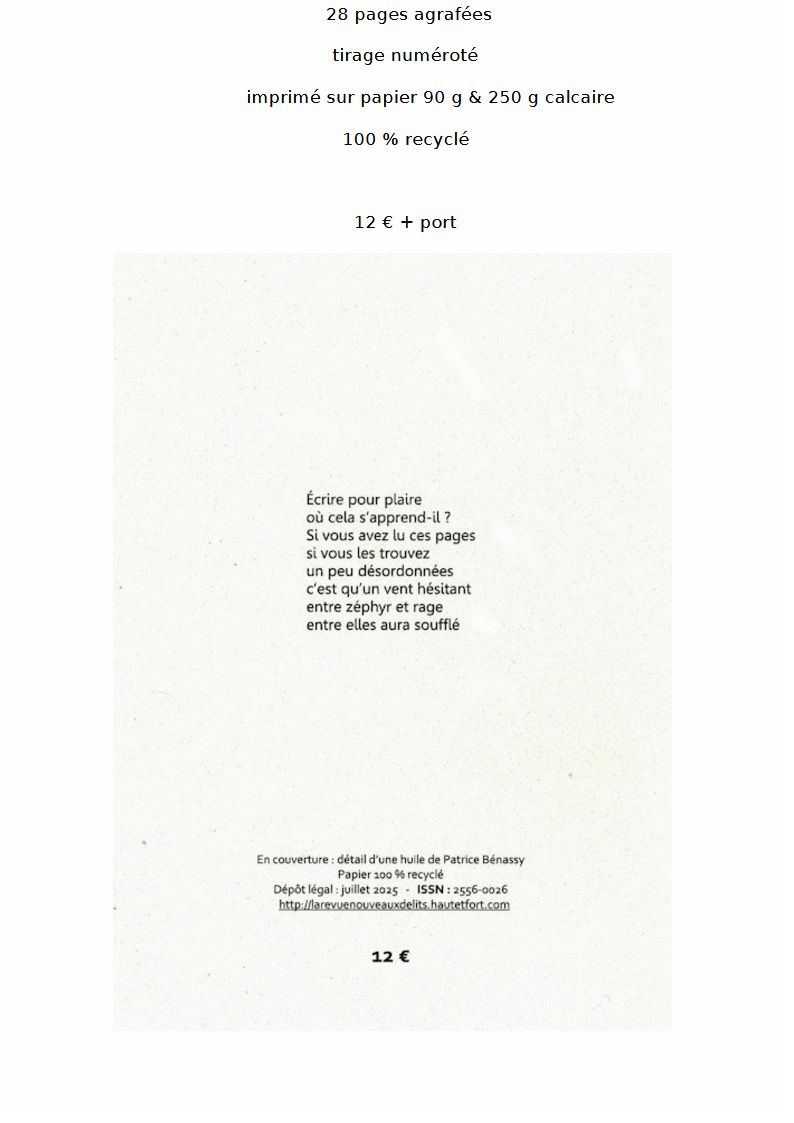
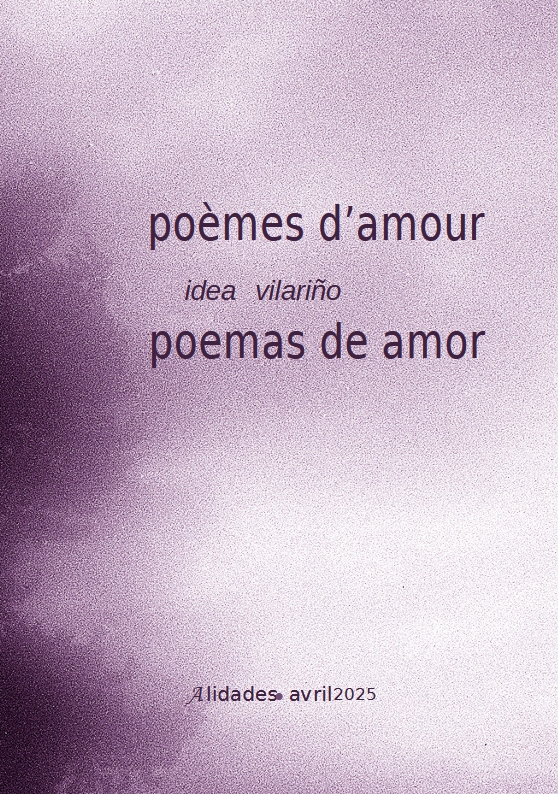




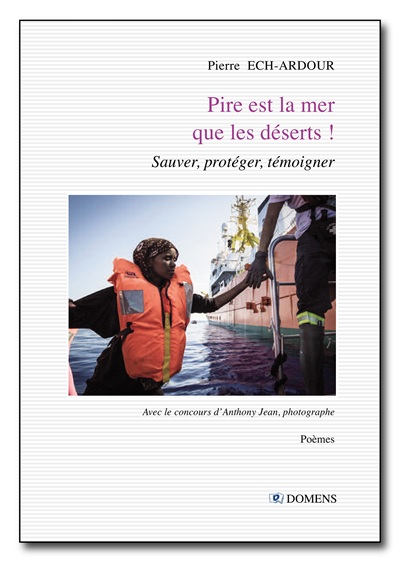











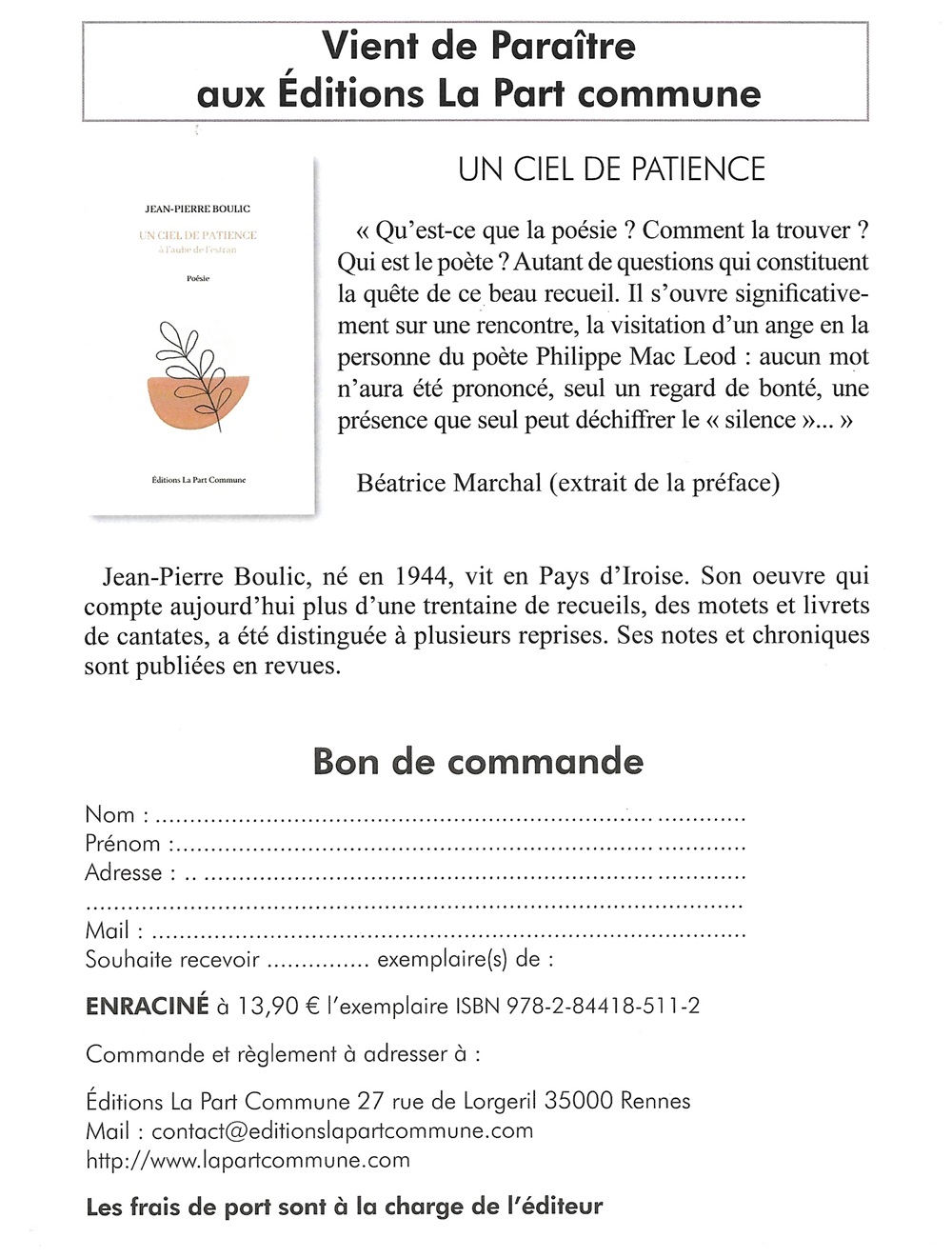












.jpg)


 Nouveauté
de fin d'été :NOS
CAUCHEMARS SONT CALMES COMME DES OISEAUX ENDORMISPoèmes
de Francis CoffinetAvec un
poème dédicace de Benoît Gréan.Postface d'Emmanuel GodoISBN 978-2-494935-08-2 –
40 pages, 6,00 €.
Nouveauté
de fin d'été :NOS
CAUCHEMARS SONT CALMES COMME DES OISEAUX ENDORMISPoèmes
de Francis CoffinetAvec un
poème dédicace de Benoît Gréan.Postface d'Emmanuel GodoISBN 978-2-494935-08-2 –
40 pages, 6,00 €.






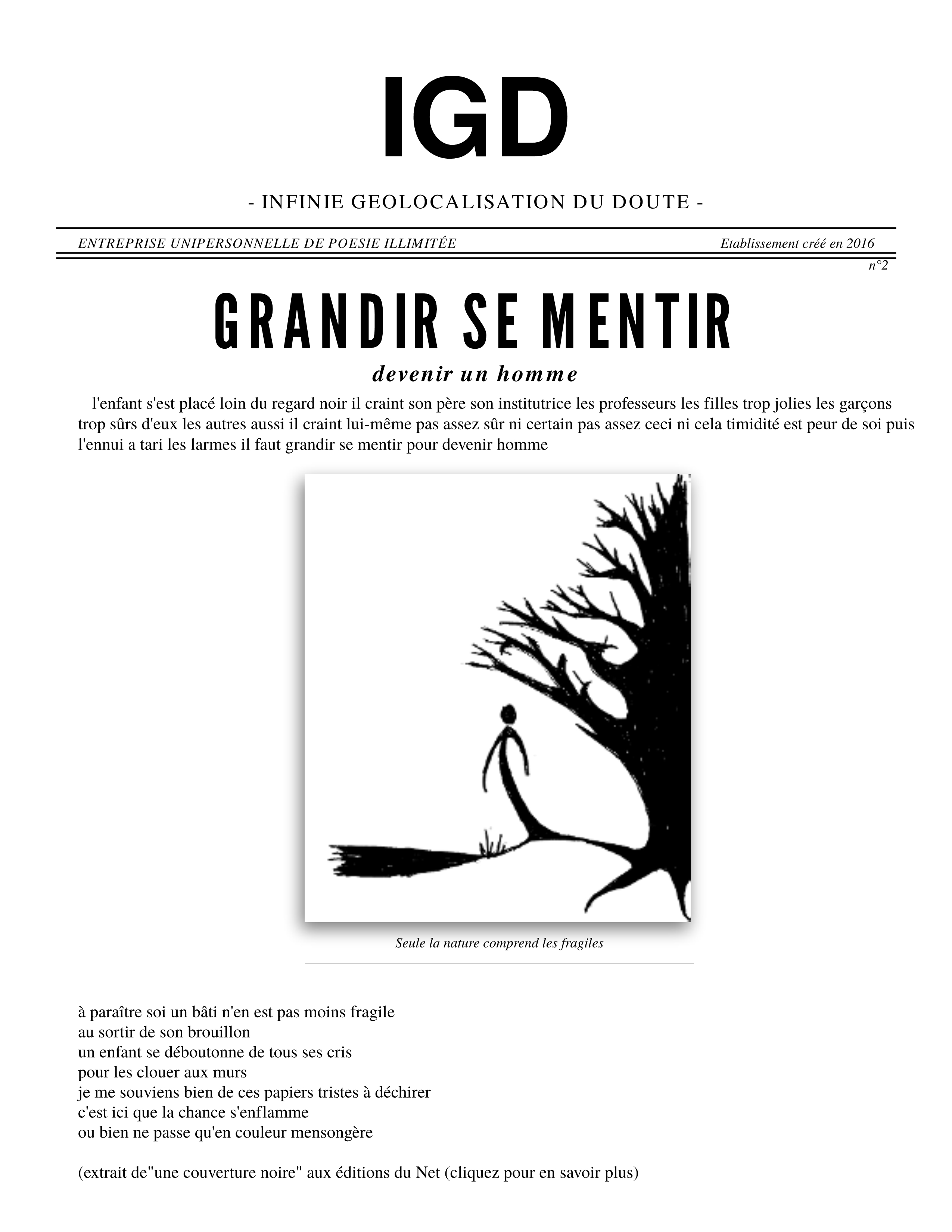
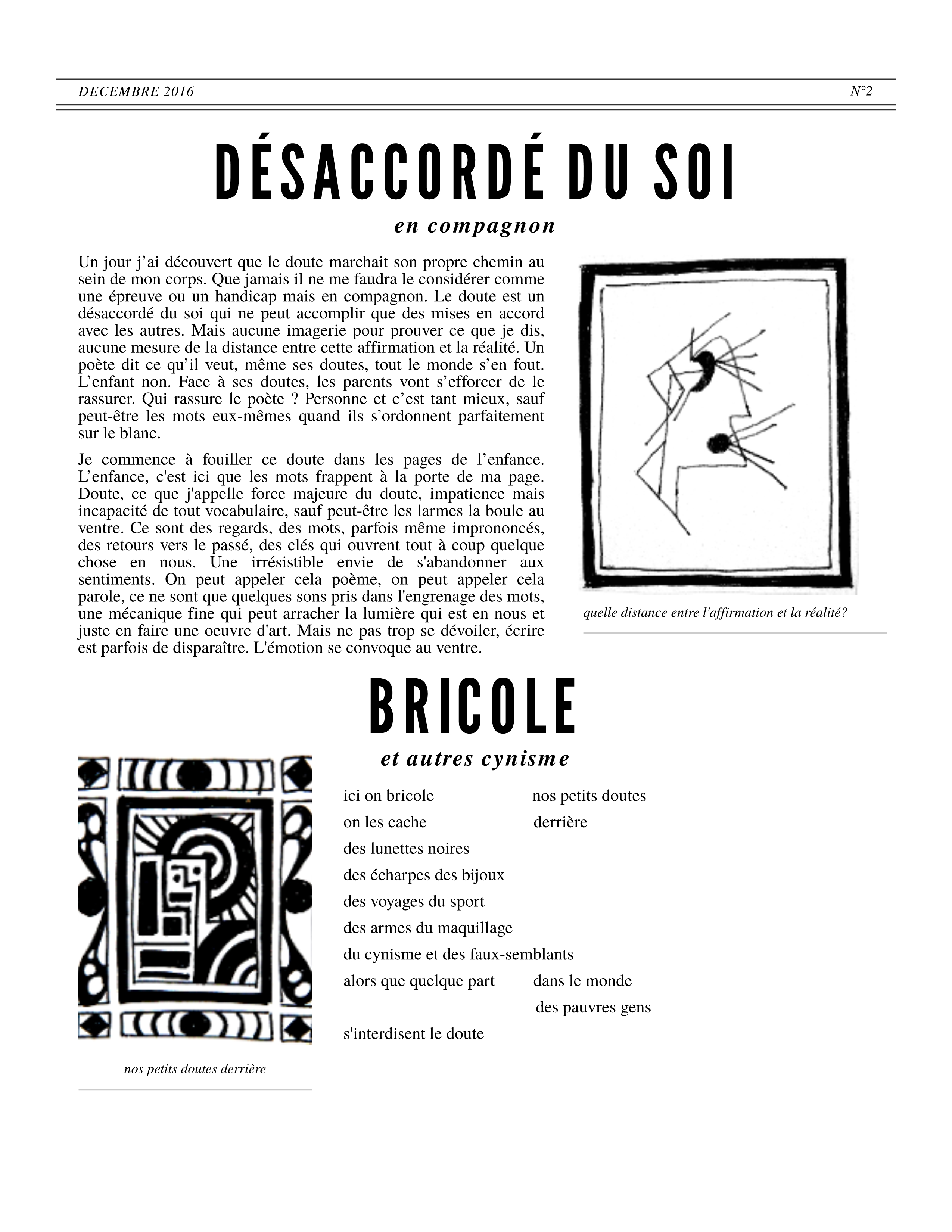









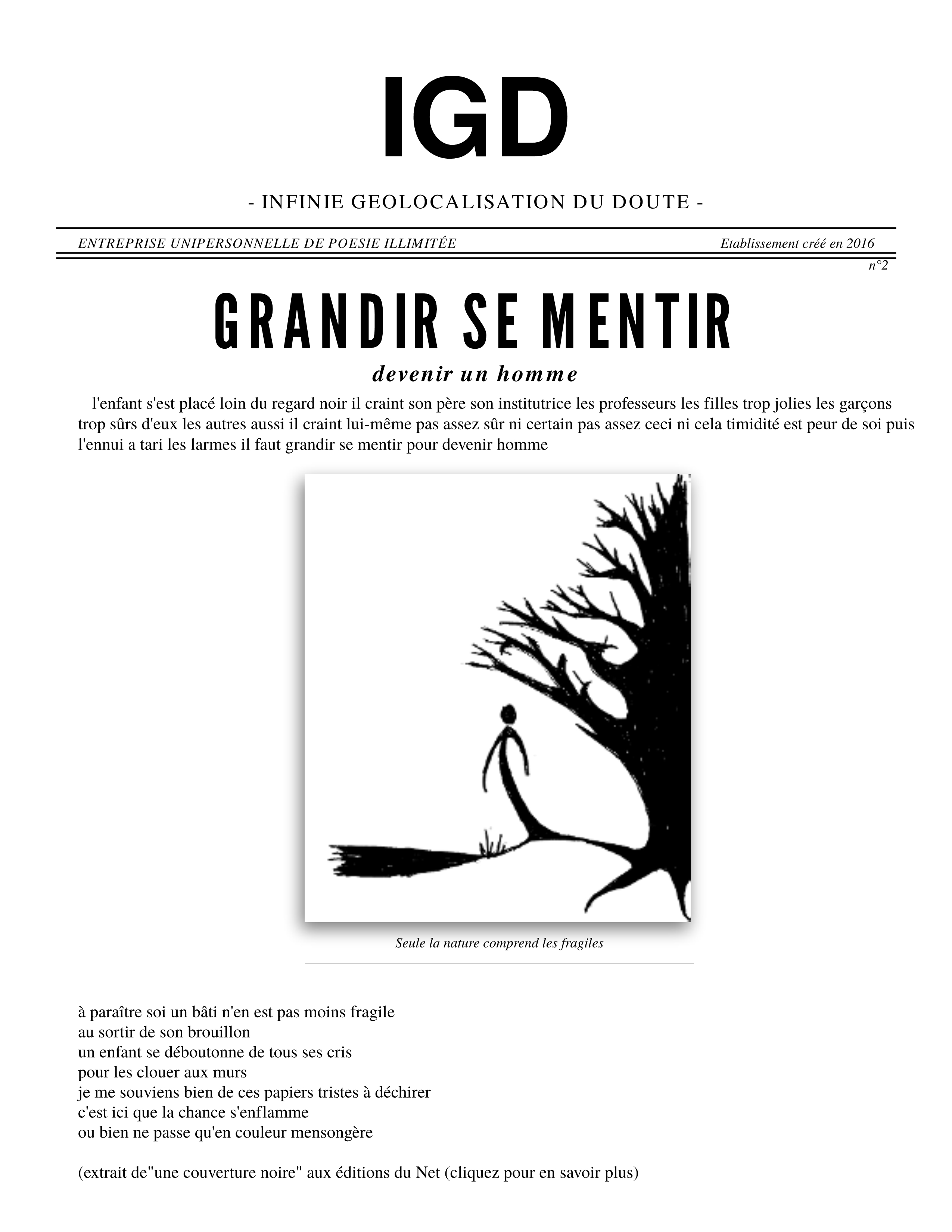
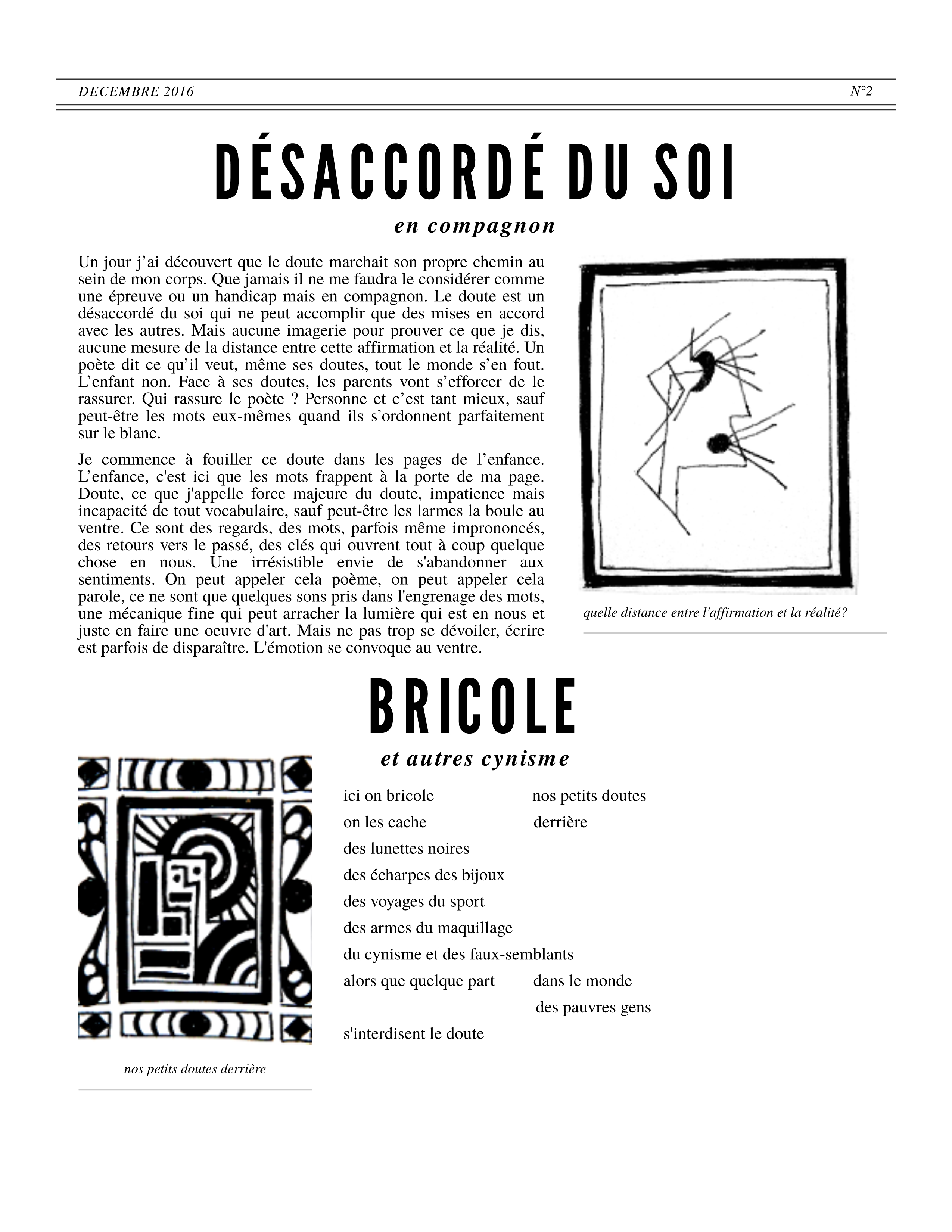















 Soscripcion
pel libre-CD
Soscripcion
pel libre-CD



